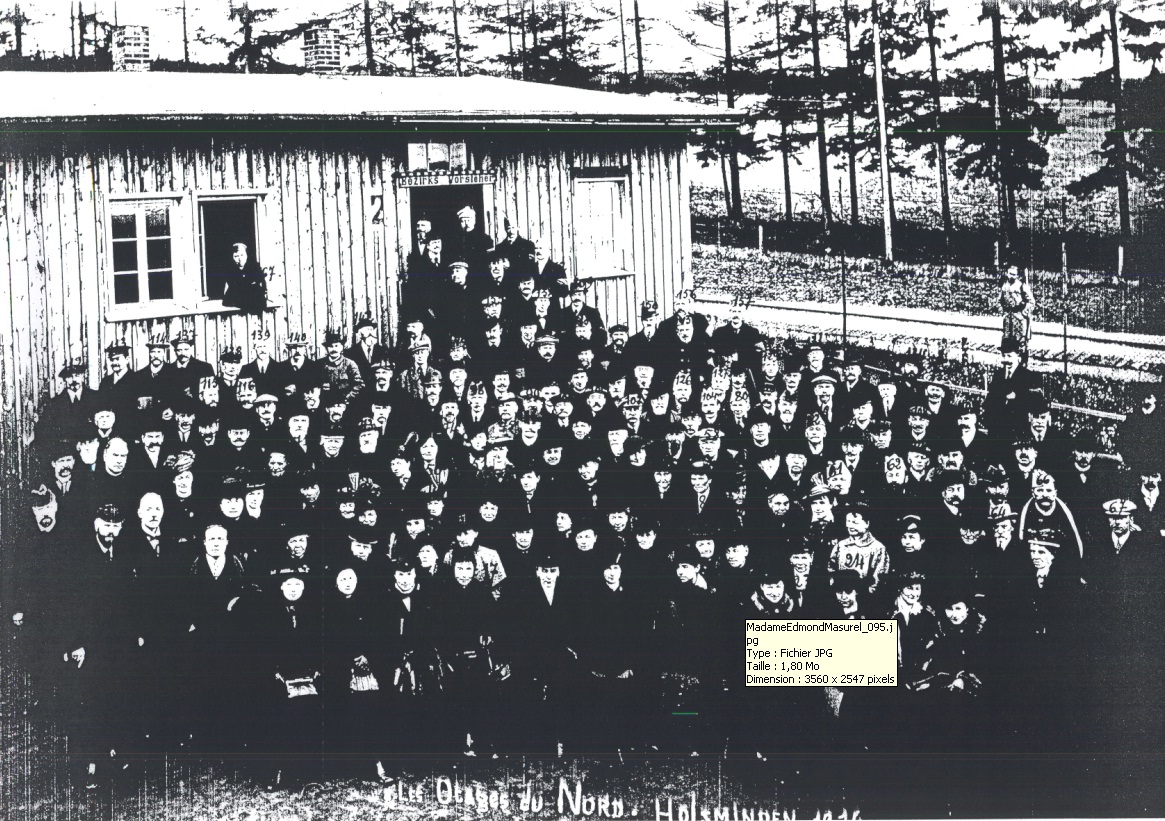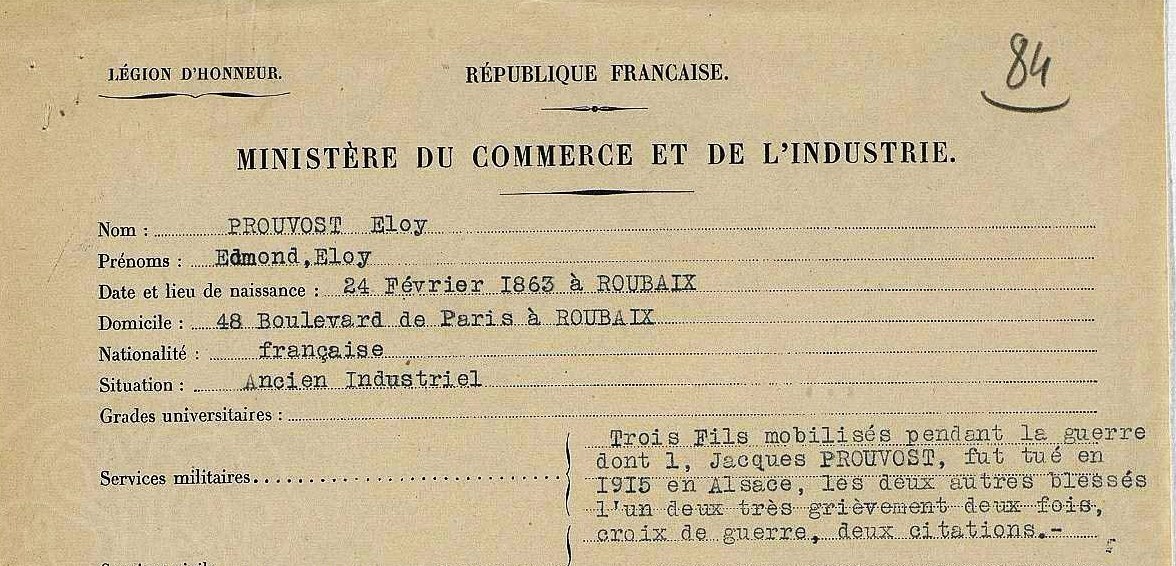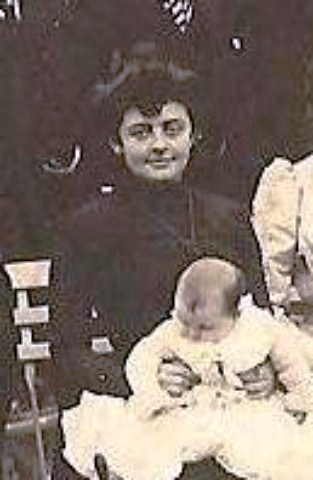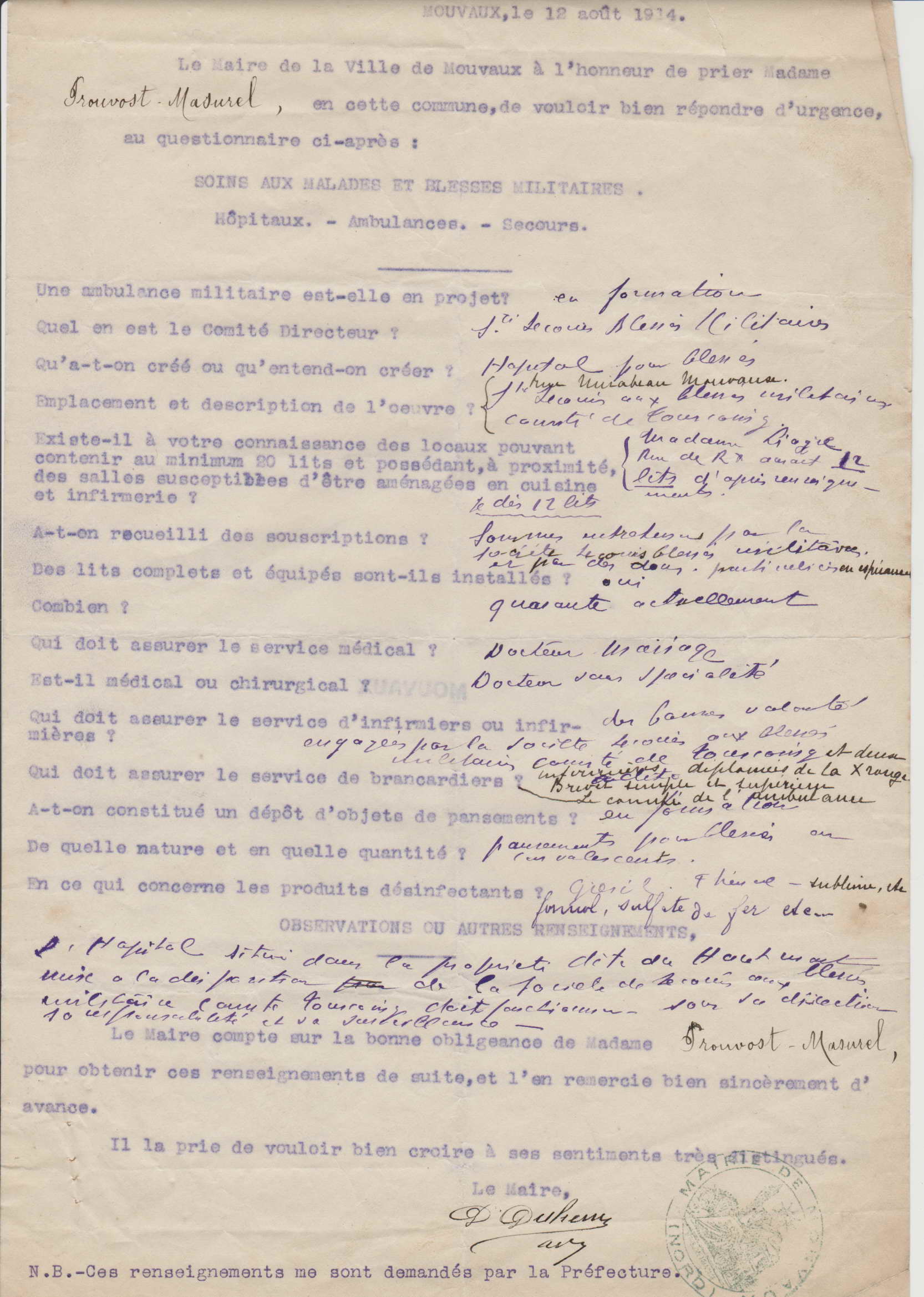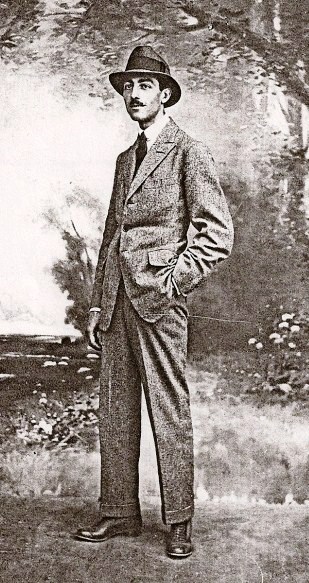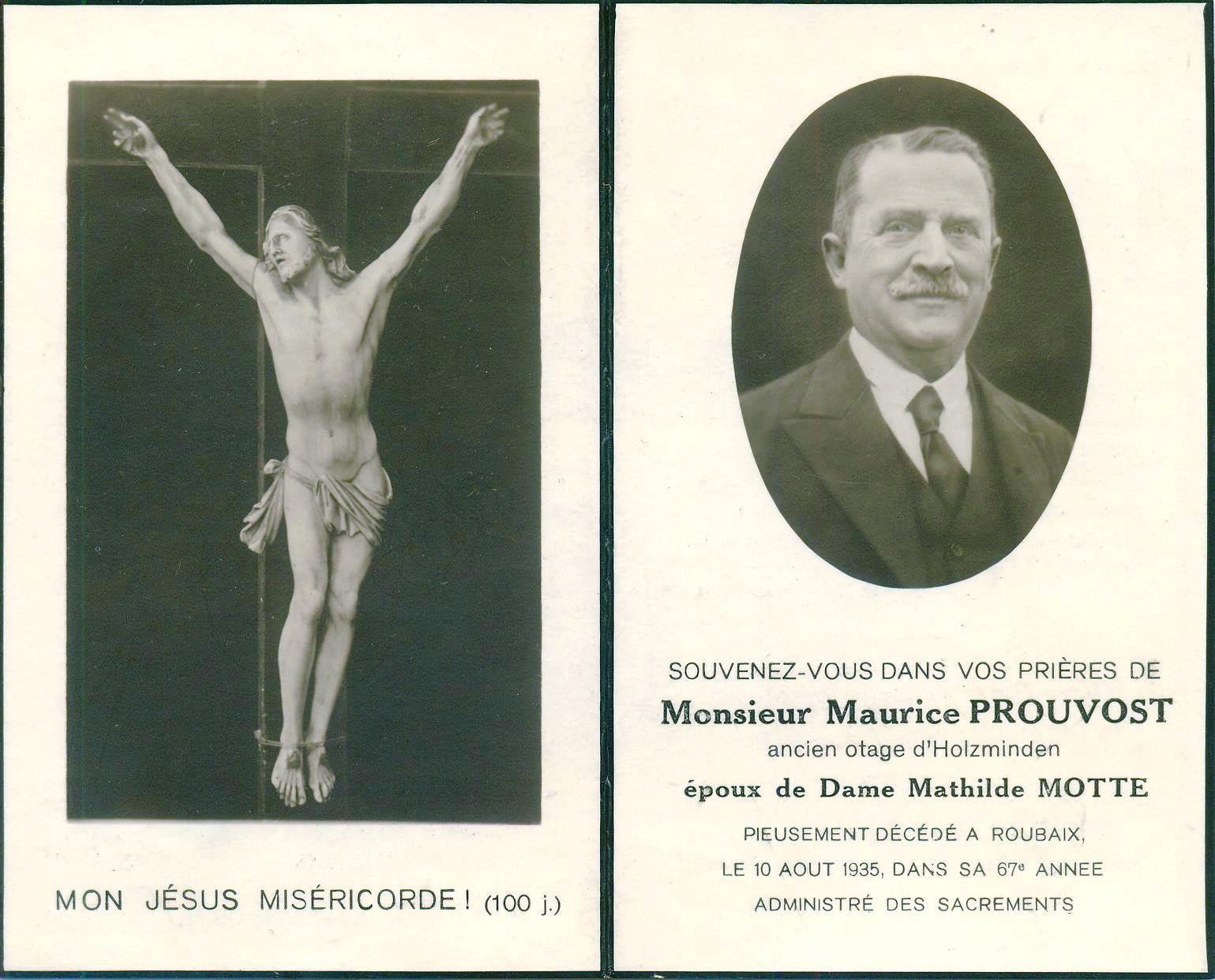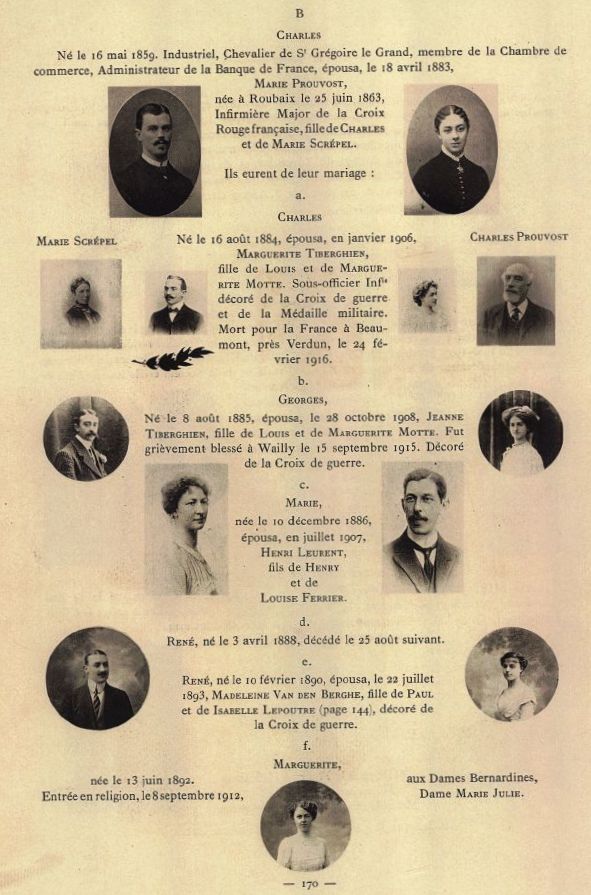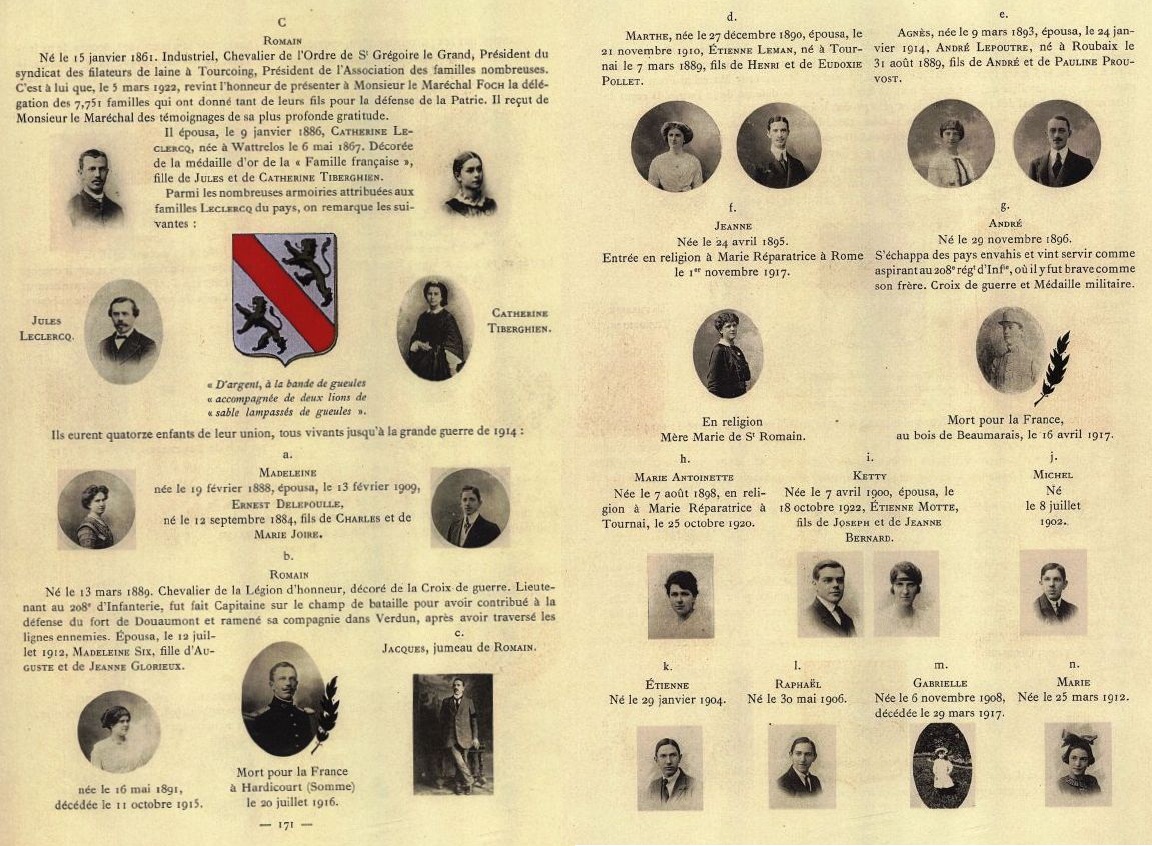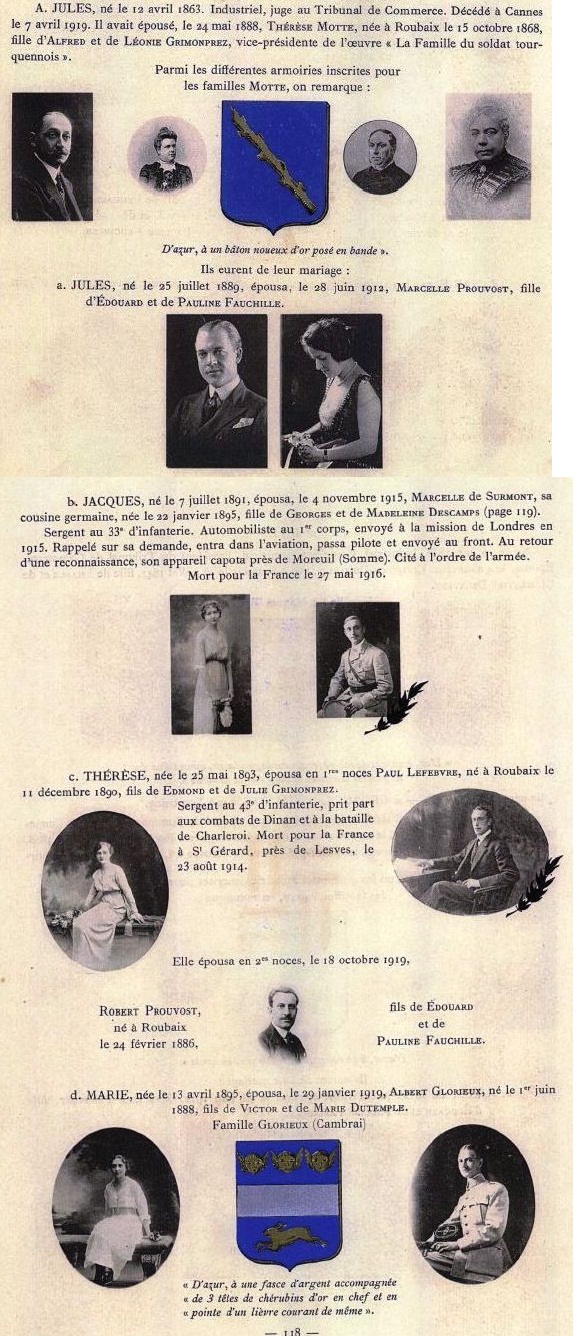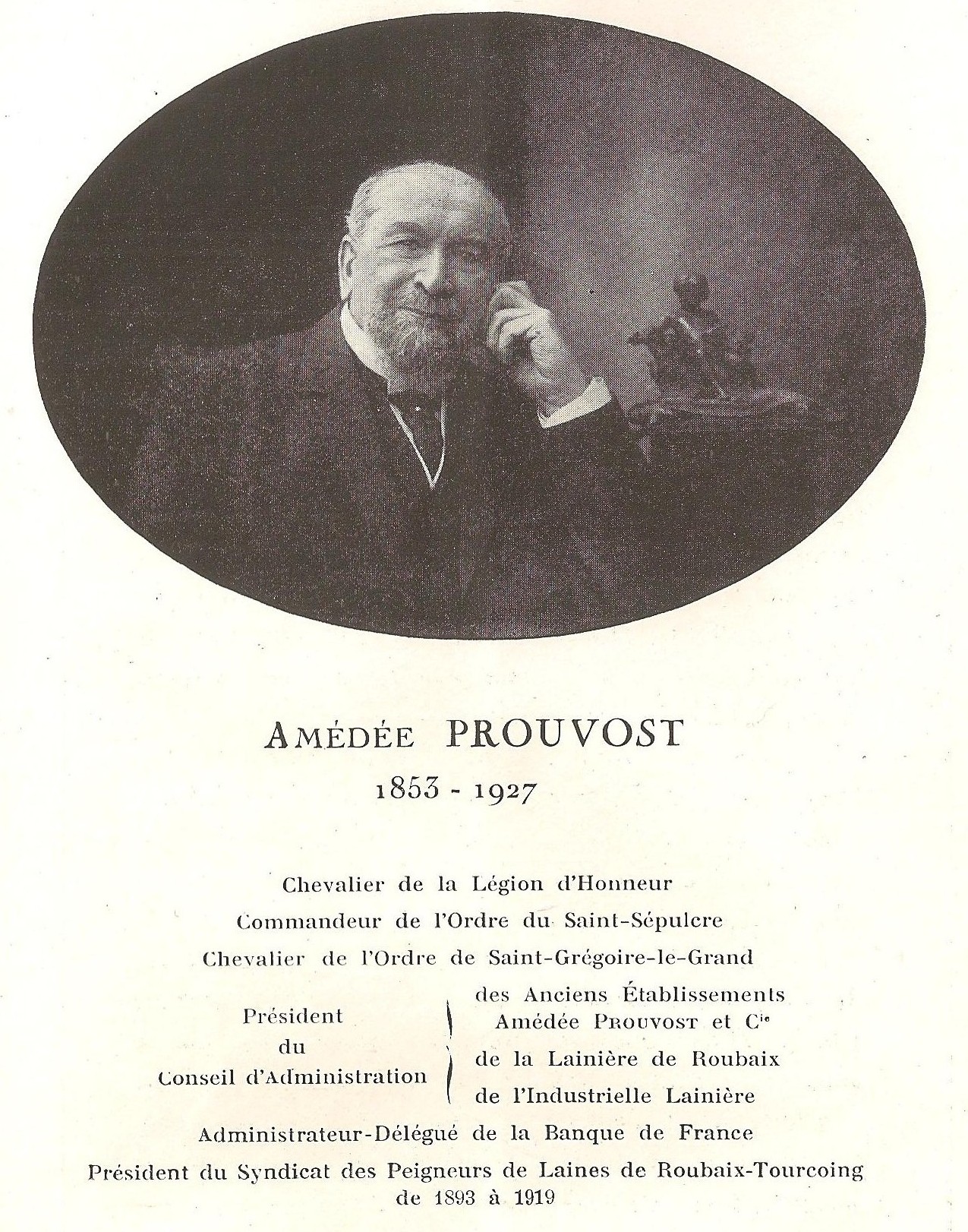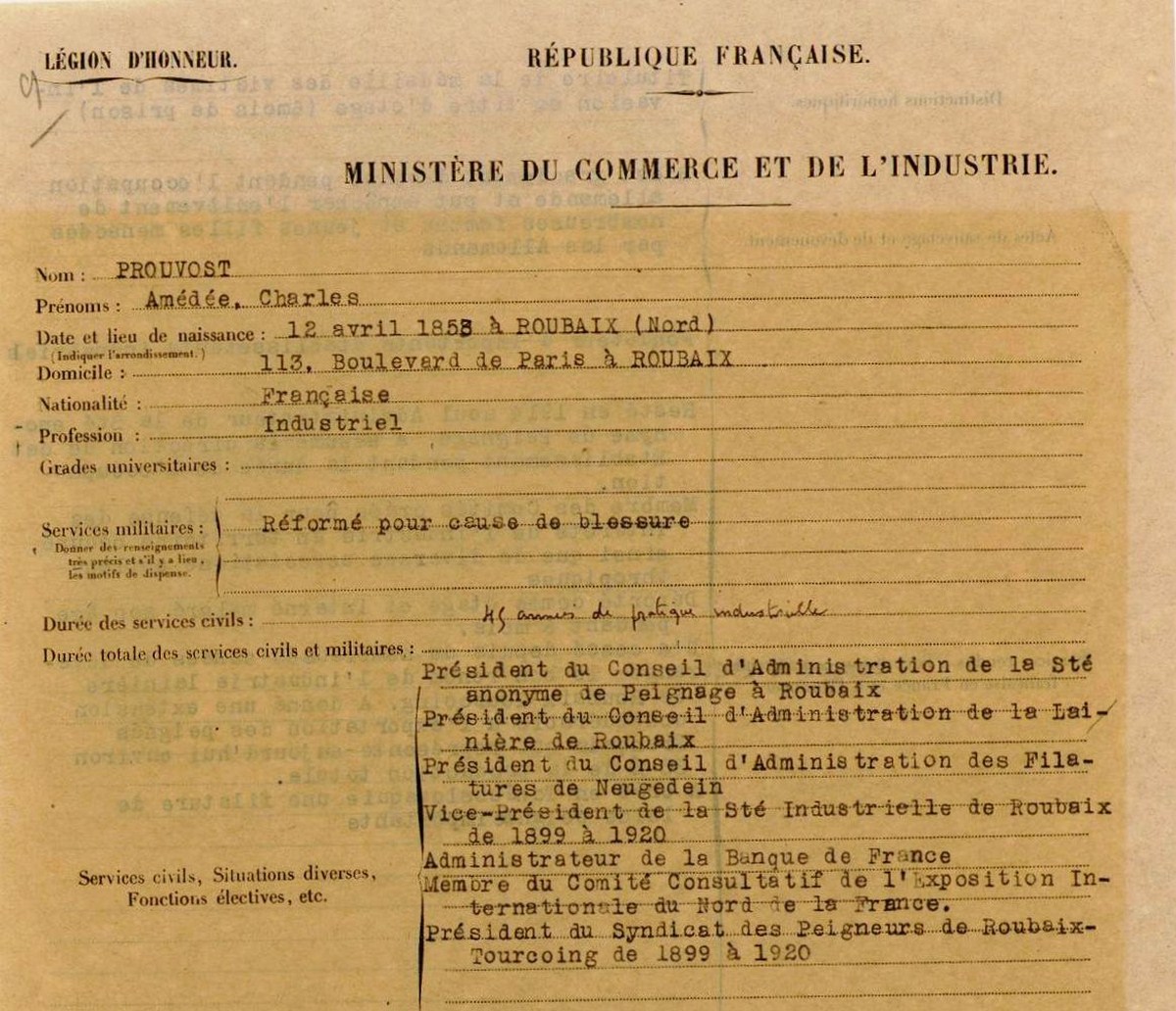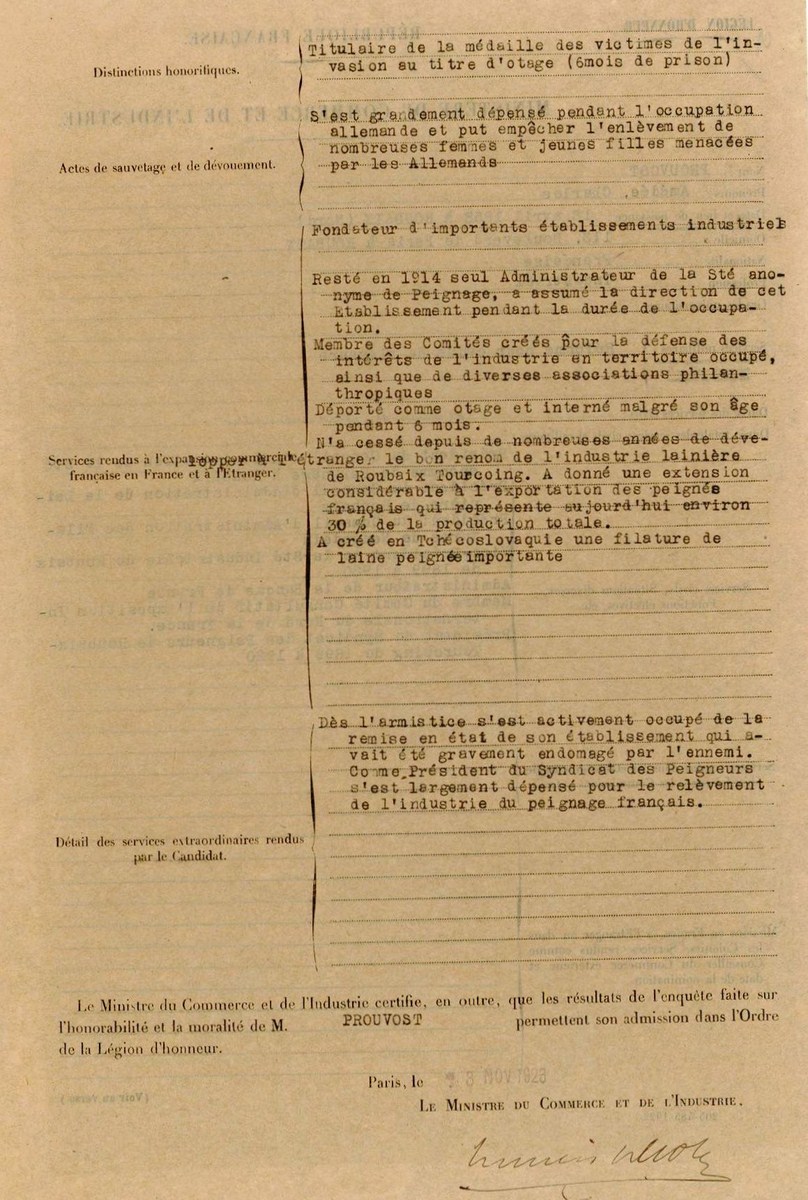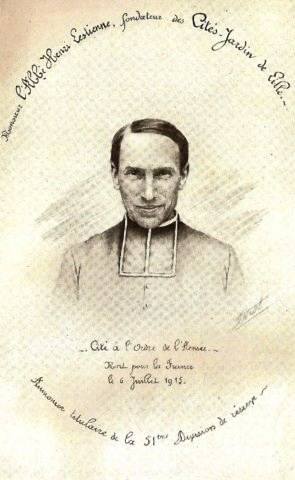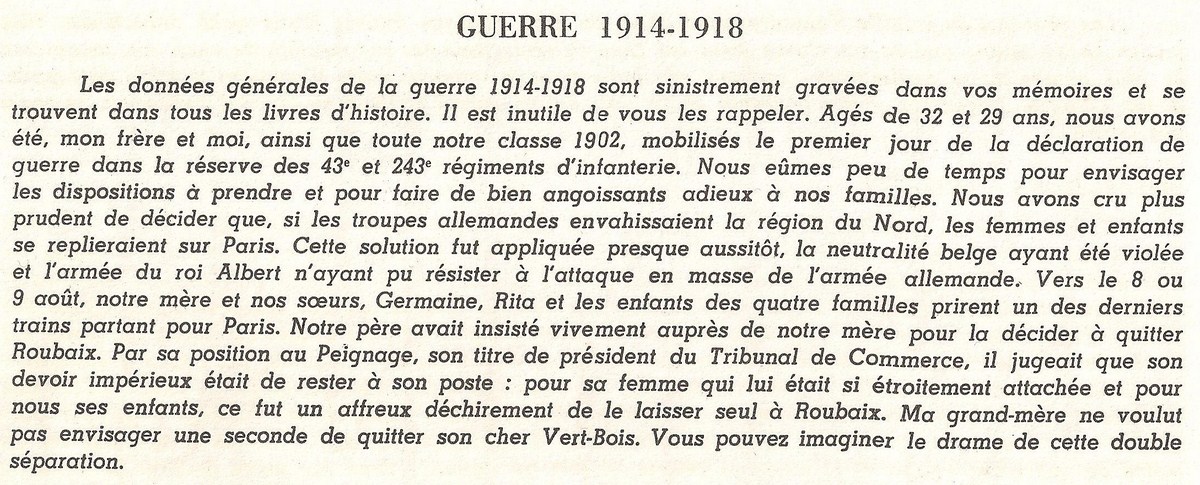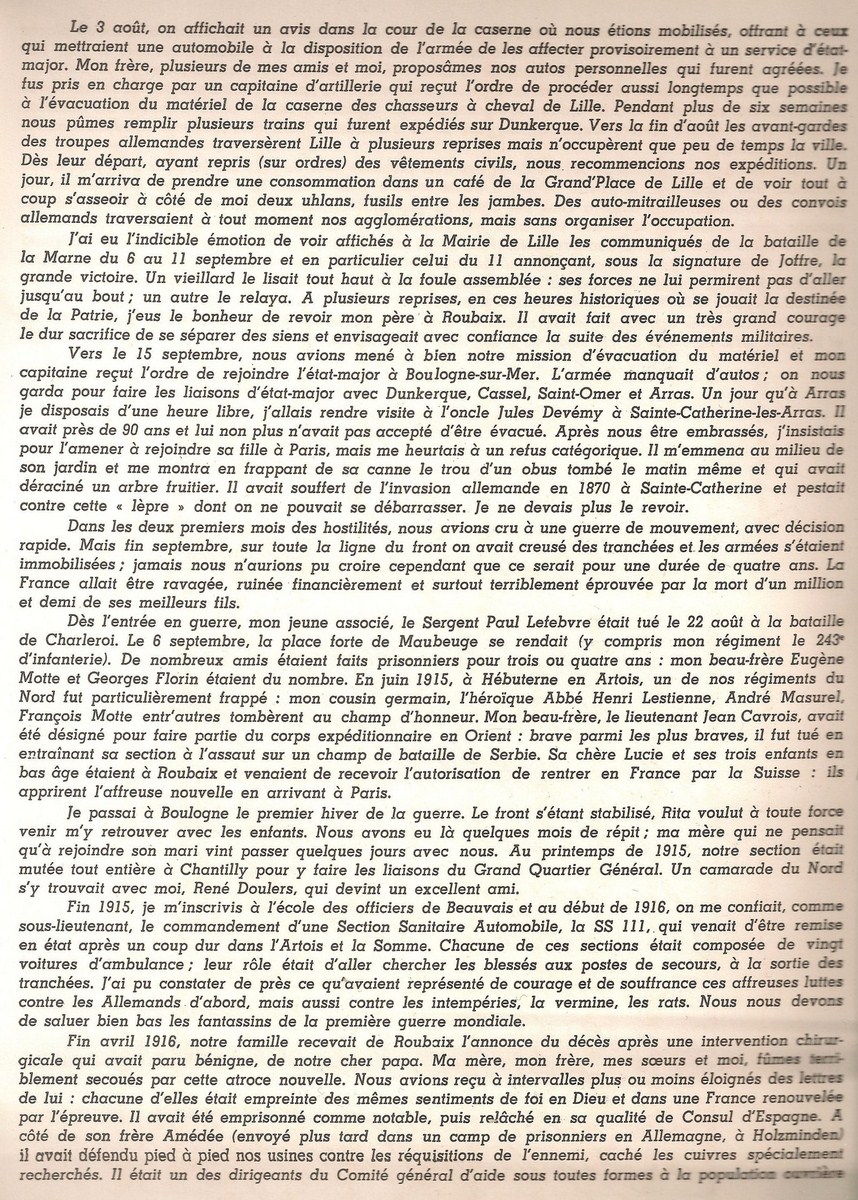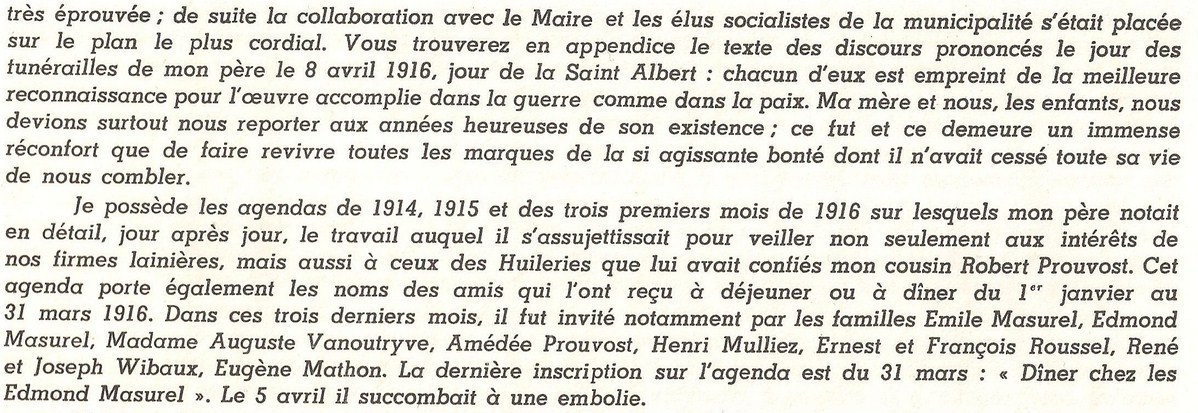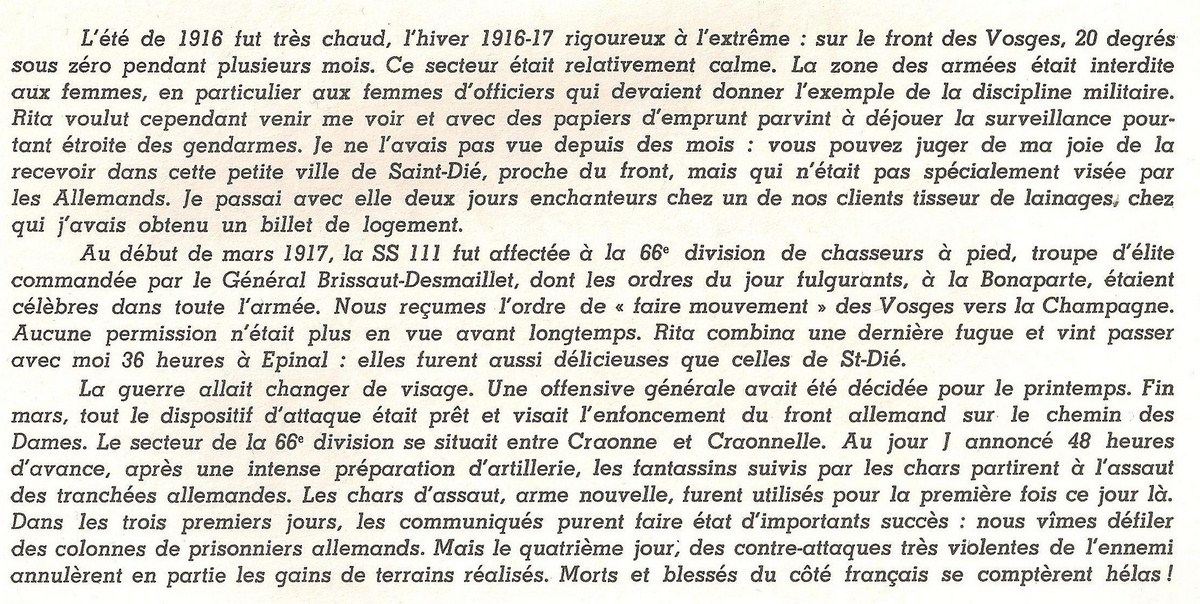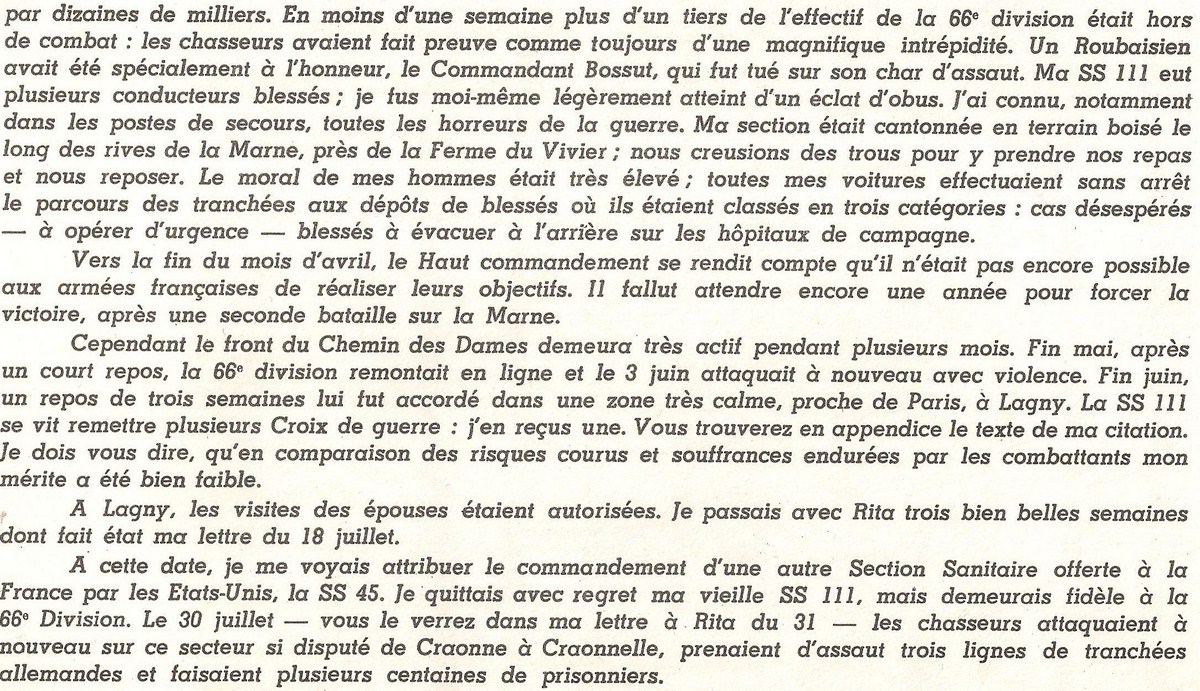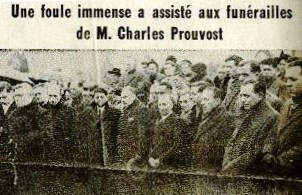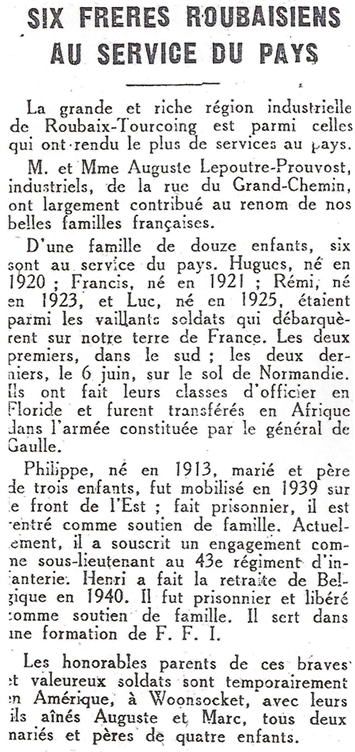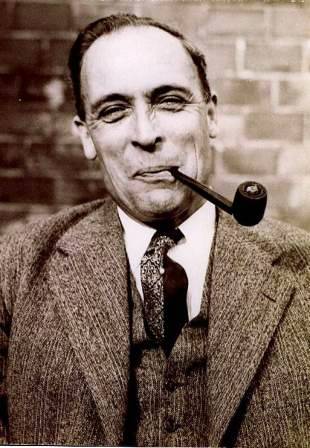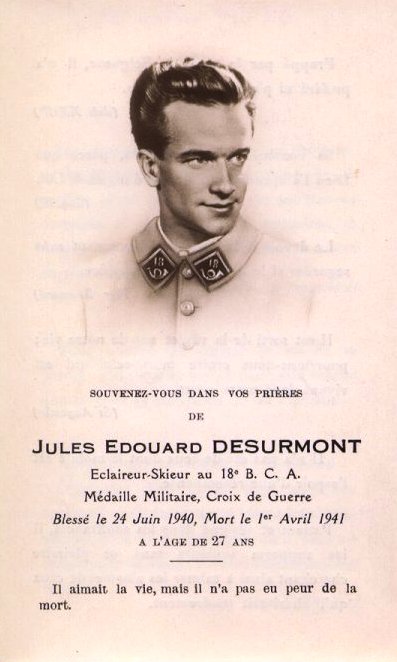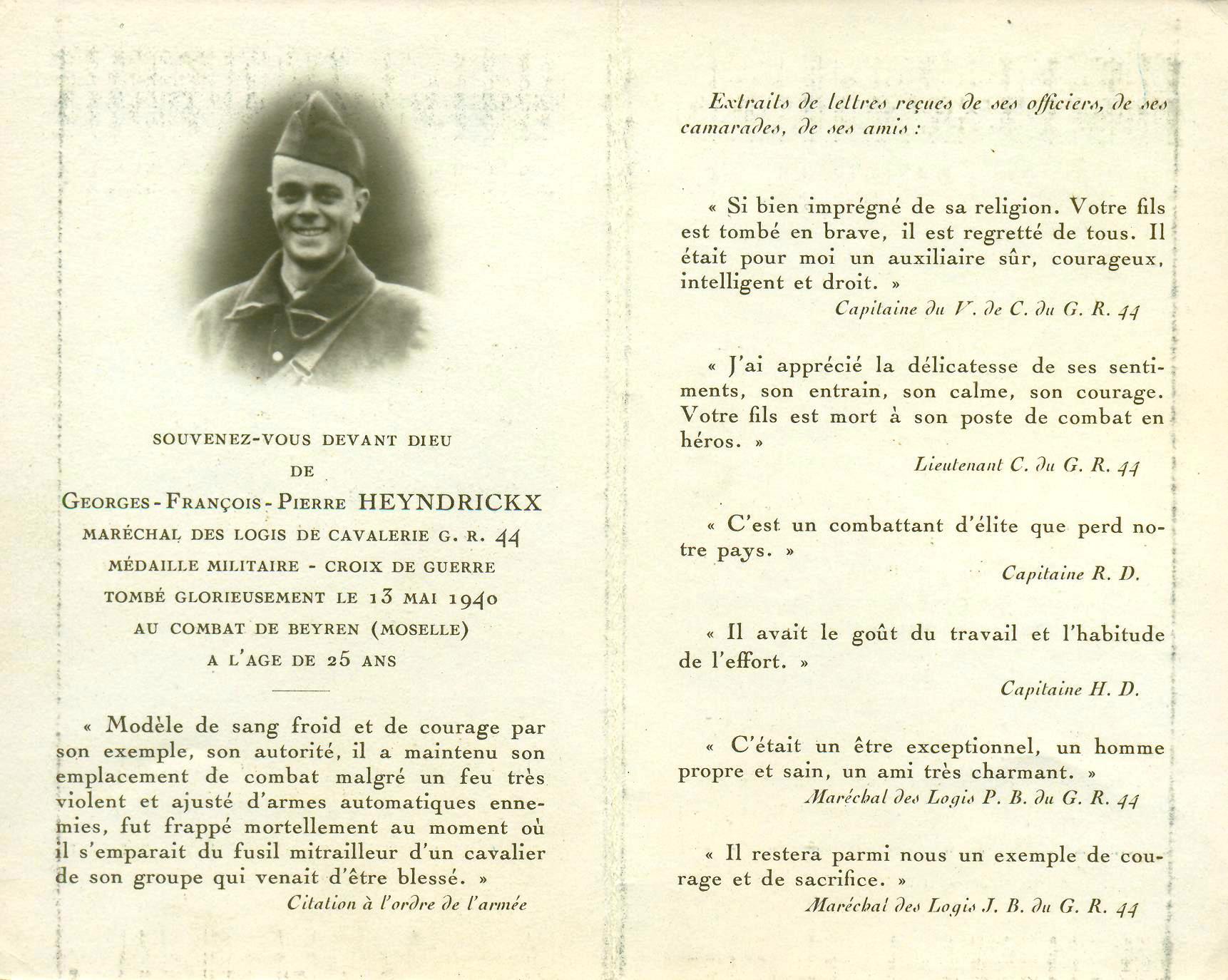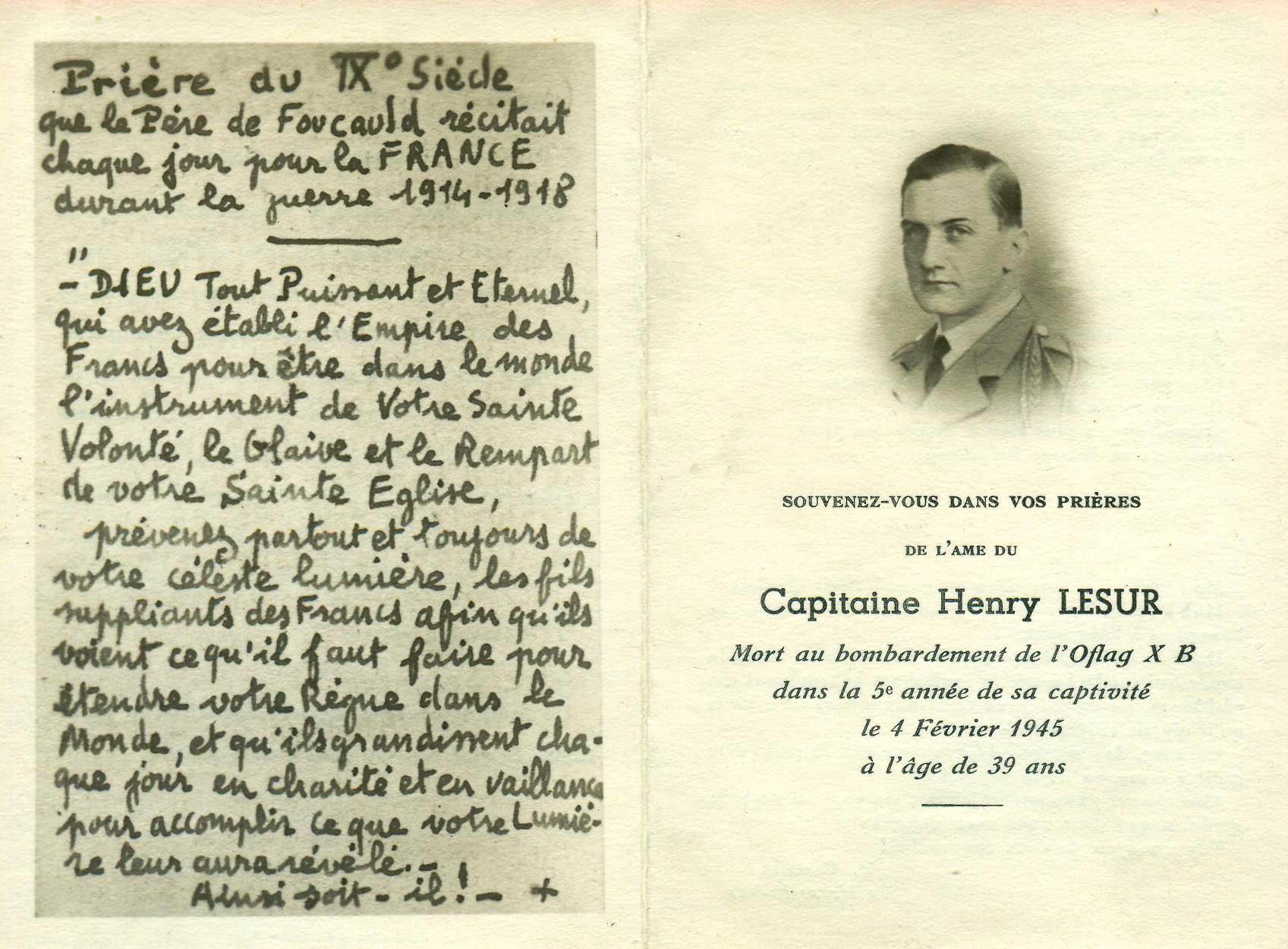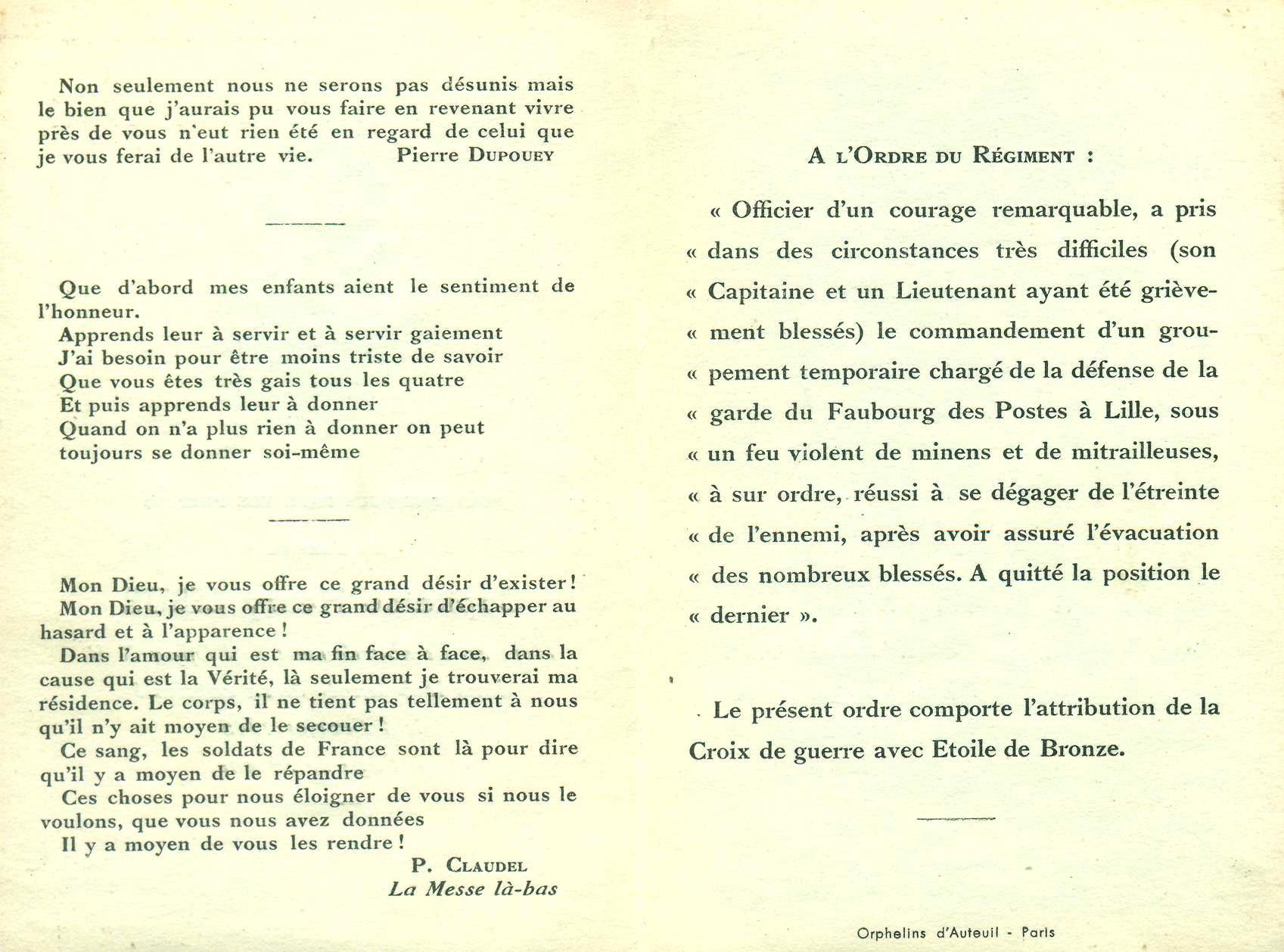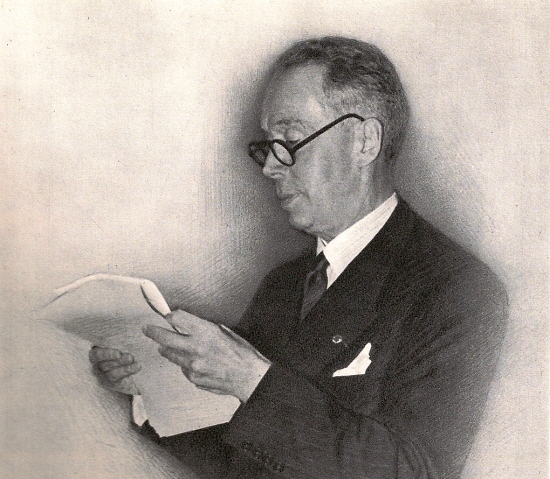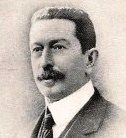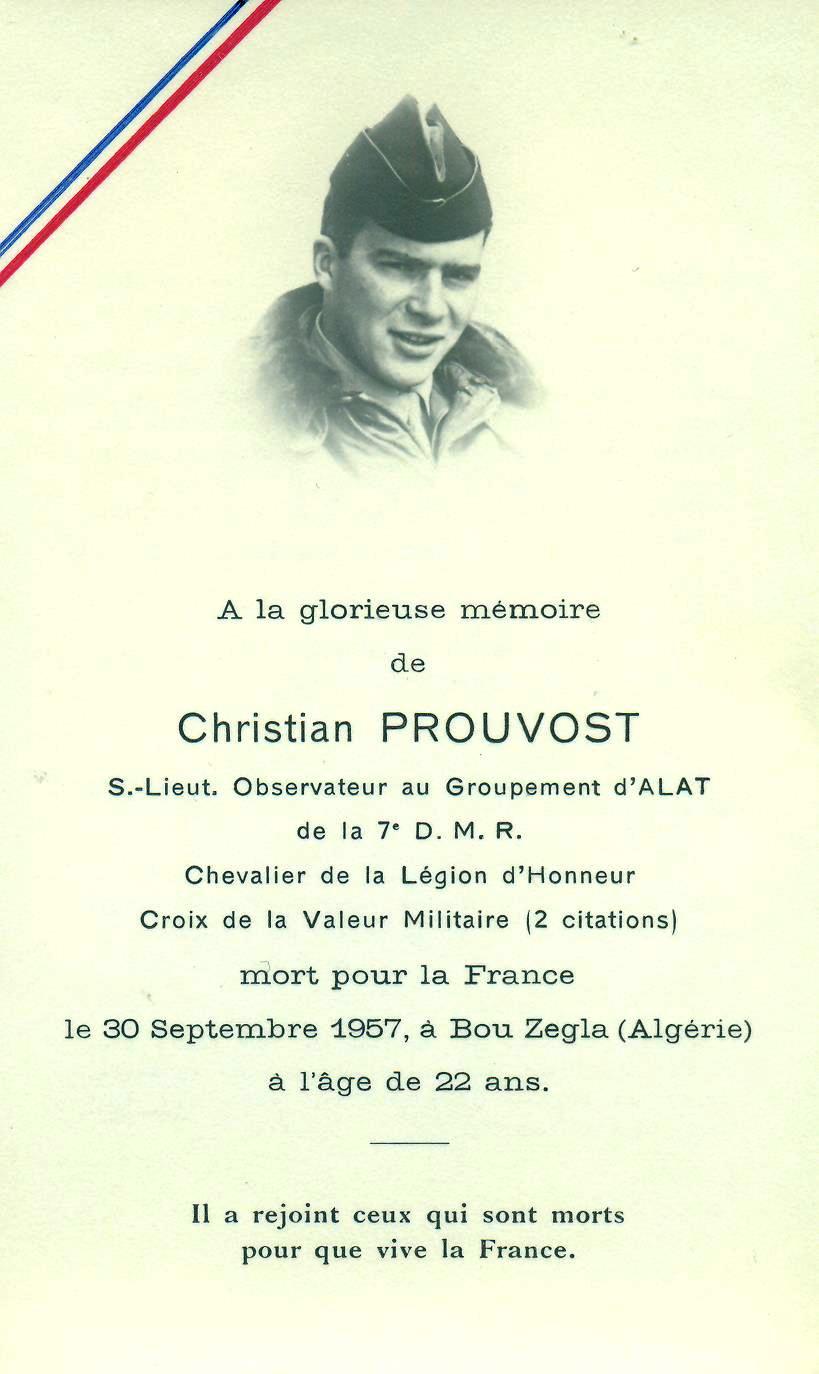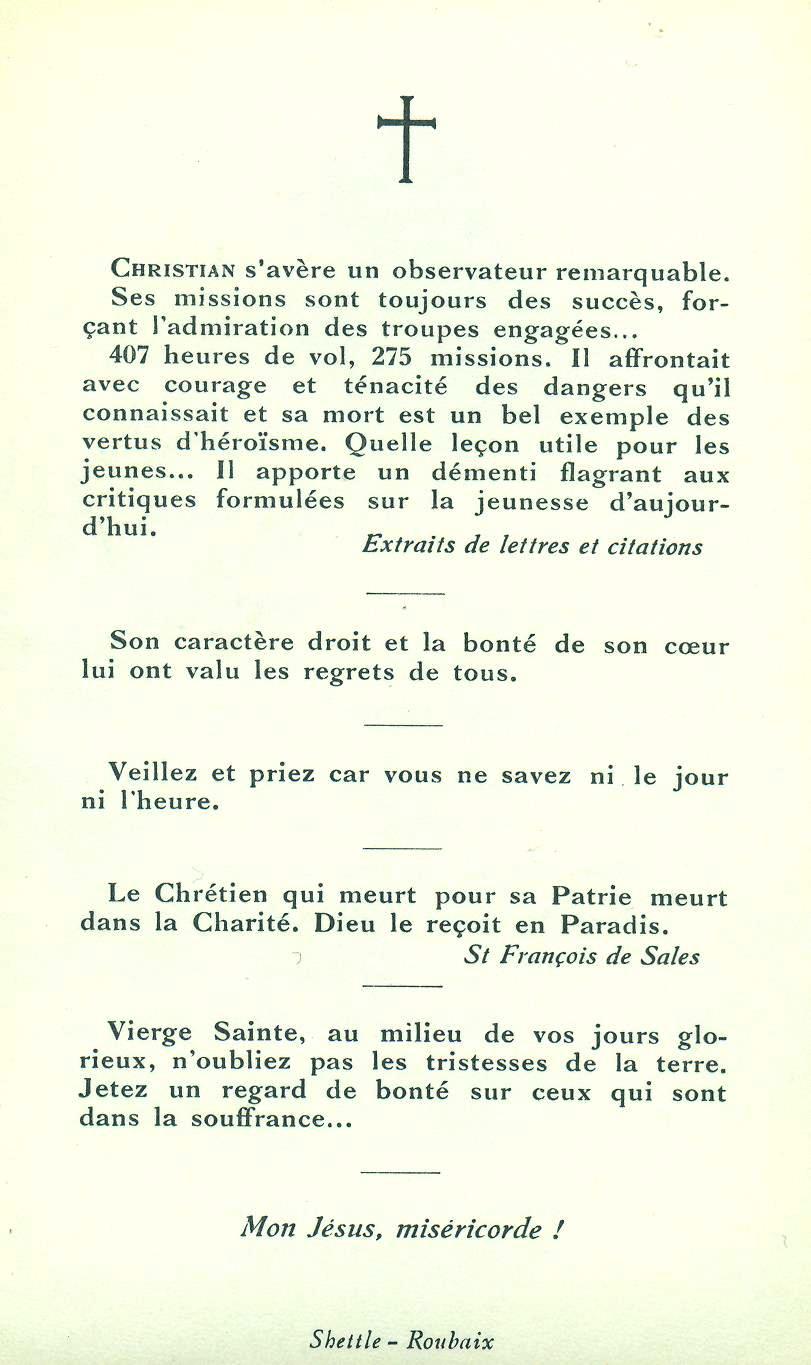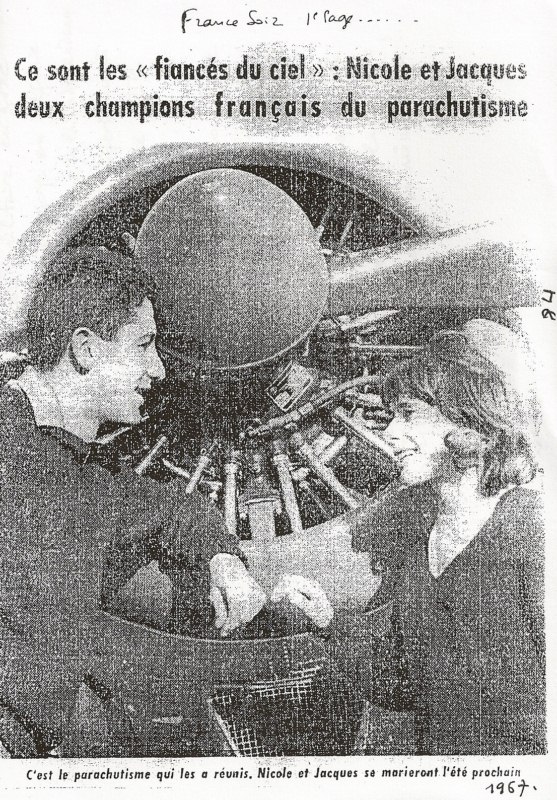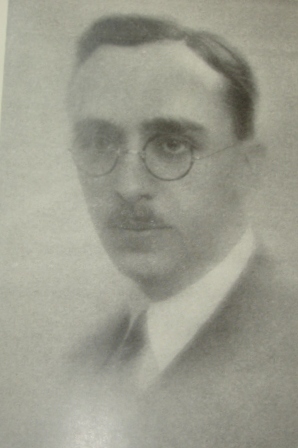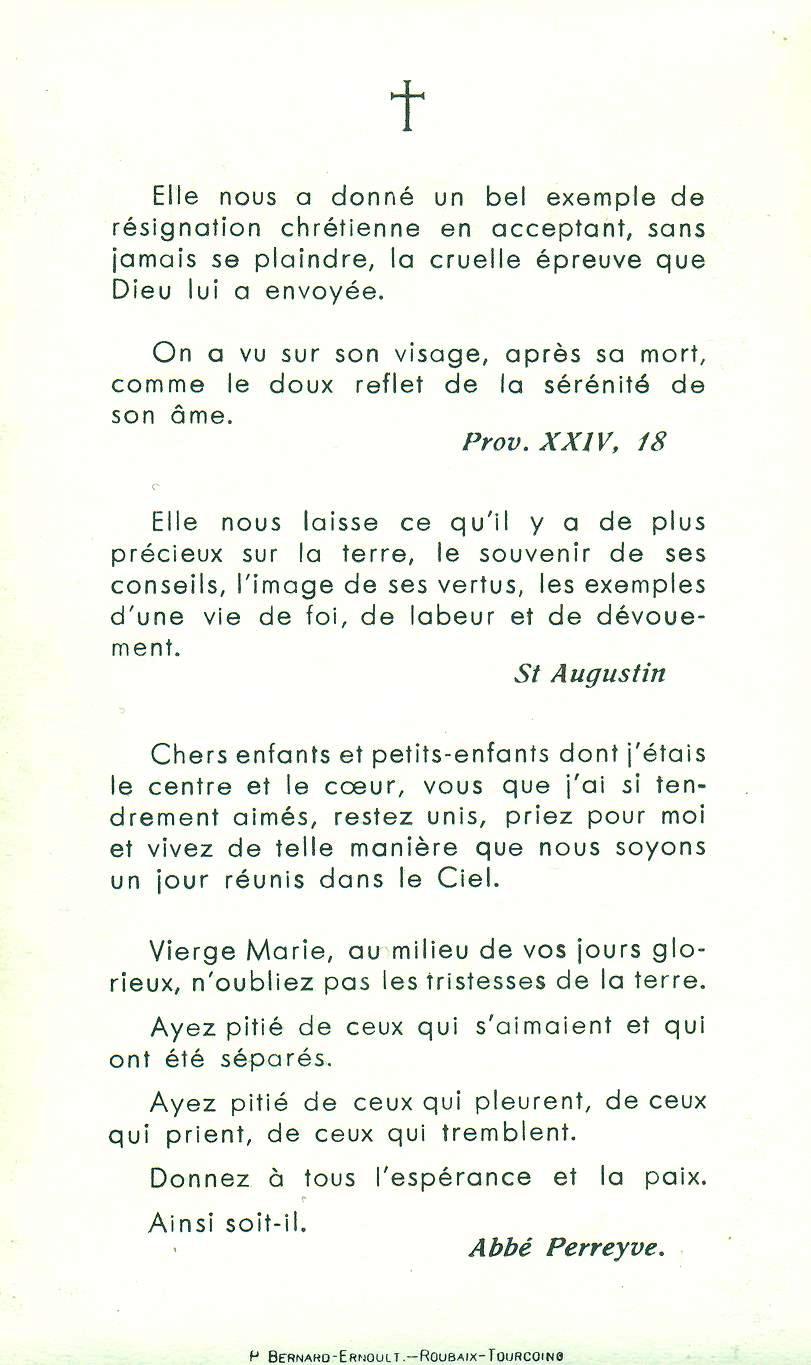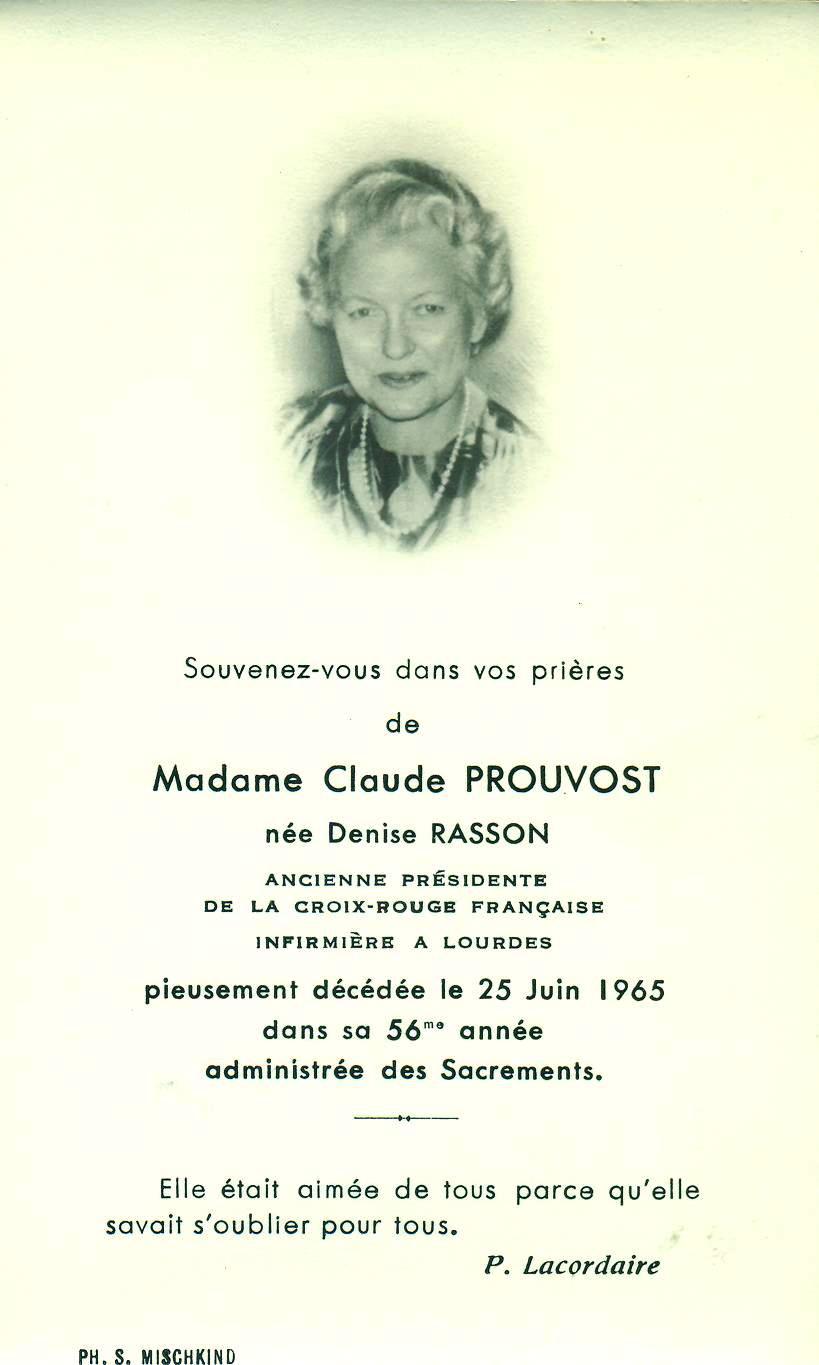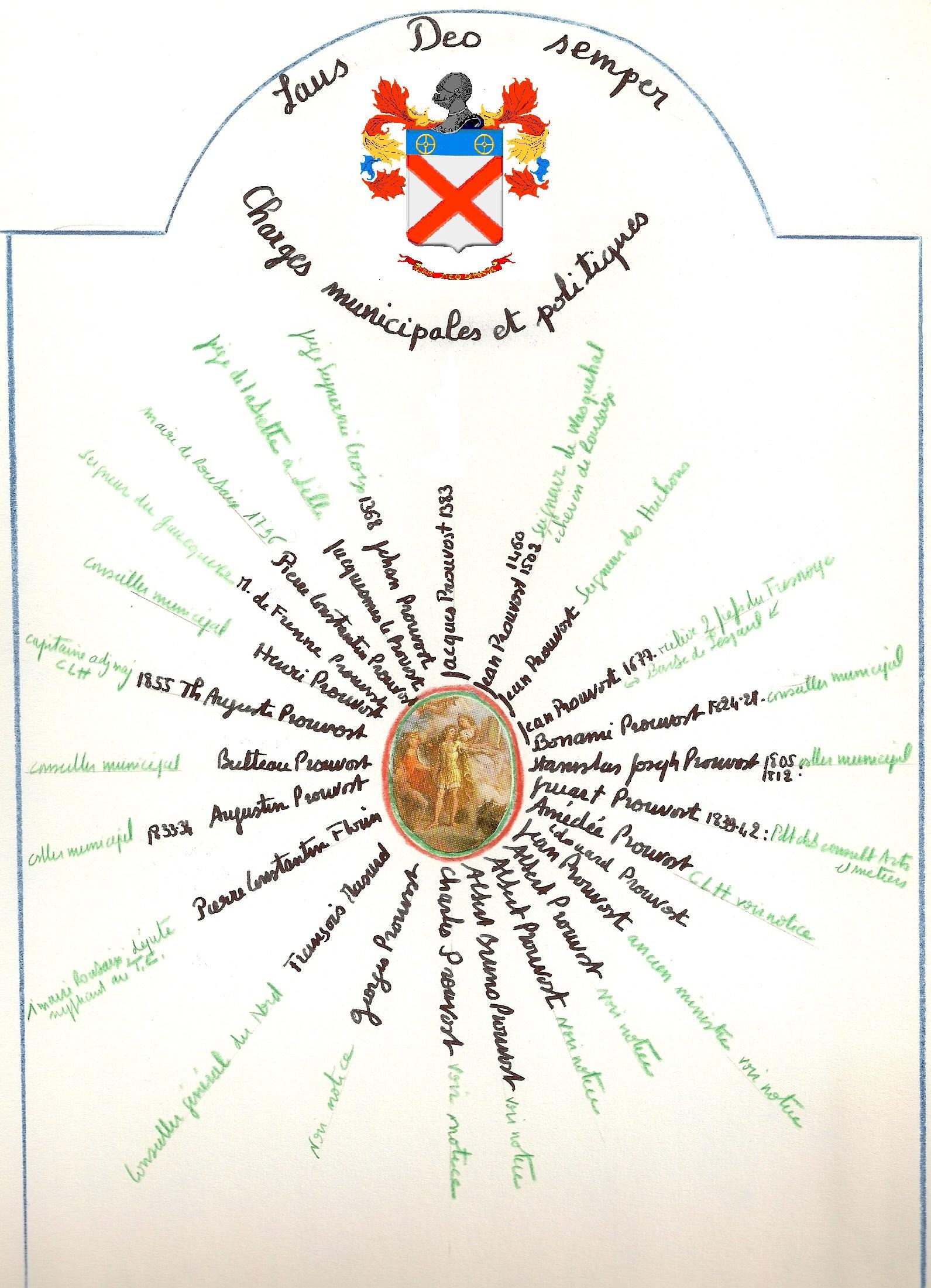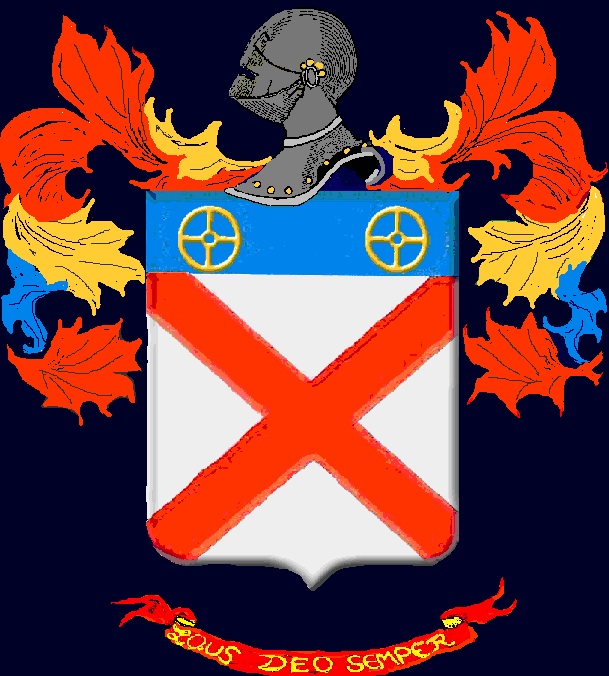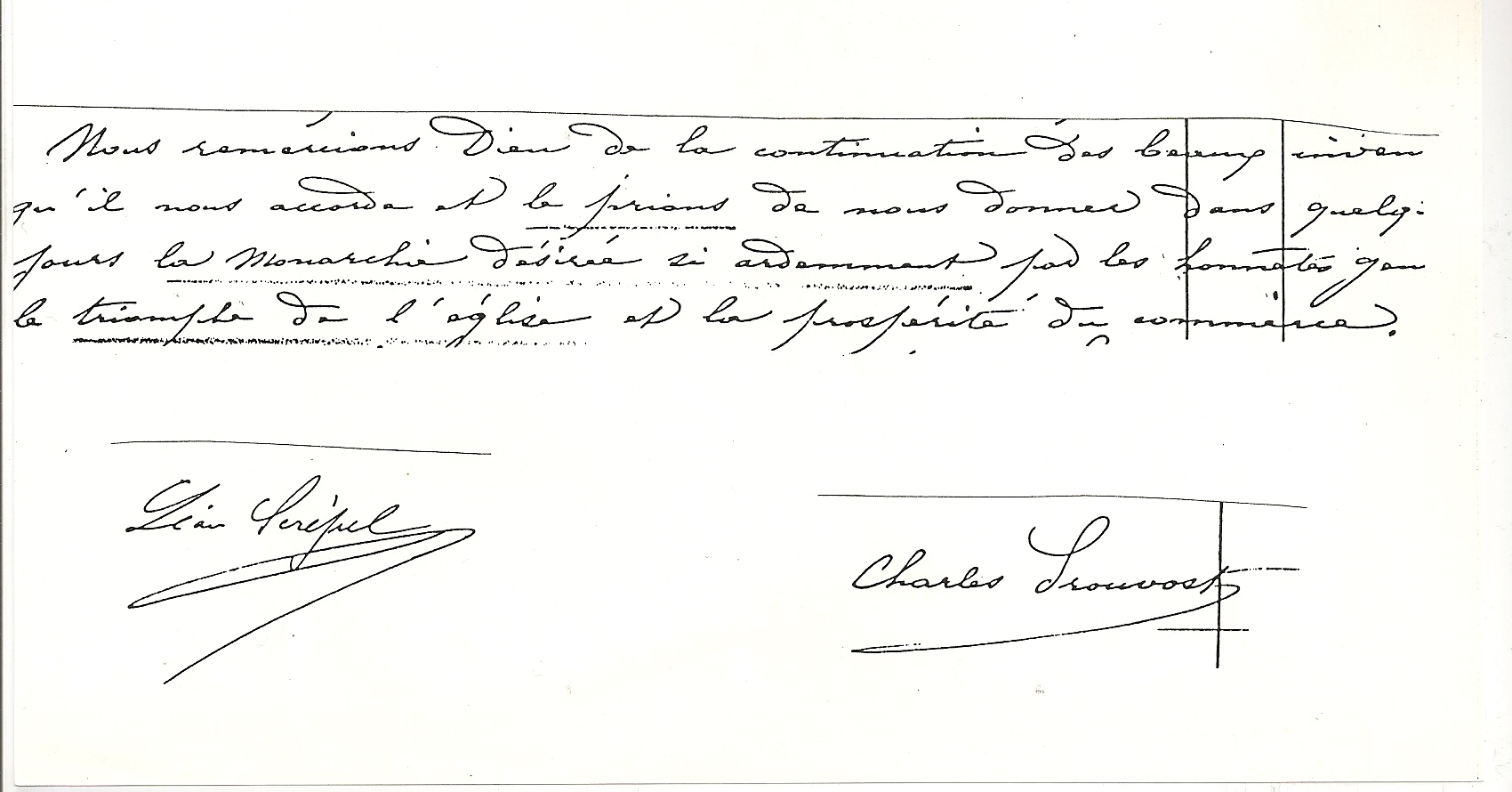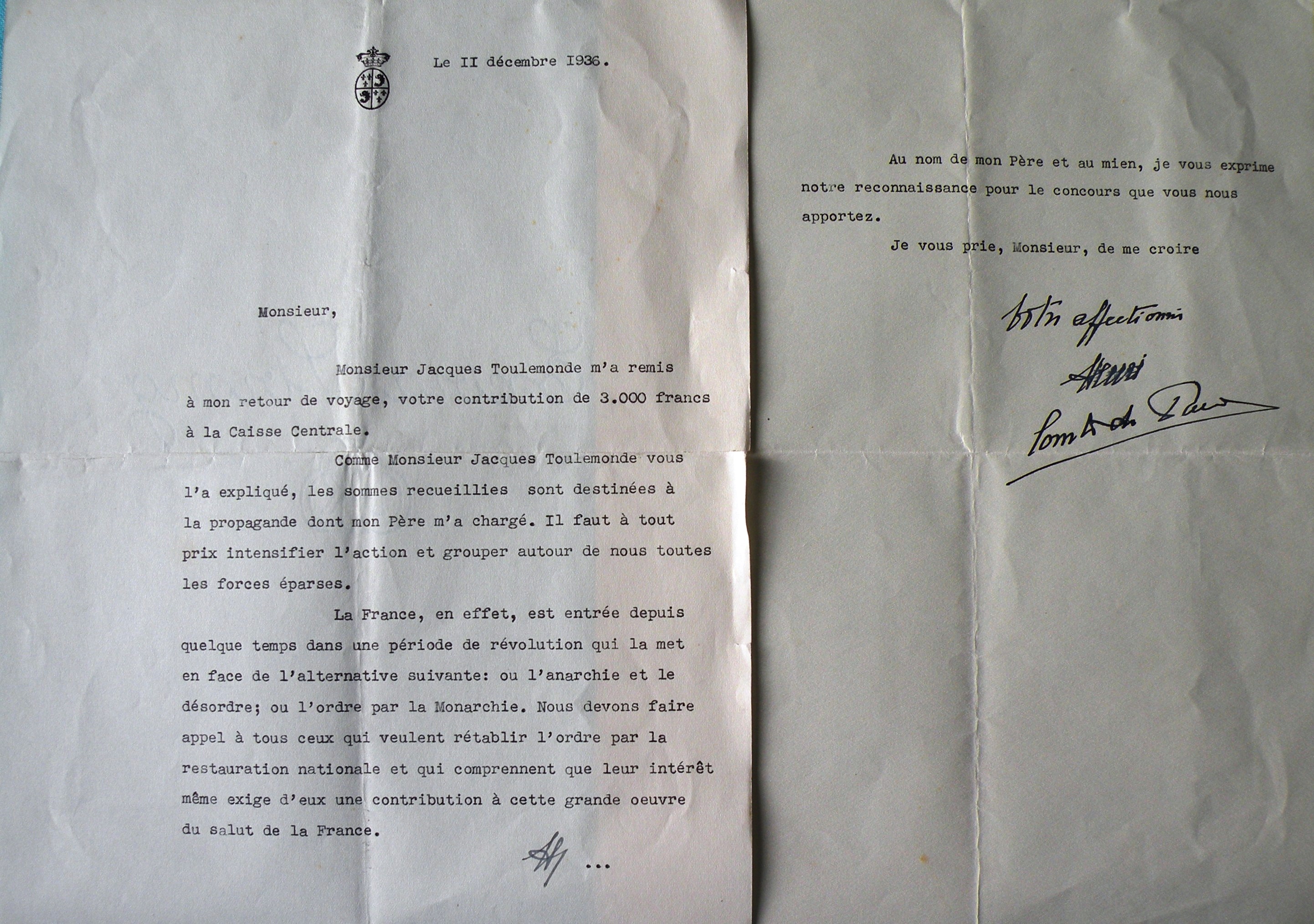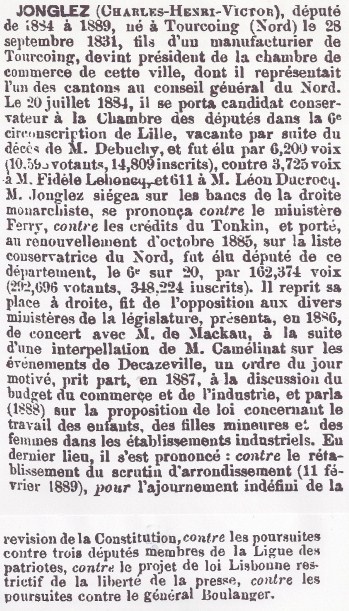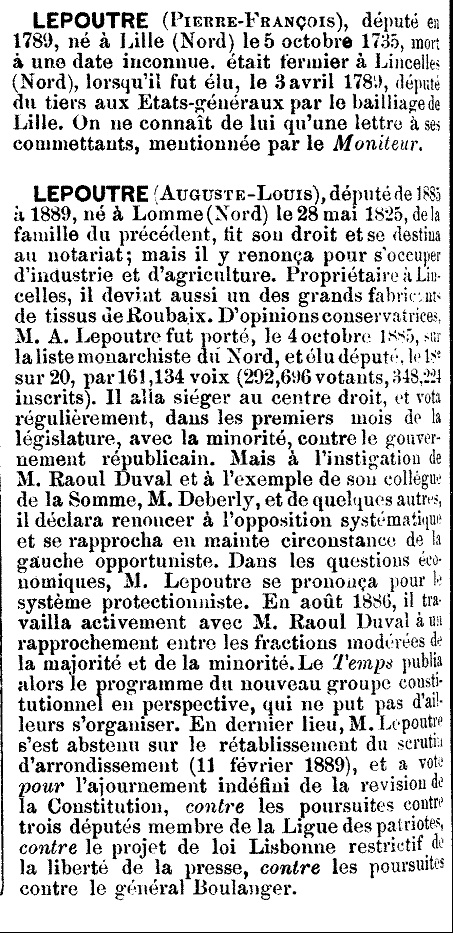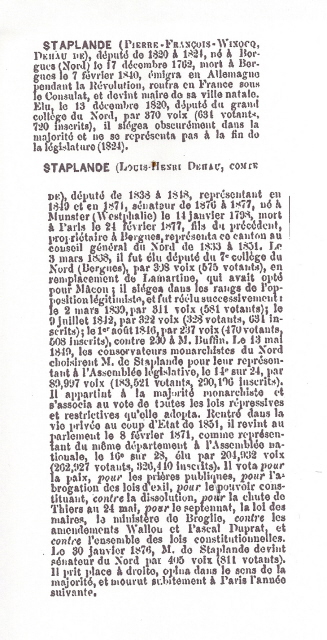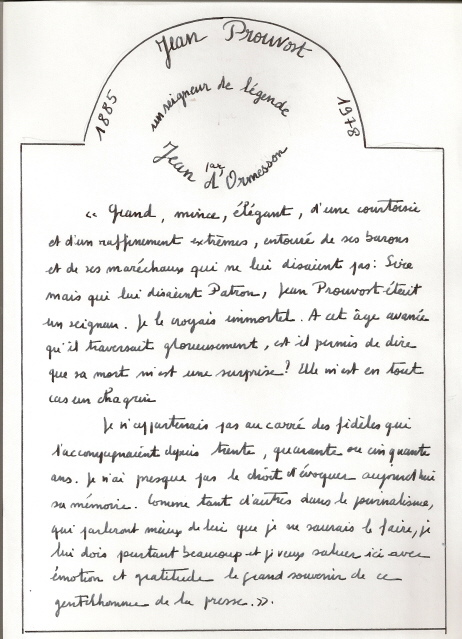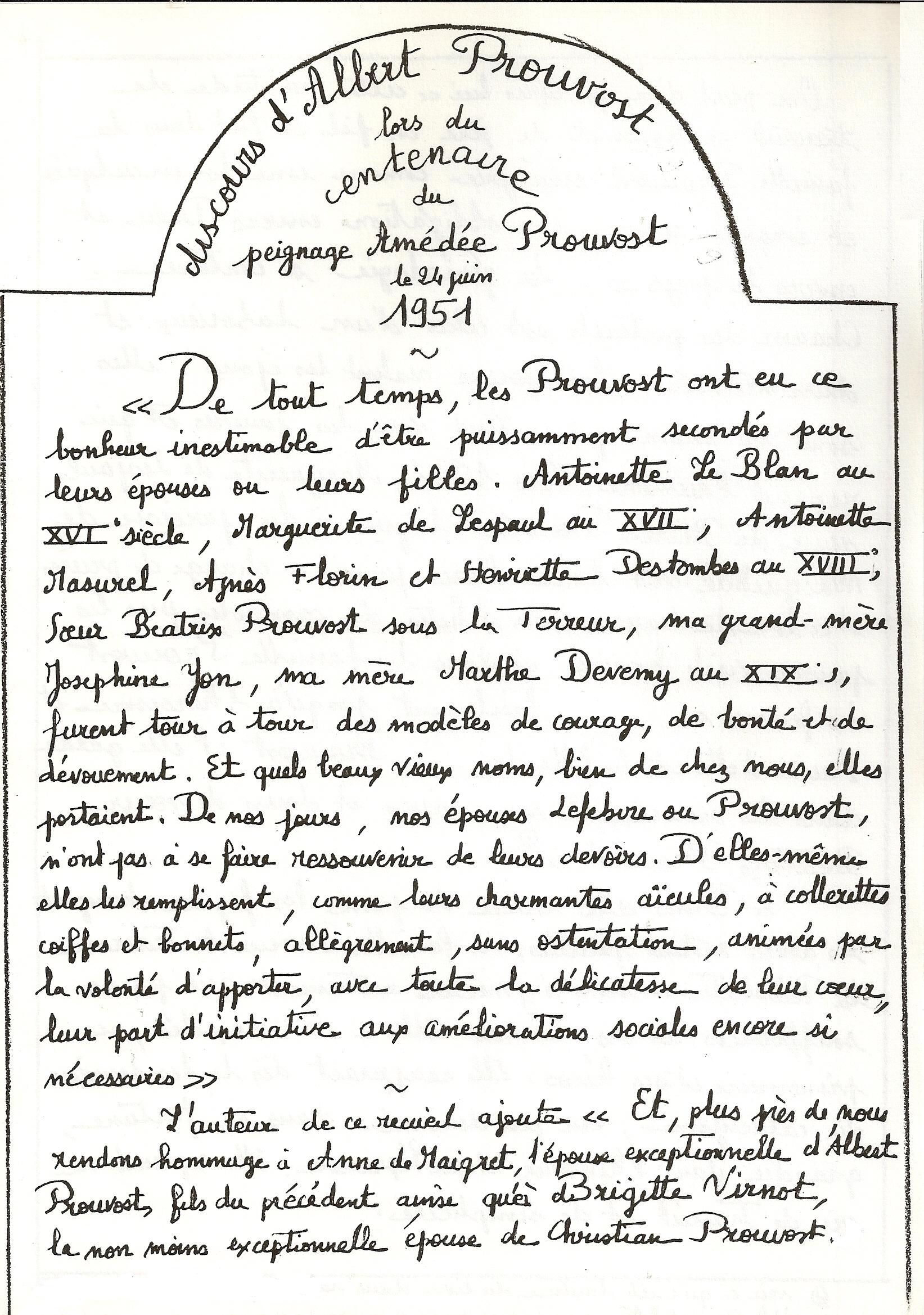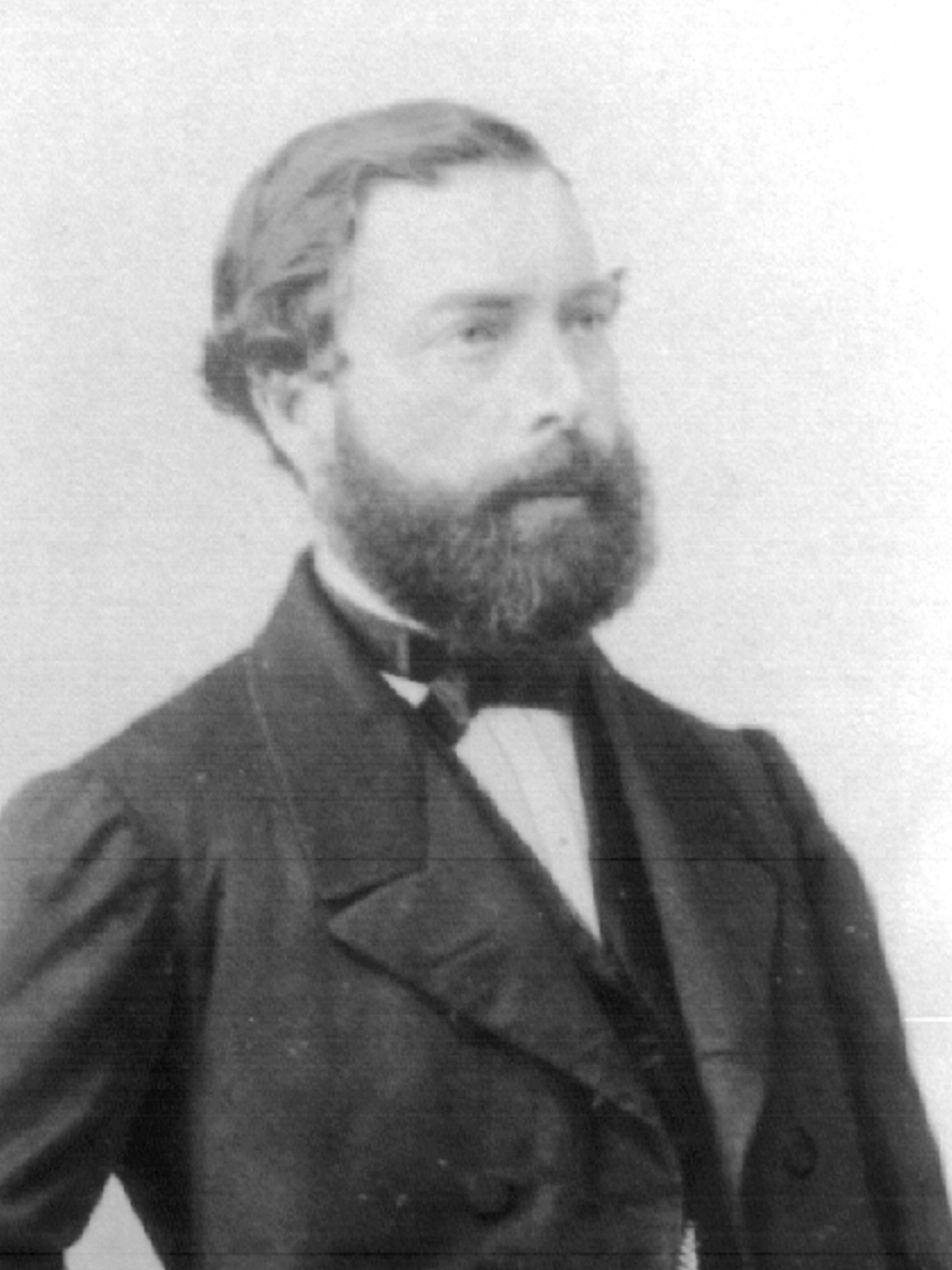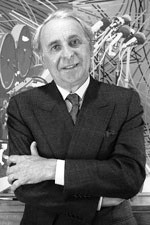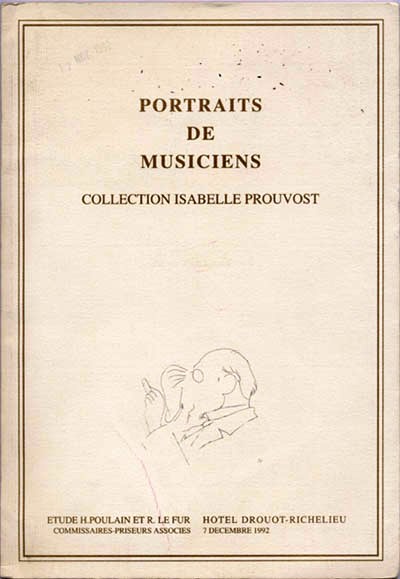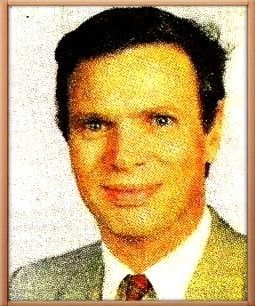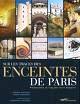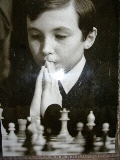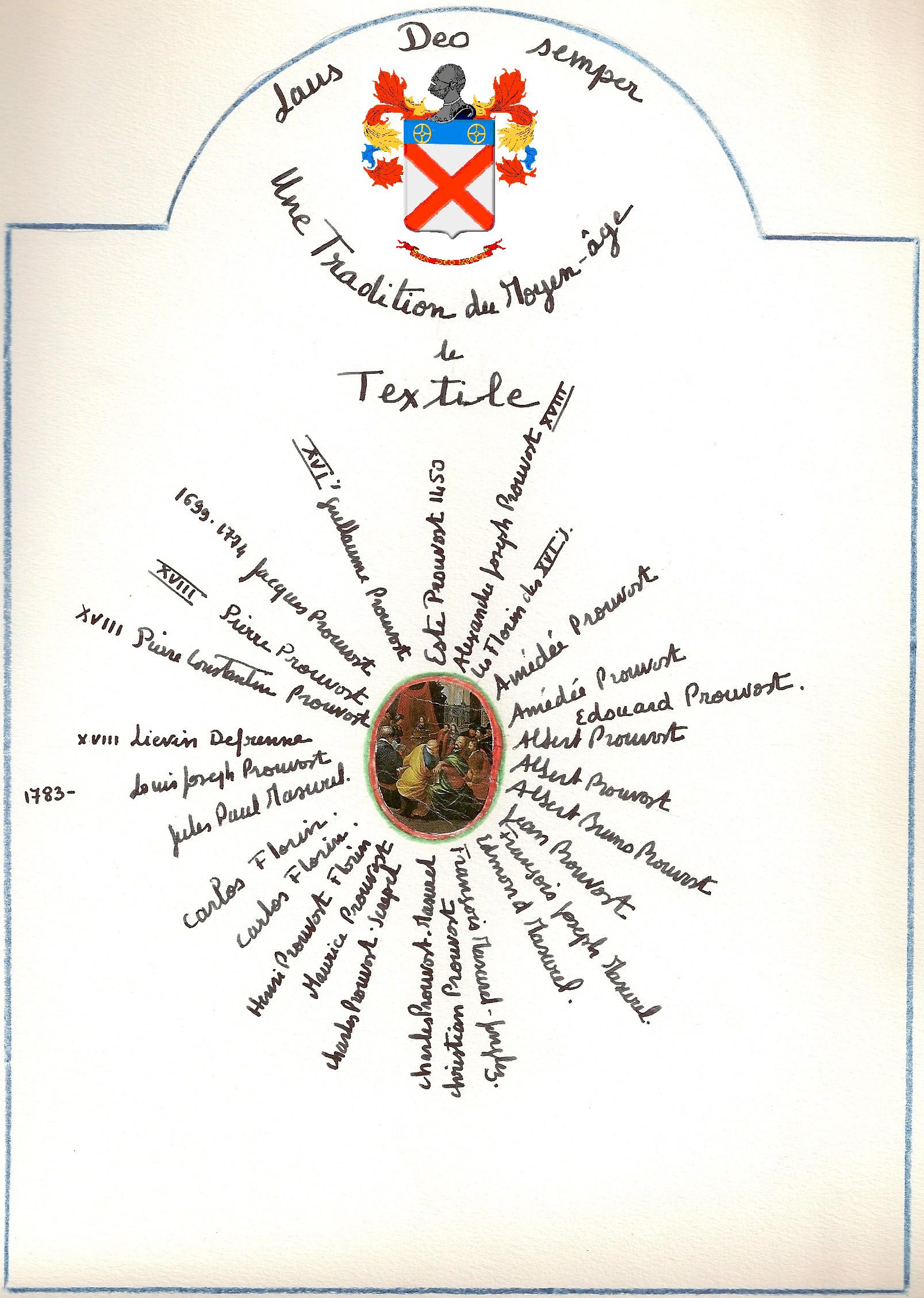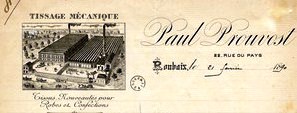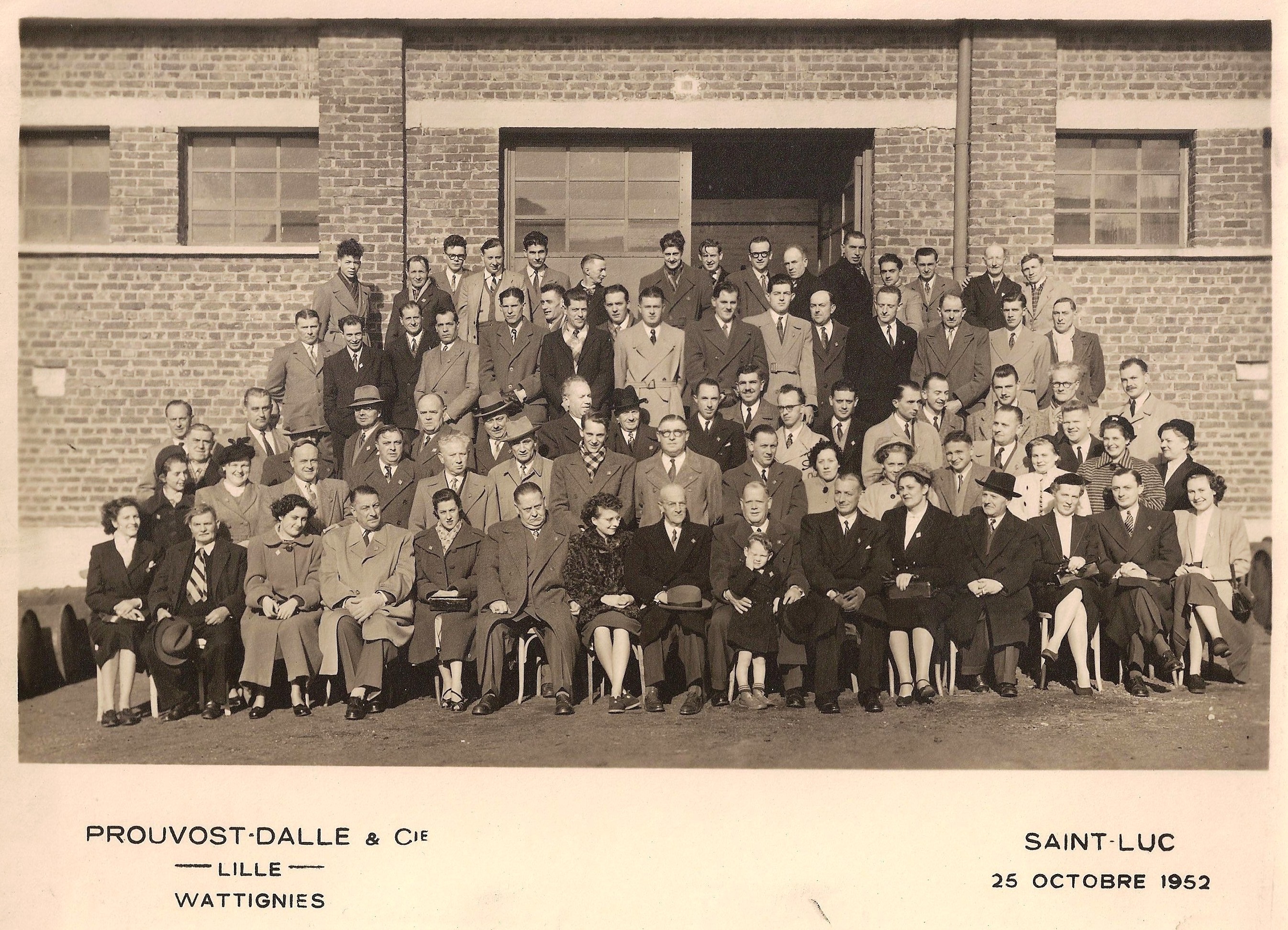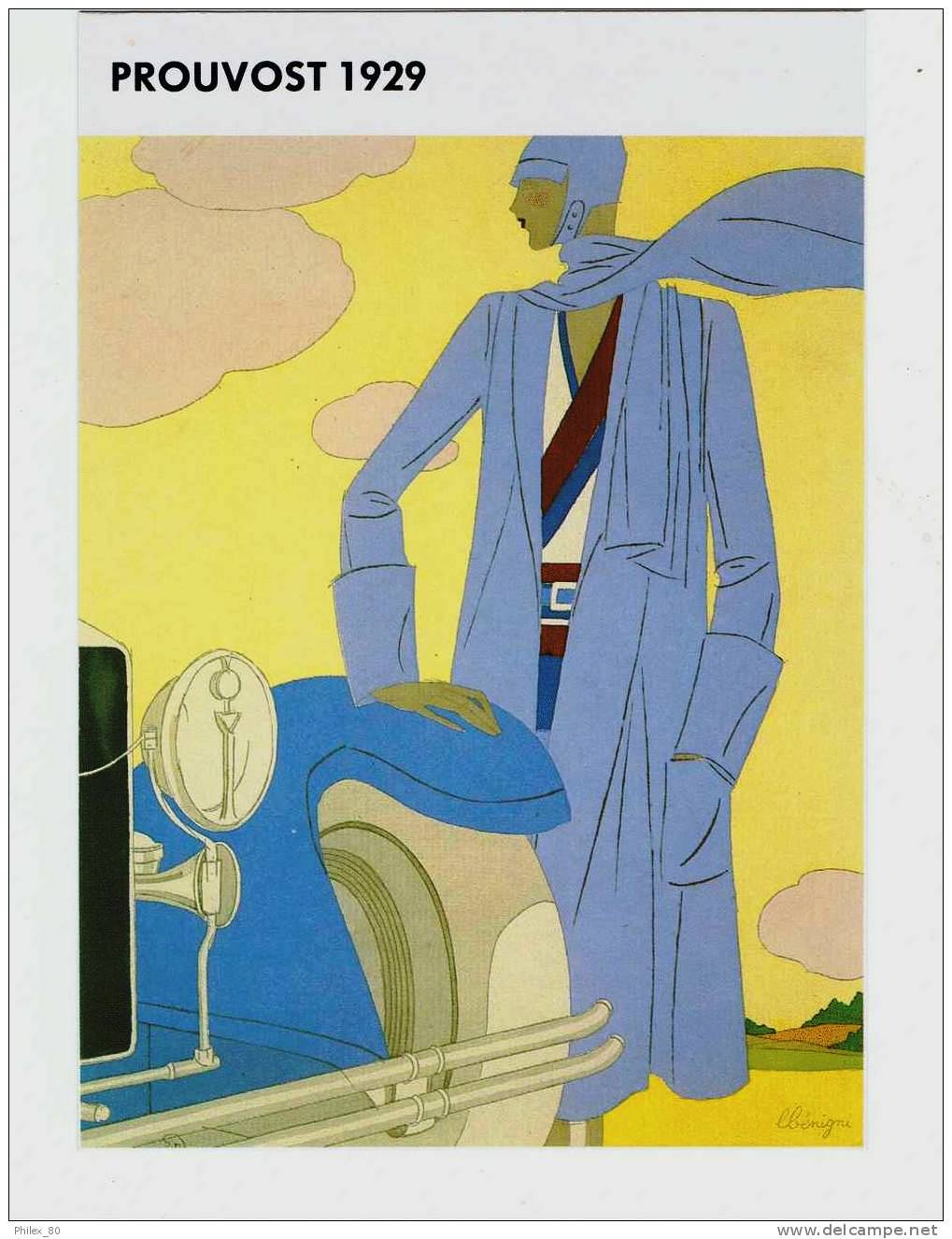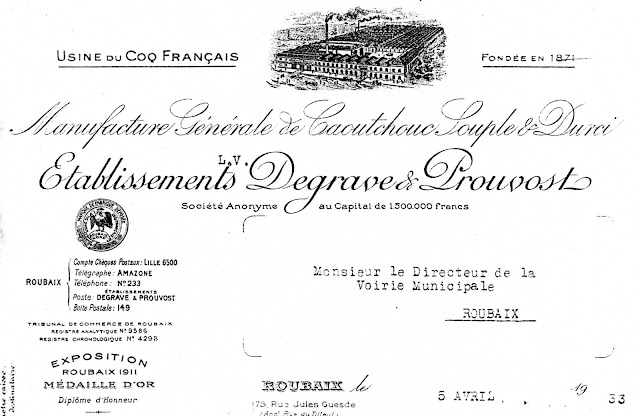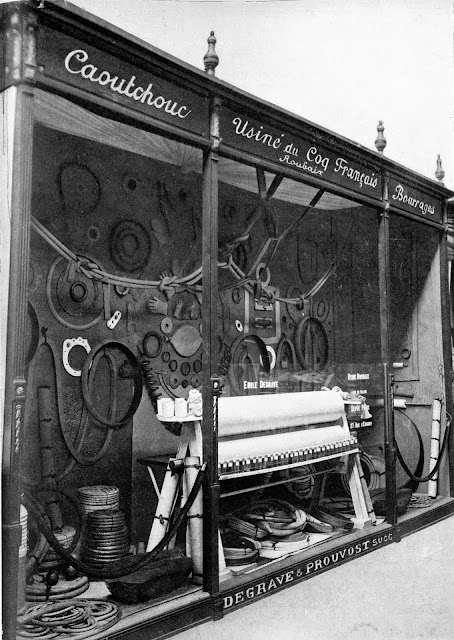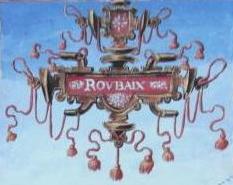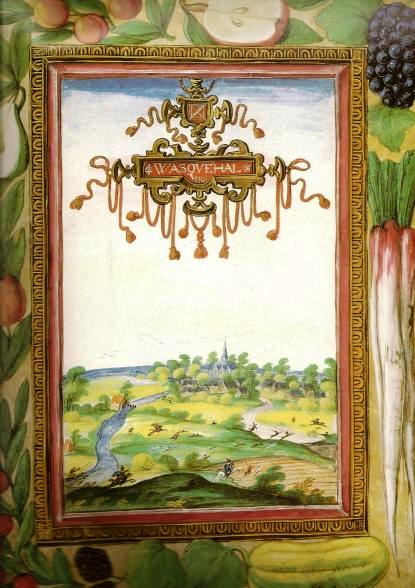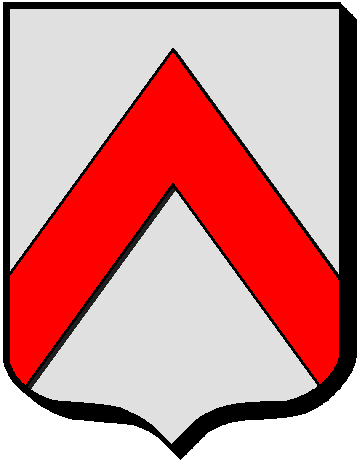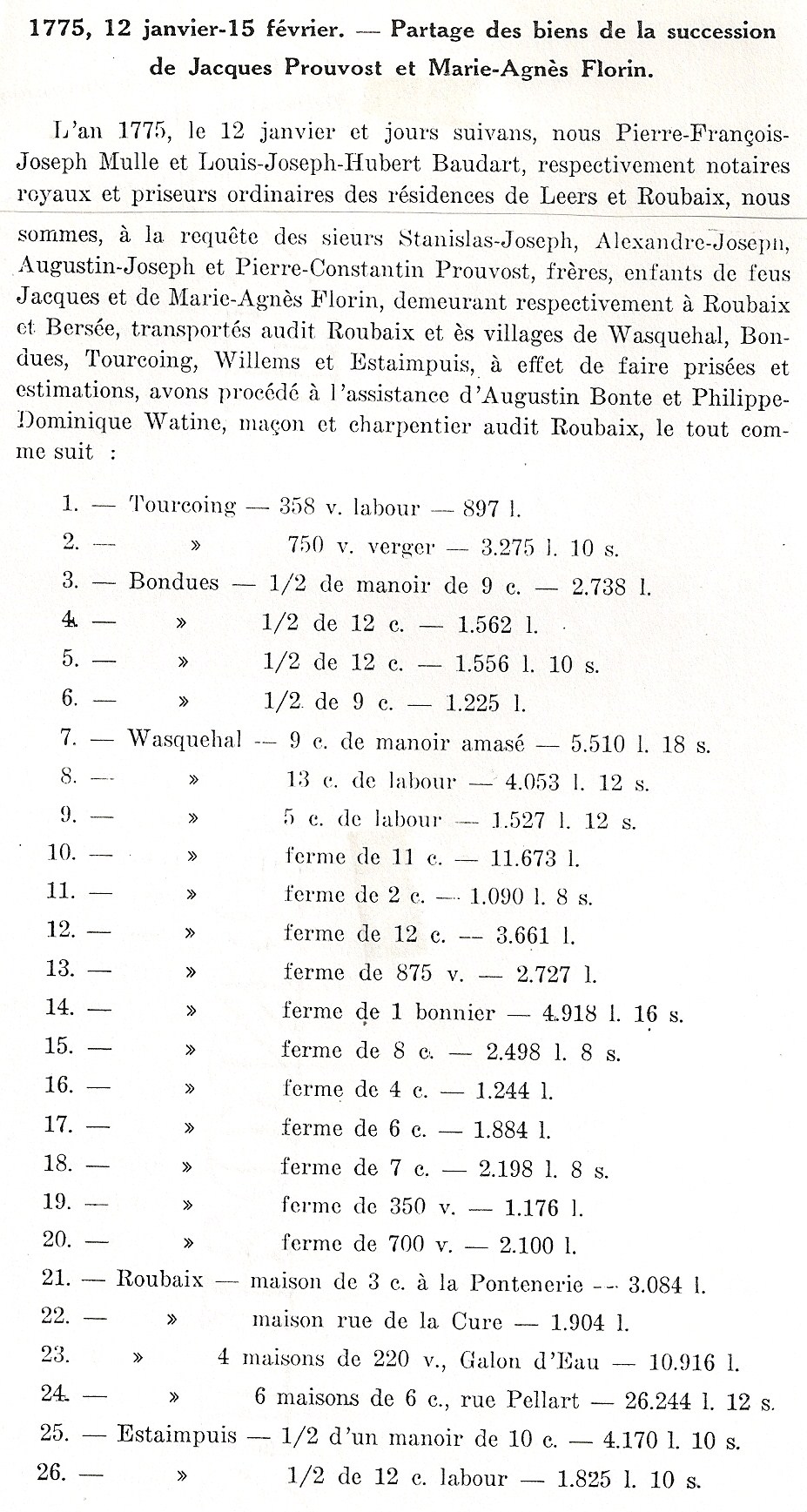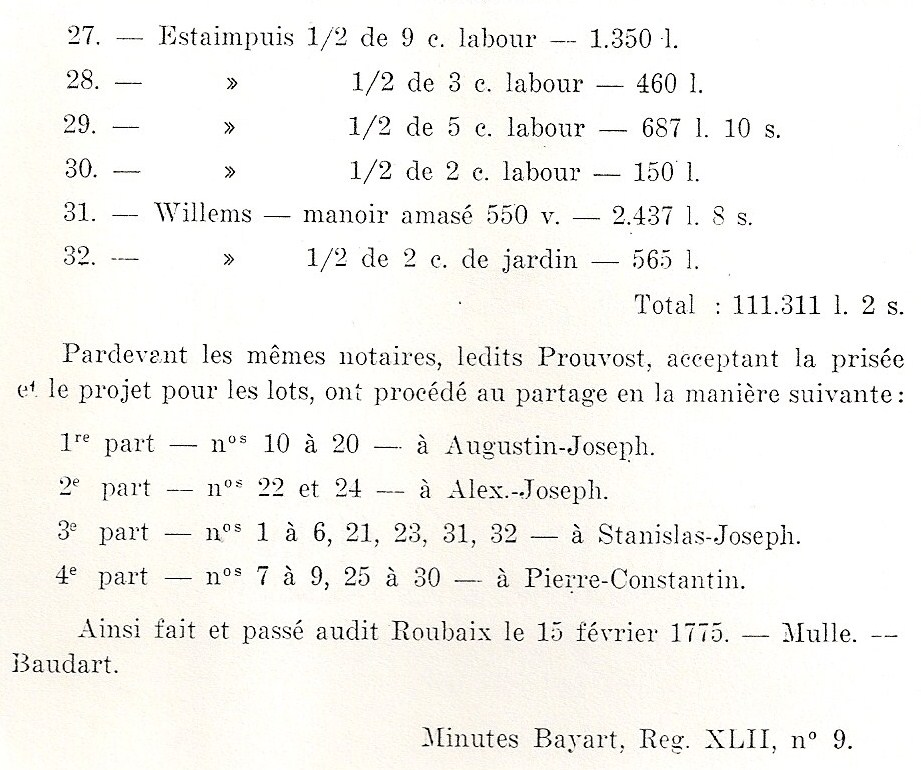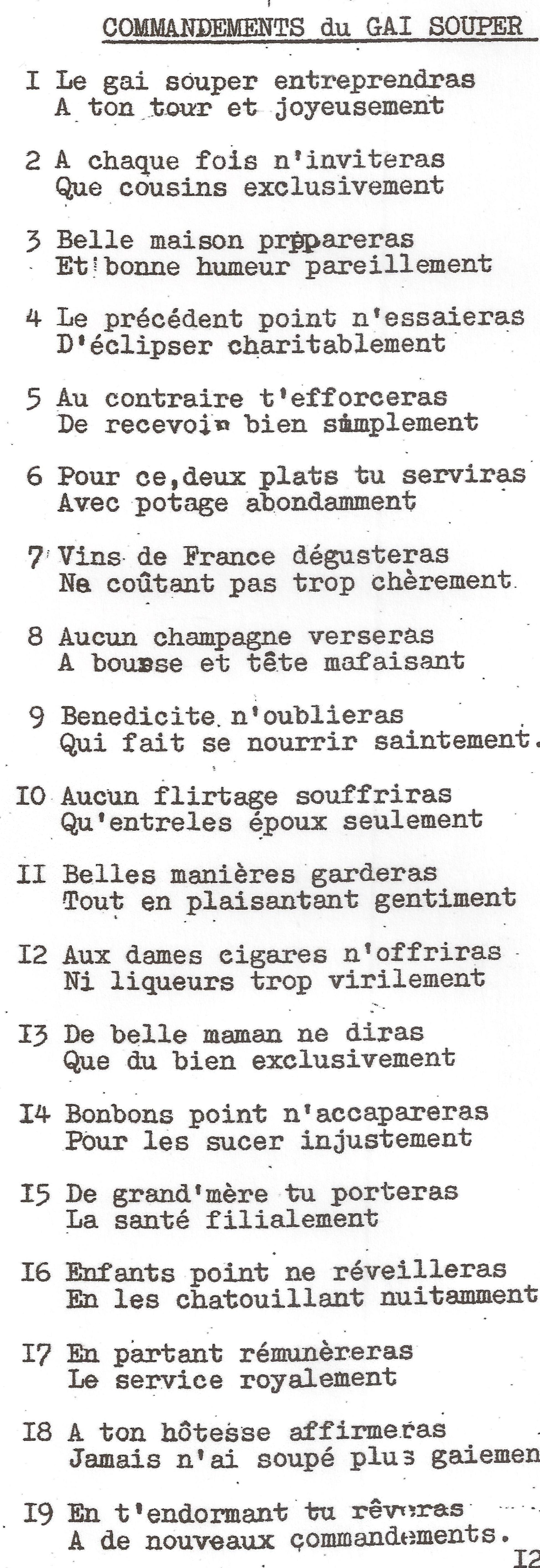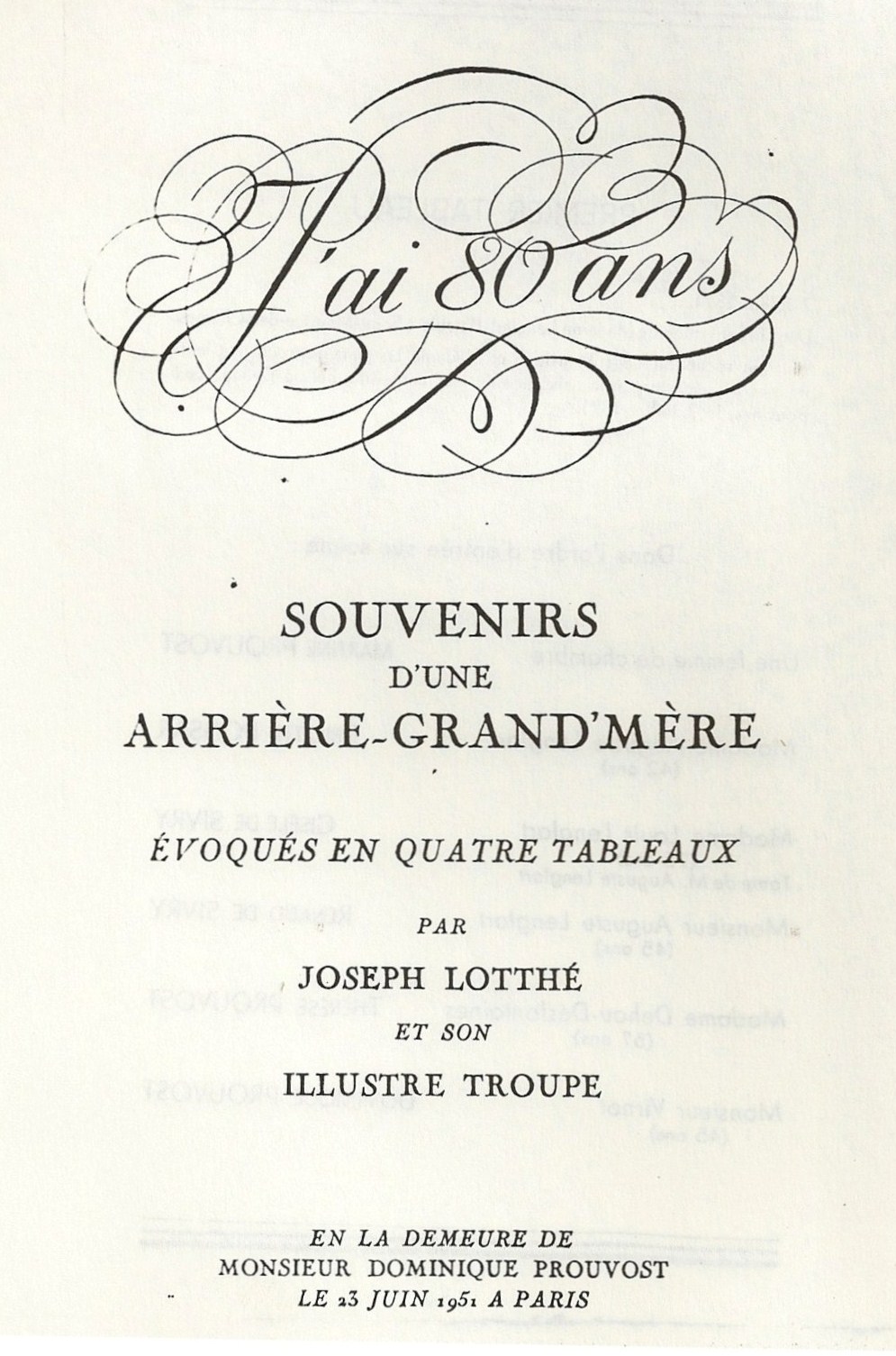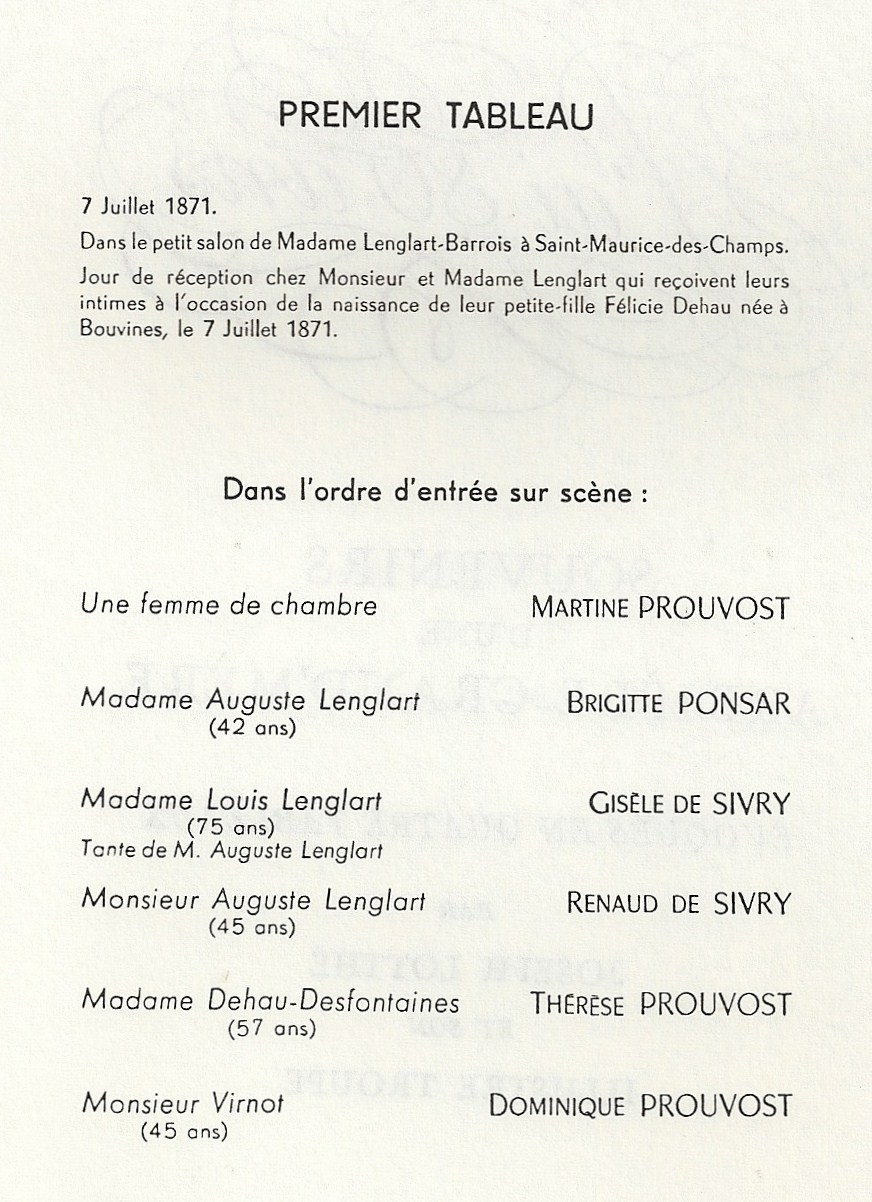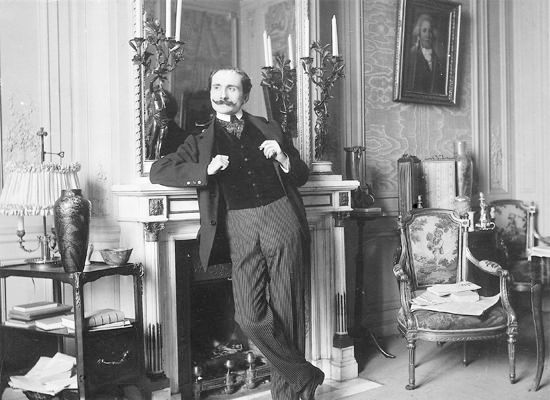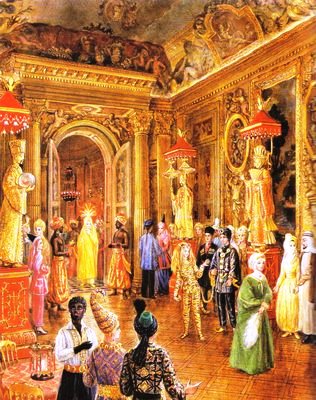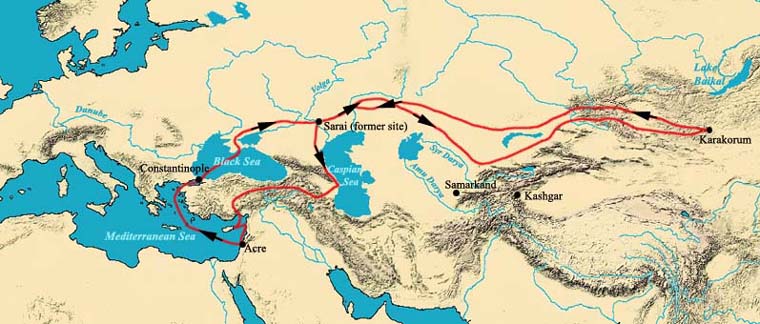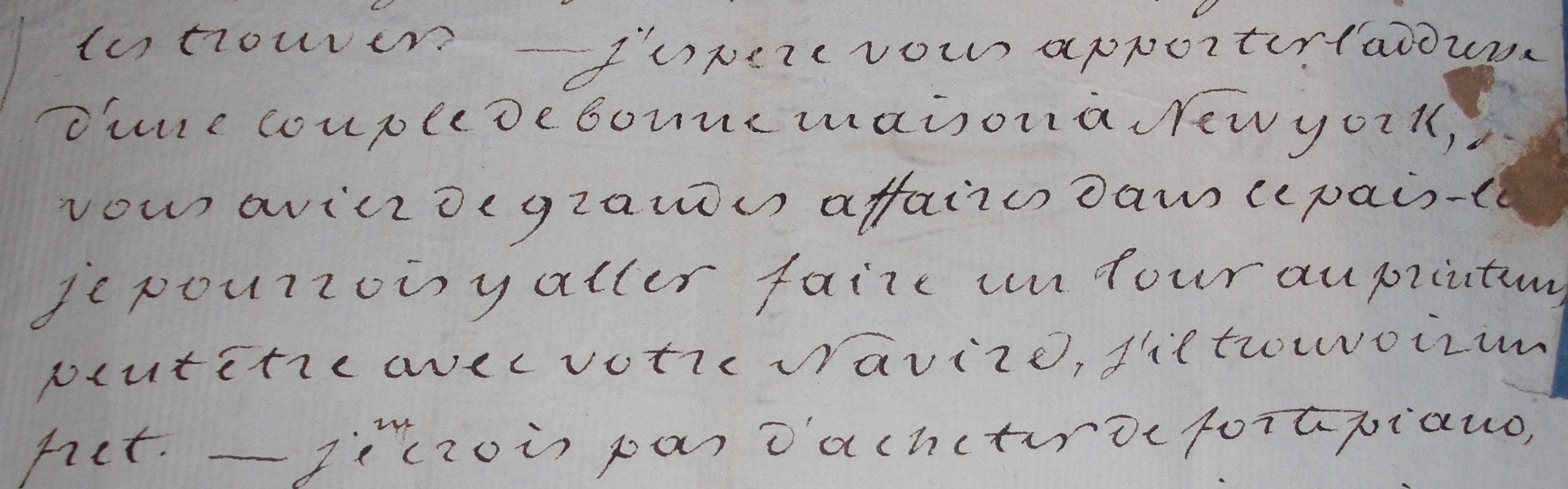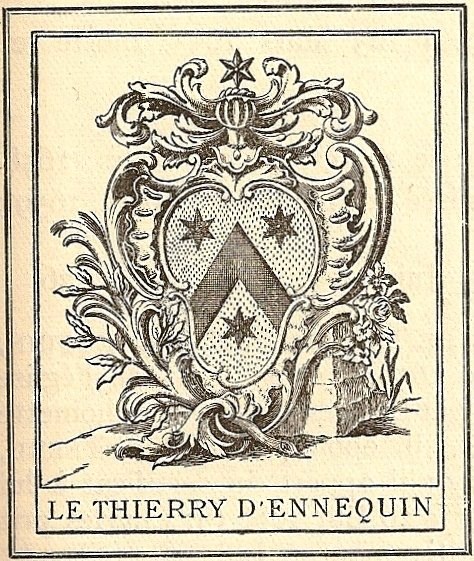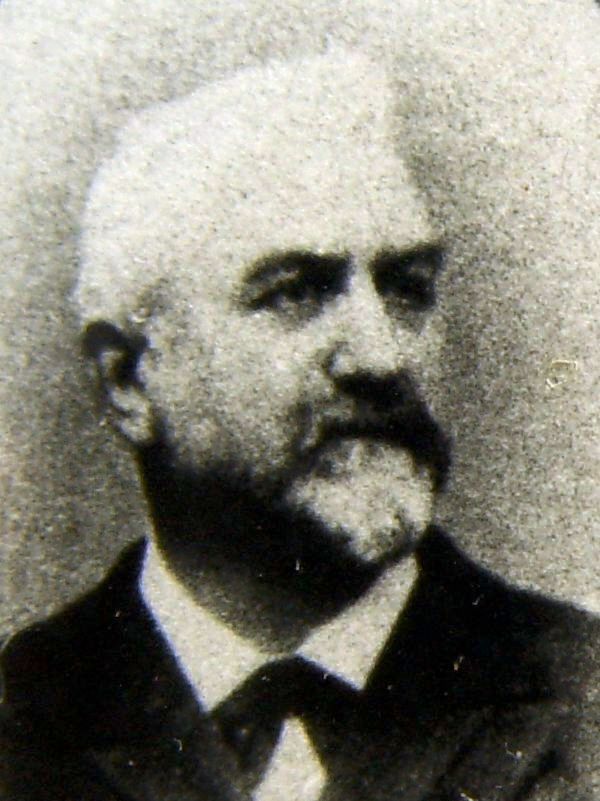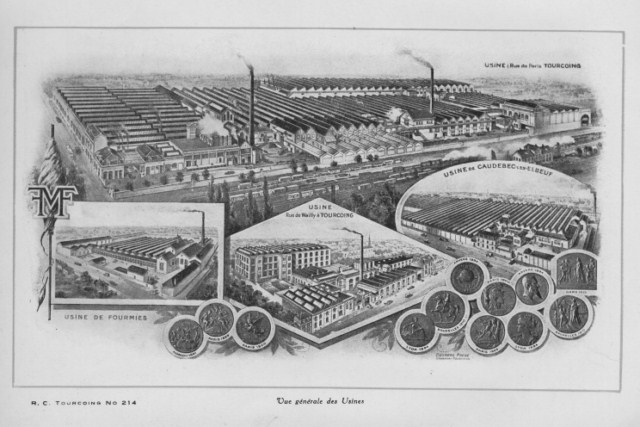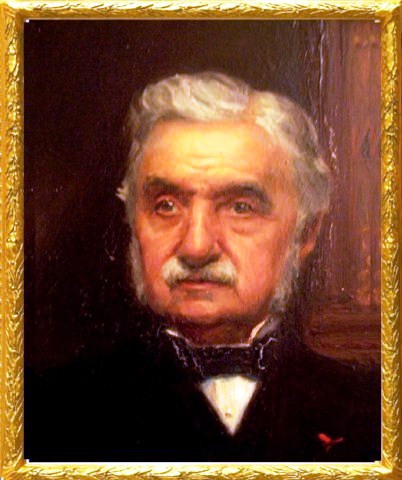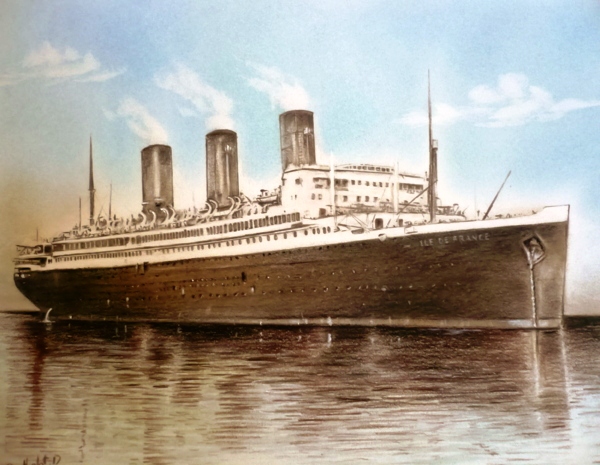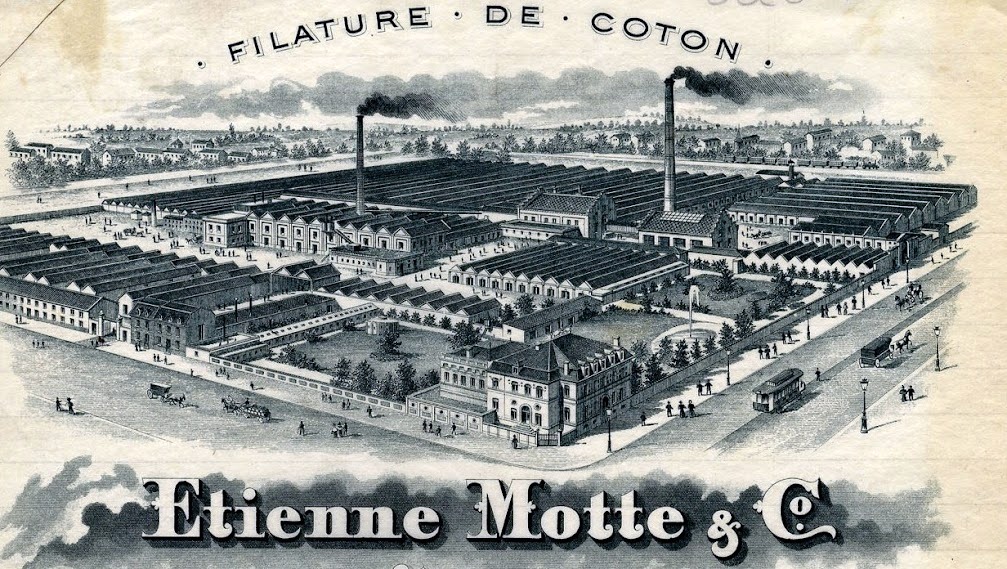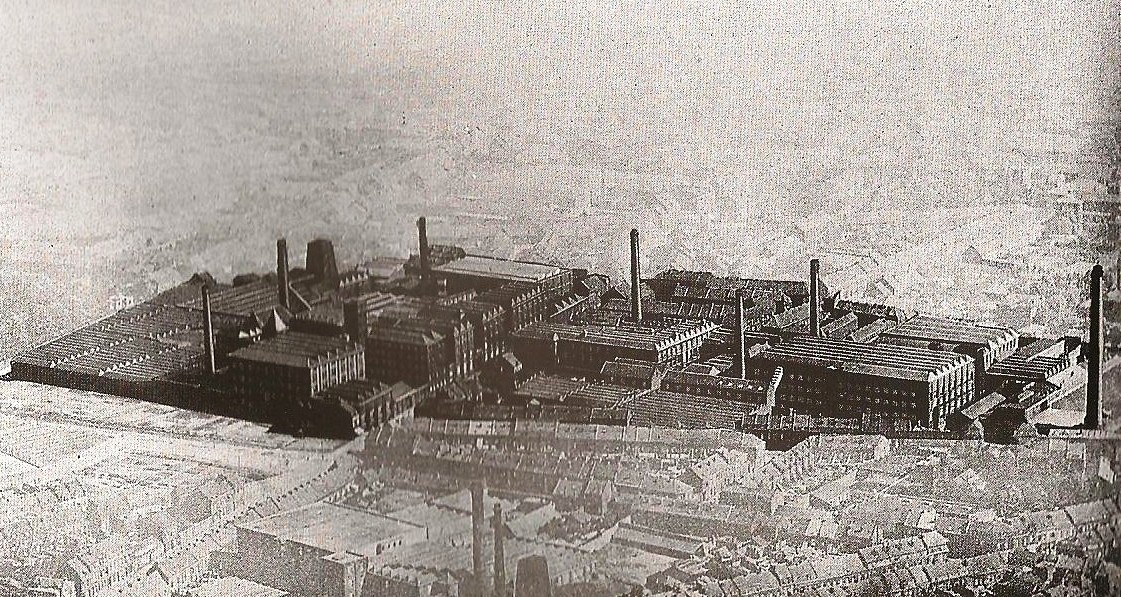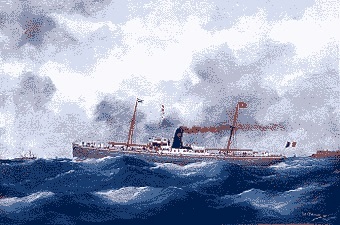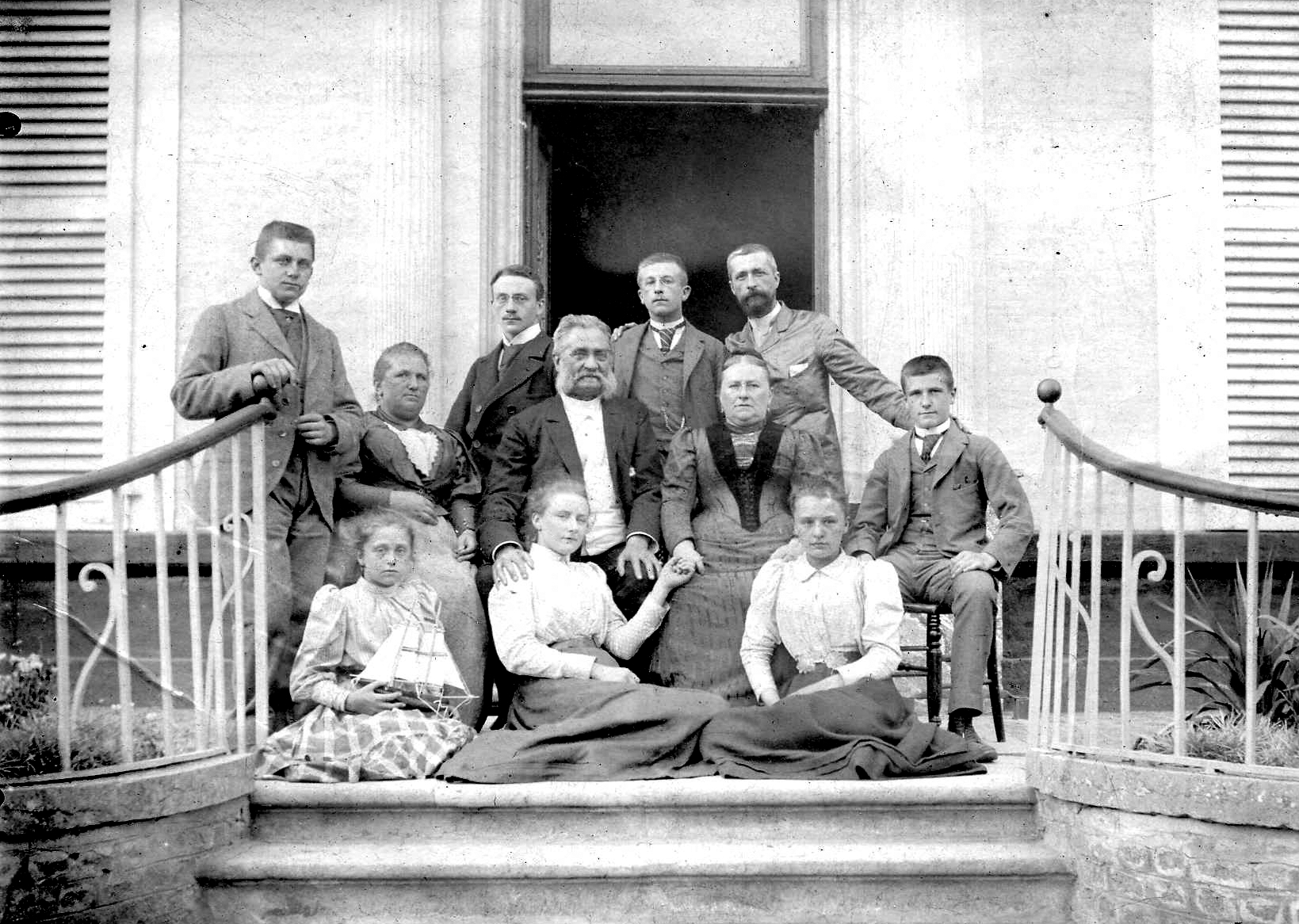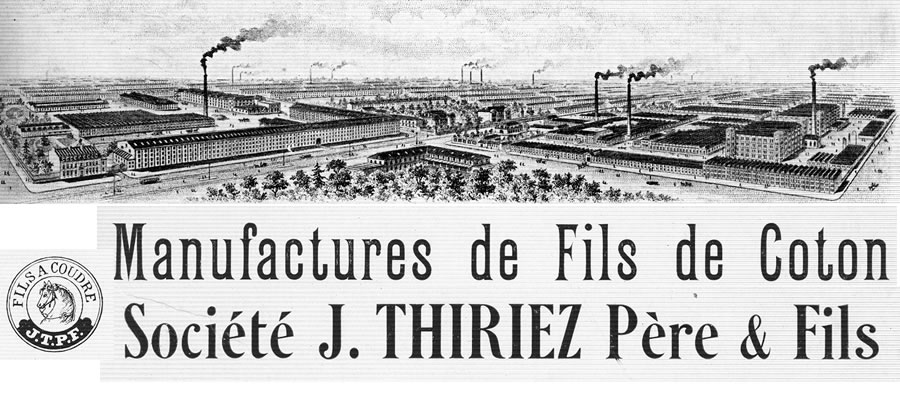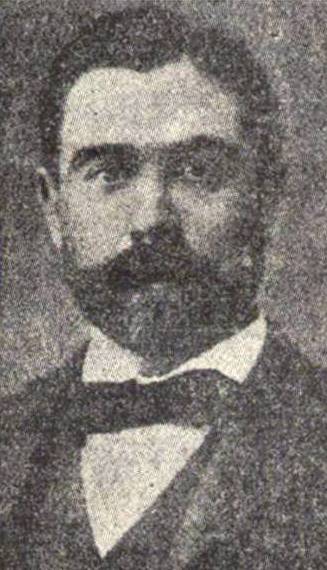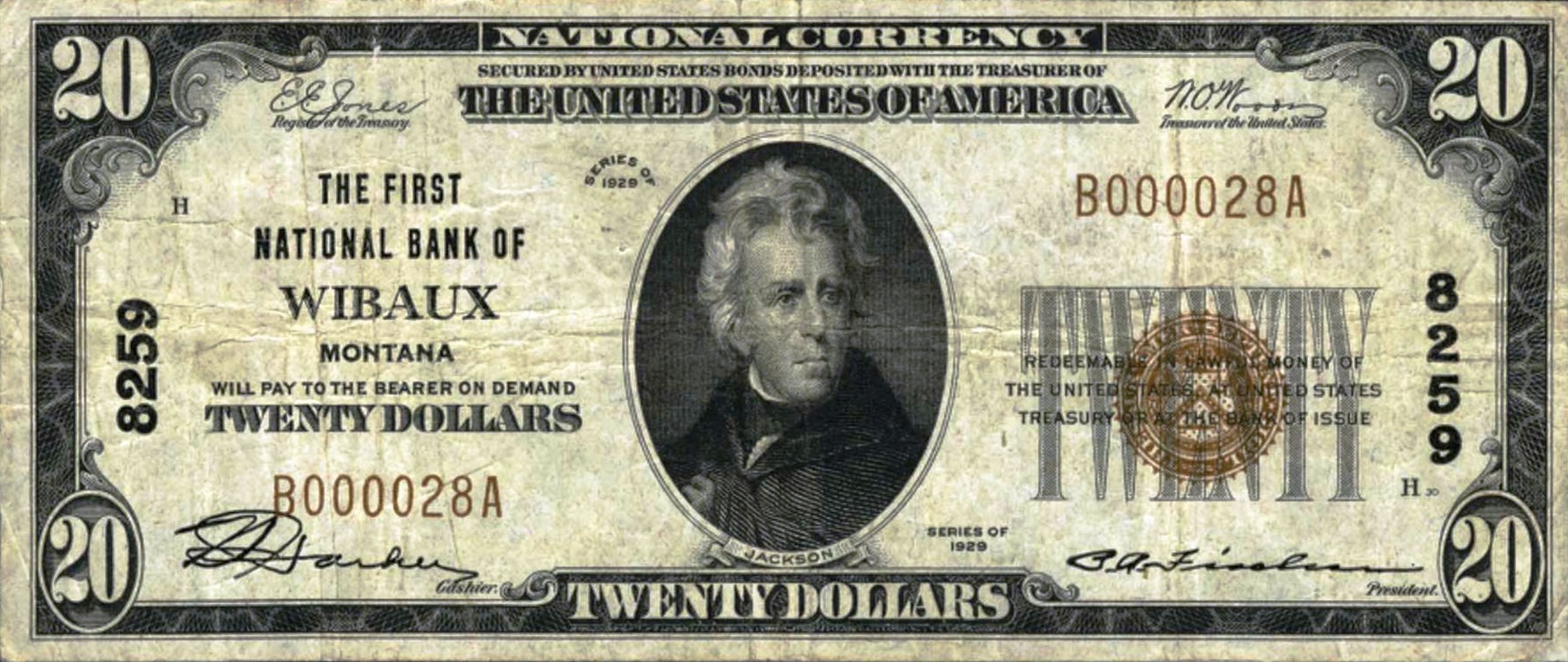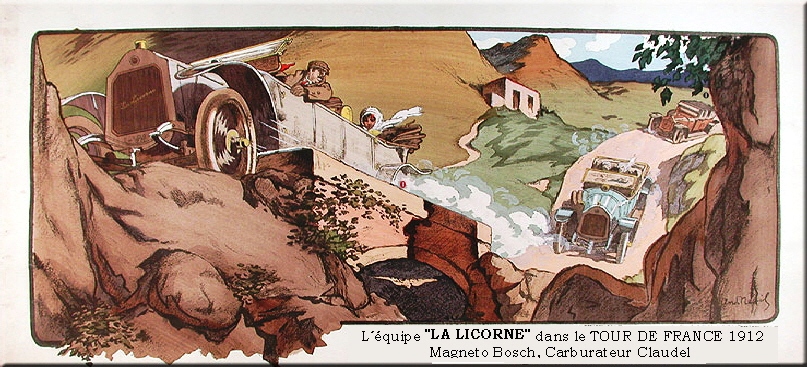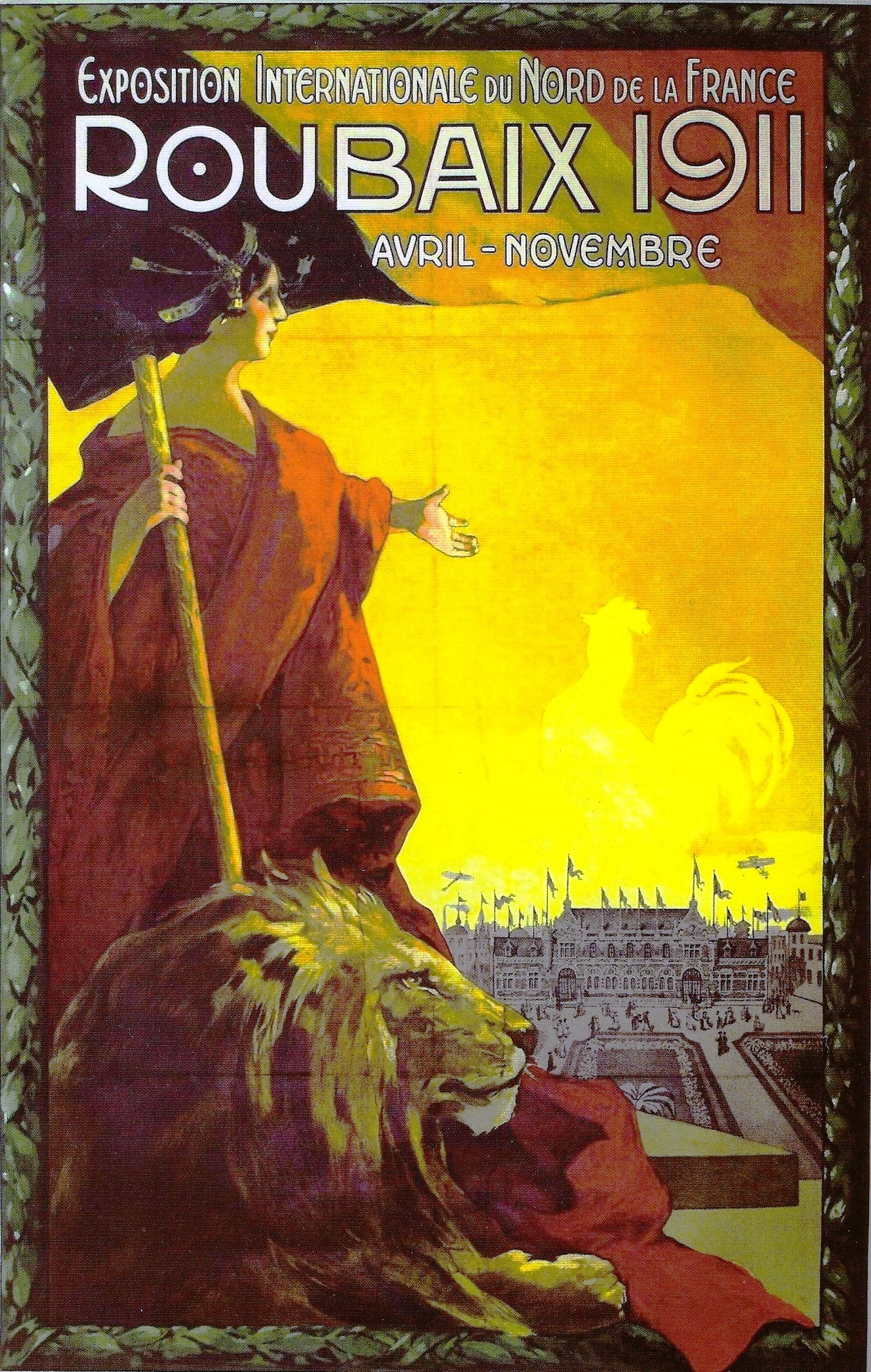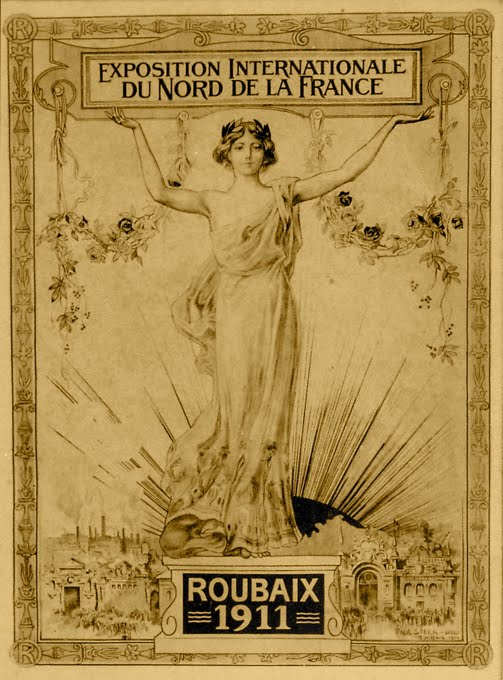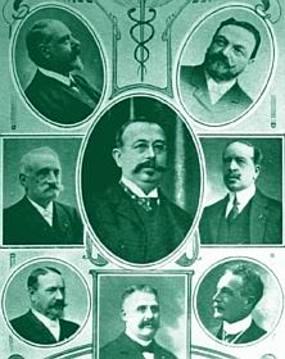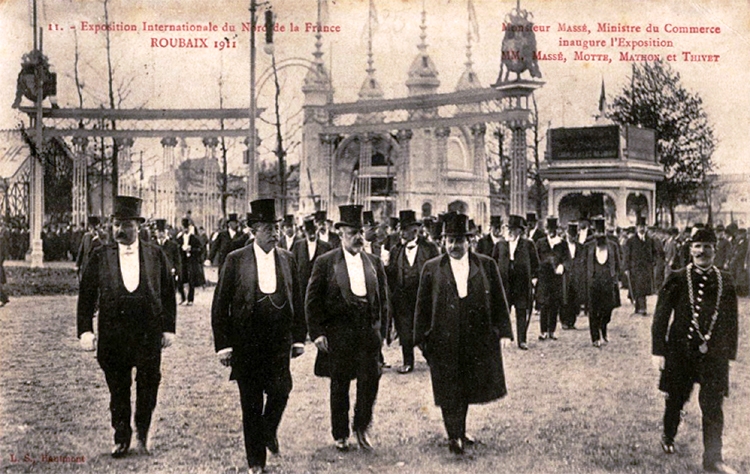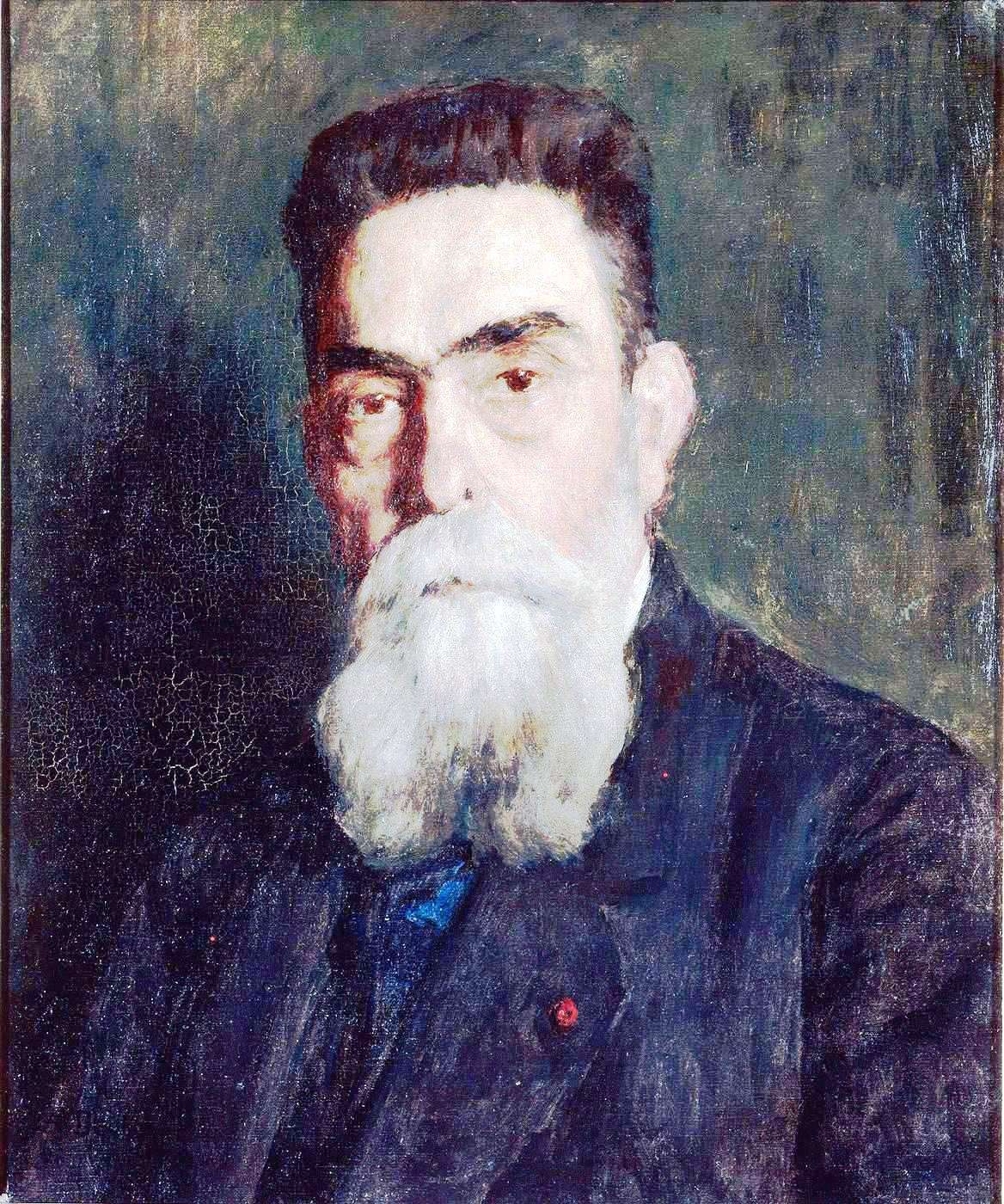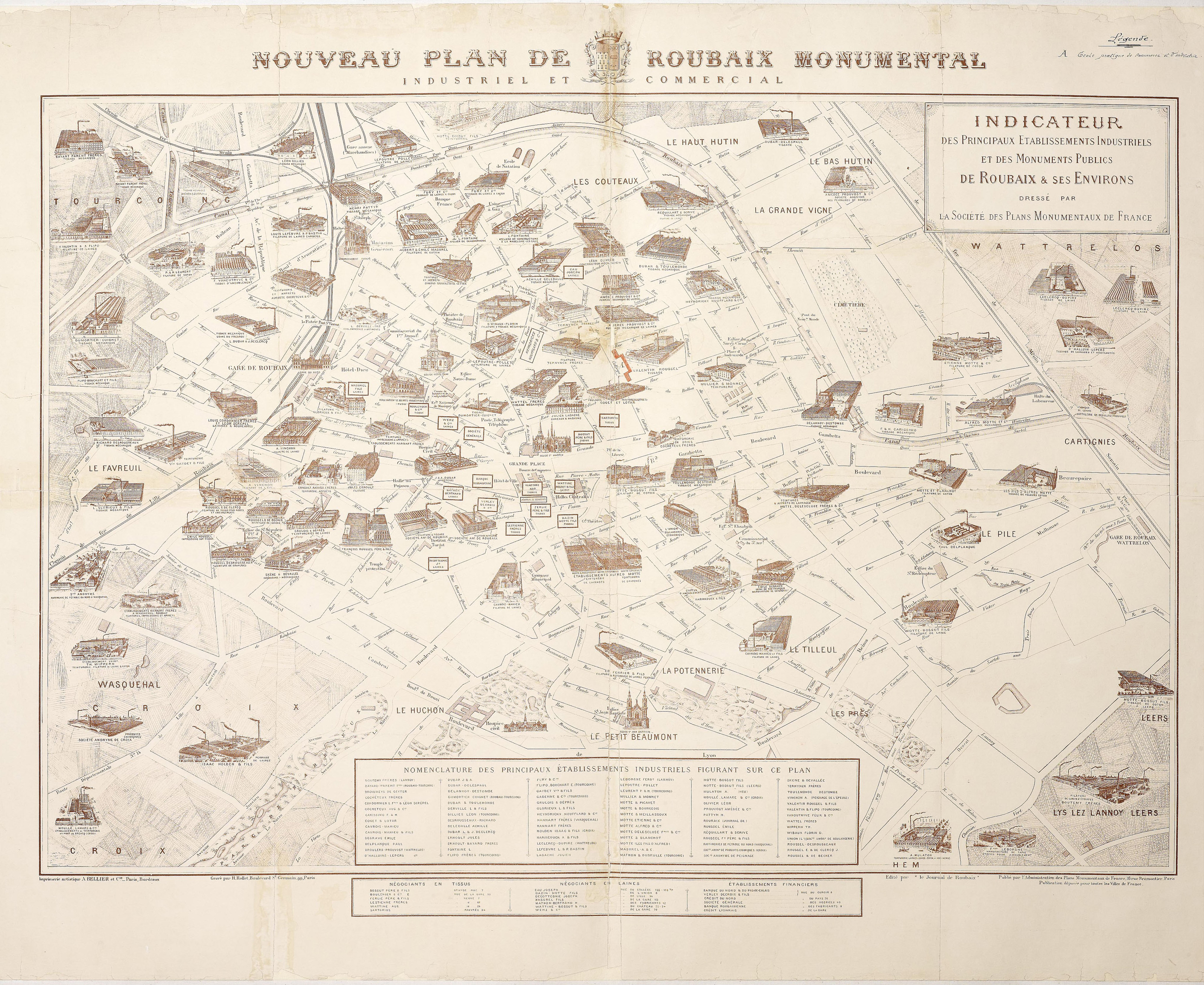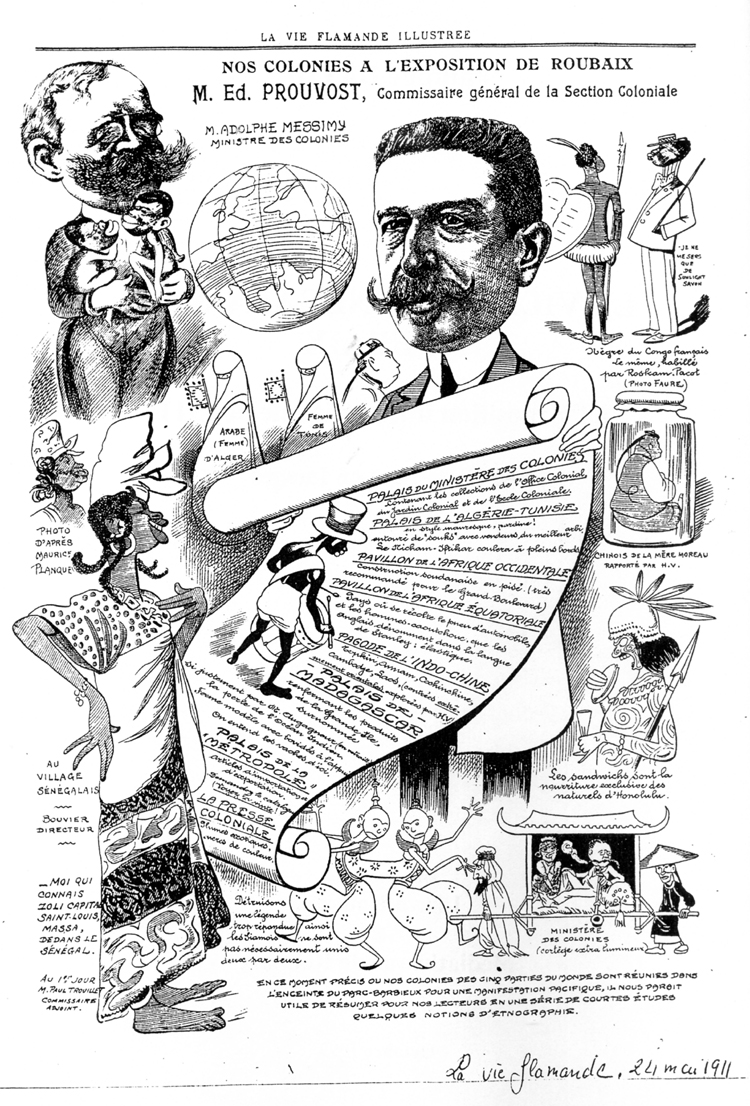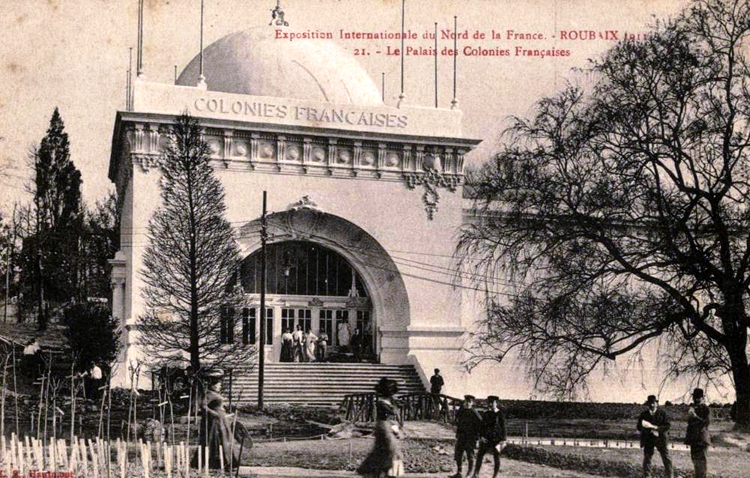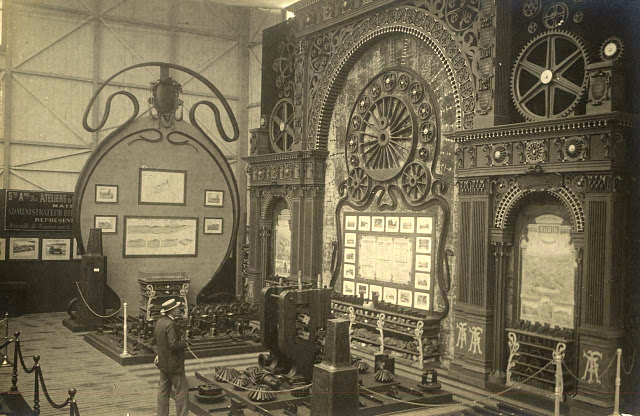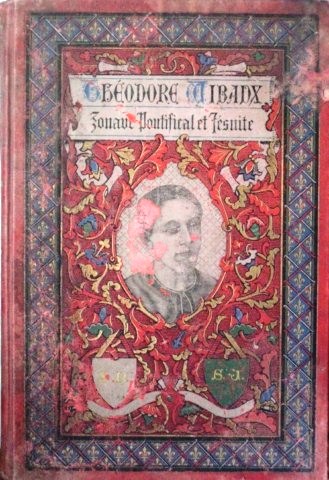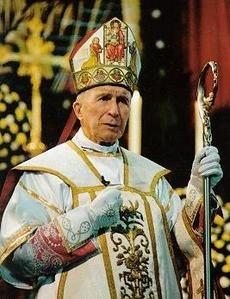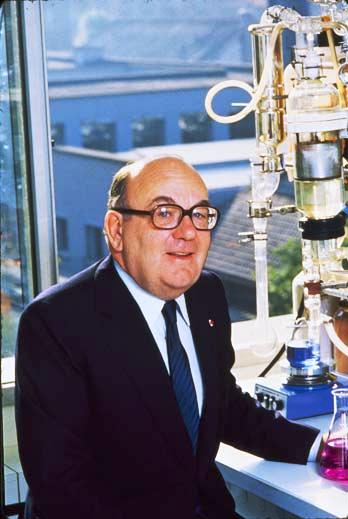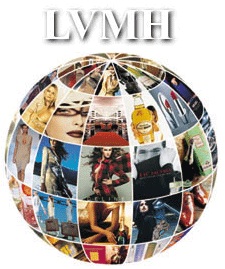Thesaurus agnatique des Prouvost
depuis le XV° siècle
Servir : leur apport au Bien Commun
Chevaliers et Capitaines
 Le thesaurus agnatique est le document le plus important de toute lignée.
Le thesaurus agnatique est le document le plus important de toute lignée.
Parmi les règles pour reconstituer de vraies élites:
On créera ou complétera un THESAURUS ECRIT AGNATIQUE généalogique,
rassemblant
en un même document – site, livre- très
souvent réactualisé et
réédité,
la liste de tous les personnages de la famille portant le nom ayant
servi le
Bien Commun : il constituera les PREUVES de
l’appartenance aux vraies
élites:
On pourra créer un autre THESAURUS VISUEL AGNATIQUE ET COGNATIQUE
sous la forme d'un collage, réunion des figures ayant illustré les deux
familles paternelle et maternelle, le tout autour du blason paternel.
Ces deux
thesaurus équivaudront aux « lettres de noblesse », guidant chaque choix de
vie, notamment matrimonial.
________________
Cette synthèse à travers les siècles est dédiée à
Monseigneur le Prince
Louis de Bourbon, Duc d'Anjou, Aîné des Capétiens, Chef de la Maison
Royale de France.
Pour dessiner chez les Prouvost, la notion de SERVIR,
principe des
élites,
un héritage spirituel :
nous commencerons par ces deux
citations:
Pierre Prouvost dans la généalogie qu'il rédigea en
1748 :
« Voila la
description des descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez
jusques a la fin de cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire
sans vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de
biens, d’honneurs et de bonne réputation en la foi catholique apostolique et
romaine et les plus notables des villages qu’ils ont habitez "
et le littéraire C. Lecigne,
en 1911, publié chez Grasset, au sujet du poète Amédée Prouvost:
" Dès l’âge de cinq
ans, Amédée Prouvost se sentit dépositaire d’une tradition et comme l’héritier
présomptif d’une royale lignée : l apprit un à un le nom de ses
prédécesseurs et que chacun d’eux signifiait depuis quatre siècles et
demi, beaucoup d’honneur, de travail et de foi chrétienne. On ne
voulut pas qu’il puisse méconnaître ce passé et, si, par impossible, il lui
arrivait d’être infidèle, qu’il eût l’excuse de l’ignorance. Un jour le père
prit la plume et, sans orgueil, sans autre prétention que de donner à ses
enfants la conscience intégrale de leurs origines, il écrivit les annales
de sa famille. Avant tout, il songea à celui qui était son premier né,
l’espérance de la dynastie ; il s’adressa à lui :
« Je crois utile, mon
cher fils, dès tes premiers pas dans ta vie d’écolier, de t’initier à ce que
tes maîtres ne pourront t’enseigner avec autant de persuasion que ton père,
j’entends
L’amour de la famille,
Le respect de ses traditions d’honneur,
Un attachement inébranlable aux convictions religieuses de nos pères,
et leur fidélité aux traditions monarchiques.
Je considère comme un devoir De te donner comme modèle cette lignée d’ancêtres."
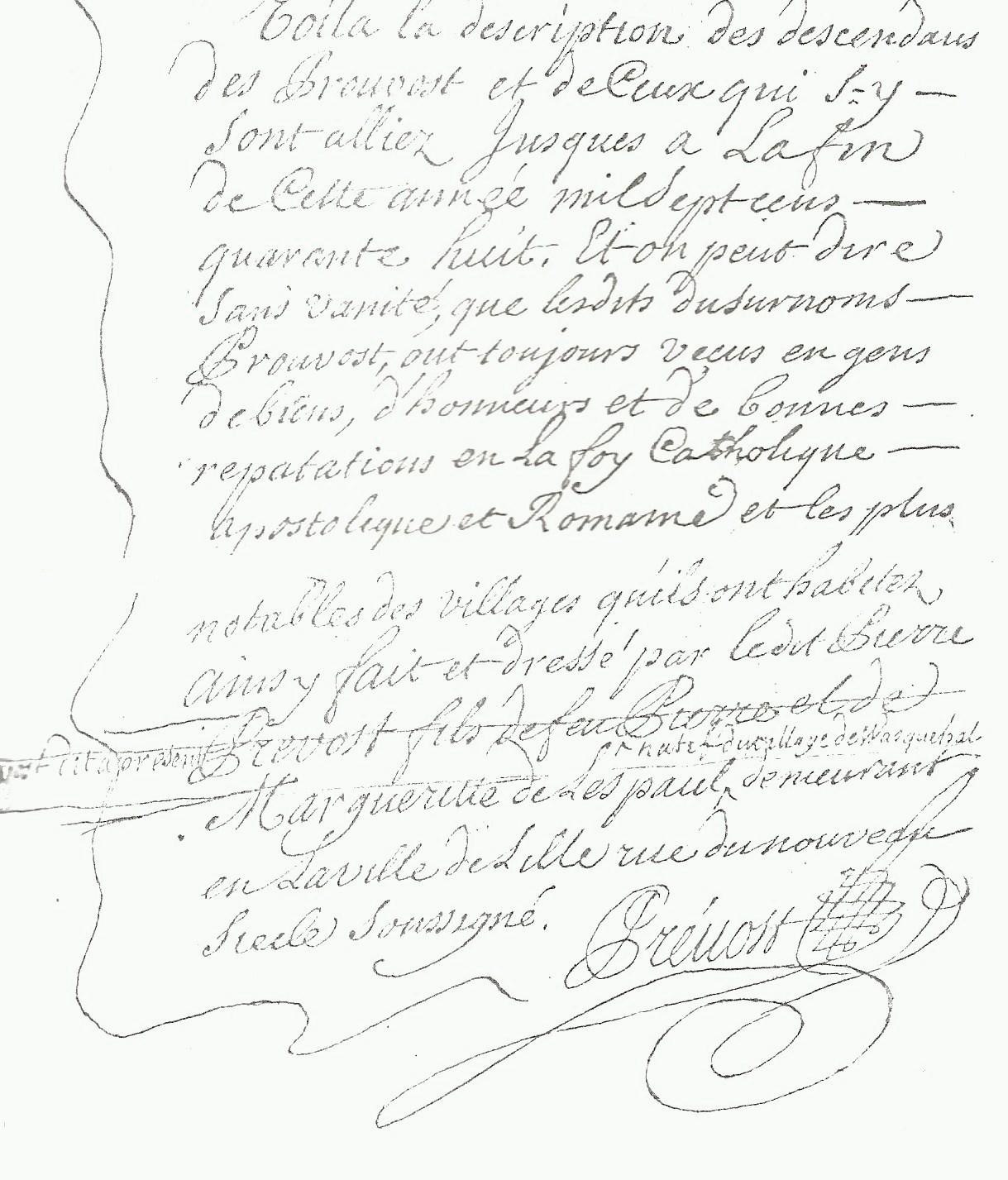
Voici un extrait de la lettre que nous avons envoyé en 2011 à Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, Duc d'Anjou:
«
Suite à un parcours long et atypique consacré à
cette recherche à travers l’art, la
généalogie, la philosophie, l’histoire, la
théologie, le marché de l’art, le marché de
l’immobilier historique à Paris, j’ai
créé, il y a cinq ans, une agence de communication et
d’évènementiel : « Pour vous, les princes
» spécialisée dans la communication et les
évènements oniriques dans les plus beaux lieux
historiques.
Le nom de cette agence est le fruit de mes études de
théologie et de philosophie au sein du Séminaire
traditionnel d’Ecône et il est synthétisé par
la sphère de mon logo : tout être est transcendé
par ses transcendantaux : Un = Vrai = Bien = Beau = Amour = Dieu ; une
fois ces transcendantaux replacés au cœur de chacun
par chacun - en tant que Créature - dans le cadre de son
parcours de vie, alors peuvent s’épanouir les attributs de
l’Être ; pour l’être humain, il s’agit
des qualificatifs de Prince ou de Princesse, au sens spirituel du
terme, c'est-à-dire toutes les qualités qu’on peut
y observer. La sphère représente donc l’Être
dans sa plénitude.
Il est étonnant de constater que ceci est perçu
inconsciemment, que mes premiers évènements me valurent
les plus oniriques photographies dans les plus belles revues et que
chacun entend et interprète le nom de « Pour vous, les
princes », comme il est à l’intérieur de
lui-même.
Mais mon œuvre de communication réside dans mes deux
importants ouvrages sur la famille de mon père, les Prouvost et
alliés, 1000 pages, et sur la famille de ma mère,
les Virnot-Virnot de Lamissart et alliés, 550 pages ;
c’est œuvre d’exhumation, d’inspiration,
de synthèse, et surtout d’ordonnancement ; vous pourrez en
juger en allant vers mes sites : www.thierryprouvost.com et
www.virnot-de-lamissart.com qui rassemble 90% des textes et
illustrations et que 10.000 internautes fréquentent chaque mois;
j’éditerai ces ouvrages comme des livres d’art
luxueux.
Je fais donc l’œuvre que les Monarques n’ont pas fait
depuis deux cents ans, ce qui a laissé les familles orphelines
et sans jardinier, la République ne se considérant pas
compétente quant à l’ordonnancement des
familles, ceci relevant de la tête ; exaspéré par
cette situation, j’ai franchi impétueusement, il y a trois
ans, le 15 août 2008, les terres largement en friche de mes
aïeux et alliés et j’ai commencé, depuis cette
même sphère s’élevant par le Souffle,
à user de ma formation en contemplant et étudiant ; alors
j’ai pu découvrir la beauté du tracé de ces
parcs et de ces demeures patriciennes à la bourguignonne,
à la flamande, à la Française
hérités de mes pères ; j’ai pu
distinguer, sous les mauvaises herbes et les aprioris, la beauté
des chênes tutélaires que sont les grands ancêtres,
ces topiaires qui ne demandaient qu’a retrouver leur
sculpteur, la rectitude des allées de dévouements, de
consécrations, de créations, d’inscription dans la
cité ou le charme des dessins plus artistes de l’Art de
vivre en société; et, alors, mes ancêtres
réapparurent, un à un, me présentèrent
leurs illustrations et donc leurs apports à Dieu et à la
Cité, celles-ci gommant leurs défauts; ils se
rassemblèrent toujours plus nombreux et
commencèrent à collaborer avec moi, m’apportant
leur amour, leur fidélité, leurs œuvres; et chaque
jour, c’est un ou plusieurs trésors ; le 15 août
2009, date du premier anniversaire de mes sites, ils
dévoilèrent leurs merveilleuses et familiales
Manufactures Royales du Dauphin dont j’ai repris la marque :
http://www.manufacturesdudauphin.com; aujourd’hui,
c’est l’inspiration qu’ils m’apportent
pour venir vous parler.
Ma famille a été représentative des deux voies que
représenta la Grande Révolution : la famille de ma
mère était composée, au XVIII° siècle,
de deux frères, très fortunés et influents
à Lille et qui incarnent chacune des deux options : la
transcendance en la personne de Charles-Louis Virnot de Lamissart dont
la descendance appartient encore aujourd’hui, par les femmes,
à l’ancienne (puisque non renouvelée) aristocratie
et le pragmatisme plus commode du XIX° siècle qui
s’ouvrait en la personne d’Urbain-Dominique Virnot dont la
descendance masculine perdure. La famille de mon père restera
très longtemps monarchiste jusqu’à mon père
et moi-même. En voici deux textes qui leur sont consacrés
: celui de Pierre Prouvost dans la généalogie qu'il
rédigea en 1748 : « Voila la description des descendants
des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques a la fin de
cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans
vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu
en gens de biens, d’honneurs et de bonne réputation en la
foi catholique apostolique et romaine et les plus notables des villages
qu’ils ont habitez " et le littéraire C. Lecigne, en 1911,
au sujet du poète Amédée Prouvost: " Dès
l’âge de cinq ans, Amédée Prouvost se sentit
dépositaire d’une tradition et comme
l’héritier présomptif d’une royale
lignée : il apprit un à un le nom de ses
prédécesseurs et que chacun d’eux signifiait depuis
quatre siècles et demi, beaucoup d’honneur, de travail et
de foi chrétienne. On ne voulut pas qu’il puisse
méconnaître ce passé et, si, par impossible, il lui
arrivait d’être infidèle, qu’il eût
l’excuse de l’ignorance. Un jour le père prit la
plume et, sans orgueil, sans autre prétention que de donner
à ses enfants la conscience intégrale de leurs origines,
il écrivit les annales de sa famille. Avant tout, il songea
à celui qui était son premier né,
l’espérance de la dynastie ; il s’adressa à
lui : « Je crois utile, mon cher fils, dès tes premiers
pas dans ta vie d’écolier, de t’initier à ce
que tes maîtres ne pourront t’enseigner avec autant de
persuasion que ton père, j’entends l’amour de la
famille, le respect de ses traditions d’honneur, un attachement
inébranlable aux convictions religieuses de nos pères, et
leur fidélité aux traditions monarchiques. Je
considère comme un devoir de te donner comme modèle
cette lignée d’ancêtres.»
Je ressens la défection de la Monarchie depuis plus de 150 ans
en France tel un orphelin et je regarde la division bicentenaire des
deux branches de la famille royale française comme un Scandale
au sens évangélique du terme : le principe des
élites est de SERVIR, a fortiori le Roi et les princes.
J’ai donc appris depuis 54 ans à me servir par
moi-même pour servir à mon tour : j’organise des
évènements oniriques puisque la République,
malgré ses indispensables qualités, n’a pas le
niveau de transcendance de la Monarchie démunie pour vraiment
enchanter (charme=chant magique) à l’invitation de la Vie,
seule vraie puissance invitante. Le fruit de mes deux ouvrages
familiaux est d’avoir ordonné seul cette centaine de
familles patriciennes des Flandres méridionales, personne ni
aucune institution ne daignant les observer avec une juste
transcendance ; il y a trois ans, on me regardait, en tant que membre
de ces familles, comme un « fabricant de chaussettes » ;
aujourd’hui, je reçois dans les deux demeures ancestrales
restaurées que sont mes sites et j’ai pu regrouper les
caractéristiques uniques de ces familles depuis sept cents
ans au Patrimoine Vivant de la Civilisation, en facilitant aux
hôtes la vue aérienne des illustrations et des
dévouements depuis la sphère.
http://www.thierryprouvost.com/PATRIMOINE%20VIVANT.html
Cet héritage spirituel était de
principe dans ces familles du Nord à travers les générations;
il est ici
illustré deux cents ans après par le parcours de vie d'Auguste Lepoutre et de son épouse
Simone Prouvost,
fille d’Henri Prouvost-Ernoult, ainé de la branche ainée ; ils étaient parents
de 12 fils et d’une fille.
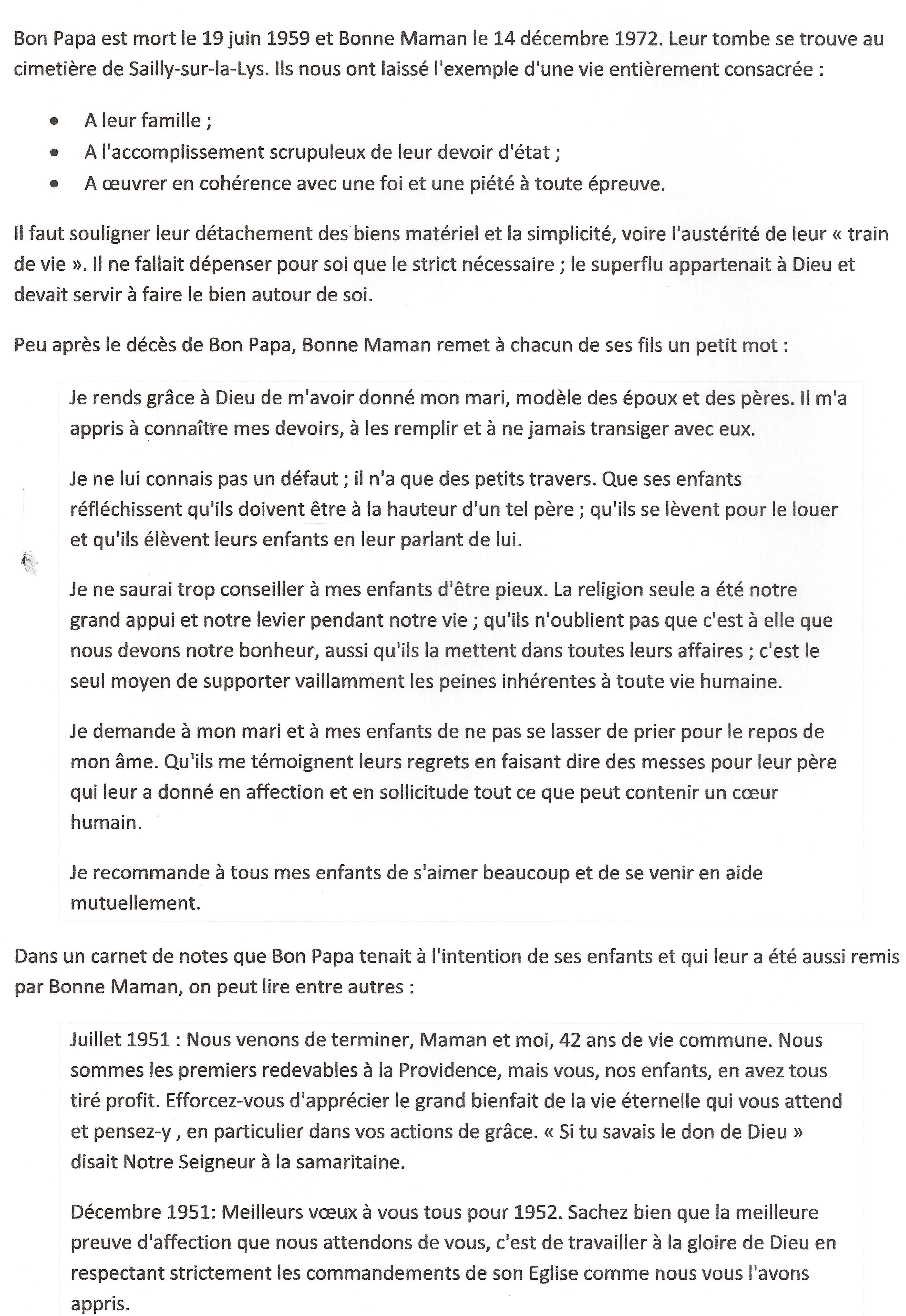
Les Prouvost s’illustrèrent à chaque génération;
on en conserve le témoignage à partir du XVI° siècle
S'ils
descendent d'une lignée de propriétaires aisés
installée à Wasquehal
(Jehan, fils de Willaume, fils de Jehan, fils de Guilbert) et les
environs, suite aux travaux dans les archives d'Alain Watine Ferrant
que nous adoptons,
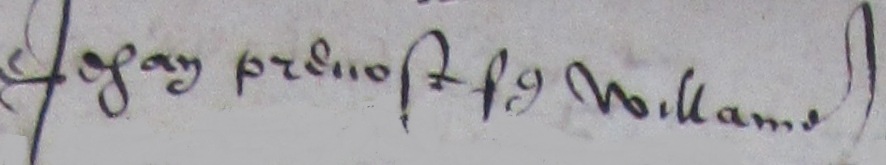
les
Prouvost actuels ont, jusqu'à 2012,
été reliés aux voisins Prouvost des Huchons
du XV° siècle dont
les terres se situaient autour du fief des Huchons et dont ils
descendent cognatiquement, c'est à dire par les femmes ; Jehan Prouvost, échevin de
Roubaix, Seigneur de Wasquehal, était le bras droit de Pierre de Roubaix, proche de
Charles de Bourgogne. Ces familles patriciennes et terriennes des Flandres
étaient au service de leur ville et de
leurs suzerains qu’elles servaient comme un souverain dont
on connait le luxe de la Cour, le talent de ses peintres (Van Eyck).


Pierre de Roubaix et ses
cinq collaborateurs : Le bailly Jean de Langlée,
les échevins Jean de Buisnes et Jehan Prouvost, les lieutenants Jean Fournier
et Guillaume Agache.
Guillaume Prouvost
terrien, fabricant et négociant textile
Il est le grand modèle de
la race
censier
et laboureur d'une surface importante:
" plus de 26 bonniers de bonnes terres et de lieux manoirs situés
sur les villages de Bondues, Marc-en-Baroeul, Roubaix et Tourcoing et de plus de 12.000 florins en capital de
bonnes rentes héritières sur des particuliers solvables; ils étaient encore laboureurs d'une de leur
fermes qui est situé entre le Trieu du Grand Cottignies et la ferme de la Masure audit
Wasquehal" (généalogie par Pierre
Prouvost de 1748).
Il faisait aussi le négoce de la
laine peignée
et des filets de sayette. qu’il faisait peigner, blanchir et
ensuite filer dans
l’Artois où se trouvaient de nombreuses fileuses au rouet
et à la quenouille. Il est le grand modèle de
la race: Il associe ses fils à son
labeur et à ses affaires" Lecigne; " Guillaume Prouvost
fut à la fois laboureur et chef d'industrie." Albert Prouvost
" Depuis Charles
Quint, les mêmes familles dominent la Fabrique Roubaisienne : Pollet, Mulliez,
Prouvost, Van Reust (qui devient Voreux), Leclercq, Roussel, Fleurquin, Florin,
Malfait. Elles assurent la majorité de la production." Hilaire-Trénard: Histoire de Roubaix" :
on reconnaît ici la permanence de ces familles dans l’économie de la France
depuis 500 ans.
Il était l'époux
d'Adrienne Wattel, née en 1580.

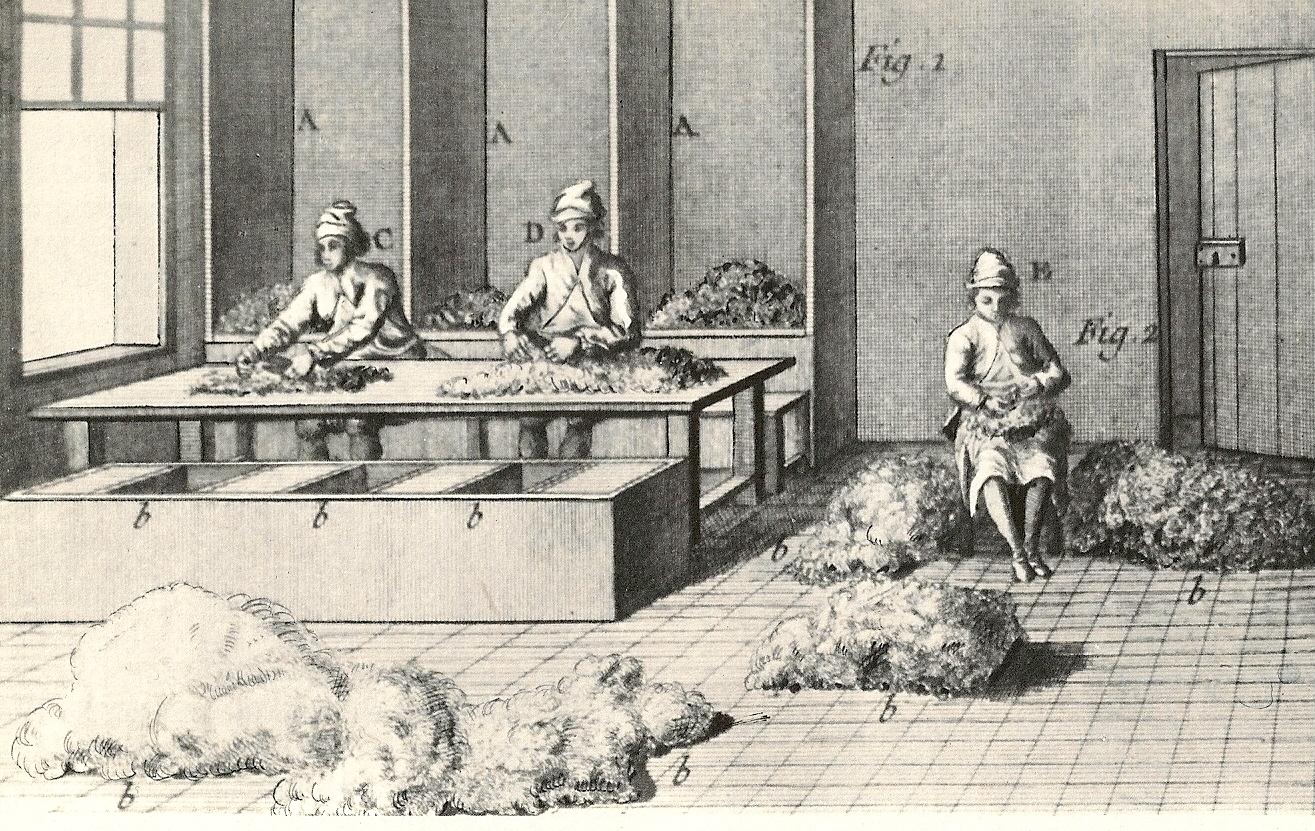
Pierre II Prouvost, de
Wasquehal 1648-
4 mars 1691
fils
de Pierre, et de Péronne Florin, époux de Marguerite de
Lespaul, de Roubaix, fille de Jacques et de Jeanne de Le Dicque, mort
le 7 juin
1681; et inhumé dans l'église de Wasquehal où on
lisait son épitaphe à gauche
de l'autel Saint-Nicolas, légua à ladite église
une somme de 350 livres parisis
pour être converties en rente héritière, à
charge d'an obit à trois psaumes et
trois leçons, etc., avec distribution de camisoles à des
pauvres vieux hommes.
La veuve de Pierre Prouvost, Marguerite de Lespaul, mourut le 27
janvier 1720
et fut aussi inhumée dans l'église de Wasquehal,
près de l'autel Saint-Nicolas
où l'on voyait sa pierre sépulcrale. Elle fonda de
même un obit à perpétuité,
avec distribution de 4 camisoles à 4 vieilles femmes. Sur la
censé occupée en
1748 par la veuve de Martin Franchomme, étaient assignés
15 florins par an pour
celte fondation. Jacques Prouvost, leur fils aîné, fut
également inhumé dans la chapelle Saint-Nicolas, sous une
pierre de marbre. Mais, la plus
importante fondation fut celle du pasteur Jacques Blampain. Par son
testament
des 16 juillet 1707 et 17 novembre 1708, levé le 4 septembre
1711, jour delà
mort dudit pasteur, Me Jacques Blampain demande â être
inhumé dans l'église de
Wasquehal au-dessous du marchepied de l'autel de Notre-Dame. Il ordonne
mille
messes pour le repos de son âme et de celles de ses parents et
amis trépassés.
Il donne à l'église de Wasquehal la table d'autel du
choeur avec la peinture de
Saint-Vincent, les reliquaires d'ébène et
d'écaillé enrichis de cuivre doré et
argenté, les reliquaires de laiton rouge enrichis d'argent et de
cuivre doré et
Généalogie manuscrite, 1748. — De Pierre
Prouvost, arriére petit- fils de
Jean Prouvost et d'Antoinette Le Blan, descend directement la belle
famille
Prouvost de Roubaix, l'une des plus distinguée de cette ville -
où elle compte
de nombreux représentants ; les derniers nés,
arrière-neveux de M. Amédée
Prouvost, constituent la douzième
génération. » Leuridan
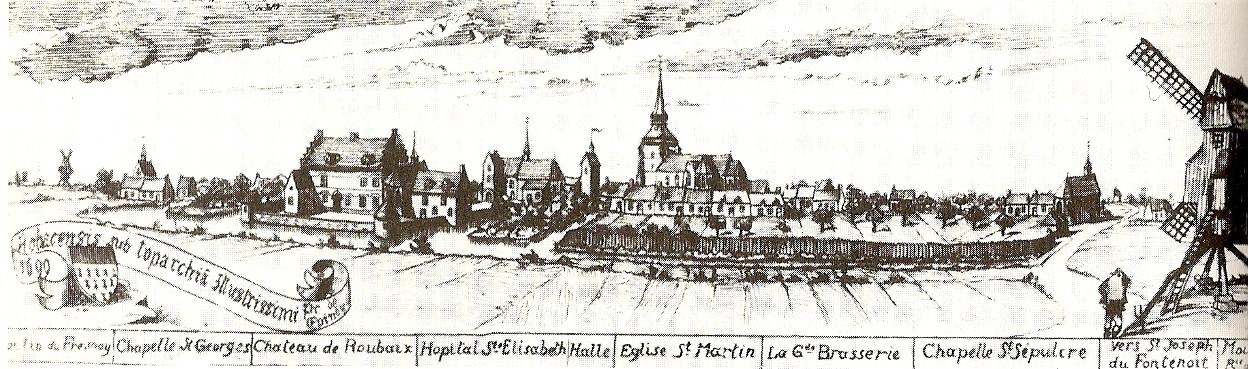
Ils s'installèrent à Lille à la fin du XVII° siècle
après le décés de Pierre II en 1691, le départ de sa veuve, Marguerite de Lespaul, de
Roubaix pour Lille, comme pour les autres membres de la lignée de Lespaul , fut
considéré comme un deuil public; ils firent partie des
familles importantes de Lille devenue française; ils furent inhumés sous le pavement des
principales églises de
Lille avant que soient interdites les inhumations à
l’intérieur des
sanctuaires.

Ce
portrait de la famille Carpentier, importants denteleirs à Lille
au XVII et XVIII° siècle, dont descendent actuellement,
entre autres, les Virnot et les Prouvost-Virnot,
nous semble une bonne représentation du statut des Prouvost au
milieu du XVII° siècle. Il est peint par Jocops,
maître de la guilde d'Anvers, est daté 1602
mais nous semble plutôt daté de 1662, compte tenu de la mode. ( collection Prouvost-Virnot)
Pierre III
Prouvost 1675-1749
auteur, en 1748, de la première généalogie de la famille Prouvost

baptisé le 6
janvier 1675, Wasquehal, Nord, décédé en 1749 (à l'âge de peut-être 74 ans),
auteur, en 1748, de la première généalogie de la famille Prouvost. Marié le 5 octobre 1705, Lille
(Saint-Etienne), Nord, avec Marie-Elisabeth Boutry, décédée le 3 octobre 1706.
Marié le 5 septembre 1712, Lille (Saint-Maurice), Nord, avec Marie Claire
Béatrix Trubert de Boisfontaines , née en 1687, décédée le 23 août 1715, Lille
(Saint Pierre), Nord, inhumée, grande nef de l'Eglise Saint Pierre, Lille, Nord
(à l'âge de 28 ans) après avoir reçu les Saints Sacrements, inhumée dans la
grande nef de l'église Saint Pierre de Lille) , fille de Pierre, receveur
héréditaire des douanes et de Jeanne de Lespaul, après en avoir obtenu dispense
en la cour de Rome. épousa, à Saint Maurice de Lille, le 5 septembre 1712 sa cousine du deux au
troisième degré, Marie Claire (1687-1715 décédée à l'âge de 23 ans neuf mois .
Il rédigea en 1748 la première généalogie de la famille Prouvost: « Voila la
description des descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques
a la fin de cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans
vanité, que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de biens,
d’honneurs et de bonne réputation en la foi catholique apostolique et romaine et
les plus notables des villages qu’ils ont habitez ». "
Les Prouvost et les Manufactures Royales de Lille
crées sous la
protection de Charles Alexandre de Calonne, 1734-1802,
intendant de Flandre et Artois à Lille (1778) ,
ministre et Contrôleur général
des finances de Louis XVI
entre 1783 et 1787,
et du Dauphin, fils de Louis XVI.


Catherine Françoise Prouvost, épouse de François Joseph Durot; le dauphin couronné.
Pierre IV Constantin Prouvost
(1747-1808)
échevin
de Roubaix sous l'Ancien Régime
puis maire de
Roubaix le 13 août 1795, après avoir échappé
à la guillotine par la grâce de la
"Réaction Thermidorienne"
"Maître de
Manufacture" en 1777,
il devint l'un des principaux fabricants
roubaisiens
fondateur de la
fortune industrielle des Prouvost
Homme généreux et probe

Ce tableau de Garemijn nous semble une parfaite illustration
de la vie familiale et du statut des Prouvost dans la deuxième partie du XVIII° siècle à Roubaix.
épouse Marie Henriette des
Tombes, 12° du nom, échevin de Roubaix de 1740
à 1751
comme ses oncles Charles et Jean et soeur de Louis-Joseph des Tombes,
échevin de 1783 à 1790 ; Reçu "Maître de
Manufacture" en 1777, il devint l'un des principaux fabricants
roubaisiens et, avant la Révolution, figurait en
tête des habitants les
plus imposés de la paroisse. A l'époque, Panckoucke
écrit dans son Petit
Dictionnaire Historique et Géographique de la châtellenie
de Lille : « Beaucoup
de villes ne valent pas le bourg de Roubaix tant dans la beauté
des maisons
du lieu que dans le nombre de ses habitants ».
Le 22 vendémiaire an IV, avec le conseil
municipal, il leva, comme maire, le séquestre apposé sur la caisse du
précepteur pour employer les fonds comme secours aux pauvres. Durant
la tourmente il songea à émigrer mais ne put s'y résigner et il se cacha dans
une de ses propriétés, une des dernières qui lui restait. Apres le 9
thermidor, on le retrouve maire de Roubaix. "Homme généreux et probe, il
avait proposé à sa commune trois actions principales. D'abord, venir en
aide aux pauvres. Ensuite, protéger les cultivateurs dont les charrois
réquisitionnés les forçaient à négliger les champs. Enfin, défendre
l'hygiène de Roubaix dont les citoyens laissaient devant les domiciles des amas
de boue et d'immondices ».
Le souci des autres pour faire leur bonheur, déjà." Albert Prouvost
Toujours plus loin ; " On peut le considérer comme le fondateur de la
fortune industrielle des Prouvost ". Le frère de sa mère était
Pierre Constantin Florin, Député suppléant aux Etats généraux de
Versailles et premier maire de Roubaix.
Henri Prouvost
Maire adjoint de Roubaix, de 1821 à 1826,
Membre du Conseil de fabrique de Saint Martin à Roubaix de 1826 à 1847,
Administrateur des hospices de 1817 à 1822 ,
Maître de manufacture.
né le 19 novembre 1783, Roubaix (Nord), baptisé le 20
novembre 1783, décédé le 20 août 1850,
Roubaix (Nord) (à l'âge de 66 ans),
.Marié le 1er août 1809, Roubaix (Nord), avec
Liévine Defrenne, née le 25 novembre 1791, Roubaix
(Nord), décédée le 4 novembre 1824, Roubaix (Nord)
(à l'âge de 32 ans). (sa soeur épousa
Gaspard-Aimé Charvet, Membre de la chambre de Commerce et
conseiller municipal de Lille)
dont Rose, religieuse du Saint Sacrement, Louis-Camille, supérieur des Rédemptoristes, Gaspard-Justine, doyen de Valenciennes.


Ces tableaux de Louis-Leopold Boilly, 1803 et 1807, peintre de la région, nous semble représenter avec justesse
la famille Prouvost à cette époque.
Bon Ami Prouvost, né le 27 mars 1785, Roubaix (Nord),
baptisé le 28 mars 1785, décédé le 8 mai
1827, Roubaix (Nord) (à l'âge de 42 ans),
négociant, administrateur des Hospices
(parrain: Philippe Constantin Prouvost 1743-1785/ ). Marié le 6
décembre 1813, Roubaix (Nord), avec Camille Defrenne, née
le 21 janvier 1793, Roubaix (Nord), baptisée le 22 janvier 1793,
Roubaix (Nord).
Pierre Constantin Prouvost (1747-1808), officier de la Garde Nationale dt François Henri Prouvost, avocat Cour de Bruxelles épx de Julia d'Elhougne dt Marie ép d'Edmond d'Heilly et
Georges Jules Prouvost, avocat, conseiller à la cour d'appel d'Amiens, lieutenant des Gardes Nationaux époux de Marie Lucie de Mailly.
Portrait d'un officier de la Garde Nationale
Voici les domaines où la famille Prouvost a servi:
1 La fidélité à l’Eglise Catholique
2 La défense de la France et de sa
Civilisation
3 La constance du service rendu à la société
4 Décorations
5 L'amour de la famille, souvent nombreuse
6 Les Beaux-arts et les lettres:
7 L'industrie et l'économie
8 Vision et génie international
partagés des "familles du Nord"
1 La fidélité à et par l' Eglise Catholique
Ce qui frappe
dans l’étude de la famille Prouvost et des autres grandes familles du Nord,
c’est l’influence, le rayonnement exclusif de l’Eglise Catholique à travers les
sièces, depuis le duché de Bourgogne puis l’absolue Contre-Réforme des
Habsbourg enfin la très Catholique Monarchie française depuis le Roi Louis XIV,
enfin le maintien de la Tradition malgré la succession des divers régimes
politiques et philosophies jusqu’à nos jours. L’athéisme fut inconcevable, le
protestantisme eut peu d’influence, la Franc-Maçonnerie eut quelque rare
influence et son caractère occulte la fit considérer comme « l’œuvre du
diable ».
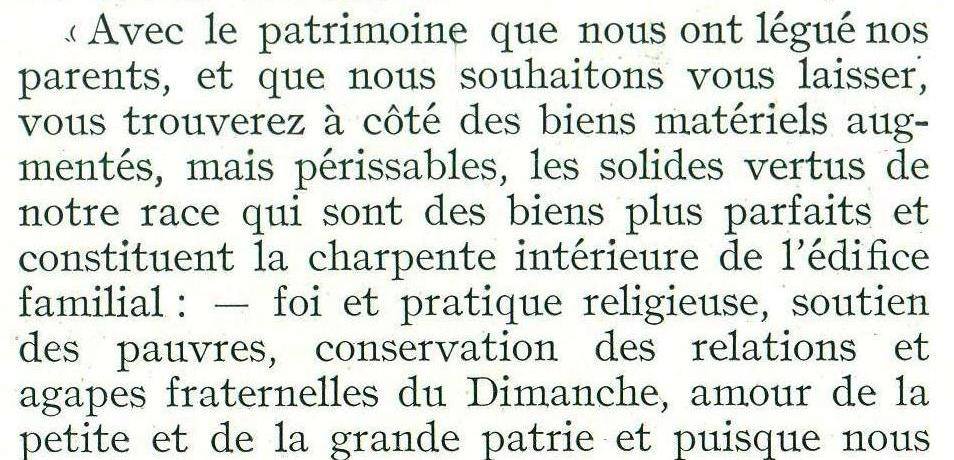
"
L’œuvre de la France, elle remplit toutes les pages de l’histoire humaine, elle
est connue de l’univers entier et ce n’est pas
Dieu qui l’oubliera, lui a qui tout est présent.
Le
zèle déployé par cette noble race pour la cause et pour le nom de Dieu,
l’esprit de sacrifice et d’abnégation, le dévouement et l’enthousiasme qu’elle
a mis au service de Jésus-Christ et de son évangile, voilà des titres qui subsistent, des mérites
qui ne s’effaceront jamais. D’autant
qu’ils n’appartiennent pas uniquement au passé. » Monseigneur Pie.
Le
peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonds baptismaux de Reims, se
repentira et retournera à sa première vocation. Un jour viendra(…) où la
France, comme Saül sur le chemin de damas, sera enveloppé d’une lumière
céleste… Tremblante et étonnée, elle dira : »Seigneur, que voulez vous que je
fasse ? » et lui : « Lève toi, lave les souillures qui t’ont défigurées,réveille
dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va,
fille ainée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, va porter, comme
par le passé, mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la Terre »
Saint Pie X : allocution consistoriale de 20 novembre 1911.
L’homme
médiocre est juste milieu sans le savoir. Il l’est par nature, et non par
opinion ; par caractère et non par accident. Qu’il soit violent, emporté,
extrême, qu’il s’éloigne
autant
que possible des opinions du juste milieu, il sera médiocre. Il y aura de la
médiocrité dans sa violence… Il admet quelquefois un principe mais si vous
arrivez aux
conséquences de ce principe, mais si vous arrivez aux conséquences de ce
principe, il vous dira que vous exagérez…. L’homme vraiment médiocre admire un
peu toutes choses,il
n’admire rien avec chaleur. Si vous lui présentez ses
propres pensées, ses
propres sentiments rendus avec un certain enthousiasme, il sera
mécontent.
Il répètera que vous exagérez. Il aimera
mieux ses ennemis s’ils sont froids que ses amis s’ils sont
chauds. Ce qu’il
déteste, par-dessus tout, c’est la chaleur. L’homme
médiocre dit qu’il y a du
bon et du mauvais dans toutes choses, qu’il ne faut pas
être absolu dans ses
jugements etc. etc. Si vous affirmez fortement la vérité,
l’homme médiocre dira
que vous avez trop confiance en vous-même… L’homme
médiocre dira que vous avez
trop confiance en vous-même… L’homme intelligent
lève la tête pour admirer et
pour adorer ; l’homme médiocre le lève pour se
moquer : tout ce qui est au
dessus lui parait ridicule, l’infini lui parait
néant… L’homme médiocre est le
plus froid et le plus féroce ennemi de l’homme de
génie… L’homme de génie
compte sur l’enthousiasme ; il demande qu’on
s’abandonne. L’homme médiocre ne
s’abandonne jamais. Il
est sans enthousiasme et sans pitié : ces deux choses sont
toujours ensemble…
L’homme médiocre est beaucoup plus méchant
qu’il ne le croit et qu’on ne le croit, parce que sa
froideur voile
sa méchanceté… Au fond, il voudrait
anéantir les races supérieurs : il se venge
de ne le pouvoir pas en les taquinant… L’homme
médiocre ne lutte pas : il peut
réussir d’abord, il échoue toujours ensuite.
L’homme supérieur lutte d’abord et
réussit ensuite. L’homme médiocre réussit
parce qu’il subit le courant ;
l’homme supérieur triomphe parce qu’il va contre le
courant." Ernest HELLO
Les Prouvost consacrés à Dieu:
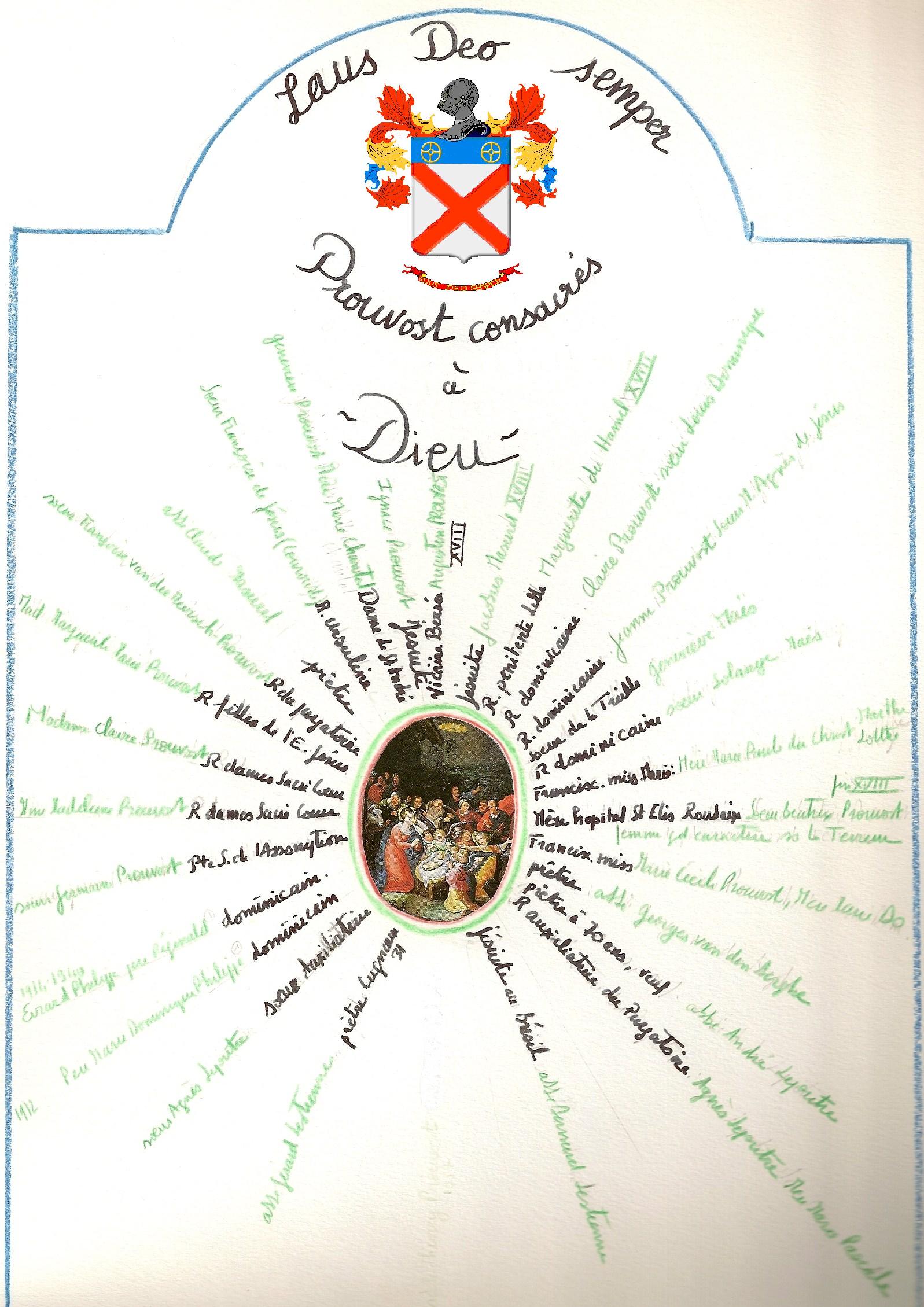
Jacques Masurel-de Courcelles
petit fils d'Antoinette Prouvost (1600-1670), prêtre jésuite.
Philippe Constantin Prouvost
né le 2 août 1743, Roubaix, Nord,
décédé après 1785, Mouscron, Hainaut, Belgique, prêtre, vicaire de Sainte
Catherine à Lille, curé de Mouscron (filleul: Bon Ami Prouvost 1785-1827). 1787. — Église de Mouscron ; près
du portail de droite. Au cimetière de cette église, au devant du crucifix
repose le corps de Mtre Philippe-Constantin PROUVOST, natif de Roubaix, fils du
sieur Pierre et de dame Marie-Jeanne DELEBECQUE, qui, ayant été curé de cette
paroisse de Mouscron l'espace de trois ans et un mois, est décédé le premier
novembre 1787, &gé de quarante quatro ans. Priez Dieu pour son àme.

Marguerite du Hamel-Prouvost
décédée
après 1710, religieuse au Couvent des Pénitentes installé à Lille en 1620.
Augustin
Prouvost
né le 29 décembre 1742, Roubaix, baptisé le 30 décembre 1742,
Roubaix, prêtre. ( parrain Augustin Florin,
marraine Marie-Anne-Thérèsevan den Berghe), vicaire de
Bersée le 28 août 1774,
curé d’Hertaing le 23 août 1785, y
décédé le 24 novembre 1790 et inhumé avec
l’épitaphe :
« D.O.M.
Dans le cimetière, derrière le chœur
de cette église, repose le corps de maître Augustin
Prouvost, natif de Roubaix,
qui, après avoir dirigé cette paroisse en
zélé et charitable pasteur pendant cinq
ans, est décédé le 24 novembre 1790, agé de
48 ans, laissant à la charge de l’église
pendant 50 ans, et ce pour le pavé en marbre du chœur
qu’il y fit poser, un
obit annuel dont la rétribution est de 45 patars au
clergé et de 6 francs aux
pauvres assistants. Requiescant in pace »
Béatrix Prouvost
née le 6 février 1728, fut
chanoinesse de Saint Augustin,
Prieure de l'hôpital Saint Elisabeth de Roubaix
qu'avait fondé en 1500 Isabeau de Roubaix, en 1764 et s'illustra lors de la
Révolution:
née le 6 février 1728, fut chanoinesse de Saint Augustin, prieure
de l'hopital Elisabeth de Roubaix qu'avait fondé en 1500 Isabeau de
Roubaix, en 1764 et s'illustra lors de la Révolution: Toute jeune, au mois de
janvier 1749, elle é tait rentrée au couvent de saint-Elisabeth de
Roubaix. Elle était prieure de son monastère lorsqu’éclata la
Révolution. Le 2 novembre 1792, des commissaires envoyés par le district
de Lille envahissent la maison et signifient aux religieuses qu’elles ont
à se disperser dans les vingt quatre heures. Sœur Béatrix avait alors 65
ans ; elle sortit très calme, sans une plainte. Elle était à peine
dans la rue qu’on la fit arrêter et écrouer dans la prison de Lille. On
l’accusait d’avoir caché une brique d’or et fabriqué je ne sais quelles boites
de plomb. La foule souveraine a besoin de colossales idioties ; on la
servait à souhait. Sœur Béatrix ne se troubla point ; elle comparut
devant le comité révolutionnaire et repoussa du pied l’absurde accusation. Elle
écrivit une lettre d’ironie sereine qui se terminait par ces
mots : « forte de mon innocence, je ne crains pas de demander
au comité la prompte décision de mon affaire et de ma mise en
liberté. » A l’heure où les femmes les plus héroïques ne savaient que
bien mourir, sœur Béatrix eut le courage de se défendre. Après une longue
captivité, elle sortit de la tourmente saine et sauve mais triste à
jamais. On la revit dans la famille, portant le deuil de son couvent
détruit et de sa mission interrompue. Elle s’en alla doucement mais elle
ne mourut pas toute entière. Son visage resta populaire au foyer des
pauvres et au chevet des malades. Sœur Béatrix ressuscitera un jour sous
le pinceau d’Amédée Prouvost:c'est bien sa figure qui rayonne dans le "Poème
du travail et du rêve": Dans le halo neigeux et frais de son rabat,Son
visage très pur que la coiffe angélise Se penche, souriant, comme un lys sous
la brise, Vers le moribond blême et las qui se débat.Près de la couche où
lentement il agonise,Durant ces nuits sans fin où la fatigue abat,Elle veille,
égrenant son rosaire tout bas,Avec une ferveur suppliante d'église.Sa robe est
vénérée au faubourg populeux Comme un habit de sainte à l'or miraculeux. De ses
lèvres les mots ainsi que des prières Viennent au cœur du pauvre apaiser
la douleur,Et ses pieuses mains douces comme des fleurs Se posent sur les
fronts pour fermer les paupières. Le nom de Béatrix n'était pour Dante qu'un
symbole de divine poésie; il sera plus et mieux pour Amédée Prouvost. Il
le recueillera pieusement comme le synonyme des plus pures gloires de sa maison
et il le mettra sur le berceau de sa petite fille." "Amédée
Prouvost" par C. Lecigne, éditions Bernard Grasset, 1911
Sœur
Béatrix ressuscitera un jour sous le pinceau d’Amédée Prouvost: c'est bien sa
figure qui rayonne dans le "Poème du travail et du rève":
« Dans le halo neigeux et frais de son rabat, Son visage très pur que la
coiffe angélise Se penche, souriant, comme un lys sous la brise, Vers le
moribond blème et las qui se débat. Près de la couche où lentement il agonise,
Durant ces nuits sans fin où la fatigue abat, Elle veille, égrenant son rosaire
tout bas, Avec une ferveur suppliante d'église. Sa robe est vénérée au faubourg
populeux Comme un habit de sainte à l'or miraculeux. De ses lèvres les mots
ainsi que des prières Viennent au coeur du pauvre apaiser la douleur, Et ses
pieuses mains douces comme des fleurs Se posent sur les fronts pour fermer les
paupières.»
Alix Le Clerc, née le 2 février 1576 à Remiremont et morte le 9
janvier 1622 à Nancy, religieuse lorraine, Mère Thérèse
de Jésus. Éducatrice, créatrice d'écoles, fondatrice de l''ordre religieux
d'enseignantes,
les chanoinesses de Saint-Augustin de la Congrégation Notre-Dame. Elle est béatifiée en 1947 par
Pie XII.


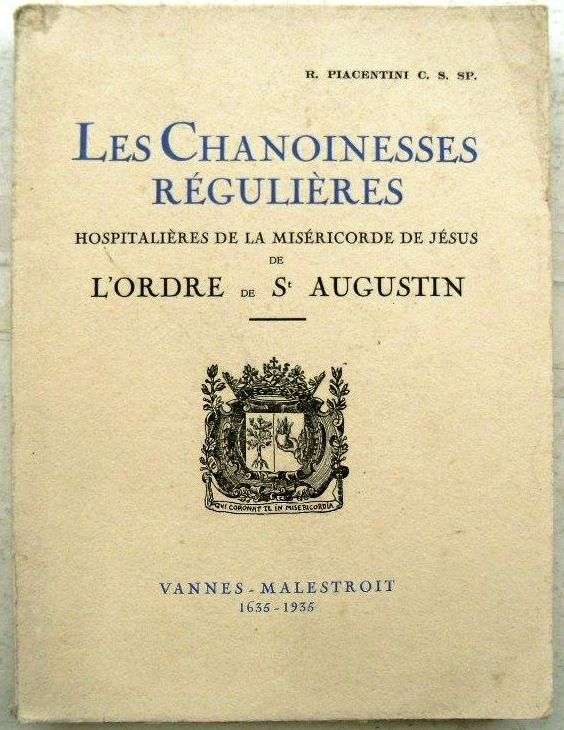
"A
Roubaix, il n'y eut pas une seule défection parmi les soeurs
Augustines chargées de desservir l'Hôpital
Sainte-Elisabeth fondé en 1488 par
Isabeau de Roubaix, veuve de Jacques de Luxembourg. Par un
mémoire adressé, le
14 avril 1790, à l'Assemblée Nationale, la
municipalité de cette ville,
demandait, au nom de l'humanité, la conservation de leur
couvent. Grâce sans
doute à cette sollicitude de l'administration, les religieuses
purent se
maintenir, dans la ville, près de trois années encore,
traversées néanmoins par
toutes sortes de troubles, visites, enquêtes, inventaires. Il y
eut même, à
certaine' époque, des menaces assez graves contre les soeurs,
parce qu'elles
recevaient des prêtres n'ayant pas prêté le serment.
Enfin des commissaires, envoyés
par le Directoire du District de Lille, vinrent, le 2 novembre 1792,
signifier
aux soeurs l'ordre d'évacuer la maison dans les vingt-quatre
heures. Qui
peindra, s'écrie l'historien de Roubaix, la douleur des
vingt-huit religieuses
expulsées sans pitié de leur cloître où,
calmes et détachées du siècle, elles
goûtaient les ineffables charmes d'une vie
d'austérités, de prière et de
dévouement ? Violemment arrachées des lieux où
reposaient leur bienfaitrice et
leurs compagnes qui, plus heureuses, les avaient devancées dans
un monde
meilleur et éternel; ravies aux pauvres chartrières que
leur angélique charité
entourait des plus tendres soins, on les refoulait au sein d'une
société que
les passions agitaient, où elles devaient trouver à peine
un toit pour
s'abriter ! Douze de ces religieuses ne quittèrent pas Roubaix
et, pour se
conformer à l'arrêté du département du Nord,
du 11 décembre 1791, déclarèrent à
la municipalité leur intention était de faire leur
résidence en cette ville. La
vénérable prieure, dame Béatrix Prouvost, fut
arrêtée et incarcérée, mais elle
sut se défendre énergiquement et victorieusement contre
les ineptes accusations
auxquelles elle fut en butte. Après le Concordat, six des
pauvres soeurs de
Sainte- Elisabeth, vénérables débris de la plus
florissante communauté,
regagnèrent leur couvent, appelées par l'administration
municipale à s'y vouer
à l'instruction de la jeunesse; mais,
affaiblies par l'âge, les misères et les privations de l'exil, elles durent
bientôt renoncer à ce pénible travail et vécurent tristement de la modeste
pension que leur faisait le Gouvernement. Une autre vivait encore à
Valenciennes, en 1836, presque aveugle et sans ressources ; le conseil
municipal de Roubaix lui accorda un secours annuel de 150 francs. Les Soeurs de
Notre-Dame-des-Anges de Tourcoing ayant également refusé de trahir leurs voeux,
furent forcées de quitter leur monastère le 4 novembre 1792. Leurs biens
eussent été vendus, comme ceux de la plupart des maisons religieuses, si la
municipalité ne s'en fût emparée au profit de l'hôpital, en vertu d'une loi
portée dans ces temps de détresse. Ces biens furent depuis lors réunis à la
fondation primitive et administrés en faveur des vieilles femmes par une
commission que nomma le Gouvernement. Lorsque la persécution cessa, les
autorités de la ville écrivirent à chacune des soeurs pour les prier de revenir
dans leur maison et de reprendre la mission de charité qu'elles avaient été obligées
d'interrompre. Théodore Leuridan, Histoire de Roubaix, 1.1, p. 304; t. Il, p. 371 à
277.
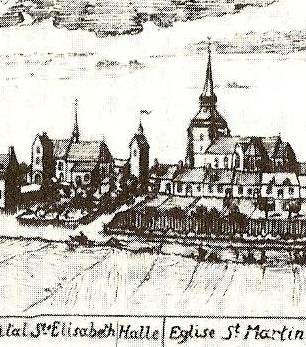
Rose Prouvost
religieuse du Saint Sacrement,
Louis-Camille
Prouvost
supérieur des Rédemptoristes, ordre fondé en 1732 par Saint Alphonse de Liguori ( 1696-1787).
Bonami-Louis-Romain-Joseph
Prouvost
né le 6 janvier 1817, prètre en 1847, vicaire à Faches la même année,
curé de Thumesnil en 1853, entra en 1859 chez les Rédemptoristes, mourut le 16
mai 1894 comme supérieur de la Maison de Montauban (51).

Rue Carnot
«
Dès le XVIIIème siècle, la population de Thumesnil
demande la construction d’une église dans le hameau, celle
de Faches étant
assez éloignée. Dans les années 1840,
l’abbé Prouvost, vicaire à Faches, œuvre
à la fondation d’une église dans le hameau de
Thumesnil, désormais peuplé de
1711 habitants. En décembre 1850, l’église, qui a
le statut de chapelle, est
inaugurée, et en 1851, la préfecture décide
d’ériger Thumesnil en paroisse.
L’église néo-gothique est la première
église française dédiée au
Sacré-Cœur de
Jésus-Christ, dont le culte est encouragé par le pape Pie
IX. En 1898, une
travée est ajoutée au bâtiment. La population ayant
considérablement augmenté.
Lors des inventaires de 1906, la population de Thumesnil s’oppose
à l’entrée
des représentants de l’Etat dans
l’église ». © Association Culturelle et
Historique de Faches-Thumesnil.
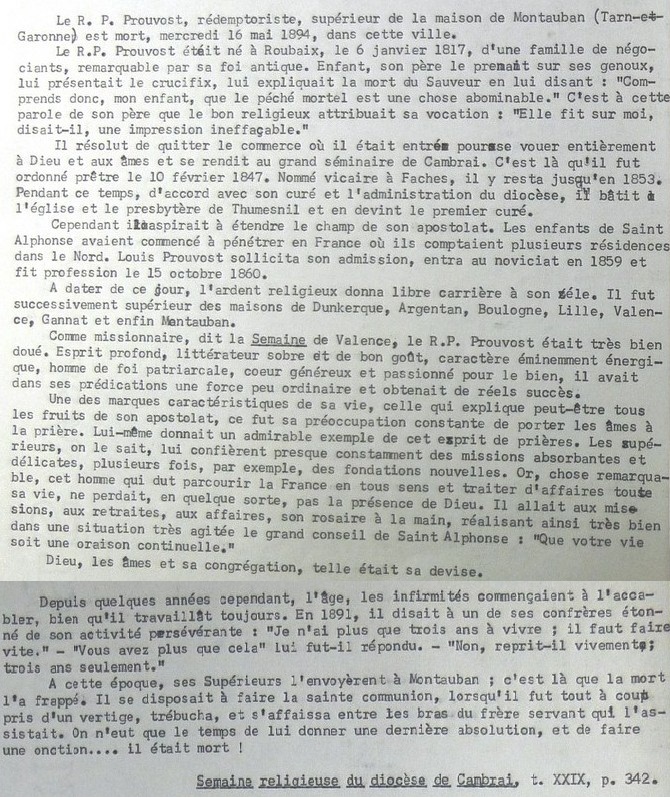
Son frère, Gaspard-Justine
Prouvost
doyen de Valenciennes (Un doyen est également le prêtre coordinateur
d'un doyenné, c'est-à-dire d'un ensemble de plusieurs paroisses).
Leur sœur Rose-Marie, née le
3 janvier 1824, fut Religieuse du Saint Sacrement.
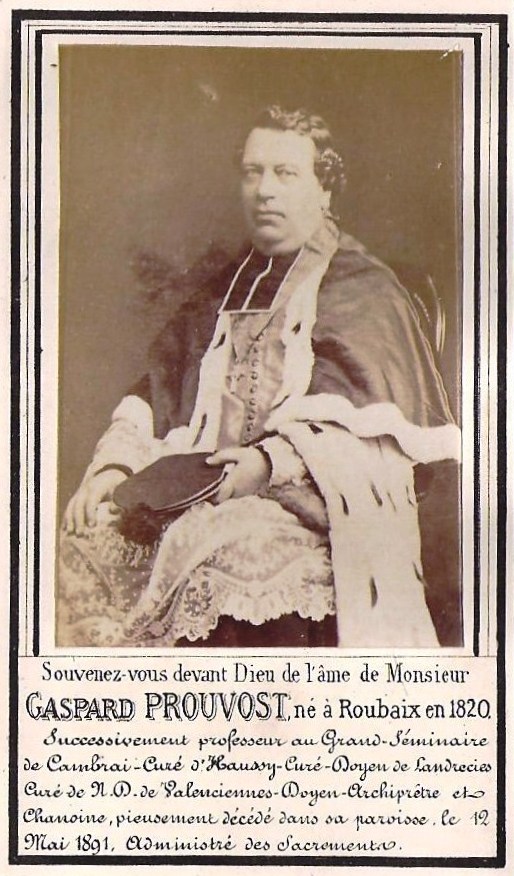

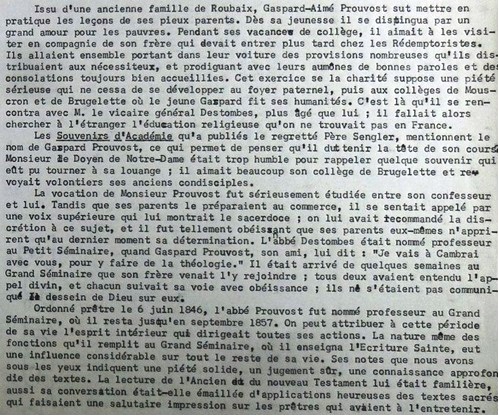
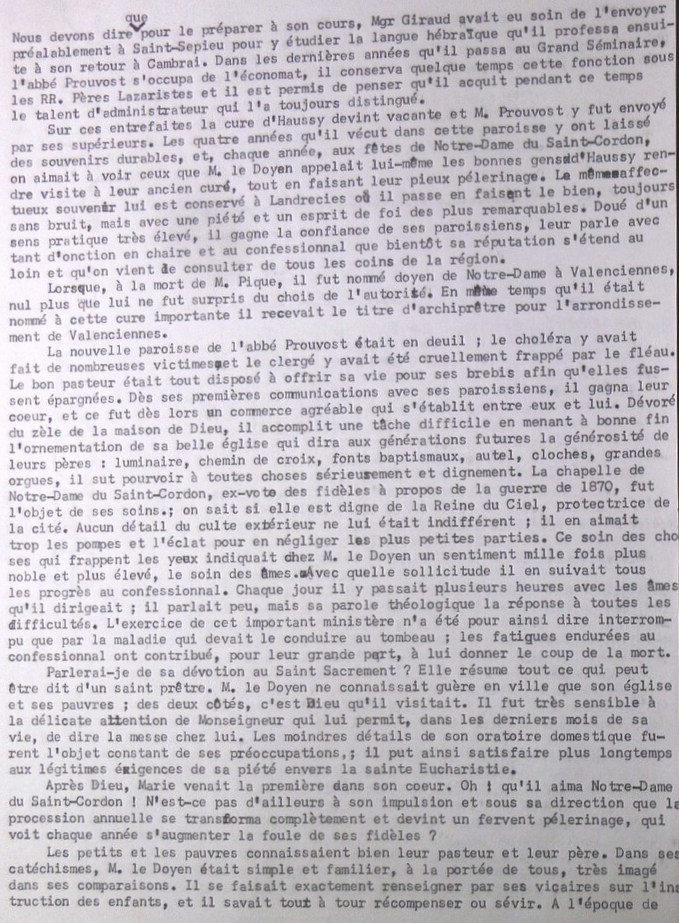
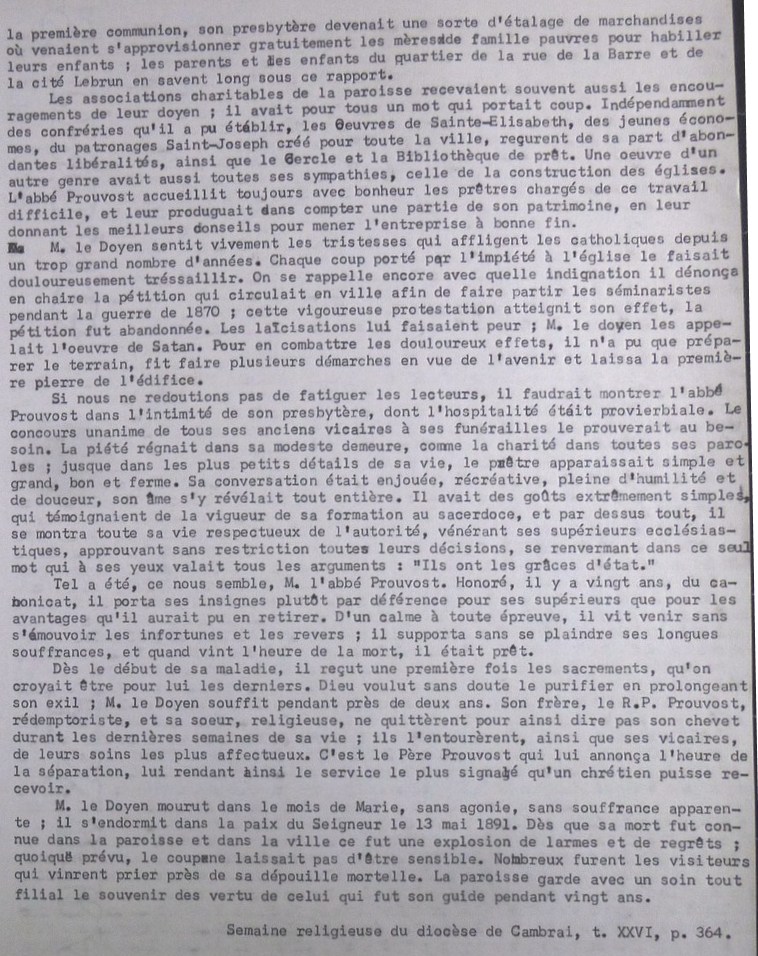
Transmis par le chanoine Leuridan grâce à Philippe Rammaert
« CÉRÉMONIE DE VILLERS-BRETONNEUX Une touchante cérémonie funèbre a eu lieu à
Villers-Bretonneux pour les victimes de la bataille livrée, le 29 novembre
dernier, sur le territoire de cette commune. L'administration du chemin de fer
du Nord avait bien voulu, en délivrant des billets à prix réduit, faciliter ce
patriotique pèlerinage. On évalue à environ dix mille le nombre des étrangers
qui se sont rendus à cette solennité, de tous les points des départements de la
Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Cette immense foule, on le comprend, n'a pu
trouver accès dans l'enceinte pourtant si vaste de l'église : mais les
paroissiens l'ont pour ainsi dire agrandie par leur abnégation personnelle, en
cédant leurs places aux étrangers.
L'église avait été décorée par. les soins de M.
Demarcy, sous l'intelligente direction de M. Delplanque, avec autant da luxe
que de goût. Le catafalque, dont la forme ogivale s'harmonisait avec le style d
u mo nument, n'empêchait point la vue de pénétrer dans le sanctuaire. Des
inscriptions rappelaient. les noms des régiments qui ont pris une part
glorieuse à la bataille du 27 novembre : 2e régiment d'infanterie de marine,
43e, 65e et 75e de ligne, 2e chasseurs, 12e et 15° d'artillerie, compagnie du
génie, 7e, 8e et ge bataillons du 48e régiment de marche des mobiles du Nord.
Parmi les inscriptions empruntées aux Livres Saints, nous avons remarqué les
suivantes, si bien appropriées à la circonstance : Leurs corps ont été
ensevelis en paix et leurs noms vivront éternellement. (MATTHIEU, 2) Ils ont
sacrifié leur vie pour ne pas être asservis. (DANIEL, 3) Mieux vaut pour nous
mourir en combattant, que de voir les maux qui pèsent sur notre patrie. (MARC,
3) A Dieu ne plaise que nous prenions la fuite devant l'ennemi ! Mourons
bravement pour nos frères et ne souillons pas notre gloire. (MACCHABÉES, 9)
Est-ce que celui qui tombe ne se relèvera pas un jour ? (JÉRÉMIE, 8) La
grand'messe a été chantée par M. Prouvost, curé-doyen de N. D. de Valenciennes,
en présence de Mgr l'évêque d'Amiens, qu'assistaient M.
Morel, vicaire général, et M. Boucher, curé de
la Cathédrale. Les fonctions de sous-diacre étaient remplies par un ancien
aumônier de l'armée, M. Poiré, curé d'Herleville. On remarquait dans
l'assistance M. le préfet de la Somme, les conseillers de préfecture, M.
l'avocat général, le commandant de gendarmerie, M. de Thannberg, aide-de-camp
du général Paulze d'Ivoy, M. le juge-de-paix de Corbie, de nombreux
ecclésiastiques des diocèses d'Amiens, d'Arras et de Cambrai; des officiers et
des soldats de l'armée du Nord, dont quelques-uns, blessés ou mutilés, ont vu
la mort de si près dans les plaines de Villers ; enfin, de nombreuses familles
des mobiles du Nord (citons celle de M. de Brigode), dont les enfants gisent
aujourd'hui dans la grande allée du cimetière.
A l'issue de la messe, M. Potier, chanoine
honoraire, curé de Saint-Etienne de Beauvais, est monté en chaire. Son
discours, conçu en dehors des formes ordinaires de l'oraison funèbre, est de
ceux qu'on n'analyse point. Il serait difficile, en effet, de rendre exactement
le- caractère de cette parole toujours facile, souvent poétique, tantôt
familièrement incisive, tantôt puissamment émue. Nous avons surtout été'
impressionné par les aperçus sur l'immortalité de l'âme, sur l'héroïsme de la
conscience, sur le sentiment de la patrie, sur les félons de l'honneur, et sur
les doctrines matérialistes qui ont failli précipiter la France dans l'abîme. ,
On s'est ensuite rendu processionnellement au
cimetière, où Monseigneur a fait l'absoute autour de ce long tertre, couvert de
fleurs, qui recouvrent les dépouilles de 126 victimes.
M. le curé de Villers a adressé d'e chaleureux
remercîments à Monseigneur qui a oublié les soins de sa santé pour aller
présider à cette fête- funèbre ; à M. le Préfet, dont la démarche est un digne
hommage rendu à la valeur de nos soldats; au clergé des diocèses voisins qui a
voulu s'associer au deuil de nos contrées.
M. Dauphin, en qualité de préfet de la Somme, a
remercié, au nom du Gouvernement, tous ceux qui ont contribué à cette
cérémonie. C'est à Villers-Bretonneux, a-t-il dit, c'est dans ces plaines
illustrées par la bravoure de nos soldats, de nos généraux et surtout de
Faidherbe, qu'il' était juste de voir apparaître pour la première fois les
uniformes français et les trois couleurs du drapeau national. Ces souvenirs de
gloire se mêlent hélas! à ceux de nos revers. le Dieu des armées nous a
abandonnés. En face de ces désastres inouïs, on est amené à en rechercher les
causes. Est-ce parce que nous avons oublié Dieu que Dieu nous, a délaissés ? Est-ce
parce que, plongés dans le culte des intérêts matériels.
Nous avons mis l'argent au-dessus du devoir? Est-ce
parce que, déshabitués à faire nous-mêmes nos propres affaires, nous les avons
imprudemment confiées à d'autres mains ? C'est pour toutes ces causes, et bien
d'autres encore. Mais le sentiment du devoir, qu'éveille si énergiquement
l'aspect de ces tombes, renaîtra dans la France régénérée, et ces héros pour
qui nous venons de prier prieront pour nous à leur tour.
, Ces mâles paroles, si religieuses et si
patriotiques, ont fait courir dans l'auditoire un murmure d'approbation qui n'a
été contenu que par le respect dû aux lieux saints.
Monseigneur, atteint par une affection de
larynx, qui nécessite son départ aux eaux du Mont-Dore, a exprimé à M. le
Préfet le profond regret qu'il éprouvait de ne pouvoir traduire, par une voix
affaiblie, les sentiments dont son cœur était rempli.
Cette fête funèbre laissera de profonds
souvenirs à ceux qui en ont été les témoins. Mais cela ne suffit pas ; il faut
qu'un monument plus durable de la piété publique honore la mémoire de ceux qui
ne sont plus. Ce projet a été conçu par la municipalité de Villers et par M.
Delplanque dont le zèle s'est si activement déployé en far de nos soldats
pendant les tristes péripéties de cette guerre. Déjà il a reçu une offrande de
500 francs des mains de Monseigneur et une pareille somme donnée par un
anonyme. Une quête, faite pendant la grand'messe pour cette même destination, a
produit 900 fr. Tout fait donc espérer qu'on aura bientôt réuni les fonds
nécessaires pour ériger, sur les tombes militaires de Villers-Bretonneux, un
monument digne de ces héros du devoir, de ces martyrs de la conscience. Leurs
noms resteront à jamais gravés sur la pierre, comme ils le sont dans le
souvenir des familles, et aussi, devons-nous l'espérer, dans le Livre de Vie :
car le sang versé pour la patrie crie miséricorde au Seigneur, et les champs de
bataille, comme l'a dit l'éloquent prédicateur, sont bien souvent de nouveaux
chemin de Damas qui conduisent à Dieu. (N* 2 du Dimanche). L'abbé J. CORBLET. »
Souvenirs de Villers-Bretonneux : 4 juillet 1871Impr. de Yvert (Amiens) 1871
Auguste-Joseph
Prouvost
fils de Modeste Prouvost et Zoë Wacrenier, né à Fives en 1848, prêtre
le 29 juin 1873, vicaire de Notre-Dame de Valenciennes puis vicaire à Saint
Vincent de Paul à Lille en 1875, aumonier des petits frères de Marie à
Haubourdin en 1883, prêtre à l’église
Saint Maurice de Lille en 1887.
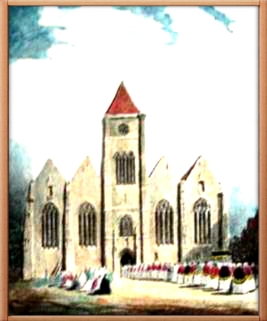
Sa soeur Marie
Prouvost fut bénédictine à Blandain.
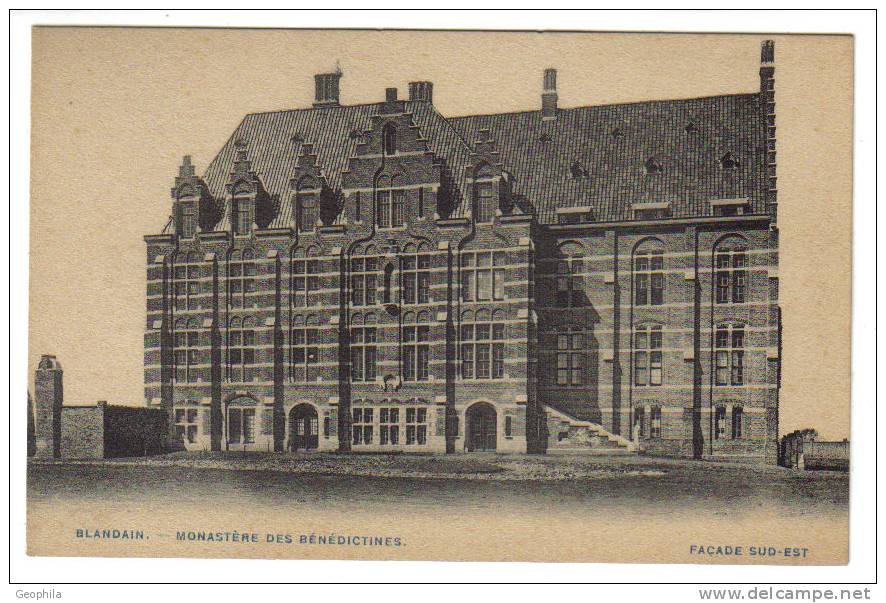
Georges
Piat-Prouvost
fils de César Piat et Sophie Prouvost, né en 1864, prètre le 29
juin 1889, professeur au petit séminaire d’Hazebrouck, aumonier de Saint Maur à
Cassel en 1899, supérieur de l’école Saint Vincent de Paul à Cassel en 1900,
aumonier à Bon-Secours en 1905, curé de Lambres en 1908, curé de Wattignies en
1913.
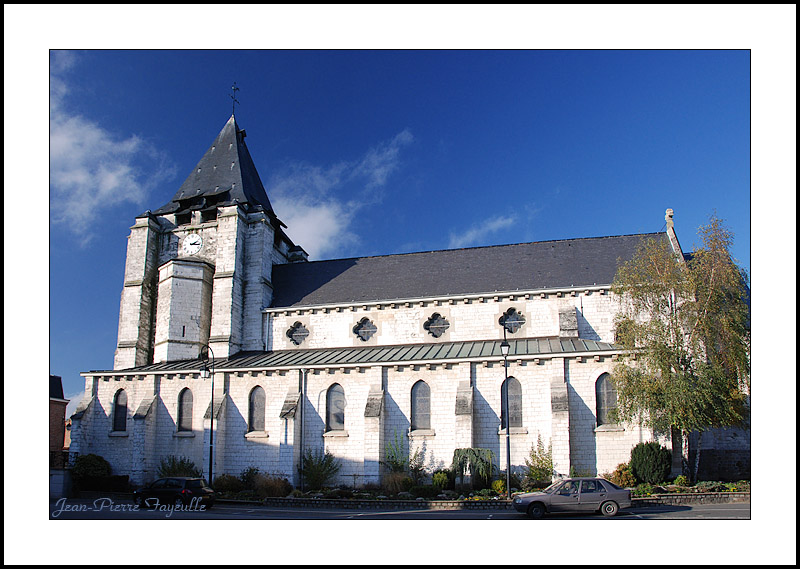
Pierre Léon
Watine-Prouvost
fils d‘Edouard Watine et Caroline Prouvost, né le 25 avril
1874, prètre le 25 février 1899, vicaire à Jeumont la même année, vicaire à
Leers en 1902.

Sa sœur Marie
Watine-Prouvost fut religieuse à Niderbronn.

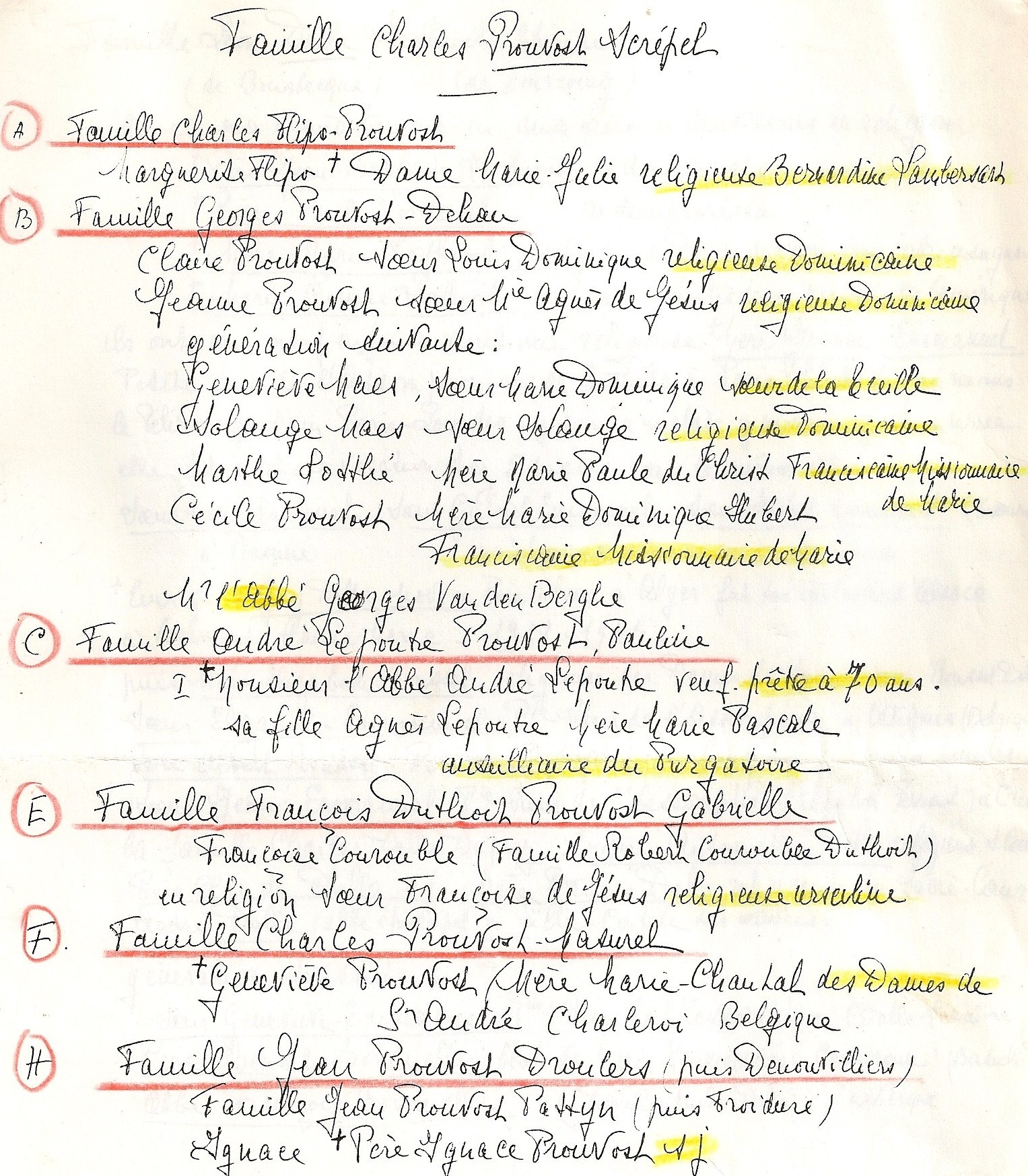
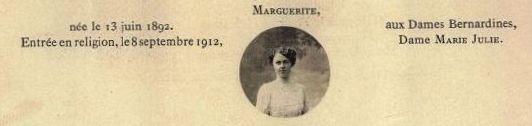
Marguerite Flipo-Prouvost
Mère Marie-Chantale Prouvost
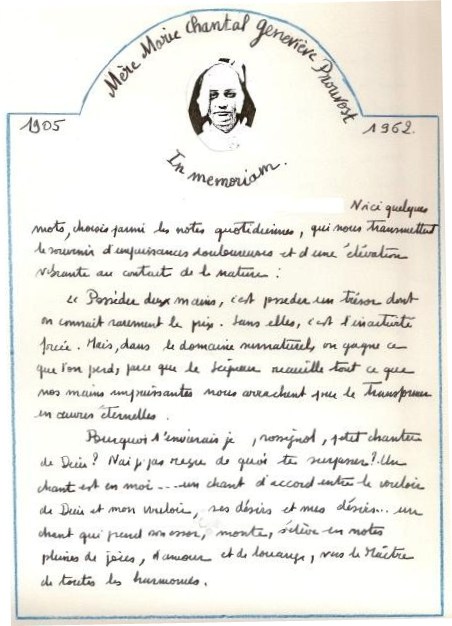
Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983
Franciscaine missionnaire de Marie
Fille de Georges Prouvost (cousin germain de
Charles, petit fils de Félix Dehau) et Marthe Virnot
« L’homme propose et Dieu
dispose ! Je m’étais tellement réjouie de t’avoir comme correcteur et dessus m’a lancé le grand appel. Au cours
d’une opération d’urgence, le chirurgien a découvert en moi un cancer bien
avancé. J’en ai pour quelques mois. Je suis émerveillé de cette délicatesse du
seigneur qui m’a ccordé un délai pour que je puisse partager ma confiance et ma
joie avec tous ceux que que j’aime. Je sais que, dans quelques mois, ma
connaissance sera totale ; alors je préfère m’abandonner à la prière
plutôt qu’à l’étude. Je suis revenue à la tente, ma famille et mes sœurs
acceptent que je finisse mes jours au milieu de ceux que j’aime(…) Je suis dans
la plus grande action de grâce, la plénitude de joie."
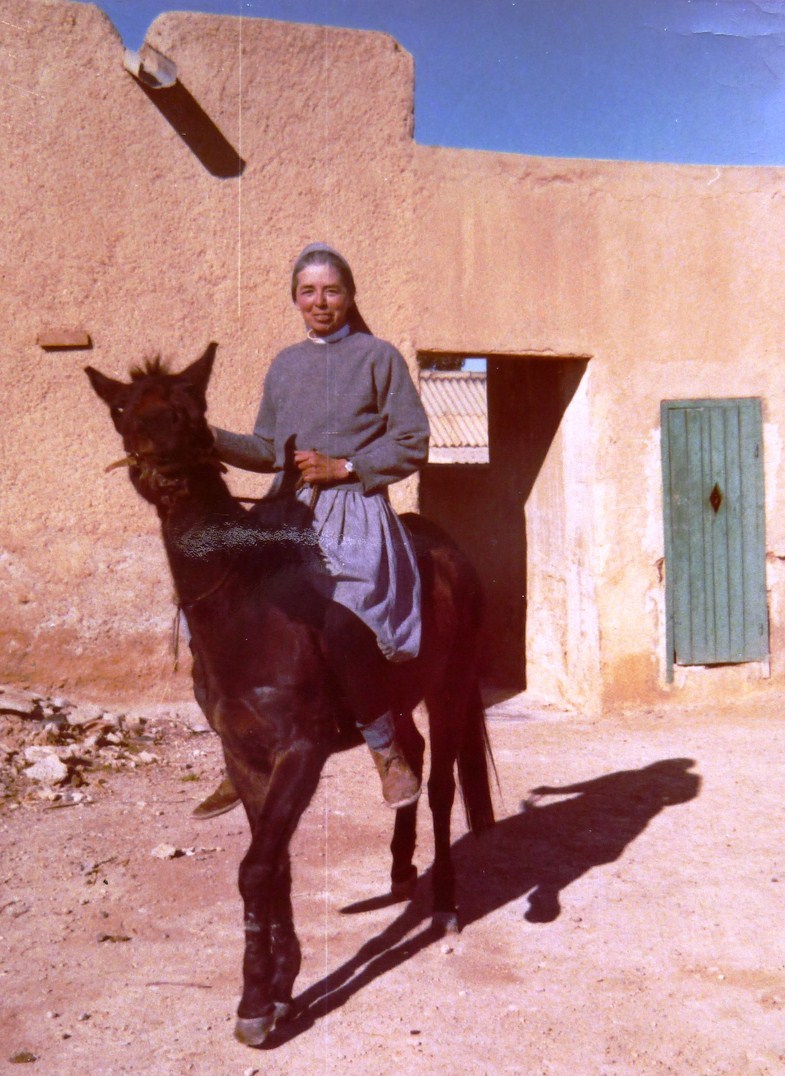
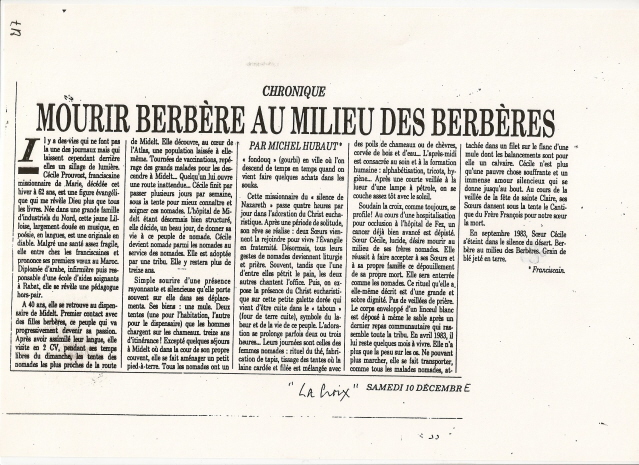
Une femme qui a voulu se faire nomade avec les
nomades
Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983. Née
le 15 juillet
1921 à St Maurice des Champs, près de Lille, dans une
famille d’industriels,
elle connut une enfance sans privations dans un milieu aisé.
De sa jeunesse, de
la première année de guerre, de sa vocation, on ne sait
rien. Entrée dans
l’Institut des franciscaines missionnaires de Marie en 1940
à dix-neuf ans,
elle laissa le souvenir d’une novice
« casse-cou » toujours à
l’affût
de quelque chose à entreprendre, à inventer, sans avoir
peur de l’effort, de la
difficulté, du risque ou du danger. Après son noviciat,
elle fit des études d’infirmière puis fut
envoyée au Maroc. Elle écrit, fin 1969, dans un bref
résumé de sa vie : "J’étais prête
à aller dans n’importe quel pays de
monde, sauf en Afrique du Nord et chez les musulmans. C’est
là que l’obéissance
m’envoya. J’étais jeune et pleine
d’enthousiasme. Je me suis livrée avec ardeur
à toutes les tâches que le Seigneur m’offrit :
vie d’infirmière, étude de
la langue du pays, de la religion, de la civilisation. Je passais
successivement dans les maisons (communautés) de Fès,
Casablanca, Taroudant,
Rabat. En 1961, j’eus mon obédience pour Midelt. Je fus
partout, malgré des
croix réelles, profondément heureuse dans ma vocation,
trouvant dans l’Institut
mon plein épanouissement humain et spirituel. Midelt fut donc la dernière étape de sa vie conventuelle, avant
le grand saut, chez les nomades. Là, elle avait un poste d’infirmière dans le
dispensaire, dépendant de la Santé publique, et elle s’occupait plus spécialement
de prévention maternelle et infantile. À la fin de 1969, Cécile écrit : Depuis
deux ans, le Seigneur m’attire vers une intimité constante avec lui et un
profond désir de vie contemplative. Lors de ma dernière retraite en septembre
1969, il me fit voir clairement que ma vie serait nomade-contemplative.
C’est en juin 1969, au
cours de l’ascension de l’Ayachi (le deuxième
sommet du Haut-Atlas, 3735
mètres) qu’elle ressentit vivement et douloureusement
combien les nomades
étaient abandonnés au point de vue sanitaire. À la
fin de 1969, elle présente, par écrit, son projet
à la Provinciale et à son conseil, ainsi
qu’à la
Supérieure Générale et à
l’archevêque de Rabat. Elle explique : "Je voudrais donc, dès le printemps 1970, avoir l’autorisation de
passer, de temps en temps, une nuit sous la tente, soit près d’un malade, soit
chez des amis sûrs – et j’en ai de très sûrs. Il faudrait que rapidement, le
rythme atteigne deux nuits par semaine ; tout en continuant mes activités
normales au dispensaire et en communauté. Puis mon désir serait, dans deux ans,
c’est-à-dire au printemps 1972, pouvoir vivre cinq jours sous la tente, dans la
montagne et rentrer dans ma communauté le samedi et le dimanche. Plus une
partie de l’hiver. Il me semble que là, je vivrais mieux l’imitation de Jésus
Christ, la Voie, la Vérité, la Vie de nos âmes, qui a voulu vivre cette vie de
proximité et de communauté avec les plus pauvres de son pays qui étaient si
semblables au nomades de nos régions ; nomade avec les nomades. Non sans
appréhension, ses supérieures et l’archevêque laissèrent ouverte
cette
possibilité de proximité avec les plus pauvres de la
montagne. Un projet qui
devint réalité en 1970, au rythme prévu. Comme
« compagne », dans ces
débuts, elle eut, non pas l’une de ses sœurs, mais
une femme berbère et elle
dira : Il s’est créé entre nous une
amitié profonde et actuellement, nous
vivons en fraternité comme deux sœurs, heureuses
l’une et l’autre de montrer à
notre entourage qu’une musulmane et une chrétienne peuvent
vivre ensemble en
réalisant chacune à fond sa religion. Pour nous,
ajoute-t-elle, c’est le
dialogue islamo-chrétien vécu, avec simplicité,
mais dans la réalité. Très
vite, elle pourra dire : J’ai enregistré et arrive
à suivre d’une manière régulière
près de trois cents familles (de nomades). Il doit en rester
à peu
près cent cinquante que je n’ai pas encore
touchées. Le travail est surtout de
prévention, vaccinations, visites prénatales,
surveillance des nourrissons, dépistages de
tuberculose...Nous faisons aussi les soins… Ce qui est important
pour elle dans ce vivre avec,
ce sont les contacts avec les gens qui l’entourent. Entre 1972 et
1974, elle
circule dans un rayon de trente kilomètres autour de Midelt, ce
qui lui permet
de contacter un grand nombre de personnes. En 1972, elle compte 584
familles,
soit 3475 personnes. En 1974, elle compte 659 familles, soit 3833
personnes et,
en infirmière méthodique, elle établit une fiche
par famille. Elle essaie de
sensibiliser les parents à la nécessité des
vaccinations. Mais comment faire
admettre qu’on pique un enfant en bonne santé ? Elle
ne vaccine aucun
enfant sans l’accord de l’un des deux parents. Un autre
point à obtenir, c’est
l’hospitalisation quand le médecin la demande car les gens
ont peur. Elle suit
avec grand soin les enfants : les rachitiques, les
anémiés, les mangeurs
de terre. Mais elle porte surtout ses soins sur
l’éducation : hygiène,
alimentation : « Cela m’est facilité par le
fait que je vis avec eux, et,
en partie comme eux. Je suis à la disposition de ceux qui
viennent chaque jour
entre 7 h 30 et 17 h 30 ; mais pour les urgences, il n’y a
pas d’heure, je
suis à leur disposition jour et nuit. Pour se faire nomade avec
les nomades,
Cécile est vêtue d’un grand burnous d’homme,
coiffée d’une manière qui n’était
ni féminine ni masculine, et chaussée de grosses sandales
berbères, même en
plein hiver. Lorsqu’elle devait prendre le car, pour ne pas
déranger, elle
était prête à partir de bonne heure.
Enveloppée dans mon burnous, je me couche
sur un banc public, on me prend pour un homme et on me laisse
tranquille. Sa
vie à la tente était partagée entre son travail
d’infirmière, la prière à
laquelle elle consacrait beaucoup de temps et l’étude, car
Cécile lisait,
écrivait et étudiait beaucoup. Elle avait même
composé un lexique
français-berbère et berbère-français. Elle
avait entrepris la traduction en
berbère de l’évangile selon saint Marc et
commencé celle de l’évangile selon
saint Jean. Elle avait traduit le « Notre
Père », le « Je vous
salue Marie » et le « Magnificat » et
composé quelques chants.
Elle suit des cours par correspondance, cours de Bible,
d’islamologie, de
théologie. On lui doit aussi un livret sur le traitement par les
plantes qu’elle complétera au cours des années, ainsi que
des notes sur l’acupuncture. Sa
vie fut laborieuse et austère. Pour bien le comprendre, il faut
se l’imaginer
dans son contexte habituel : non au calme dans sa chambre ou son
bureau, elle n’en a pas ; mais assise au pied d’un arbre, ou
l’hiver, près du feu
sous la tente ouverte à tous. En 1978 Cécile
reçoit une sœur comme compagne
sous la tente ; mais pour que la Fraternité soit reconnue
par les
instances suprêmes de l’Institut, il faudrait une
troisième sœur, qui se fera
attendre encore cinq ans. En février 1983, Cécile est
opérée à l’hôpital d’une
occlusion intestinale. Et cette opération révèle
un cancer très avancé. Trop
avancé même pour qu’on puisse intervenir. Elle est
mise au courant par le
médecin et elle accepte dans la foi, dans la joie et dans
l’espérance. Puis,
malgré l’insistance des siens, elle exprime le
désir de finir ses jours à la
tente, puisque médicalement il n’y a rien à faire.
Elle quitte l’hôpital quand
la plaie est cicatrisée et continue de soigner les nomades par
l’intermédiaire
de la sœur qui est avec elle sous la tente. Les derniers mois,
les souffrances
physiques furent intenses ; et pareillement sa vie d’union
à Dieu. Deux
mois environ avant sa mort, Cécile commença un
jeûne, ne buvant que du liquide.
Je ne vois pas pourquoi je devrais nourrir mes cellules
cancéreuses quand il y
a tant de gens qui meurent de faim…Ce fut la veille de sa mort,
le 10 octobre
1983, qu’arriva – dernière délicatesse du
Seigneur – la reconnaissance par Rome
de cette fraternité sous la tente. C’était dans la
montagne les fêtes de mariages et toute la nuit avaient résonné les sons des derbouka (tambours), plus proches ou plus
lointains. C’était pour Cécile, l’annonce d’un autre festin, d’autres noces. À
l’aube du mardi 11 octobre 1983, après une nuit de grandes souffrances,
entourée de ses trois sœurs, elle dit : « Je vais vers mon
Père », prononça le nom de Jésus, entra dans la lumière qui n’a pas de
déclin et dans la joie de Dieu. À ses obsèques, dans le cimetière de la Kasbah
Myriem, c’est une foule qui l’accompagnait, composée de chrétiens et de
musulmans, de prêtres et de religieuses ; mais surtout de ses frères et
sœurs de la montagne, les nomades. Témoignages : Un prêtre qui l’a bien
connue : Le but premier de Cécile a été de vivre avec les plus pauvres, de
partager le dénuement de ce peuple berbère, nomade, qu’elle aimait. Le partage
de leur vie avec tout ce qu’il y a de difficile, de dur et parfois même de
rebutant, c’était son choix et non pas une conséquence à supporter tant bien
que mal. Elle aimait les pauvres, non pas en phrases et en théorie, mais dans
la réalité des actes quotidiens. Son programme de vie : - Imitation de
Marie : surtout dans son mystère de la Visitation, puisque, comme elle, je
porte le Corps de son Fils.- Adoratrice de cette Eucharistie avec laquelle je vis
en intimité totale.- Victime, car les sacrifices ne manquent pas quand il faut
affronter les intempéries, la privation de tout ...- Missionnaire, selon
l’esprit de Mère Fondatrice, Marie de la Passion.Son faire-part de décès
composé par elle-même: "Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, Jésus a
dit : Je suis la
Résurrection. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jn 11, 25) Réjouis-toi
avec moi ! Le Seigneur est venu me chercher pour la vie qui ne finit pas. Je
prie pour toi et je t’attends dans la joie de la Résurrection. Amen.
Alleluia !" Cécile Prouvost; Monseigneur Chabert, l’archevêque de
Rabat : Je
l’admirais et j’étais fier d’avoir dans mon diocèse une telle ambassadrice de
Jésus parmi les plus pauvres. Elle représentait bien cette option
préférentielle que l’Église demande. Et sa Provinciale : Telle que je la
connais, l’estime et l’admire, profondément dans son don total, dans ce
cheminement qu’elle a fait depuis des années et qui […] me semble une
authentique recherche du Seigneur, à l’exemple de saint François et de Marie de
la Passion.
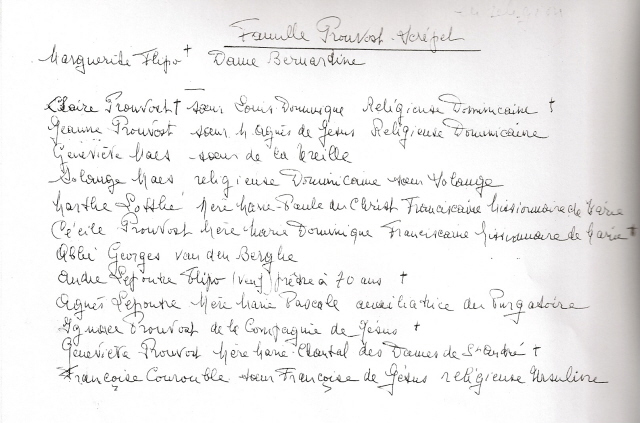
Descendance de
Augustine Élisabeth Joseph
Prouvost 1731 - Roubaix (Nord) 1801 - Roubaix
fille de Pierre Prouvost
1699-1770 et Marie Jeanne Delebecque 1707-1778, mariée le 21 septembre 1755,
Roubaix (Nord), avec Liévin Joseph Defrenne, sieur du Gaucquier 1728-1795
Petits enfants :
Cécile Martine
Duquesne,
1801-1859, Présidente de la Conférence
des Dames de Saint Vincent de Paul,
Arrière petits enfants :
Pierre Edulphe
Joseph Defrenne,
Prêtre
jésuite, missionnaire à Madagascar, 1867-1929, arrière petit fils d’ Augustine
Élisabeth Joseph Prouvost 1731-1801
Jeanne Dupont, née le 21 novembre 1855,
Douai (Nord), décédée le 9 février 1945,
Rome (Italie) (à l'âge de 89 ans), religieuse des Dames du Sacré Coeur,
religieuse à Chicago, assistante générale du Sacré-Cœur à Rome.
Marthe Dupont, née le 6 février 1864,
Douai (Nord), décédée le 1er mai 1930,
Laredo (Texas, Etats-Unis d'Amérique) (à l'âge de 66 ans), religieuse des Dames
du Sacré-Cœur, missionnaire au Texas.
Adrien Bontemps, né le 17 mars 1856,
décédé le 15 janvier 1940
(à l'âge de 83 ans), prêtre, chanoine, supérieur des Dames de la Sainte-Union à
Tournai, érudit, historien, généalogiste, membre de la Société d’Histoire &
d’Archéologie de Valenciennes.
Léon Dupont, né le 17 février 1865,
Valenciennes (Nord), décédé le 13 janvier 1941,
Batticaloa (Sri Lanka) (à l'âge de 75 ans), prêtre jésuite, missionnaire de la
Compagnie de Jésus, supérieur de la Mission de Batticaloa à Ceylan.
Louise Dupont, née le 1er avril 1881,
château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), décédée le 31 mai 1971,
Menlo Park (Californie, Etats-Unis d'Amérique), inhumée, Menlo Park
(Californie, Etats-Unis d'Amérique) (à l'âge de 90 ans), révérende Mère Louise,
religieuse des Dames du Sacré Coeur au Couvent de Menlo Park.

Marthe Dupont,
née le 22 mars 1885,
château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), décédée le 3 mars 1958,
Lourdes (Hautes-Pyrénées) (à l'âge de 72 ans), révérende mère Marie du Coeur
Immaculé de Marie, religieuse du Bon Pasteur à Angers.

François Marie
Joseph Dupont, né le 7 mars 1888,
château du Guindal, Saint-Saulve (Nord), assassiné le 17 janvier 1941,
Shien-Shien (Chine) (à l'âge de 52 ans), prêtre jésuite, préfet des Etudes à
l’Ecole Polytechnique, missionnaire de la Compagnie de Jésus, professeur de
théologie & Supérieur de la Maison des Jésuites de Shien-Shien.

Charles Petit,
né le 4 janvier 1870,
décédé en juin 1950 (à
l'âge de 80 ans), prêtre jésuite à Enghien,
Belgique, recteur du Collège Notre-Dame de Mouscron.
Petite fille de Bonne Thérèse
Prouvost 1807-1847, Thérèse Wattinne,
née le 22 juillet 1854,
Tourcoing (Nord),
décédée le 23 février 1886,
Roubaix (Nord) (à l'âge de 31 ans), religieuse.

Réunion écclésiastique chez les Lestienne-Prouvost
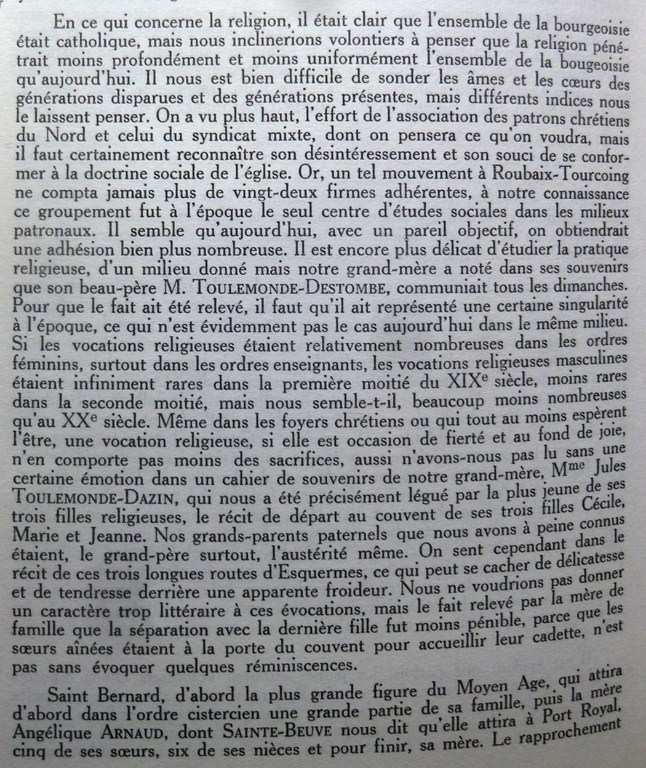
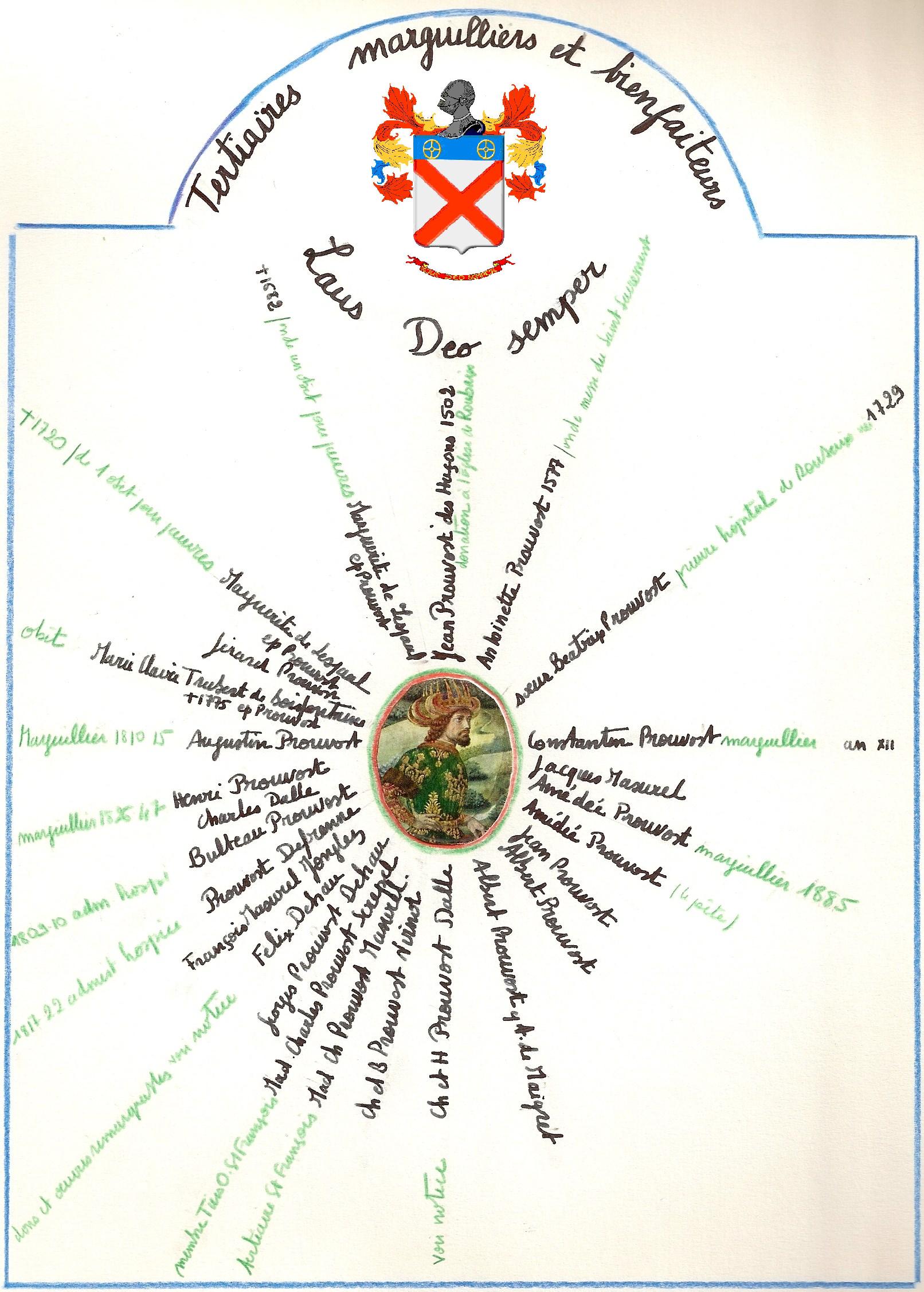
Parmi les fondateurs de la Conférence Saint Vincent de Paul de Roubaix, le
6 novembre 1846, on note : MM. Constantin Prouvost; Louis Prouvost, plus tard
rédemptoriste; Gaspard Prouvost, qui mourut doyen de Notre-Dame, à Valenciennes;
Willebaud Wibaux, nommé secrétaire quoique absent de la séance. Parmi les membres
entrés dans la Conférence de 1842 à 1852 : Gruart-Prouvost, membre honoraire
(date d’admission?). ; Prouvost Joseph, membre actif. Henri Prouvost. 6
Février 1843. Wattinne-Prouvost, membre honoraire. Prouvost Liévin, membre
honoraire.
Le père de Charles Flipo-Prouvost, Jean François Flipo
1792- 1867, filateur, Conseiller général, fondateur de la fortune de la
famille; crée sa filature, utilise une des toutes premières machines à vapeur,
s’installe dans une grande maison de la rue de Tournai, épouse Adélaïde
Cécile Holbecq,-1803-1892), femme très
courageuse et pieuse qui financera l’ essentiel de l’ église Saint Louis et
soulage les misères sans compter ; à la fin de sa vie, veuve, elle
dirigera la fil ature ; elle allait à la messe chaque matin à la chapelle de l’
hospice d’Havré du XVII ° siècle
(exactement) en face de son domicile; par contre le dimanche, son cocher attèle
les deux chevaux pour la conduire en bel équipage entendre la grand messe à
Saint Christophe de Tourcoing, parée de
ses robes de taffetas dites « des fêtes de l’ église » texte
d’André Leurent-Maës; ( Jean Baptiste avait un frère Charles Flipo, né le 6 novembre 1800, Tourcoing,
décédé le 25 avril 1824 (23 ans), en
religion – trappiste).
Amédée II
Prouvost était, comme sa femme, membre du Tiers-Ordre
de Saint-François. Il fit édifier à
M'Rira, prés de Tunis, dans un domaine où il
fut associé avec son frère Edouard, une chapelle qui devint paroisse. Il
contribua à faire édifier prés de sa propriété de Mandelieu une chapelle, N.-D.
des Mimosas. Il contribua certainement à
la construction du grand couvent de la Sainte Famille à Roubaix, rue de Lille,
où sa belle-sœur, religieuse, tante Jeanne Bénat, laissa un très grand
souvenir. Pendant la guerre de 1914-1918, il
prit la tête d'un Comité dit du Vœu de Roubaix, dans
le but de demander
à Dieu la protection de la ville , qui fut heureusement
épargnée. Le clocher
qui manquait à l’ église du
Sacré-Cœur, fut ainsi construit. Il avait de tout
temps porté de l’ intérêt à l’
Orient Chrétien et présidait le comité de
Roubaix de l’ Œuvre d'Orient. Son dévouement
à l’ Œuvre d'Orient, lui valut
d'être nommé Commandeur de l’ Ordre du
Saint-Sépulcre, et nous avons eu sous
les yeux une photo de grand-père, revêtu d'une cape
prestigieuse.
Mentions
de Prouvost dans les monuments de Roubaix:
Église Notre-Dame de Roubaix
La première pierre de cette
église fut posée le 28 juillet 1844; au commencement de l’année 1847,
l'édifice était achevé et fut consacré le 10 février par Mgr Giraud. Les plans
avaient été dressés par M. A. Dewarlez, architecte de la ville.
1844. — Première pierre,
provenant de l'ancienne chapelle du Saint-Sépulcre; avec plaque de
cuivre :
D. 0. M. et B. M. V. huncce lapidem primarium rite et faustis consecratum
auspiciis, ut in perpetuum templi fundamentis inhesereat, avitamque fidera ad
posteros testetur, anno Domini M DCCC XLIV, die vero vigresima quinta Juvi,
solemniter apposuit D. Joannes-Baptista Bossut, civitatis Rosbacensis
magistratus, sicut ex diplomate ibi incluso latius constabit.
Louis-Philippe, roi des Français ;
Pierre Giraud, archevêque de Cambrai; le vicomte de Saint-Aiqnan, préfet du
Nord; Auguste Mimerel, conseiller du département; Wattinne-Wattel, conseiller
de l'arrondissement; Jules-Philippe Maes, doyen-curé de Roubaix ; Jean-Baptiste
Bossut, maire de Roubaix; Achille Delaoutre, Louis-Alphonse Lanyin, adjoints.
Conseillers municipaux, Scrépel-Lefebvre, Julien Lagache, Gésar Piat, Auguste
Lemaire, Julien Mourmant, Vincent Decarne, Auguste Mimerel, Louis Lecomb,
Roussel-Dazin, Dellebecq-Desfontaines, Théodore Descat, Duhamel- Housez,
Jean-Baptiste Dujardin, Delcourt-Béghin, Salembier-Bulteau, François-Frasez,
Motte-Duthoit, Motte-Brédart, Cocheteux-Segard, Jean-Baptiste Selosse,
Lepers-Agache, Tiers-Bonte, Clarisse-Desbarbieux, Camille Hertogh, Secrétaire
de la mairie : Hippolyte Lemaire. Architecte de la ville : Achille Dewarlez.
Entrepreneur: François Ferlié fils.
1846 — Seconde cloche.
« Patrinus P. C.
Prouvost; matrina
Floribona Duthoit, uxor D. Lespagnol, in arte medica doctoris. M DCCC XLVI. Sub
auspiciis D. Salembier-Bulteau, civ. Rosb. magistratus. »
Église du Sacré-Cœur
de Roubaix.
De style gothique XIII°
siècle, en briques, avec contreforts de pierre blanche, et affectant la forme
d'une croix latine, cette église fut construite pour accomplir le vœu formulé
par les catholiques de la ville, en 1870, « pour obtenir la délivrance du Pape,
le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité en France et la préservation
de l'invasion prussienne. » La première pierre fut posée le 16 juin 1871 ; l’église
fut bénite et ouverte au culte le 20 juillet 1873, et érigée en paroisse par
décret du 19 novembre 1878.
1866-1887. — Dans la
chapelle de Saint-Joseph.
A la mémoire de M. Louis-
Joseph Delerue, décédé le 23 mai 1865, à l'âge de 72 ans et 6 mois ; de M.
Amand-Fidèle-Joseph Delerue, décédé le 27 Juin 1876, à l'âge de 72 ans
et 9 mois ; de M. Pierre-François-Joseph Delerue, décédé le 29 mai 1878, à
l’âge de 76 ans et 6 mois ; de Marie-Joséphine Delerue, décédée le 13 novembre
1887, à l’àge de 82 ans, donateurs de cet autel. R. I. P."
1871. — Première pierre, « D. O. M. et Sacratissimo Gordi Jesu hunc ce
lapidem primarium rite benedictum, ut in perpetuum templi fundamentis
inhaereat, avitamque fidem ad posteros testetur, anno Domini M.D.CCC.LXXI, die
vero decima sexta Junii, recurrentibus festo Sacratissimi Gordis Jesu et
anniversario vigesimo quinto creationisâs. DD. Pii Papœ IX, solemniter apposuit
R. D. Bernard, vicarius generalis. »
1871- — Dans la
chapelle absidale, sur les quatre panneaux à gauche et à droite de l’autel.
Nous prierons pour ceux qui
ont fondé cette église ou qui en ont été les bienfaiteurs :
MM. Charvet, MM. Julien Lagache, Binet Réquillart-Dessaint, Berteaux,
doyen. Louis Scrépel, MM. Toulemonde- Destombes, Motte –Motte, Grouset-Segard,
Th Duhamel, Etienne Motte, Mulliez-Delmasure, Leclercq-Mulliez, J.-B. Scrépel, Amédée Prouvost, Delrue frères et sœur,
Denis Salembier, Jean Delcroix, Wattinne-Bossut, Vve Flipo, Bossut
père,Julien Lagache fils, Droulers-Prouvost, J. Pollet,
Desrousseaux- Defrenne, Droulers-Éloy, MM. Éloy-Duvillier, Ve Éloy-Desbouvrie.
Henri Toulemonde, Jules Toulemonde, Henri Wattinne, Wattinne-Ovelacque, Achille
Vernier, Christine Mullier, Alfred Motte, Scrépel-Louage, Léon Scrépel,
Dazin-Éloy, Motte-Bossut, Henri Prouvost, Narcisse
Lestienne, Charles
Prouvost,
Desfontaine, V Dupont Grimonprez, Aie Wattinne ; MM. Plancre,
vicaire ;Pollet, vicaire ; Tilmant, vicaire ; Caudron,
vicaire ;A Tiers ; Delle Houzet, Ace Delattre, yre
Watine-Meurisse, So Watine, Louis Watine, Jh Watine, Cavrois-Mahieu, Legrand
Wibaux ; Lehougne-Delecourt, Charles Roussel, Henri Wibaux, Piat- Florin,
Delobel sœurs, Vermylen, Pennel- Wattinne, Lezy-Dhalluin, Vve Delcroix,
Delambre-Seutin, MM. Niel-Cavrois, Jules Delattre, Henri Delattre fils ;
Bettremieux, Louis Dekimpe, Watine-Ferfaille, Bonami Lernould,
Lefebvre, Grimonprez-Cavrois, Vve Henri Prouvost, Delannoy-
Delcroix, Delannoy- Carré, Sophie Delrue, Piat-Agache, J. Florin, Ve Dubar-
Cliquet, Vve Y Pennel, G. Heyndrickx, Allard-Sion, Bulteau sœurs,
Allard-Rousseau, Delannoy- Castelain, Vandecrux. MM.
Carré-Gheval, Bayart-Cutklier, Wibaux-Motte, Watine-Beghin, J.-B. Bossut, Ach.
Deledalle, Ve Louis Lefebvre, Lefebvre-Mullier, Mulliez-Scalabre, Clément
Dupire, Flipo-Gousin, Dazin-Flipo, E. Moyart-Rapsaet, Vv«
Beuscart-Despontaines, Chrétien Vandecrux, Nicolas- Ravenez,
Thibbaut-Defrennes, Delcour frères, Carette-Lepers, MM. Dispa, Dazin- Motte,
Grimonprez- Delatre, Henri Duhamel, Armand Wibaux, V Meurisse-Toulemonde,Henri
Bossut, V Agache-Toulemonde, Delfosse- Motte, Pierre Gatteau,
Planquart-Boyaval, Mahieu-Bossut, Laval frères, D Billet, D. Bocjtibe,
Dejoncker, Willot, Ve Jules Bonnet, MM. Flipo-Delcroix,
Billet-Duquesnnoy, Ferret-Delcroix, Stanislas Florisse, Leroux- Delcroix,
Hodzet-Cheval, Jean Bonnet, MM ve Bouvier, J. Lamy, Renard, Ve Mathon,
Messen, J. Lefebvre, L. Lefebvre.
Hôtel- Dieu de Roubaix.
En 1853, une souscription fut ouverte par la
Chambre Consultative, en vue de l'érection d'un vaste hôpital. Après une longue
attente, le projet de construction fut voté
le 23 septembre 1869. L'édifice fut exécuté par M. Th. Lepers, architecte de la
ville, d'après les plans de M. Bottrel d'Hazeville. Cet hôpital, situé rue
Blanchemaille,
s'appela d'abord Hôpital-Napoléonprès 1870, il fut désigné sous le nom
d'Hôtel-Dieu ou hôpital civil.
Dans le vestibule à gauche en entrant :
Bienfaiteurs. 1463-1823 :
Pierre
de Roubaix, Isabeau de Roubaix., Adrien de Roubaix, Nicolas de Werchin,
seigneur de Roubaix., Yolande de Luxembourg, dame de Roubaix, Mgr de
Faigneules,
Sœur Jacqueline Despeunezeaux, Sœur Marguerite Meiganet, Yolende de
Werchin, princesse d'Épinoy, Floris de Montmorency, seigneur de Montigny, Luc
Mulliez,
Sœur Jeanne Deswatines, Sœur Liévine Vandervarent, Sœur Marguerite Farvaque,
Sœur Isabeau de Tramecourt, Lamoral, prince de Ligne, marquis de Roubaix,
Marie de Melun, princesse de Ligne, dame de Roubaix. Sœur Légère Flameng,
Valentin du Bois, seigneur de Wassegnies, Sœur Jeanne Bataille, Agnès de
Mullenart,
Sœur Agnès Delbecque, Me François Becquart, pasteur de Roubaix, M. Jean
Prus, pasteur de Roubaix, Sœur Jeanne Lefort. Sœur Barbe Lefebvre, Sœur
Marie-Catherine Obert,
Sœur Marie- Madeleine Wattrelos, Louis de Croix, seigneur de Gourgemez,
Catherine Delebecque, Sœur Antoinette de Blondel, Antoine de Blondel, Catherine
de Carieule,
Marie de Berthoult du Valuon, Sœur Anne Dulongcourty, Sœur Catherine Lariyière,
Sœur Barbe Delebecque, Sœur Agnès Desurmont, Sœur Michelle Dujardin,
Sœur Catherine-Monique Delebecq, Sœur Agnès-Florence DelebecQue, Sœur
Catherine Delespaul, Sœur Marie- Joseph Dhalluin, Sœur Dorothée Ducoulombier,
Sœur Pélagie Jager, Sœur Marie-Madeleine Lefebvre, Sœur Marie-Catherine Delespaul, Sœur Marie-Jeanne
Flameng, Sœur Marguerite Dhalluin,
Sœur Marie de S.Joseph Dhalluin, Sœur Elisabeth Prouvost, Sœur Marie-Florence Vanhœnacker, Sœur Aldegonde
Scorion, Sœur Augustine Destombes, Sœur Glaire Lepers,
Sœur Isabelle Delposse, Sœur Thérèse Destombes, Sœur Marguerite Lezaire,
Louis de Melun, prince d'Épinoy, marquis de Roubaix, Philippe-Dominique
Delespaul,
Mademoiselle de la Hayrie,Valérien Caron, Sœur Catherine-Monique Lefebvre, Sœur
M. F. Delespierre, Brecryelt-Delahaye, Jacques Delos, Marie-Catherine Destombes,
Sœur Marie-Angélique Decottignies, Sœur Jeanne Lezy, Sœur Marie-Gabrielle
Coppin, Sœur Marie-Agnès Courouble, Sœur Marie-Monique Florin,
Sœur Marie- Adrienne Lefebvre, Sœur Elisabeth Heddebaut, Sœur M. G. Hannart,
Sœur Éléonore Monier, Sœur Antoinette Monier, Sœur Marie-Mélanie Castel,
Sœur Euphrosine Delebecque, Sœur
Béatrix Prouvost, Sœur
Bernardine Dujardin, Sœur Albertine Delourme, Sœur Julie Bonte, Sœur Constance
Lantoing, Sœur Amélie Lemer,
Sœur Marguerite Gaffin, Sœur Marie -Madeleine –Joseph Dehullu, Sœur
Victoire Mouret, Sœur Marie- Françoise- Joseph-Mazurel, Sœur Angélique
Jacquart,
Sœur Anne-Marie Delebecque, Sœur Marie-Anne-Joseph Destombes, Sœur Catherine
Chauwine, Sœur Marie -Anne -Joseph Fabricy, Sœur Rose-Blanche-Joseph Bouteillier,
Sœur Bernardine Klory, Sœur Félicité Lefebvre, Pierre Frémaux.
Noms des administrateurs de l’Hôpital de
Roubaix de 1798 à l’année 1867:
P. J. Grimonpont. 1798 ; A. Dujardin
1798 ; Castel-Frémaux. 1798 ; Dazin-Duforest. 1798 ; Bulteau-Yon
1798 ; C. Florin-Delbecque. 1801 ; Dervaux-Dukorbst 1801;
Houzet-Delos. 1801 ;Delcourt-Chombart. 1801 ; Defrenne-Dervaux
1802 ; Simon-Basile Ferret. 1804 ;Ignace Gadenne. 1804 ;J. B.
Lecomte. 1807 ; Dervaux-Tiberghien. 1807 ;
Bulteau-Prouvost. 1809 ; Boyaval-Roussel. 1809. ;
Lepers-Delebecque. 1809 ; Liévin Defrenne. 1810 ; Boyaval-Morel
1810 ;Alexandre Decréme. 1810 ; Grimonprez-Tiberghien ;
Grimonprez-Bulteau. 1814 ; Duhamel-Brédart. 1817. Desrumeaux-Duthoit.
1817 ; Prouvost-Defrenne.
1817 ;
Montagne-Petit. 1818 ; Augustin
Prouvost. 1819 ;
Delebecque-Lezaire. 1819; Boussel-Dazin, 1819; Wattinne-Wattel. 1819;
Scrêpel-Lefebvre. 1819; Mulliez-Delesalle. 1823; Motte-Brédart. 1824;
Motte-Duthoit. 1825;
Lecomte-Delerue. 1826; Lehembre-Wacrenier. 1828; Florin- Wattine. 1829;
Hertogh, 1831; Paul Defrenne. 1834 ; Cavrois-Grimonprez. 1835 ; A.
Mimerel. 1837 ;
Delattre-Libert. 1839 ; Grimonprez-Bossut. 1840 ;Louis Destombes.
1852 ; Louis Scrépel. 1852 ; Aimé Delfosse. 1852 ; J.
Benaux-Lemerre. 1856; Réquillart-Desaint. 1863;
L. Watine-Wattinne. 1864 ; Pierre Catteau. 1867.
Hôpital communal de Roubaix
Le 15 août 1861, jour de l'Assomption et fête de
Napoléon 111, la première pierre de cet édifice, destiné à servir d'hôpital
communal, a été bénite par M^ Maes,
doyen de la paroisse S^ Martin, et solennellement posée par Mr
Jean-François-Auguste-Joseph Ernoult-Bayart, maire de la ville de Roubaix,
assisté de ses adjoints
MM. Julien Lagacue> Constantin Dbsgat et Jean- Baptiste Renaux-Lemetre, en
présence du clergé, des membres du conseil municipal et de la chambre
consultative
des arts et manufactures, de la commission des hospices, des diverses
administrations de la ville, et de M. Théodore Lepers, architecte.
Bienfaiteurs. 1861 :
Bayart-Gutelier ; Bayart-Lefebvre
père ;Bayart-Parent ;Bettremieux fils ; Blanquart-Delobel ;
Bodin Edouard ; Boissibre Achille ; Bossut-Delaoutre ;
Bossut-Grimonprez ;
Bossut-Pollet ; Browaeys-Degeyter ; Bulteau
Alexandre ;Bulteau-Desbonnet ; Bulteau-Mimerel
veuve ;Carette-Pennel ;Carré-Cheval ; Carré- Delescluse ;
Carré- Desfontaine ;
Castel frères et sœur ; Cateau Adolphe ; Catteau Pierre.
Catrois-Grimonprez veuve ; Cheval- Legrand veuve ; Cheval
sœurs ; Gochsteux-Castel ; Cordonnier Louis ; Cozette Léon,
Crombé Jules, Crombé Louis, Cuvru sœurs ; Dathis Léon ;
Dazin-Bulteau veuve ; Dazin fils aîné ; Dazin Joseph ;
Dazin-Motte ; Decottignies-Dazin ; Decourcelle veuve ;
Defrenne Alphonse ; Defrenne Liévin ; Defrenne Paul ; Delaoutre
Achille veuve, Delattre-Cavrois Henri, Delattre Edouard, Delattre Henri père.
Delattre Jules,
Delattre Louis fils, Deledalle Achille, Deleporte Henri, Delerue-Dazin Jules,
Delerue- Florin veuve, Delerue J.-B. veuve,Delfosse Clément, Delfosse- Motte,
Delobel-Barot, Delobel sœurs, Derville César, Descat-Crouset, Descat- Libouton,
Descat Théodore, Deschamps Auguste, Desclée frères, Destombes- Dengremont,
Droulers Auguste, Dubar-Gliquet, Dubar-Delespaul , Dubar-Perrier, Duburcq Jean-Baptiste, Duflos
Jean –Baptiste, Duhamel Henri, Dujardin Alexandre,
Du Jardin Jean –Baptiste, Dumanoir, Dupire-Duponchel, Dupont fils,
Dupont-Grimonprez, Duriez fils, Duthoit fils, Dutilleul-Lorthiois, Eeckmann
Louis, Ernoult-Bayart,
Fanyau-Ionave, Ferlié-Lecomte, Florin Carlos, Florin- Decrème,
Florin-Ribaucourt, Frasey François, Gantier- Roussel , Gaydet-Bobt.,
Grimonprez- Bossut, Grimonprez-Cavrois,
Grimonprez Eugène, Grimonprez Louis fils, Lagache Julien, Larousse
Edouard, Laigle Oscar, Lambin – Delattre, Lamy Jules, Leconte-Baillon,
Lefebtre-Mathon Louis, Lefebvre-Mathon Henri, Lefebvre-Soter Jean,
Lenain Edouard, Lepoutre-Parent ; Leroux Camille.
1861- — Salle des pas perdus; seconde plaque à
droite.
Bienfaiteurs de Lespagnol veuve ; Lestienne
frères ; Lhermine Y. Liénard veuve;Lister et Holden, Mathon-Lepers, Mathon
et Masson, Mazure Louis, Mazure-Mazure,
Messen Jacques, Mimerel sénateur,
Mimerel fils, Montagne Auguste, Montagne Jean, Motte Alfred,
Motte-Bossut, Motte-Brédart, Motte Etienne, Mourmant Julien,
Mulliez-Delesalle, Mulliez-Éloy, Parent Pierre, Parenthou Godefroy, Pennel
Alexandre, Pin-Bayart, Ployette Ferdinand, Pollet Joseph, Pollet Romain,
Poullier Louis,
Prouvost Adolphe.
Après 1861 : Prouvost Amédée, Prouvost Bonami veuve, Prouvost
Liévin, Prouvost Pierre-Constantin, Relop Adolphe, Réquillart-Barrot veuve.,
Réquillart-Desaint,
Réquillart-Scrépel, Rogues veuve, Rousseaux-Cornille, Roussel-Dazin, Roussel
François, Ryo-Catteau, Salembier Louis, Scrépel César ; Scrépel
Florimond ;
Scrépel Lefebvre ; Scrépel Louis; Scrépel-Roussel ; Ternynck Henri ;
Tettelin- Montagne ; Tiers- Werquin veuve ; Vernier- Delaoutre ;
Voreux Louis ; Vouzelle veuve ;
Watine Louis ; Watine-Meurisse veuve ; Wattel Florimond; Wattel-Prus;
Wattinne-Bossut; Wattinne-Prouvost ; Wattinne- Wattel; Werbrouck Louis; Werquin- Wattel;
Wibaux Achille. Wibaux Bonami; Wibaux Henri; Wibaux-Motte, Comte Mimerel,
Dormeuil Jules-Ernest, Renaud J.-B, Dame Grimonprez-Delaoutre, Dormeuil Alfred-
Joseph.
________________________________________________
L’œuvre de la France, elle remplit
toutes les pages de l’histoire humaine, elle est connue de l’univers entier et
ce n’est pas Dieu qui l’oubliera, lui a
qui tout est présent. Le zèle déployé par cette noble race pour la cause et
pour le nom de Dieu, l’esprit de sacrifice et d’abnégation, le dévouement et
l’enthousiasme qu’elle a mis au service de Jésus-Christ et de son évangile,
voilà des titres qui subsistent, des mérites qui ne s’effaceront jamais.
D’autant qu’ils n’appartiennent pas
uniquement au passé. » Monseigneur Pie.
Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux
fonds baptismaux de Reims, se repentira et retournera à sa première vocation.
Un jour viendra(…) où la France, comme Saül sur le chemin de damas, sera
enveloppé d’une lumière céleste… Tremblante et étonnée, elle
dira : »Seigneur, que voulez vous que je fasse ? » et
lui : « Lève toi, lave les souillures qui t’ont défigurées, réveille
dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va,
fille ainée de l’Eglise, nation prédestinée, vase d’élection, va porter, comme
par le passé, mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la
Terre » Saint Pie X : allocution consistoriale
de 20 novembre 1911.
L’homme médiocre est juste milieu sans le
savoir. Il l’est par nature, et non par opinion ; par caractère et non par
accident. Qu’il soit violent, emporté, extrême, qu’il s’éloigne autant que possible
des opinions du juste milieu, il sera médiocre. Il y aura de la médiocrité dans
sa violence… Il admet quelquefois un principe mais si vous arrivez aux
conséquences de ce principe, mais si vous arrivez aux conséquences de ce
principe, il vous dira que vous exagérez…. L’homme vraiment médiocre admire un
peu toutes choses, il n’admire rien avec chaleur. Si vous lui présentez ses
propres pensées, ses propres sentiments rendus avec un certain enthousiasme, il
sera mécontent. Il répètera que vous
exagérez. Il aimera mieux ses ennemis s’ils sont froids que ses amis s’ils sont
chauds. Ce qu’il déteste, par-dessus tout, c’est la chaleur. L’homme médiocre
dit qu’il y a du bon et du mauvais dans toutes choses, qu’il ne faut pas être
absolu dans ses jugements etc. etc. Si vous affirmez fortement la vérité,
l’homme médiocre dira que vous avez trop confiance en vous-même… L’homme
médiocre dira que vous avez trop confiance en vous-même… L’homme intelligent
lève la tête pour admirer et pour adorer ; l’homme médiocre le lève pour se
moquer : tout ce qui est au dessus lui parait ridicule, l’infini lui parait
néant… L’homme médiocre est le plus froid et le plus féroce ennemi de l’homme
de génie… L’homme de génie compte sur l’enthousiasme ; il demande qu’on
s’abandonne. L’homme médiocre ne s’abandonne jamais. Il est sans enthousiasme
et sans pitié : ces deux choses sont toujours ensemble… L’homme médiocre est
beaucoup plus méchant qu’il ne le croit et qu’on ne le croit, parce que sa
froideur voile sa méchanceté… Au fond, il voudrait anéantir les races
supérieurs : il se venge de ne le pouvoir pas en les taquinant… L’homme
médiocre ne lutte pas : il peut réussir d’abord, il échoue toujours ensuite.
L’homme supérieur lutte d’abord et réussit ensuite. L’homme médiocre réussit parce
qu’il subit le courant ; l’homme supérieur triomphe parce qu’il va contre le
courant. « Ernest HELLO
Les jardins partagés
en France
FNJFC (Fédération
nationale des jardins familiaux et collectifs.
http://www.jardins-familiaux.asso.fr
12 Rue Félix Faure, 75015 Paris
01 45 40 46 94
C'est au cours des guerres napoléoniennes que l'on
commença à parler en Angleterre d'« allotments » ou terres allouées aux
ouvriers. Pour les uns il fallait 2 000 m2, pour d'autres, moitié moins. Mais
tout le monde était d'accord sur le rôle important des jardins. En France, loué
ou cédé, le terrain attachait l'ouvrier à son usine et le maintenait loin du
cabaret. S'ils revêtaient un caractère paternaliste, les jardins ouvriers ont
séduit parce qu'ils correspondaient à un besoin réel. Les premiers jardins
ouvriers français furent inspirés des potagers encouragés par le médecin et
pédagogue Daniel Gottlob Moritz Schreber en Allemagne. Celui-ci fonda
l'association des jardins ouvriers et familiaux pour « éduquer la population »
et « améliorer la santé publique ». Cette idée fit quelques émules comme l'abbé
Volpette à Saint-Étienne, et madame Hervieu à Sedan.
L'abbé
Jules Lemire (1853-1928)
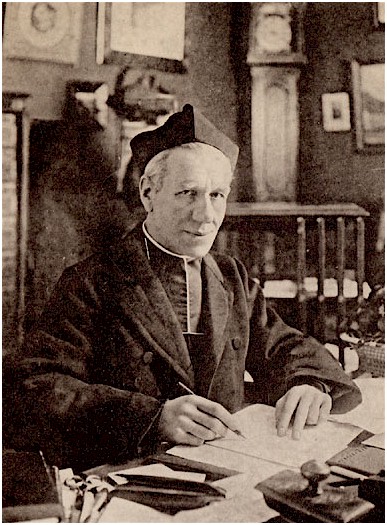
prêtre démocrate, député et
maire d'Hazebrouck, il a bataillé durant trente-cinq ans à la Chambre des
députés pour défendre les droits des plus humbles.
Il fonde en
1896 la Ligue française du Coin de Terre et du Foyer : « Les jardins
ouvriers professent une vocation sociale et défendent un certain ordre social :
s'ils permettent aux ouvriers d'échapper à leur taudis en profitant d'un air
plus respirable, ils les éloignent aussi des cabarets et encouragent les
activités familiales au sein de ces espaces verts. »
la FNJFC (Fédération
nationale des jardins familiaux et collectifs
fédère aujourd’hui 200 associations de jardins familiaux de toute nature, tant
par leur taille que par leur histoire ou leur objet. Elle assure la gestion
décentralisée de jardins familiaux au sein de 50 comités locaux regroupant
environ 6 000 jardiniers et gère directement 3 000 parcelles
réparties sur 70 groupes de jardins franciliens.
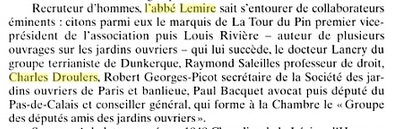
Cent
ans d'histoire des jardins ouvriers, 1896-1996: la Ligue française du ...
publié par Béatrice Cabedoce
Charles Droulers-Prouvost
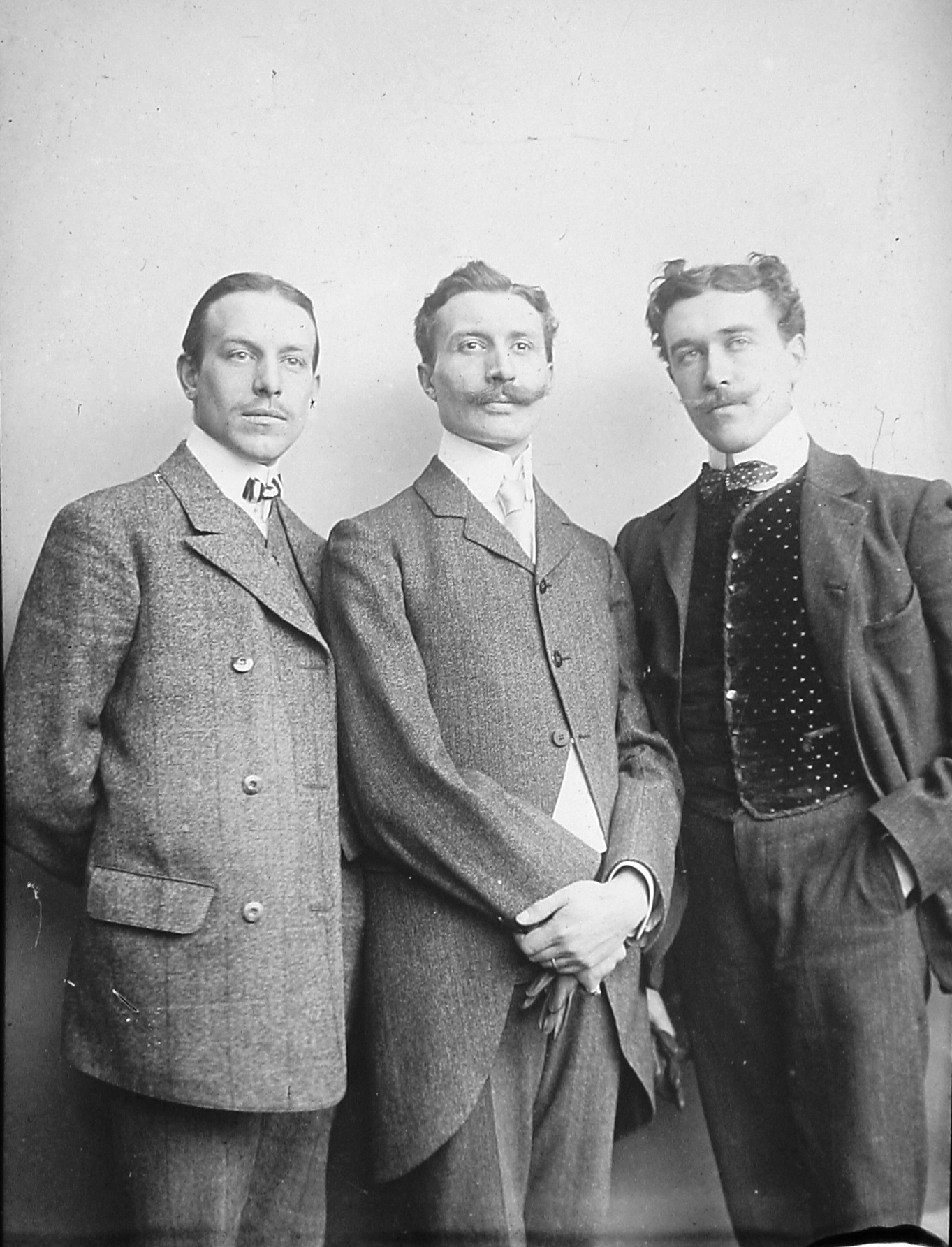
Au
centre, entouré de ses deux cousins germains Amédée 3 Prouvost et Pierre
Lestienne-Prouvost
Docteur en droit, Ecrivain,
Poète, Industriel,
Petit fils d’Amédée I Prouvost,
fils de Joséphine Prouvost,
cousine germaine de Charles I Prouvost et fille d’Amédée I Prouvost, 1845-1919, né
le 29 mars 1872 – Roubaix, décédé
le 17 février 1945 - Chenoise (77, Seine-et-Marne), à
l'âge de 72 ans.
« Noble poète roubaisien » a dit Me
Joseph Crombé, son compatriote et émule. Docteur en Droit, mais aussi homme de
Lettres, ce cousin germain d’Amédée Prouvost le poète publia une étude sur le
chansonnier patoisant Gustave Olivier – suivie d’une autre, sociologique,
« La Cité de Pascal ». Grand voyageur, d’une débordante activité, il
est l’auteur de trois recueils : « Les Rimes de Fer »,
« Les Mansuétudes » et « Feux Errants ». « Sans qu’il
les ait traités avec un égal bonheur, nul des grands thèmes lyriques, toutefois
n’a été négligé par lui. La grandeur ne manque pas à ces évocations et elles
pourront charmer et fortifier plus d’une âme selon le vœu du poète parvenu la
maturité ». (André Mabille de Poncheville).
Il épousa le 6 février 1902
Madeleine Thureau-Dangin 1878-1954, fille de Paul Thureau-Dangin, Membre de
l'Académie française, Secrétaire perpétuel de l'Académie Française en 1908, auditeur
au Conseil d'Etat, Historien et publiciste, Chevalier de la Légion d’honneur
Ami et collaborateur de
l'abbé Lemire, il préside les Jardins Populaires fondés en 1906. Il sera le
secrétaire rapporteur des congrès d’après-guerre de la Ligue du coin de terre
et du foyer. Une autre oeuvre, les jardins du Progrès, est fondée en 1909.
Charles DROULERS, Chemin
faisant avec l'abbé Lemire, in-12 de 252 p., Rivière, 1929,
M. Droulers nous donne en ce
livre, outre divers souvenirs personnels qui ne manquent pas d'intérêt, une
importante étude sur l'activité politique et sociale du député d'Hazebrouck. ,
Sur les divergences de vues entre M. Lemire et la droite de la Chambre, sur les
douloureux incidents qui sont encore présents, dans le Nord, à bien des
mémoires, l'auteur n'insiste pas. Présenté un peu sous forme de causerie, égayé
d'anecdotes,, l'ouvrage se lit facilement.
DROULERS (Charles), 12 bis, avenue Bosquet,
Paris-VIP.
L’abbé Henri
Lestienne-Prouvost 1870-1915
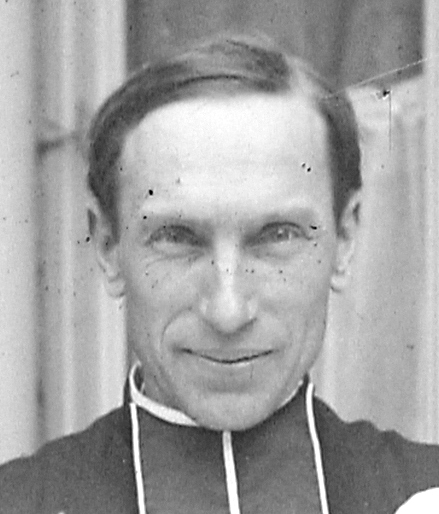
petit fils d’Amédée I
Prouvost,
fondateur des cités jardins
de Lille et de sa banlieue,
organisateur de nombreuses
œuvres ouvrières et sociales, aumônier volontaire de la Grande Guerre, cité par
l’ordre du jour de la 2° armée par le Général de Castelnau, blessé grièvement
le 18 juin 1915 dans les tranchées d’hébuterne, mort à Amiens le 6 juillet
1915, ayant offert sa vie pour ses soldats, pour la France, pour sa famille et
pour toutes ses œuvres de Lille. Il était mystique, foncièrement artiste,
philosophe, fin lettré, très bon gestionnaire.
Auteur en 1907 d’une édition
critique du discours de Métaphysique de Leibnitz. réédition par la bibliothèque
des Textes philosophiques. Paris, J. Vrin, Petit in-8, 94 pages. Le travail
critique est admirablement mené, et semble vraiment définitif.
En 1907, la
Ligue est implantée dans 63 départements.
En 1916, la Ligue est chargée par le
Ministère de l’Agriculture de distribuer une subvention d’Etat destinée à la
création de jardins pour répondre aux problèmes de ravitaillement liés au
conflit mondial. Les pouvoirs publics vont à nouveau faire appel à la Ligue
dans les années 39-45 pour développer de manière accrue les jardins potagers
indispensables en période de pénurie.
En 1918, 65m² par habitant En février 1918, les
autorités allemandes annoncent leur intention de répartir les terres incultes
entre les habitants à raison de 65 m² par tête.
Les moteurs de l’opération furent MM. Watine, Watremez et Carissimo.
Au lancement de l’opération il y eut plus de 30.000
demandes.
En 1920, la Ligue compte 47 000 jardins
ouvriers répartis sur tout le territoire. Les dirigeants bénévoles sont
influents et font avancer la législation dans le sens des jardins familiaux.
Présidents de la République, ministres, écrivains, poètes, savants… soutiennent
le mouvement. Le congrès de 1920 de la Ligue
donne le chiffre record de 32.000 jardins ouvriers à Roubaix, soit près des
deux tiers des jardins ouvriers en France ! Roubaix est alors une ville de
120.000 habitants dont près de la moitié a été mobilisée, déportée,
emprisonnée.
Après la guerre, les congrès de la Ligue permettent de
situer les jardins : neuf sociétés, dont les trois premières citées, rejointes
par les Jardins pour tous, le Coin de terre roubaisien, les Potagers
Populaires, les Jardins de la Sainte famille, les Jardins Beaurepaire, les
Jardins Cordonnier, les Jardin de la rue d’Hem. La fédération des jardins
ouvriers est organisée sous la direction de Louis Watine, très actif avec la
Croix Rouge pendant la guerre. Elle regroupe alors 1500 jardins.
Un concours
des années trente fait apparaître une trentaine de sociétés de jardins ouvriers
de Roubaix, Wattrelos et Hem, dont certains portent le nom de l’entreprise
propriétaire des terrains :
Carissimo,
Motte-Bossut, Allart-Rousseau, Leroux, Cavrois-Mahieu, Pennel et Flipo.
D’autres portent
le nom du lieu où ils se trouvent : Sartel, Constantine, Chemin neuf, Espierre.
En 1935, le 23 avril, la municipalité socialiste roubaisienne crée des jardins
ouvriers dans les secteurs du Nouveau Roubaix et des Trois Ponts, une
fédération se crée et Théo Vanovermeir en est le premier président. De nos
jours, on parle plutôt de jardins familiaux à l’image des jardins de la
Potennerie gérés par le comité de quartier
Durant tout le
20e siècle, les jardins vont s’adapter aux évolutions de la société
française. Les années 70 marquent un net recul du nombre de parcelles :
c’est l’époque des « Trente Glorieuses », années d’expansion et de
développement économique.
En revanche
depuis les années 90, la demande explose littéralement.
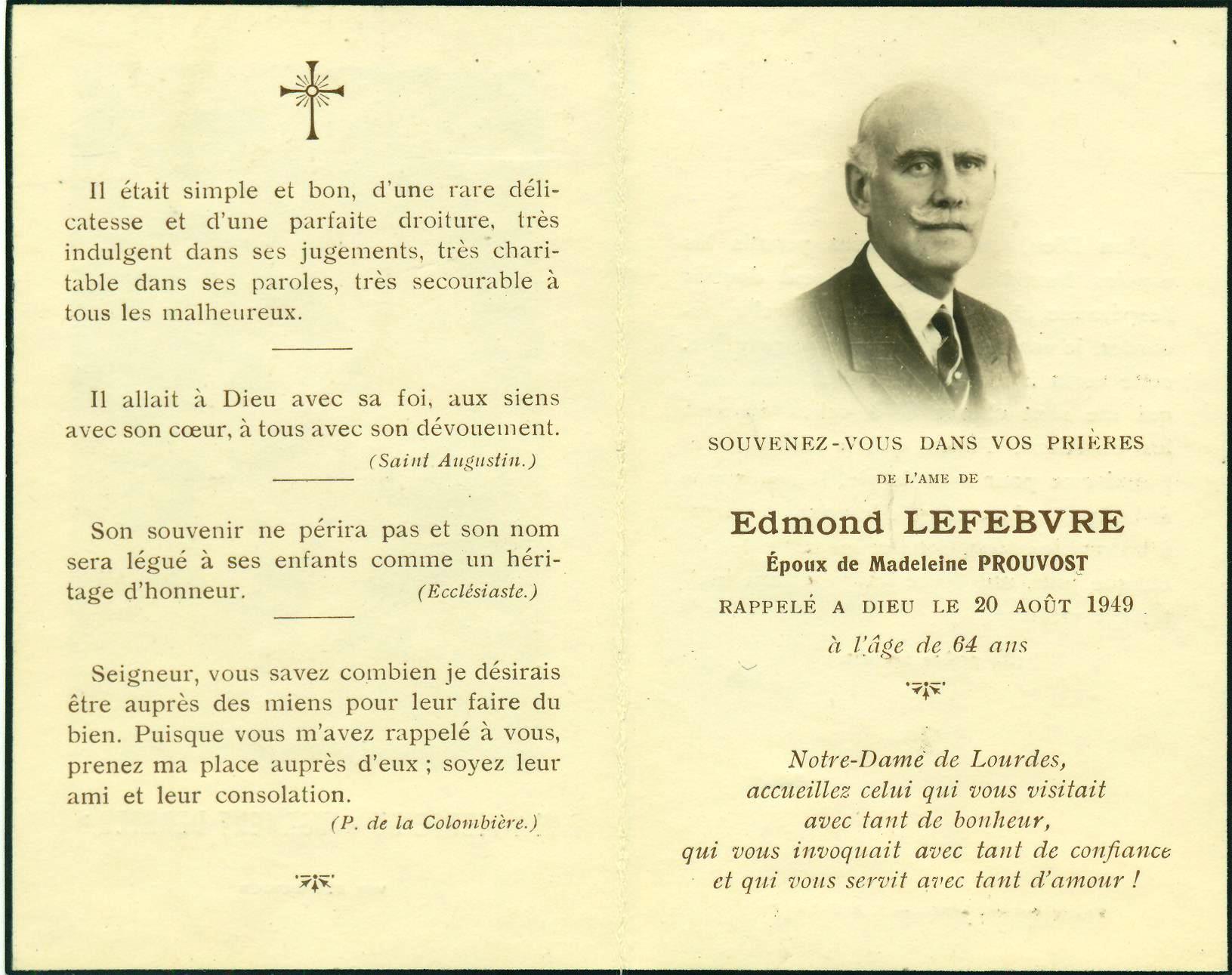
Autres
personnalités :
En février 1918, les autorités allemandes annoncent
leur intention de répartir les terres incultes entre les habitants à raison de
65 m² par tête.
Les moteurs de l’opération furent
MM. Watine, Watremez et Carissimo.
Un
concours des années trente fait apparaître une trentaine de sociétés de jardins
ouvriers de Roubaix, Wattrelos et Hem, dont certains portent le nom de
l’entreprise propriétaire des terrains :
Carissimo,
Motte-Bossut, Allart-Rousseau, Leroux, Cavrois-Mahieu, Pennel et Flipo.
« L'Abbé
Lemire est venu à de nombreuses reprises à Roubaix notamment pour des
conférences sur les jardins ouvriers mais pas seulement. Il vient à
l'exposition internationale de 1911 et le 21 octobre 1918, il entre avec
Poincaré dans Roubaix Libérée. Omer Podvin, natif de Vieux Berquin, élève de
l'Abbé Lemire, militant du Sillon à Roubaix, lance en 1904 au sein l'Institut
Populaire de l'Epeule les jardins ouvriers - 600 parcelles 20 ans plus tard. » Jean-Pascal
Vanhove
« La
population de Roubaix n'a pas oublié les bienfaits des 32.000 jardins qui l'ont
aidée à soutenir les plus durs jours de l'occupation. Et c'est pourquoi sans
doute les créations «le Jardins ouvriers ne cessent depuis lors de s'y
multiplier. Autour des oeuvres anciennes : Jardins Populaires qui comptent en
1920, sous la présidence de M. Droulers, huit groupes et 236 jardins et n'ont
d'autre inquiétude que de voir les demandes se multiplier et les terrains se
faire rares, Jardins de l'Institut populaire fondés par M. l'abbé Podvin,
dirigés aujourd'hui par M. Diligent et comptant 500 jardins, Jardins du Progrès
qui n'ont pas cessé non plus de s'accroître, des oeuvres nouvelles se groupent,
nombreuses : Jardins pour Tous, Coin de Terre Rvnbaisien, Potagers Populaires,
Jardins de la Sainte-Famille, Jardins Beaurepaire, Jardins Cordonnier, Jardins
de la Rue à"Hem... L'éclosion spontanée de toutes ces oeuvres au lendemain
de la guerre dit assez l'intensité des aspirations et des besoins auxquels
elles répondent.
La Fédération
des Jardins ouvriers, organisée sous la direction de M. Louis Watine, a pour
but d'encourager et d'aider tous les efforts en les coordonnant. »
La défense de la France et de sa Civilisation
Suivent
les registres officiels de l'Armée française; n'ont
été gardés que les Prouvost
répertoriés sauf Théodore au parcours
passionnant;
bien d'autres n'ont pas été
étudiés mais seront rajoutés au fur et à
mesure
Officiers blessés et tués pendant les guerres de l’Empire
Tableaux par corps et batailles
des
le supplément des Tableaux par
corps et batailles des Officiers blessés et tués pendant les guerres de
l’empire (1803-1815),
et l’état nominatif des
Officiers blessés et tués de 1816 à 1911
par A. MARTINIEN
Michel-Henri-Joseph
Prévost
baptisé le 8 mai
1783 ( parrain Florentin Prouvost ; marraine Augustine Gruart),
décédé le
15 décembre 1812 à l’hôpital militaire d’Eccles, fusillier de la cohorte de
l’Escaut. Son grand père était Guillaume-Joseph Prouvost époux de Marie
Françoise Destailleurs.
Prouvost, expédition de Morée 1er Bataillon
16 août 1855, Bataille de la Tchernaïa (Traktir), lieutenant, non rattaché.
Annuaires officiels de l'armée française des
années 1824, 1873 et 1914
Théodore-Auguste PROUVOST
1873 Garde Impériale
Troupes Infanterie Voltigeurs- 4° Régiment de Nancy 4° compagnie & dépôt à
Metz Capitaine
Rang d'ancienneté: 23/09/1855 1873 Infanterie en ligne -->
Lieutenant-Colonel Chevalier de la
Légion d'Honneur Régiment: 88ème Rang d'ancienneté: 8
nov. 1870 Non rattaché à la lignée Prouvost.
Théodore Auguste PROUVOST,
lieutenant-colonel commandant le 88e de ligne, chevalier de la
Légion d’honneur, né à Lille le 26 avril 1826, fils de feu
Jean Baptiste Joseph PROUVOST, bailli de la paroisse Saint Etienne de Wazemmes
(Nord), y décédé le 22 juillet 1847, et de défunte Marie Renette MINNIER,
rentière, décédée à Lille le 9 mai 1867.

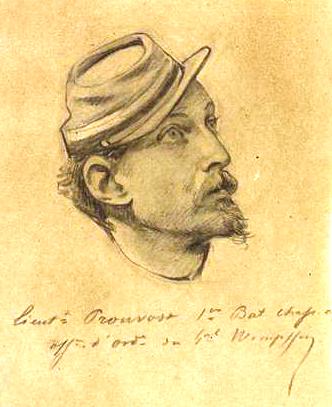

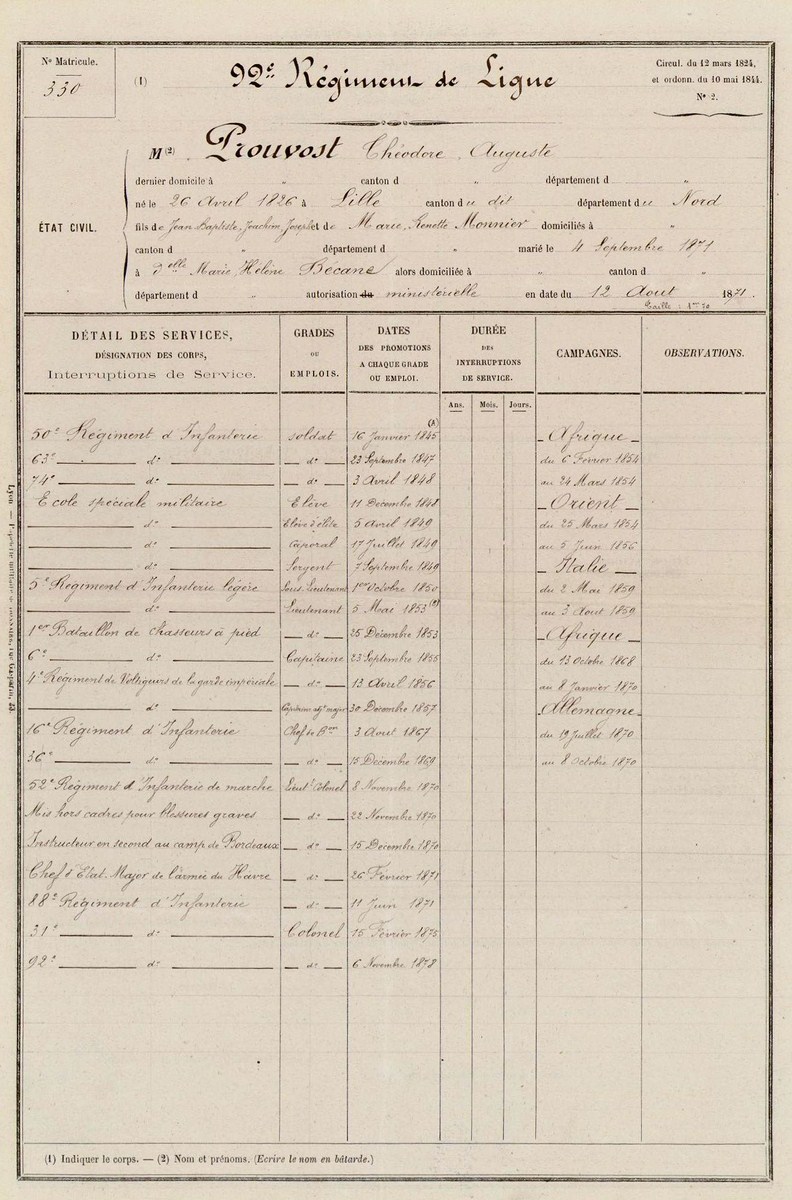
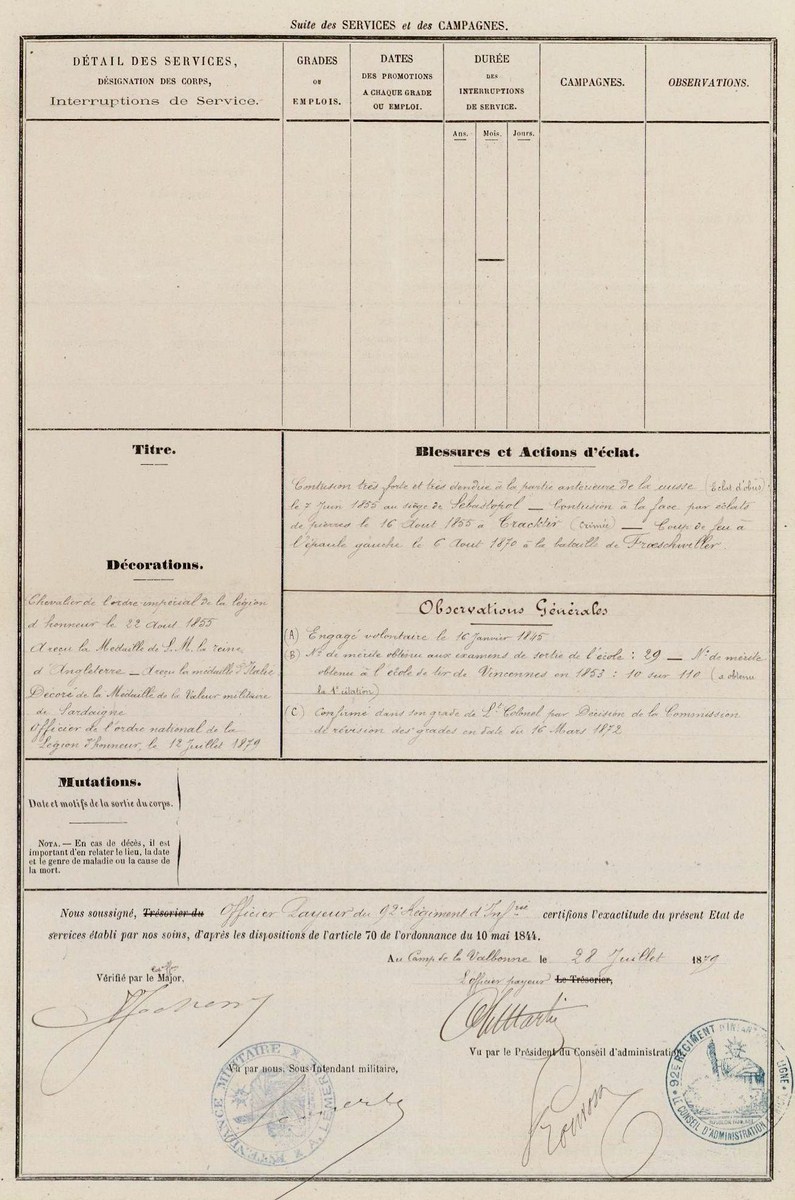
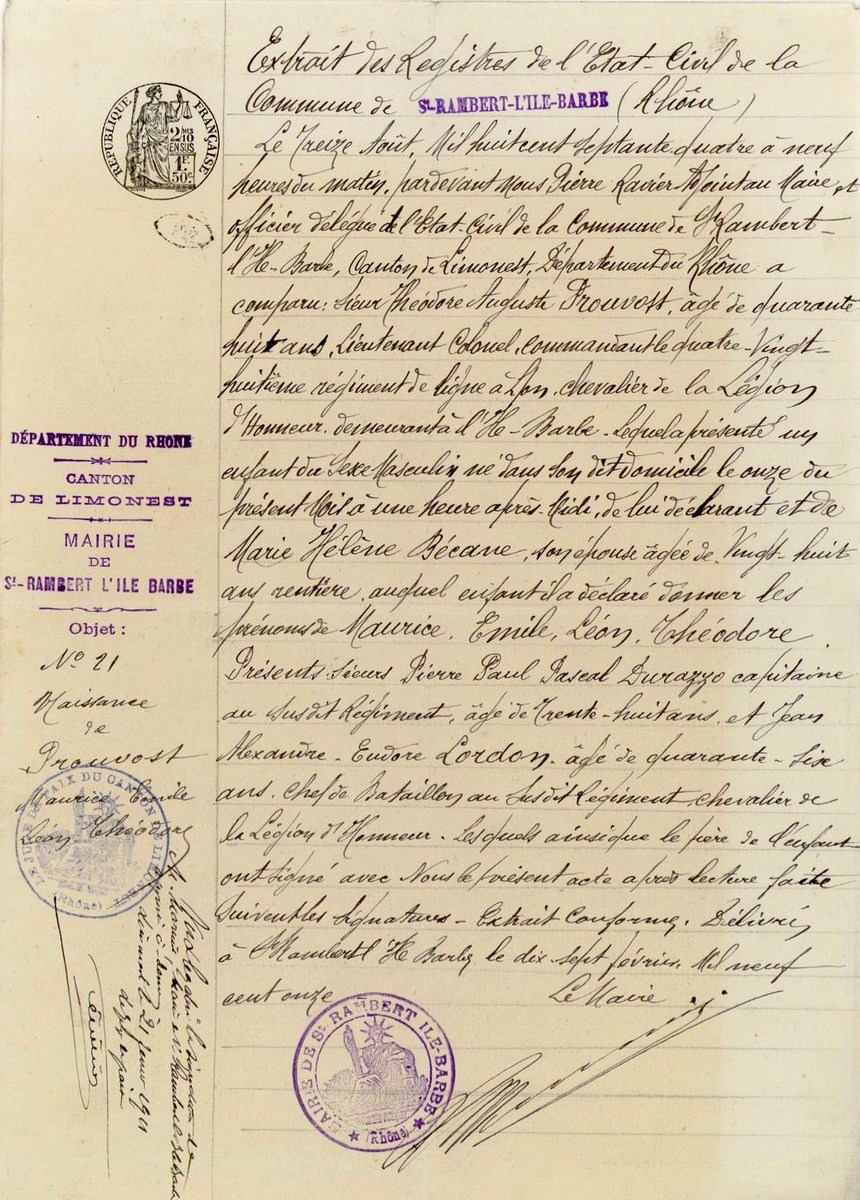
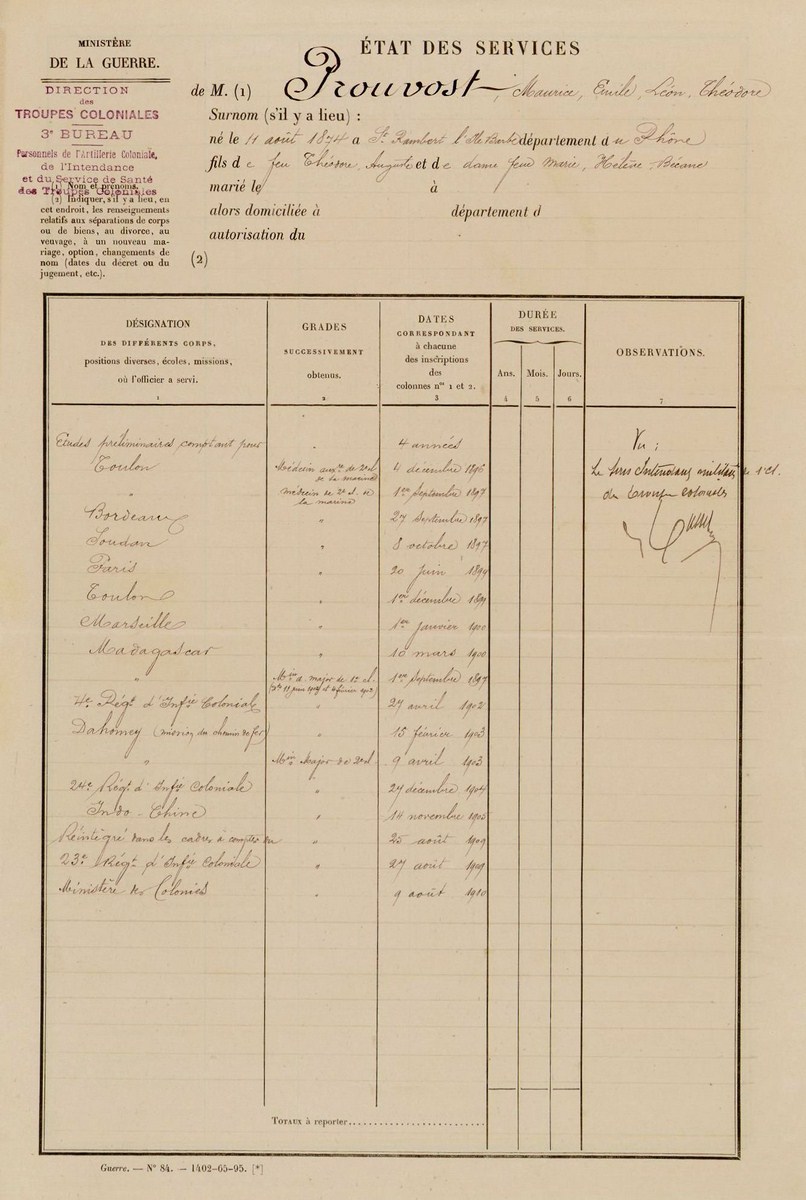
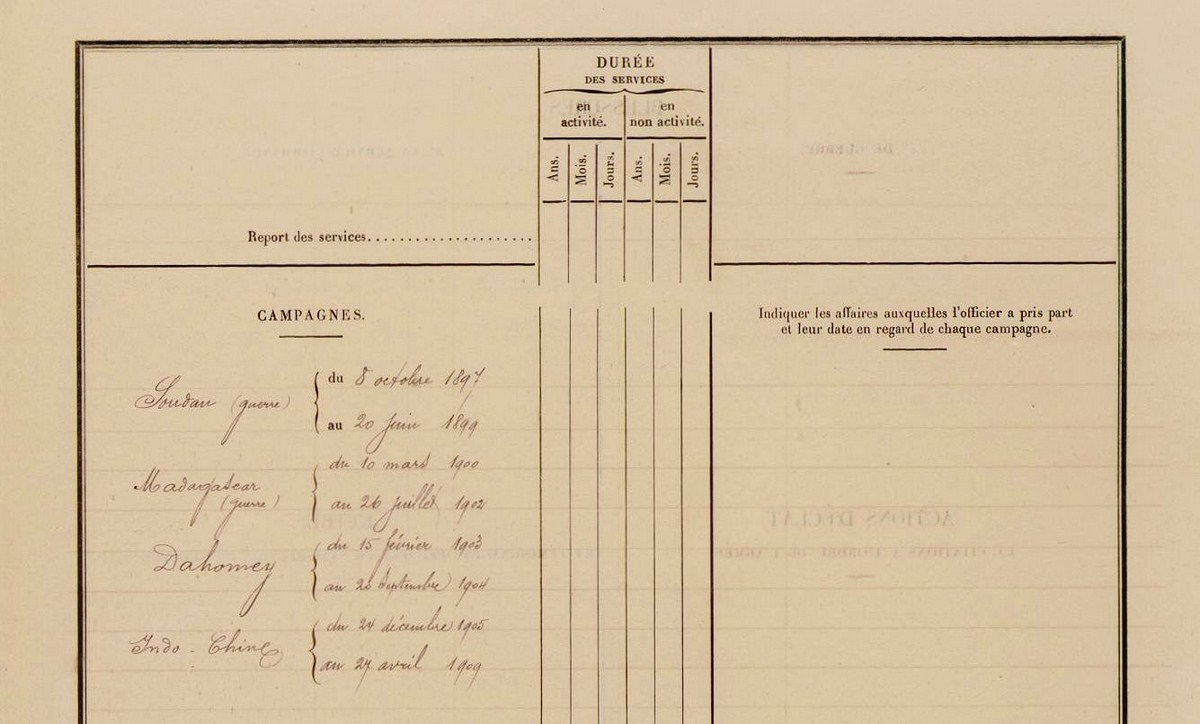
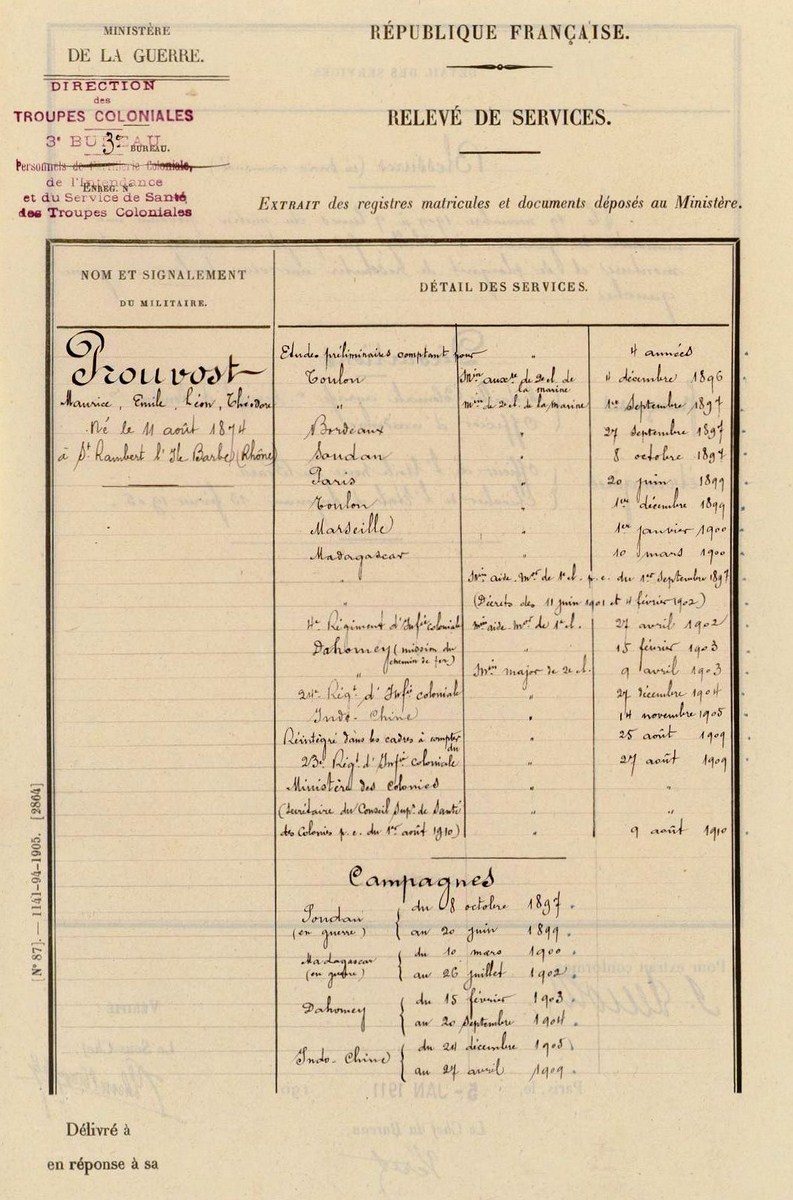
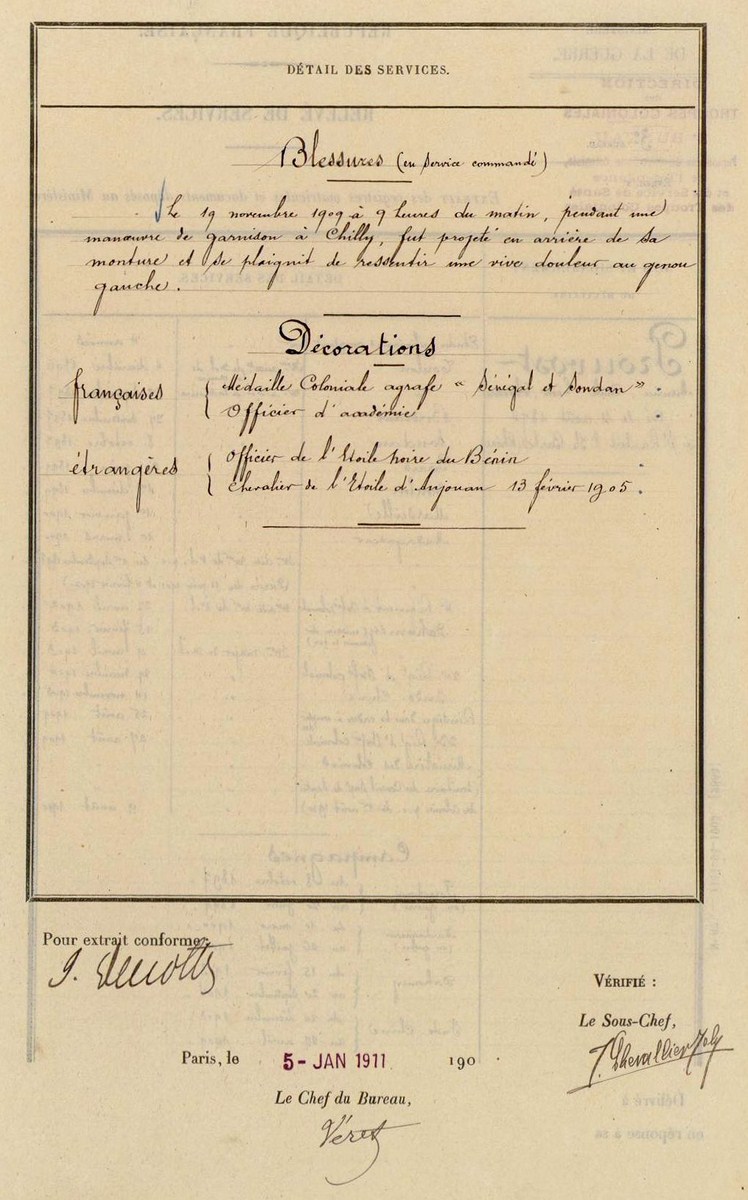
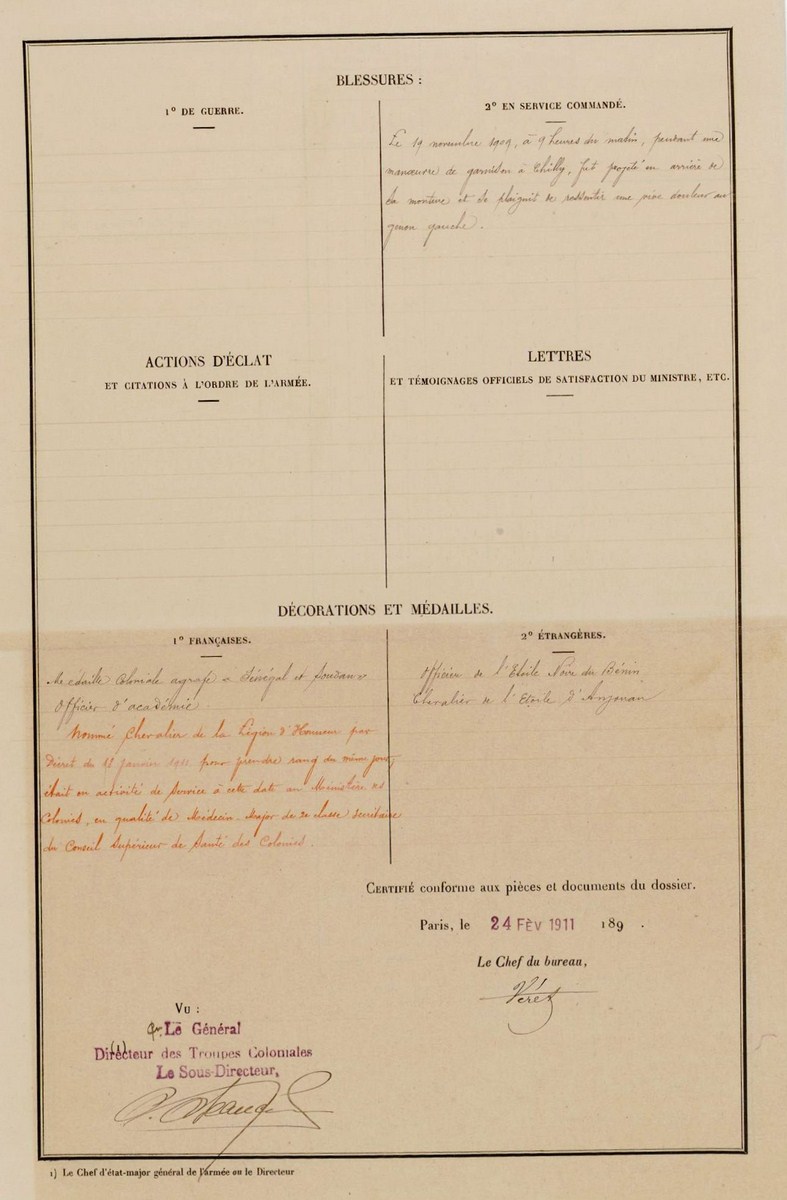
Général
de brigade, officier
de la Légion d’honneur, commandeur du Nichan-Iftikhar,
Théodore Auguste
PROUVOST est décédé en 1885. Il avait
épousé Hélène Marie Aglaé
BÉCANE, née à
Versailles le 2 février 1846, décédée
à Dunkerque (Nord), 18, rue
Alexandre-III, le 1er septembre 1900, à Cahors (Lot) le 4
septembre 1871. Le
contrat de mariage avait été signé chez
Maître LUGAN, notaire à Cahors, le 4
septembre 1871, en présence du baron Emile Alexandre de
MONTFORT, général de
brigade, 56 ans, Paul Jean Jacques LESPINASSE, capitaine
adjudant-major, 43
ans, Louis Honoré DARCY, médecin-major de 2e classe, 50
ans, et Jean Alexandre
LORDON, capitaine adjudant-major, 43 ans. veuve, elle se remaria
au
château de Roquefoulet à Montgeard (Haute-Garonne) le 28
décembre 1886 avec le
marquis Rodolphe Jean Gabriel Charles de CHAMPEAUX d’ALTENBOURG,
né à Toulouse
le 26 juillet 1839, propriétaire rentier, ancien conseiller
général de la
Haute-Garonne, ancien secrétaire d’ambassade, fils de feu
le marquis Léonard
Pierre de CHAMPEAUX d’ALTENBOURG, et de Madame Louise
Aurélie de SAINT-FÉLIX,
âgée de 72 ans, sa veuve. Le contrat de mariage avait
été signé le 23 décembre
courant chez Maître SENAC, avocat, notaire à Toulouse, en
présence du comte
Adrien de BERTIER, 39 ans, propriétaire, demeurant au
château de Pinsaguel,
Benjamin de GENNES, 51 ans, propriétaire à Fonsorbes,
Emile LE CAMUS, avocat,
ancien avoué, 75 ans, et Eugène MARTIN,
propriétaire, 48 ans. Ce mariage a été
dissous par jugement de divorce suivant arrêt de la Cour
d’Appel de Toulouse en
date du 14 décembre 1892, réformant le jugement rendu par
le Tribunal civil de
première instance de Toulouse du 11 août de la même
année, le dit arrêt suivi
de désistement de pourvoi de cassation en date du 3 mai 1893. On
le retrouve
dans L’Annuaire militaire de l’Empire Français
pour l’année 1870. Non
rattaché à la famille étudiée dans cet
ouvrage.
L’Annuaire militaire de l’Empire Français pour
l’année 1870,
publié sur les documents communiqués par le Ministère de la Guerre.
Liste des Officiers et Fonctionnaires
qui ont été inscrits d’après les actes de naissance qu’ils ont produits au
Ministère de la Guerre.
Marie Prouvost ép d'Edmond d'Heilly

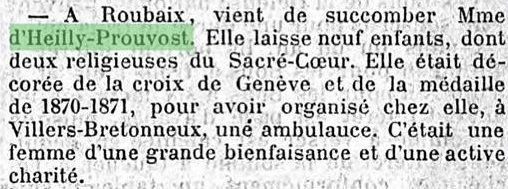
Georges Jules Prouvost,
avocat,
conseiller à la cour
d'appel d'Amiens,
lieutenant des Gardes Nationaux
époux de Marie Lucie de
Mailly ; fils de François Henri Prouvost, avocat Cour de Bruxelles, avoué à la
Cour d'Amiens épx de Julia d'Elhougne ; petit fils de Pierre Constantin
Prouvost (1747-1808), officier de la Garde Nationale.
Après de brillantes études, se destinait au notariat, quand éclata la guerre de
1870. Il fit alors noblement son devoir ; la fin de cette néfaste campagne le
trouva capitaine adjudant-major dans l'armée de Faidherbe et proposé pour la
croix de la Légion d'honneur. Revenu à Amiens il se fit inscrire au Barreau.
PROUVOST Pierre Edouard Joseph
(Branche Henri Prouvost-Florin, né en 1865)
1914 Armée
territoriale-Services de santé militaire-Officiers d'administration du cadre
auxiliaire du service de santé (Réserve d'armée territoriale) officier d'administration de
2º classe Affectation/Fonction: nommé par décret du 20/06/1900 Date
d'affectation: 23/07/1907
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Militaires
distingués de 14-18
(Légion d'Honneur et médailles militaires) durant la guerre de
1914-1918
Branche ainée:
Henri IV Edmond Prouvost 1861-1917

, Chevalier
de la Légion d’Honneur, est décédé
à Holzminden en Allemagne le 22 janvier 1917, Médaille
militaire mle 11642,
soldat au 165e régiment d'infanterie, compagnie de
mitrailleuses: bon soldat,
zélé et plein d'entrain. A été très
grièvement blessé dans l’ accomplissement
de ses devoirs, le 23 février 1916. Amputé de la jambe gauche. Epoux de Laure Jeanne Ernoult, petite
fille de Jean François Ernoult, 1797-1868, maire de Roubaix en 1860 qui reçut l’
Empereur Napoléon III dans sa ville .
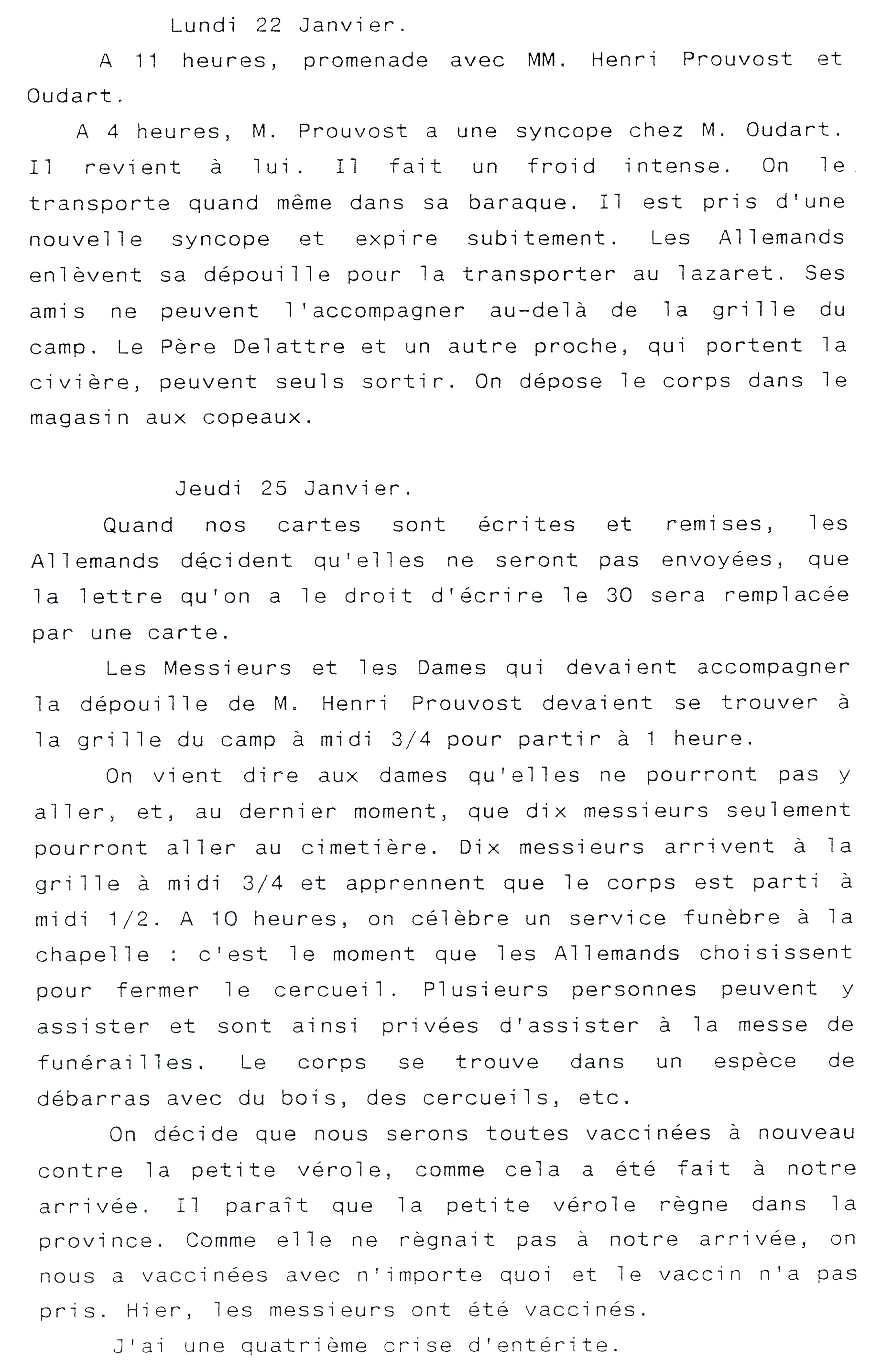
Journal de Madame Edmond Masurel, otage (documents Ferdinand Cortyl)
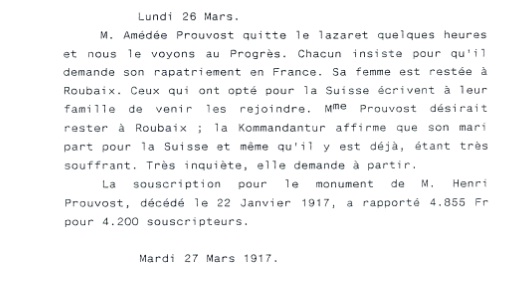
 *
*
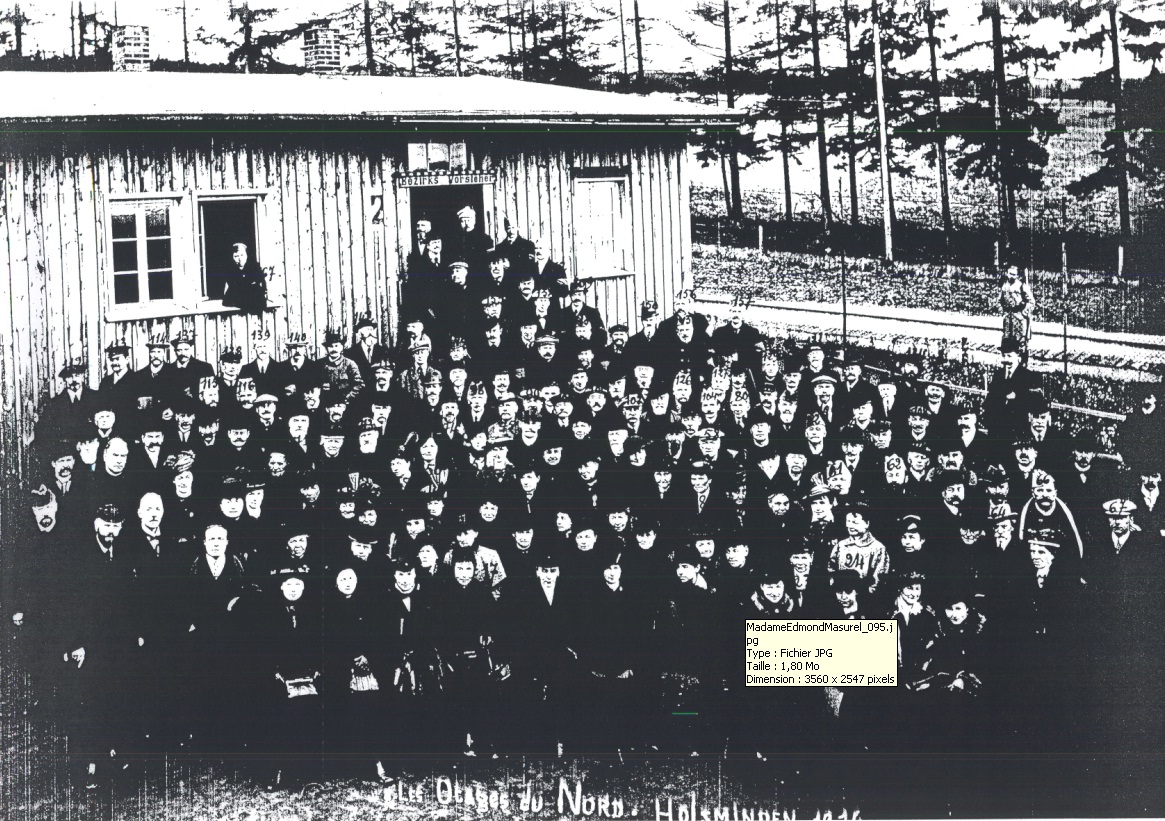
Les fils d' Edmond Prouvost, né en 1863

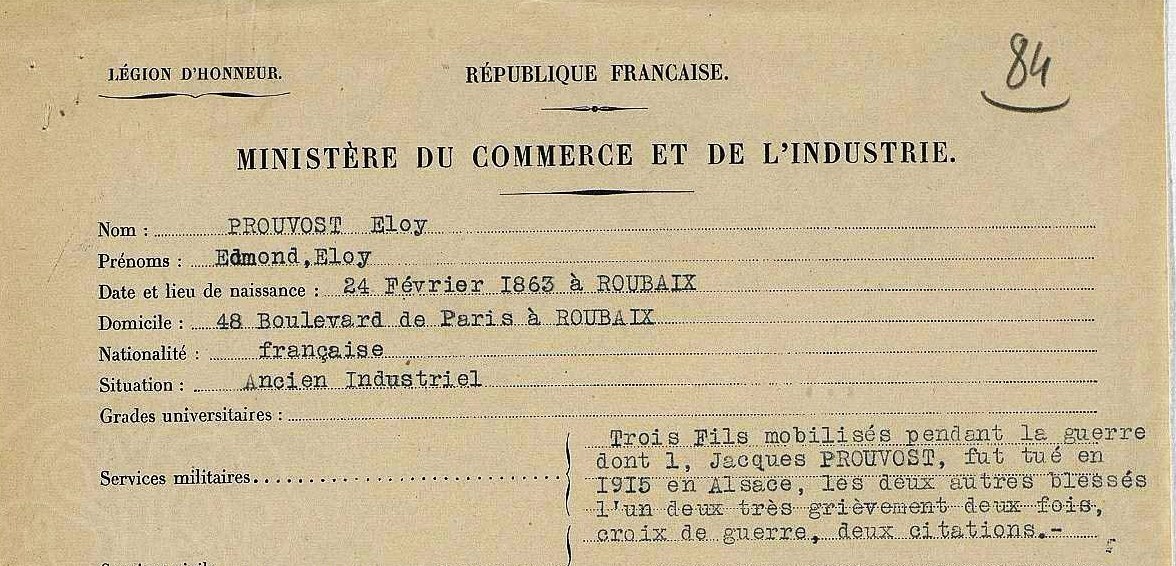
Jacques Prouvost tué en 1915 en Alsace
Les deux autres
blessés, l'un d'eux très brièvement deux fois, croix de guerre, deux citations.
Madame Charles Prouvost-Masurel
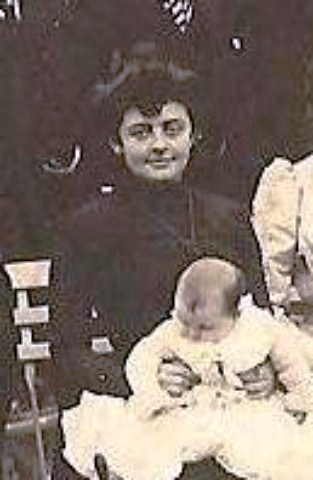
Et sa cousine:
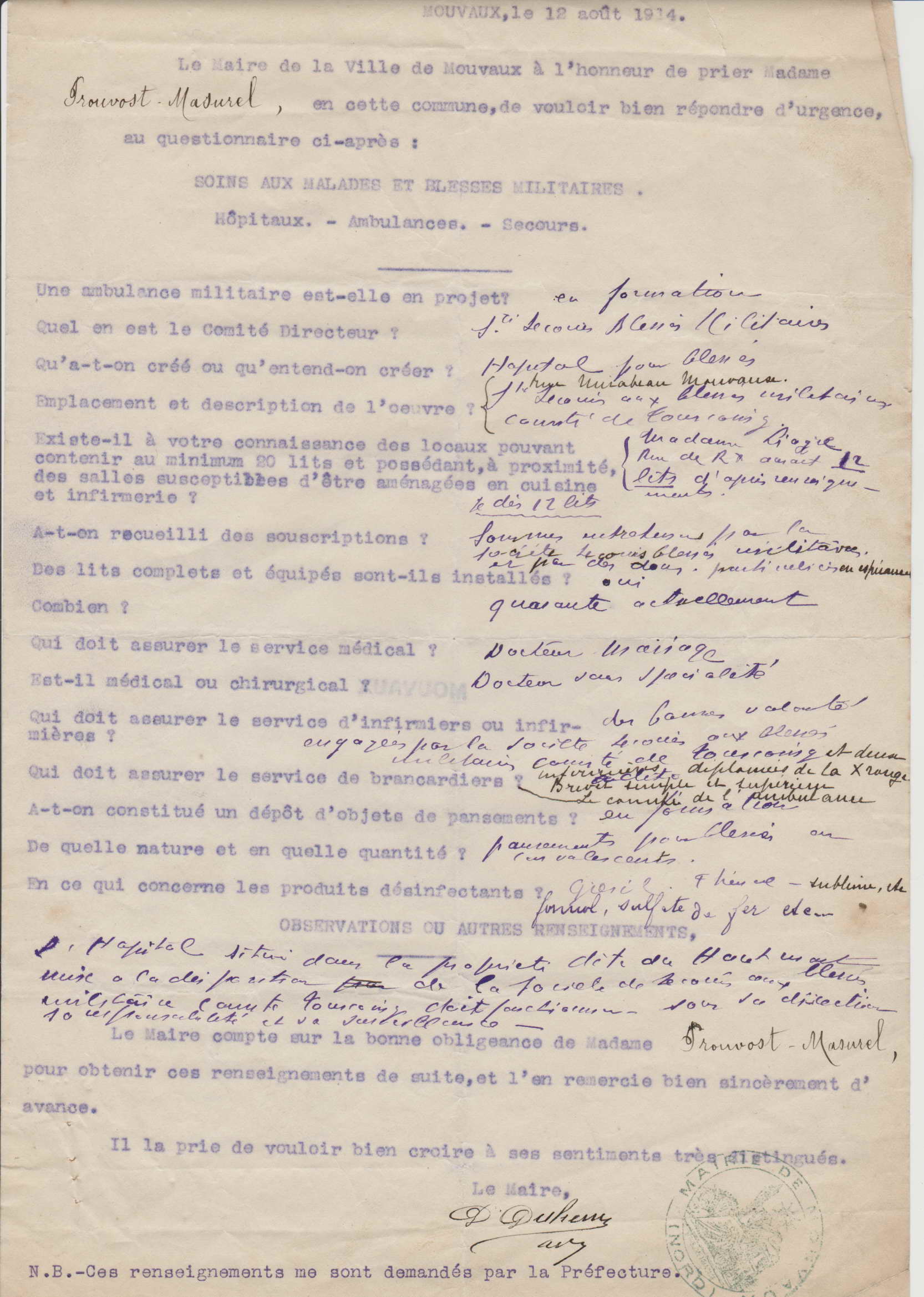
Initiatives de soin des malades de Madame Paul Prouvost-Masurel
pendant la première guerre mondiale. (documents Alain Prouvost)
PROUVOST Georges-Louis-Joseph
né en en 1894, époux de Marthe Virnot, cousin germain de Charles Prouvost, Croix de guerre 14-18
Eugène Maurice
Antoine Prouvost

né le 31 juillet 1895,
Roubaix , s'engagea volontairement dans le RI 43 à Lille, puis blessé
à la jambe au Chemin des Dames près de Berry-au-Bac en 1916,
s'engagea dans
l'aviation et descendit 3 avions allemands entre juin 1917 et 1918 ; ce qui lui
valut la médaille militaire et la croix de guerre avec palmes.
Marie Flipo-Prouvost
Infirmière major de la Croix-Rouge française
Son fils Charles Romain Flipo-Prouvost,
né le 16 août 1884, Tourcoing (Nord), tué le 24 février 1916, Beaumont (Marne),
inhumé
(à l'âge de 31 ans), filateur
Son autre fils Georges Flipo-Prouvost,
fut blessé à Wailly le 15 septembre 1915; décoré de la Croix de guerre.
Le
beau frère de Marie Prouvost , Romain Flipo
eut
l'honneur le 5 mai 1922 de présenter
au Maréchal Foch la délégation des 7151 familles qui ont donné tant de
fils pour la défense de la patrie. Il reçut du Monsueur le Maréchal le
trémoignage de sa plus profonde gratitude. Son fils Romain est mort
pour la France à Hardicourt. Son autre fils André eut une conduite
d'exception.
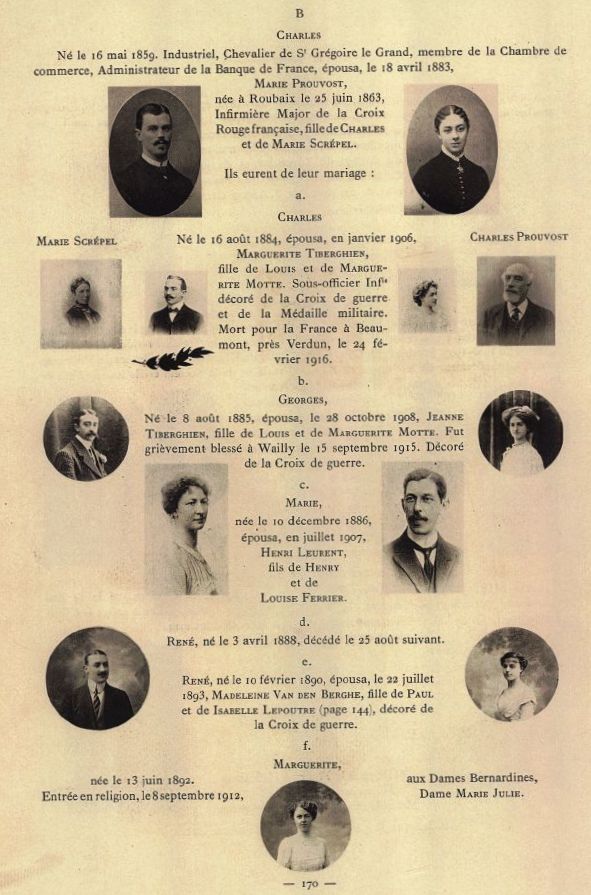
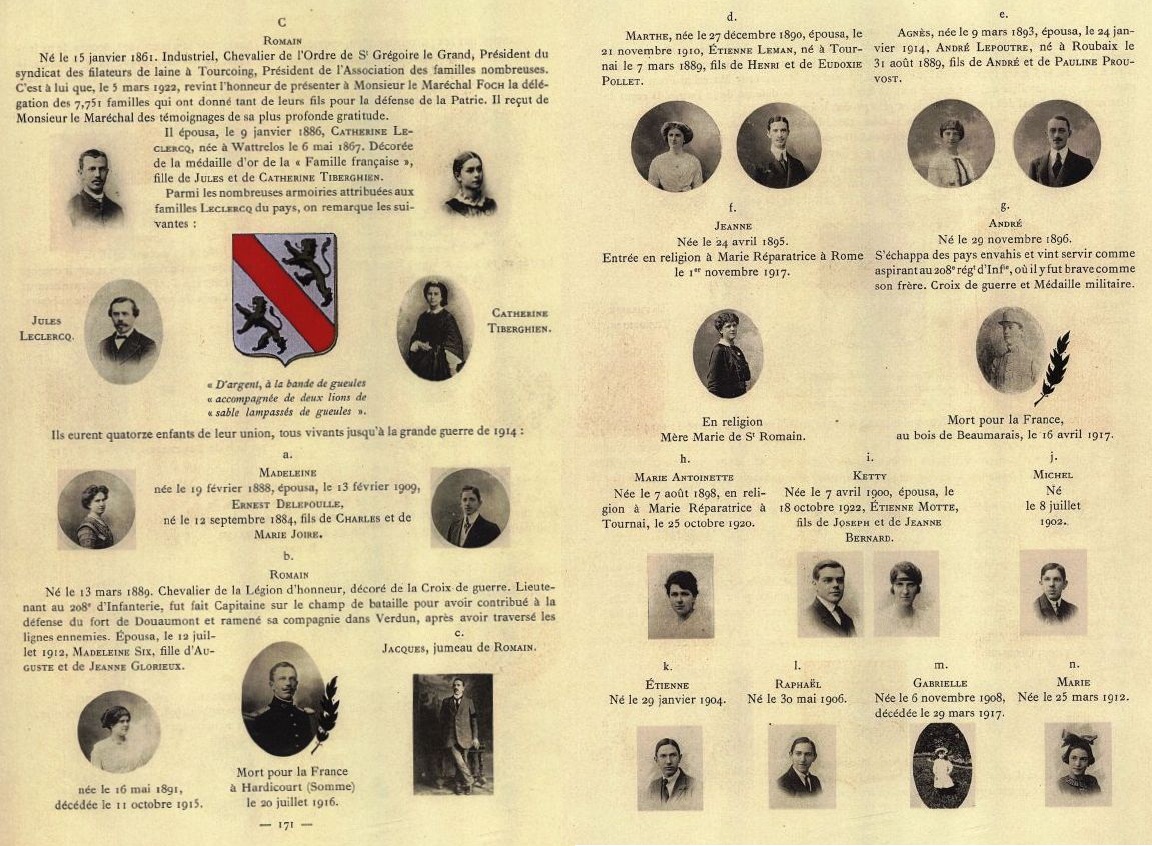
Beaux-frères
de Marcelle Prouvost :
Jacques
Desurmont,
sergent au 33° d’infanterie. Automobiliste au 1° corps, envoyé en
mission de Londres en 1915. Rappelé sur sa demande, entra dans l’aviation,
passa pilote et envoyé au front. Au retour d’une reconnaissance, son appareil
capota près de Moreuil (Somme). Cité à l’ordre de l’armée. Mort pour la France le
27 mai 1916.
Paul
Lefebvre,
sergent au 43° d’infanterie, prit part aux combats de Dinan et à la
bataille de Charleroi. Mort por la France à Saint Gérard, près de Lesve, le 23
août 1914.
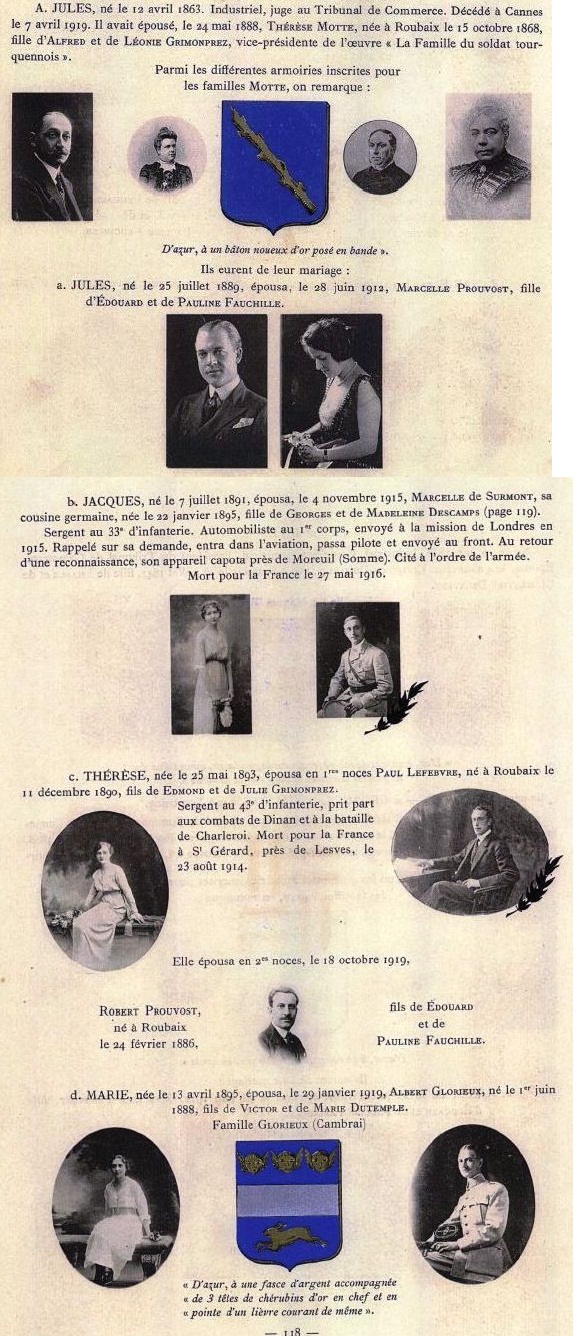
Le beau frère
de Pauline Sophie Prouvost,
Auguste
II Lepoutre, 1861-1932,
refusa de fabriquer du tissus aux Allemands et fut déporté à Gustrow en
1915 puis Holtzminden en 1916
. Il avait 14 enfants.

Jean Lepoutre-Prouvost,
fils d’André
Lepoutre et Pauline Sophie Prouvost né le 28 février 1893, Mouvaux , décédé le
16 septembre 1916, ambulance 18/13 à Guesnel (Somme) (à l'âge de 23 ans),
canonnier au 62e régiment d'artillerie.
Parlons parmi les cousins :
" Trois frères Masurel et trois frères Tiberghien;
François, Alfred, Jean et Raymond Motte morts au champ d'honneur en 14-18
et
nos vingt oncles et cousins, morts au champ d'honneur en 14-18, 39-45
et en Algérie" nous dit Jacques Toulemonde, petit fils d'Amédée 2
Prouvost.
Branche des Amédée:
Amédée 2 Prouvost
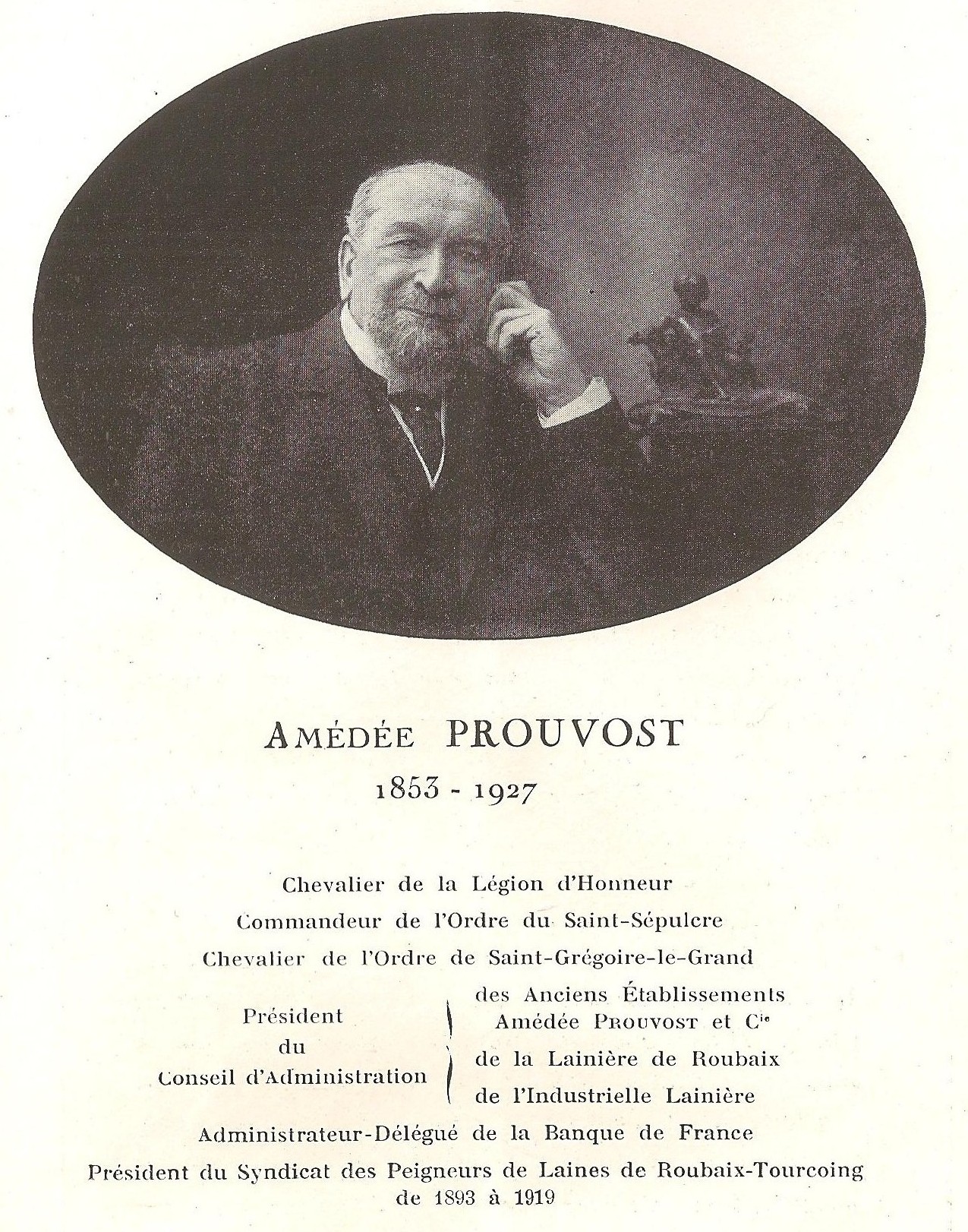
Les allemands internèrent en Allemagne 150
otages roubaisiens issus des grandes familles .Au sujet d’Amédée II
Prouvost : « C'est
pendant la guerre de 1914 que grand-père
donna le plus bel exemple de sa foi patriotique et religieuse. Le 1er mars
1916, il était emmené par les Allemands
avec tout ce que Roubaix comportait de notabilités politiques et économiques,
comme otage au camp d'Holzminden. Cette captivité, écrit grand-mère dans un
petit opuscule « In Memoriam », fut extrêmêment dure pour lui à cause de
sa santé précaire, de l’ infirmité de sa jambe récemment soumise à une
intervention chirurgicale. J'ai eu des échos de l’ admiration qu'il suscita en se rendant à pied, au lieu de
rassemblement. La captivité - elle devait durer 6 mois bien que dure pour un
homme de 63 ans (hiver terrible, couchage sommaire, promiscuité) ne semble pas
avoir altéré sa bonne humeur et dans ses lettres grand-père ne se plaint pas. Il remercie des photos de famille qui
lui ont fait un immense plaisir. En se prolongeant, la captivité lui devenait
de plus en plus pénible. Son cousin et compagnon de captivité, Henri Prouvost,
était mort dans ses bras et cela l’ avait beaucoup affecté. Rien ne manqua à
son angoisse, il fut hospitalisé six
semaines au lazaret du camp, a cause d'une grande dilatation de l’ aorte, qui
donnait des complications cardiaques. Il fut en grand danger. Grand-mère poursuit dans l’
opuscule déjà cité : « Après six mois de captivité, le retour à Roubaix fut une
meurtrissure pour son cœur, trouvant une maison vide de toutes ses affections
et pleine d'Allemands installés en Maîtres . En outre, par suite d'information
erronée, tant à Roubaix qu'à Holzminden, on s'attendait à ce que les otages
libérés fussent dirigés vers la France libre. Grand-mère et Mimi partirent, en
conséquence, pour la France libre, vers laquelle les Allemands organisaient
parfois les trains via la Suisse, et quand grand-père revint à Roubaix, la
maison était vide; il semble d'après les
documents que m'a communiqués Hubert Dubois et dont grand-mère a donné lecture
a ses enfants avec un admirable courage au lendemain des funérailles de son
mari, que grand-père ait été a nouveau inquiète par les Allemands après son
retour de captivité. On lit en effet en date du 12 novembre 1917 :
« En partant au tribunal de
guerre, « je ne cesse de penser à toi,
chère compagne, â mes chers enfants, à mes petits-enfants, et à toute la famille.
Si ma santé devait être ébranlée, et que je succombe dans mon cachot, je
mourrai en bon chrétien et en partant vers Dieu ma dernière pensée , mes
dernières bénédictions seront pour vous. J'ai le cœur qui saigne, mais j'ai l’âme
en paix, je serai courageux dans mes heures de souffrance, je vous embrasse
tous avec affection et tendresse. P.S. Que mes petits-enfants demeurent de bon
chrétiens fidèles à nos traditions familiale
s. « Laus Deo Semper!
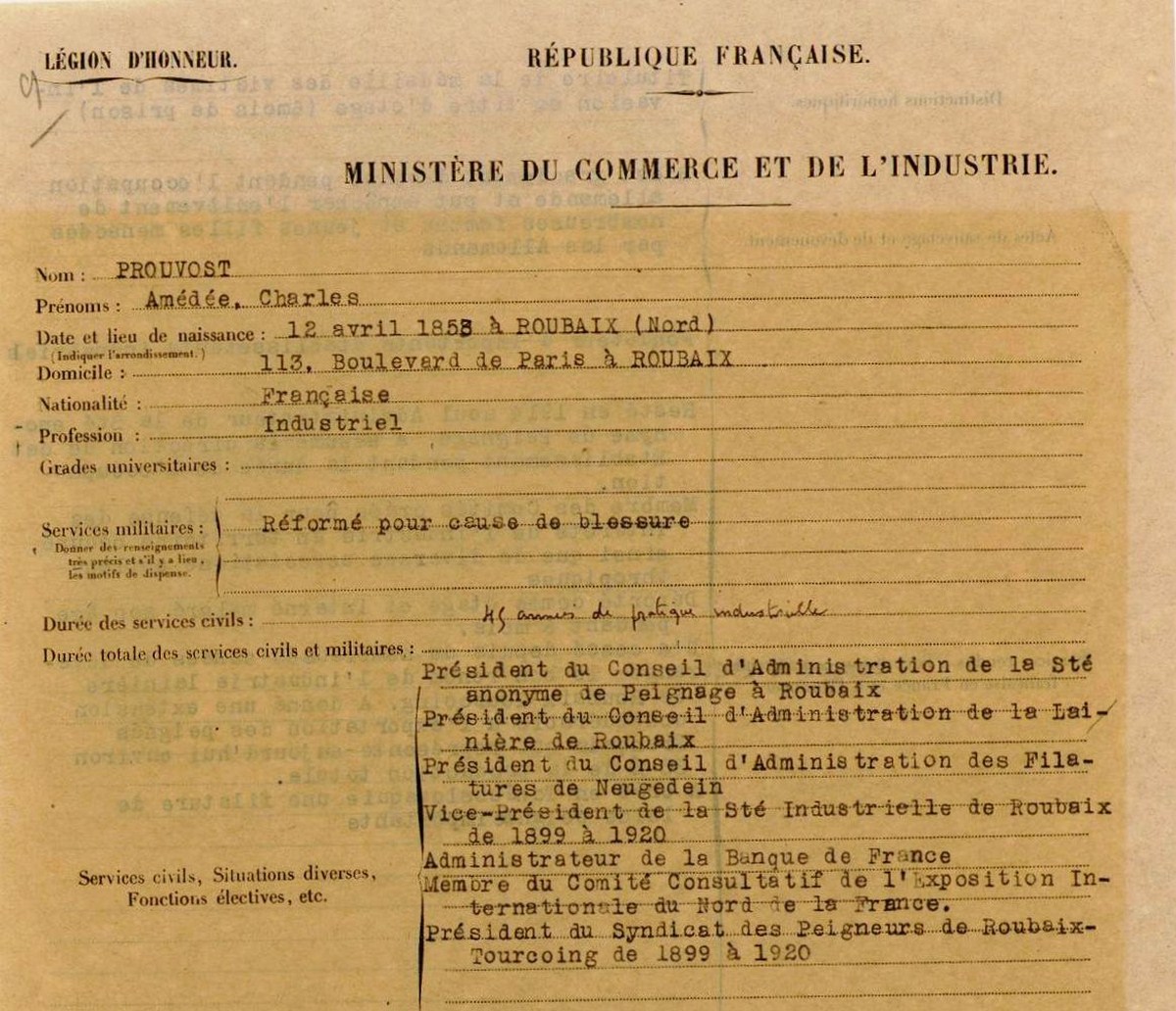
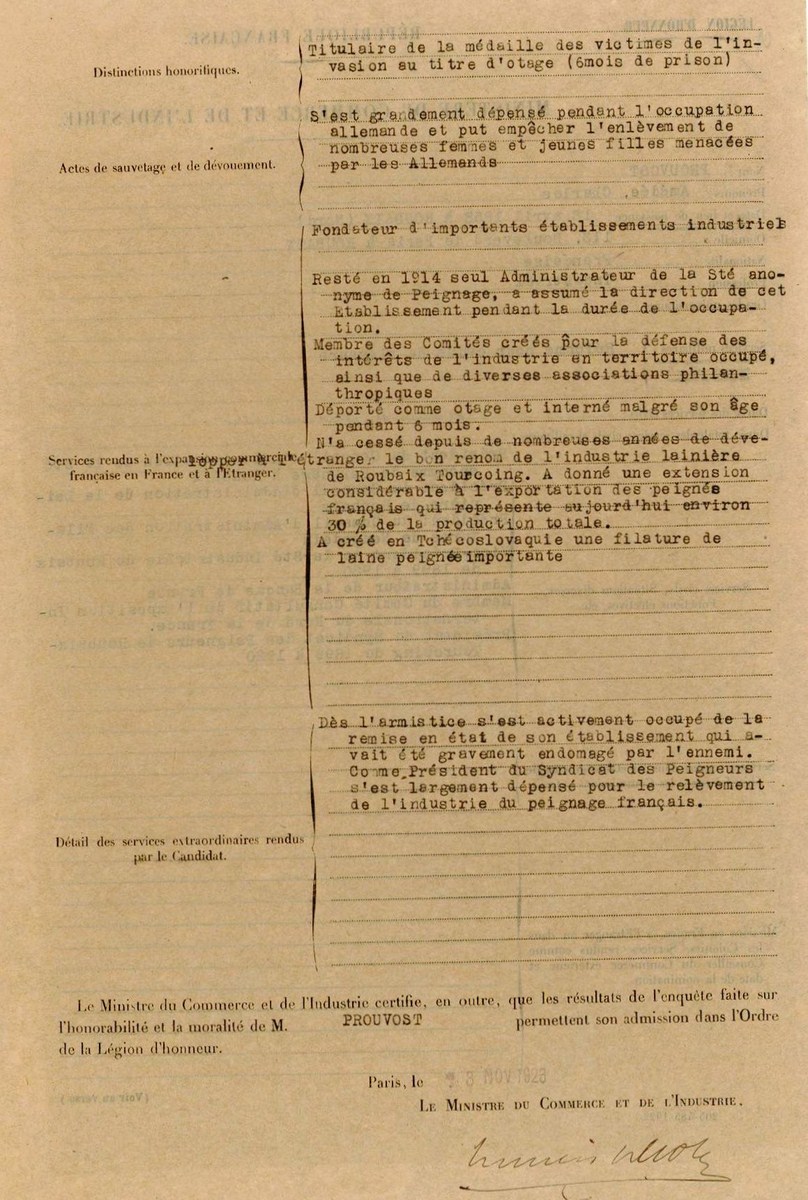
Henri Lestienne-Prouvost
Né en 1870, Décédé en 1915 - Amiens (80, Somme), hôpital, à
l'âge de 45 ans
Né d’Henri Lestienne
1845-1912 et Antoinette Marie Prouvost 1849-1924, fille d’Amédée I Prouvost, « fondateur des cités jardins de Lille et de sa
banlieue, organisateur de nombreuses œuvres ouvrières et sociales, aumônier
volontaire de la Grande Guerre dans la 51° division, cité par l’ordre du jour de la 2° armée par le
Général de Castelnau, blessé grièvement le 18 juin 1915 dans les tranchées
d’hébuterne, mort à Amiens le 6 juillet 1915, ayant offert sa vie pour ses
soldats, pour la France, pour sa famille et pour toutes ses œuvres de Lille. Il
était mystique, foncièrement artiste, philosophe, fin lettré, très bon
gestionnaire ».
« En 1914, autour du 55 de la rue de la
Justice à Lille, l’abbé Henri Lestienne verra fonctionner avec bonheur la
cité-jardin modèle, moderne et lumineuse (soit 46 appartements et 5 magasins
rassemblés autour d’une cour intérieure) qu’il vient de fonder. »
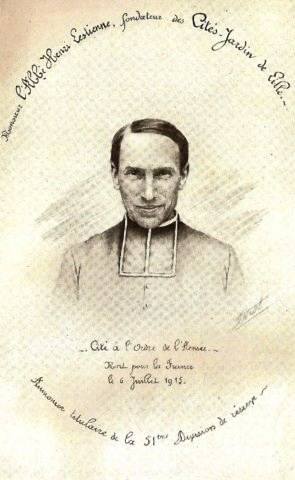
Les petits fils d'Antoinette Prouvost,
Henry Lestienne,
né en octobre 1897, décédé le 7 mai 1919 (à l'âge de 21 ans), maréchal des logis.
Jacques Lestienne,
né en novembre 1898, décédé
en avril 1916, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) (à
l'âge de 17 ans).
Le fils de Jeanne Prouvost, Jules Toulemonde,
né le 28 mai 1899, Roubaix (59, Nord), décédé le 18 septembre 1917, Talloires (74, Haute-Savoie) (à l'âge de 18 ans).
Beau frère de Gabrielle Prouvost, fille d’Amédée, épouse de Léon Wibaux,
Le général Achille
Deffontaines
fut le premier général français tué pendant le premier conflit
mondial, le 26 août 1914 (l’Allemagne a déclaré la guerre à la France le 3
août), alors qu’il commandait sa brigade. Son fils Jean fut tué l’année
suivante, à l’âge de 18 ans. ».

Général de Division le
22.08.1914
Maintenu a titre définitif de la 5éme B.I (composée du 128éme R.I et du 72ème
R.I)
en poste à Amiens à la déclaration de la guerre
Le 22.08.1914 le général REGNAULT, commandant la 3ème D.I lui indique la ferme
de Herpigny - Robelmont (Belgique) comme objectif.
Avec un parfait mépris du danger le général DEFFONTAINES accompagne à pied les
unités du 128ème R.I
Sous les rafales d'artillerie, il reste debout et ne pressait même pas la
marche. Blessé à Virton (B)à 16h00 un obus, après tant d'autres qui l'avaient
épargné, éclate près de lui, et on le voit tomber.
Blessé le 23/08/1914 à Sommethone près de Virton d'une balle de Schrapnel à la
tête
Opéré à Reims
décédé suites de blessures de guerre le 26/08/1914 à l'Hôpital Auxiliaire N°101
à Reims (51) inhumé à Reims (51)
ré-nhumé à Bouvines le 01.03.1921 après que le corps ait été rendu à la
famille.
Un détachement du 128ème R.I lui rend les Honneurs
1er Général Français Mort.p.l.France
sur le Monument aux Morts inscrit sur le livre d'or sur la plaque commémorative
de l'église St Martin d'Amiens (80)
sur le Monument aux Morts de Bouvines (59)
inscrit sur le Mémorial, Hôtel des Invalides
Musée des Armées - Eglise St Louis des Invalides - 129 rue de Grenelle : Aux
Généraux morts au Champ d'Honneur 14-18.
Chev Légion d'Honneur le 29/12/1890
citation O.10éme Armée N°226 - J.O du 4/03/1917
Croix de Guerre 1914-1918
Médaille Interalliée dite de la Victoire
Médaille Commémorative de la Grande Guerre
Vincennes SHD 10 Ye 1517 - A.N L.H 687.22 —
|
|
|
|
|
Willebaud Wibaux 1819-1897
&1844 Stéphanie
Motte 1823-1882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Achille Deffontaines 1858-1914
|
|
|
Joséphine Wibaux 1868-1954
|
|
|
Léon Wibaux 1858-1910
|
|
|
Gabrielle Marie Prouvost
1863-1920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entourage familial:
8-7 Anna Thérèsa Wibaux 1854-1906,
épousa en 1876 à Roubaix, Carlos Eugène Cordonnier, 1845-1921,
zouave pontifical ; on le trouve à Loigny et Patay.
8-12 Sa sœur Stéphanie Wibaux 1865-1928
épousa en 1889 à Roubaix, Léon Paul Cordonnier, 1861-1941, frère du précédent,
Général, Commandeur de la Légion d’honneur.
Leur frère fut
l’autre 8-4 Théodore WIBAUX, Zouave pontifical
à 18 ans pour la défense des états Pontificaux et
Jésuite, né à Roubaix, le 13 février
1849, dans une famille de treize enfants. Son père était
directeur d’une filature. Son éducation fut pieuse. Les
enfants étaient réunis tous les soirs pour la
prière, dans le vestibule devant la statue de Notre Dame,
appelée par eux la Vierge de l’escalier. Il fit ses
études dans un institut de Roubaix, puis comme interne à
Marcq. Il devint membre de la Conférence de Saint-Vincent de
Paul et s’occupa d’un patronage, le dimanche en fin
d’après-midi.
Souvenirs de guerre 1914 – 1918
de Marie-Louise Toulemonde 1874-1957 épouse de Pierre Amédée Lestienne-Prouvost
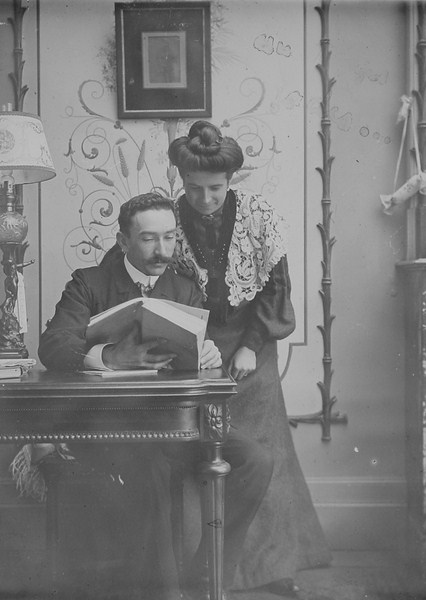
« Malgré les angoisses, on n’en réalise pas encore toutes les
horreurs.
A ROUBAIX, on craint des troubles. Comme nous habitons Rue Neuve, au centre
de la Ville, nous allons chez mes parents, 49 Rue Saint Georges, la maison ne
donnant pas directement sur la rue. Mes belle-sœurs font de même. Nous sommes
une cinquantaine : on couche par terre et les enfants dans des paniers à linge.
Le calme revient : chacun rentre chez soi.
Le 24 Août, les Allemands sont à BRUXELLES. Ici, c’est la panique. Mes
parents partent pour DINARD, avec les familles de Joseph et Pierre TOULEMONDE.
Pour moi, je ne songe pas à partir : mon mari n’étant pas mobilisable à cause
de ses nombreux enfants. Mais au début d’Octobre, les Allemands demandent
l’inscription de tous les hommes. Mon cher mari part au début d’Octobre pour la
France libre. Je reste seule, bien angoissée, attendant mon 15ème enfant.
L’Abbé part avec son père pour reprendre ses études au Séminaire d’Issy. Henry
a 17 ans, je le garde avec moi. Mais peu de temps après, les Allemands demandent
l’inscription des jeunes. Je le mets en pension chez les Jésuites au TOUQUET
(Belgique) attendant la première occasion pour le faire partir pour la France
libre. La frontière belge est bien gardée, et je dois user de stratagème pour
aller voir Henry, en trompant la surveillance des Allemands.
Le 9 Décembre 1914, naissance de Marie-France : belle grosse fille que son
Papa ne connaîtra que quand elle aura 10 mois. Nénette, encore bien jeune, est
une bonne société et un soutien pour moi.
Je n’ai plus qu’un désir, c’est de partir en France libre. Mais comment,
avec mes 13 enfants ?.. Il faut d’abord que je mette Henry en sûreté. Après
bien des hésitations, je le confie à un forain spécialisé comme passeur. Il
part au début d’Avril, avec Maurice PENNEL, Séminariste, ami de l’Abbé, qui
sera tué quelques mois plus tard. Henry lui-même, mourra des suites de gaz
asphyxiants quelques mois après l’armistice, bien triste de n’être pas mort au
front. Le voyage est difficile : 80 kilomètres à pieds, trompant la
surveillance des Allemands, passant la nuit dehors, se traînant sous les
barbelés pour arriver en Hollande, et de là à BOULOGNE où il retrouve son Père.
Je suis sans nouvelles de lui pendant plusieurs semaines et bien angoissée, car
les Allemands tirent souvent des coups de feu à frontière. Grande joie de son
Père. Henry s’engage à 17 ans I /2 pour ses classes dans l’artillerie et part
pour le front en Avril et il est blessé au genou et hospitalisé à NORTON. Il
sera gazé à la forêt d’Hothulst (Belgique) et réformé.
En Avril 1915, je commence mes démarches pour partir en France libre. Elles
n’aboutiront qu’en Septembre, après bien des difficultés et des déceptions.
Nénette est mon bras droit et mon ange gardien ; elle a pris ma cause en mains
et se débat dans les commandanture. Ses frères et sœurs ne se rendront compte
que plus tard de son dévouement.
En Mai 1915, les Allemands donnent des laisser-passer aux Français habitant
la Belgique pour retourner en France libre. Par la complaisance d’une famille
amie : Me LEFRANCOIS à qui je dois beaucoup de reconnaissance, j’obtiens de me
faire domicilier chez elle à HERSEAUX, ce qui avait de graves inconvénients,
(comme on le verra par la suite). Les Allemands font des enquêtes chez Me
LEFRANCOIS. J’y laisse plusieurs enfants qui ont consigne de dire que leur mère
est en courses. Je demande un certificat de malade pour partir plus facilement,
et je suis appelé à BRUXELLES où un médecin allemand, bon cœur, me donne un
certificat de complaisance « maladie de cœur, très grave », pour que je puisse
rejoindre mon mari. Un laisser-passer en bonne forme arrive à HERSEAUX en
Septembre. Je dois passer la frontière belge en fraude avec 13 enfants ; le
cœur me bat, je passe la dernière. A la frontière hollandaise, fouille
minutieuse. J’avais de faux papiers pour Jacques, et de l’argent français : à
BRUXELLES on m’avait dit que je ne pouvais pas l’emporter. Je passe la nuit
avec Nénette à le cacher dans les ourlets des robes. On le trouve, mais la
femme qui visite a encore pitié de moi et de mon troupeau d’enfants, et me le
rend.
Donc, les Allemands, furieux de mon départ de ROUBAIX, où j’étais inscrite,
se vengent sur ma belle-mère : A.M.LESTIENNE, âgée de 65 ans et qui habitait
chez sa fille, Me Joseph TOULEMONDE. Ils
vont la réveiller le soir à 11 heures et veulent l’amener en prison. On obtient
sa grâce pour le lendemain. Elle peut se défendre en montrant une lettre que je
lui avait écrite lui disant que « j’étais tout à fait brouillée avec elle, que
j’étais partie sans lui dire au revoir, qu’elle n’avait pas essayé de m’aider
pendant cette guerre, et qu’elle ne savait pas ce que j’étais devenue ». Grâce
à cela, elle a été relâchée.
J’arrive à FLESSINGUE (Hollande) vers 11 heures du soir. Nuit dans un hôtel
borgne près des quais. Les enfants couchent 5 ou 6 dans le même lit, et moi,
dans un fauteuil. Le lendemain, visite au Consulat où l’on me donne les papiers
pour l’Angleterre. Embarquement le soir pour TILBURY. Longues formalités de
douane. Les jumelles tombent par terre, endormies. De FLESSINGUE, j’envoie un
télégramme à DINARD, à mon cher mari, qui arrivera à LONDRES deux jours plus
tard. C’est dans la Gare de CHARING CROSS que nous nous retrouverons. Je passe
sous silence la joie de revoir.
La traversée a été bonne – 36 heures – à TILBURY où je débarque, les
Anglais me demandent des renseignements sur les armées allemandes qui sont à
ROUBAIX. Je retrouve à LONDRES mon frère Louis et des amis. La guerre semble
terminée pour moi avec le revoir de mon cher mari. Les épreuves recommenceront
vite avec la mort de mon cher papa à DINARD, celle d’Henry à Paris et de
JACQUES à ST GERMAIN.
De FOLKESTONE, nous partons pour DIEPPE. Le bateau est convoyé par des
avions car des sous marins sont signalés. Je ne crains plus rien maintenant que
mon mari est avec moi. Les Dames de St Maur à AUTEIL nous hébergent dans leur
pensionnat. Tous les maris éplorés viennent me demander des nouvelles de leurs
femmes et de leurs enfants restés à
ROUBAIX. Trois mois plus tard il y aura des trains de réfugiés. Je pars pour
DINARD (Septembre 1915) où je revois mon cher Papa qui mourra quelques semaines
plus tard. Puis c’est ST GERMAIN où Jacques sera opéré de l’appendicite et
mourra le 27 Avril 1916.
ST GERMAIN est loin de PARIS ; les communications sont difficiles et mon
mari ne peut revenir déjeuner. Les DOGUIN mettent à notre disposition le 56,
Rue du Docteur Blanche à AUTEUIL, maison spacieuse, quartier agréable. Les
enfants jouent sur la rue comme au village. L’hiver se passe tranquillement.
En Septembre 1917 commence l’idylle entre Nénette et Marcel. Ce dernier est
interné en Suisse, comme grand blessé, après avoir eu une conduite héroïque
pendant la guerre. Blessé très gravement en Septembre 1914, il reste plusieurs
jours sur le champ de bataille ; ses plaies s’infectent et il est transporté
mourant, comme prisonnier de guerre en Allemagne. Quelques mois plus tard, a
lieu l’échange des grands blessés et il est dans les premiers à être interné en
Suisse. Après l’enfer de la guerre, ce séjour est pour lui un paradis
terrestre. Il demande la main de Nénette qu’il connut avant la guerre, revient
en France : première rencontre à Notre Dame des Victoires, et ce sont les
fiançailles, puis le mariage en l’église de l’Assomption : beau militaire en
uniforme bleu horizon de la couleur de ses yeux, médaille militaire, légion
d’honneur. Puis c’est le repas : 50 personnes à table, repas du grand traiteur
de PARIS : POTEL & CHABOT; quelque noce après ces années de privations,
chant des enfants composé par Père. L’hiver 17 se passe tranquillement et
tristement. En Avril 18 les Allemands tirent sur Paris avec la grosse Bertha
installé en secret. C’est la fuite générale. Nous partons pour le VAL ANDRE où
Henry est hospitalisé, et c’est le début de la grande offensive dirigée par
FOCH et qui mettra fin à la guerre. Le 12 Juin c’est la naissance de mon 16me,
Louis ; baptême à PLENEUF, dragées lancées aux enfants, et le 4 Août, la joie
recommence avec la naissance de Marcel Fils. Comme l’hiver sera dur au Val
André où il n’y a ni charbon, ni électricité, nous refaisons des bagages pour
la 10me fois et nous partons pour la BAULE, avec Henry cette fois, qui a été
réformé. François et Claire y font la scarlatine et sont soignés par une bonne
sœur … qui n’a de bon que le nom. Henry devenant plus malade et l’armistice
étant conclu, adénite généralisée suite des gaz, nous retournons rue du Dr
Blanche où Henry mourra le 7 Mai 1919. Il sera enterré dans la crypte de la
chapelle espagnole, par faveur, en attendant le retour de son corps à ROUBAIX.
Puis nous passons l’été au BOUQUETOT, près de Pont l’Evêque. Et c’est le retour
à ROUBAIX en Septembre 1919. Il nous manquait Henry et Jacques, morts
tous deux saintement : Que la volonté de Dieu soit faite. »
Albert-Félix Prouvost
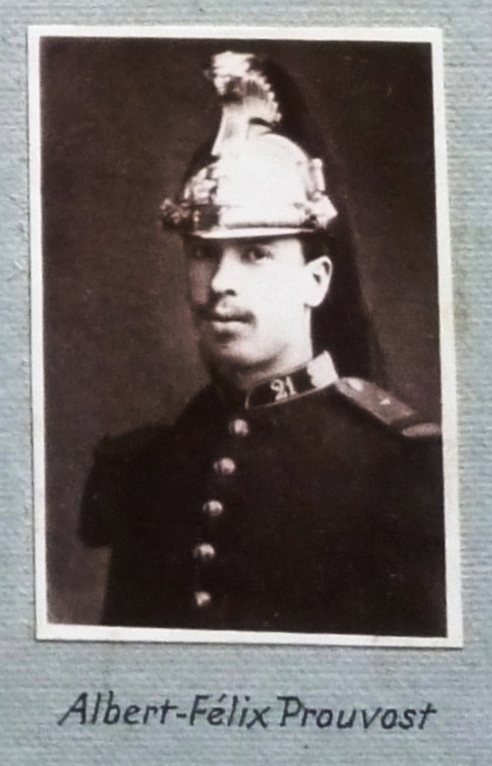
« Notre père (Albert-Félix
Prouvost) avait insisté vivement auprès de notre mère
pour la décider à quitter Roubaix. Par sa position au Peignage, son titre de
président du tribunal de Commerce, il jugeait que son devoir impérieux était de
rester à son poste » Albert-Eugène Prouvost
Il avait été emprisonné comme notable puis
relaché en sa qualité de Consul d’Espagne, il avait défendu pied à pied nos usines contre
les réquisitions de l’ ennemi. Il était
un des dirigeants du Comité général d’aide sous toutes ses formes à la
population ouvrière très éprouvée ; il décéda des suites d’une opération bénigne
après avoir écrit des lettres empreintes
des mêmes sentiments de foi en Dieu et dans une France renouvellée par l’ épreuve.
Dans les trois derniers mois, il marque
sur ses carnets ceux chez qui il fut
invité : les Emile Masurel, Edmond
Masurel, Madame Auguste Vanoutryve, Amédée Prouvost, Henri Mulliez, Ernest et
François Roussel, René et Joseph Wibaux, Eugène Mathon ; le 31 mars :
« dîner chez les Edmond Masurel ». Le 5 avril, il succomba à son embolie.
Les élus socialistes prononcèrent des
discours empreints de la meilleure reconnaissance
pour l’ œuvre accomplie.Albert-Eugène Prouvost
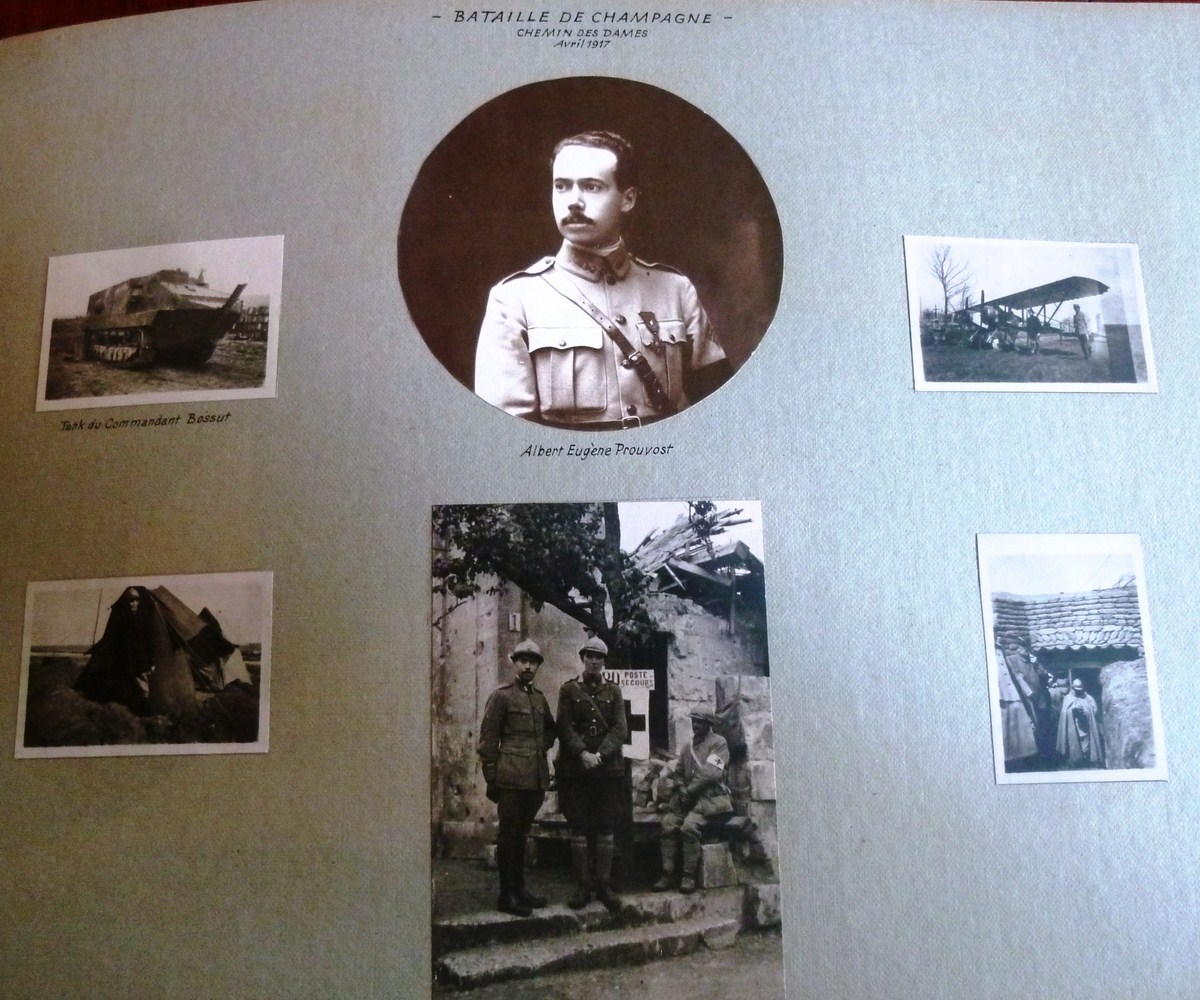
Robert Prouvost
né le 24 février 1886, Roubaix ,

Photo Ferdinand Cortyl
« Il était officier de liaison entre deux généraux, son cheval tué sous lui, grand
blessé : on veut lui couper la jambe dans un hopital de campagne ce qu’il
refuse, se fait prendre par un taxis de la Marne, est opéré et sauvé à
Deauville. Il repart en Russie où les huileries de Roubaix et d’Odessa sont
dirigées par lui : hélas prises par les Rouges.Les deux directeurs partent
sans prendre rien avec peur.Robert fut toujours lié à l’huilerie ; stages
à Marseille où il veut s’installer après la Russie : toujours en avance de
deux générations. A Verminck et
Valabrègue à Marseille, deux sociétés valables mais mangées par les
actionnaires.En 1937, décu d’essayer le Sénégal poursuit le projet d’allier les
coopératives de production sénégalaises et celles de consommation en France
avec une société roubaisienne : ce fut un succès. Il fut un génie de la
construction. Il fut « un second frère » d’Albert Eugène
Prouvost : « Entre la vie du Nord qui lui apparaissait trop placide
et une existence lui permettant de faire preuve d’imagination et d’initiative
personnelle, il n’hésita pas. Dès 1908, il
se lança dans la grande bataille de l’ huilerie. Des déboires l’ y attendaient,
mais il fit front avec un courage et une
force de caractère qui finirent par l’ emporter. Il a aujourd’hui la satisfaction de voir sa
magnifique huilerie de Lyndiane, près de Dakar, consolider chaque année une
situation de premier plan. Fondée par Robert Prouvost juste après la guerre de 14 où
il loua des terres, ( il y avait aussi un port), Lyndiane est une grande
réussite des Prouvost au Sénégal. : production d’huiles de 4000 à 120.000
tonnes lors de la nationalisation, les deux plus grands fabricants
d’arachides du monde : Lyndiane Sodec et Lesieur.Jalousés par les
sénégalais.Tous les mois trois bateaux qui livraient en vrac les distributeurs
français, allemands, Angleterre qui mettaient en bouteille. Merveilleuse
collaboration entre les noirs et les blancs. » Philippe Prouvost son
fils en 2012.»
_______________________________________________________________________
Henri PROUVOST
Liste officielle No 60 de
prisonniers français A Paris le 4 janvier 1941; D’après les renseignements fournis par
l'Autorité allemande.; né le
23-11-1918 à Waquechy
2e cl.
23e R.A.F. Camp
: Stalag XII A. ALLEMAGNE Lieu
: Hohenstein
Georges PROUVOST et ses fils Dominique et François
"Les
deux frères Dominique et François Prouvost ont
été membres de la Résistance, l'un fit ensuite la
campagne d'Allemagne et l'autre en Italie ; leur père Georges
Prouvost-Virnot avait tenté de se rendre en Angleterre à
la suite de l'appel du 18 Juin, et, avec son épouse, Marthe
Virnot, ils prirent la route de l'exode jusqu'à Brive la
Gaillarde où ils furent accueillis par leurs cousins Wallaert
dans leur propriété de la Majorie .
Georges Prouvost était parti avec son fils Dominique. Ils
passèrent à Chausey, puis à Jersey, mais à
Jersey il n'y avait plus assez de bateaux et l'on ne prenait que les
officiers munis de leur uniforme. C'était le cas de Georges,
mais pas celui de Dominique ! Les Allemands étant entretemps
arrivé en Normandie, Georges n'a pas osé renvoyer son
fils seul, craignant que, revenant des îles anglo-normandes, il
soit exécuté par les allemands à
l’arrivée. Il n'a donc pas voulu en prendre le risque. Je
crois que cela a été un des grands regrets de sa vie, car
arrivé à Londres il n'aurait pas manqué de faire
partie de l'état major de de Gaulle auquel il était
apparenté par son épouse (La 2° femme de son grand
père, Victor Virnot était une Cailliau dont le
frère avait épousé Marie Agnès de Gaulle,
qui était très liée aux Virnot." Notes
relevées de leur soeur, Martine Frapier-Prouvost
Charles 3 PROUVOST
né en 1901

Armée de Terre: Lieutenant Artillerie 242°RA il est affecté à un
régiment d'active et de 1926 à 1940, il est souvent rappelé pour des
périodes: quatre fois entre 1938 et 39.
Mobilisé
en août 1939, il est, en avril 1940, renvoyé provisoirement dans son
foyer, comme père de six enfants, ce dont il ressentit beaucoup
d'amertume; sa nomination au grade de capitaine fut victime d'un
bombardement: il était accablé de nae pas avoir pu faire son devoir.
Charles Prouvost
a toujours
manifesté un certain attrait vers l’ Armée. Tout ce qui était militaire l’ intéressait.
Non pas pour en profiter personnellement : il a été dégagé de toutes obligations militaire s
comme lieutenant de réserve et sans aucune décoration, mais parce que, pour
lui, l’ armée représenta l’ Honneur, le Devoir, l’Abnégation, Qualités qui
étaient bien les siennes. Bien souvent, il ma confié sa passion sincère pour la Marine.
Sa destinée - si tragiquement influencée par la guerre 1914-18- a été toute autre.
Mais rappelez vous combien il aimait se
comparer à un commandant de navire, faire appel a sa vieil le et jeune garde, rédiger dans un style militaire
et accueillir officiers et soldats avec un sens très net de la hiérarchie . C’est
en 1934, que pour la première fois j’eus l’ occasion de le connaître à LAON,
lors d’une convocation de réservistes au I7eme d’Artillerie où il avait déjà servi autrefois comme
« bleu » à Abbeville . Rien ne pouvait déceler en lui l’ officier de
réserve. Toujours en tenue impeccable, droit, simple, très à l’ aise a cheval, il
en imposait. Il avait dans le sang cette
aptitude du commandement qui ne s’apprend pas dans les règlements~ mais qui est
le réflexe naturel des qualités du cœur, de la droiture et de la volonte: il était l’ homme de l’action personnelle. N’a-t-il
pas été, en 1940, volontaire pour
prendre le commandement d’une batterie anti-char. Puis ce fut, jusqu'en 1939,
des rappels souvent inopinés. Il est
peut-être nécessaire de préciser que Charles PROUVOST n'a jamais demandé comme
industriel - et c’était son droit - une affectation spéciale de fournisseur
agréé de la Défense Nationale. Non; chaque fois que son grade son âge, son
affectation~ la situation l’ exigeaient, Charles PROUVOST par le premier train
rejoignit LAON où j'ai eu la joie de l’ accueillir presque chaque année. 25
août 1939, nous sommes déjà en position de couverture dans la Trouée de Chimay.
c· est bien notre place à nous, gens de l’active, dont la tradition est tout de
même d’être en avant, Oui, mais derrière nous, nous avons laissé un échelon qui
grâce à l’arrivée des réservistes, doit nous apporter rapidement l’ appoint
nécessaire à notre cohésion totale. Et c’est là, dans ce rôle modeste et terre
à terre, que Charles PROUVOST a donné son maximum. Lui, l’ impétueux, le
rapide, le bouillant, il a su, parce qu’il l’ a voulu, rejoindre le régiment avec une
unité de formation rodée et capable de nous suivre. Charles PROUV03T ne pouvait
pas s’attacher à une routine, il n’est
pas un partisan, il ne suit pas, il
attire. Janvier 1940,- Fremestroff. La
petite guerre au contact des Allemands vers Forbach: Une circulaire prévoit que
les pères de 5 enfants et plus peuvent être renvoyés dans leur foyer. Cas de
conscience ! Cependant, grâce aux sages conseils du Colonel Thomas, Charles PROUVOST
accepte de rentrer à Lille. Mai 1940, la vraie guerre, cette fois ! Sans
Charles PROUVOST dans les rangs de ce 242eme qu’il aimait tant. Hélas ! Il n’y fut pas. Mais il fit tout pour rejoindre. Ses télégrammes ~ ses
essais attestent son désir de venir participer au combat. Dès l’ hiver 1940~ il
participe à ce magnifique mouvement de
regroupement des anciens et d·aide des prisonniers et de reclassement des démobilisés.
Ses dons les plus généreux ne sont pas spectaculaires, et l’ édition, à ses
frais, d’un journal de marche n’est rien a coté du "dépannage »
de la main à la main~ les yeux dans les yeux, qui s'est répété bien souvent en
faveur des anciens.Après ces années sombres, après la libération, il est resté aussi attaché a l’ Armée. Il n’aurait jamais voulu manquer la réunion
annuelle de notre Amicale, nous faisant souvent l’ honneur d'y convier Madame PROUVOST.
Lors de mon entrée chez PROUVOST-DALLE & Cie, il fut entendu entre nous que le tutoiement
serait aboli et que je l’ appellerais Monsieur PROUVOST", comme tous ses autres
collaborateurs. Et il avait coutume de dire : « Il était mon capitaine~ j’étais son lieutenant,
maintenant c’est le contraire et nous continuons à bien nous entendre." Et
quand je suis parti en Indochine, le premier, dans un geste que je n’oublierai
jamais; il a précisé "Mon vieux
René, je t’embrasse." Et maintenant il n’est plus. Beaucoup d'entre vous l’ ont vu
malade et ont pu exprimer leur peine à sa famille. Si vous saviez comme il est douloureusement inhumain à 15.000 kilomètres
d’apprendre la disparition de quelqu’un
que l’ on a aimé comme un ami, servi comme un chef.
Comme officier
de réserve, il était affecté à un
régiment d’active et, de 1926 à 1940, il est souvent rappelé pour des périodes~ quatre
fois entre 1938 et 1939. Il se fait, à
ce moment-là- de nombreux amis dans l’ armée. Mobilisé en Août 1939, il est, en Avril
1940, renvoyé provisoirement dans son foyer,
comme père de six enfants: il était
accablé de ne pas avoir pu faire son devoir. Sa nomination au grade de
capitaine de réserve, qui fut effective, fut victime d'un bombardement. Avant l’
évacuation, sur ordre du Ministère de l’ Air, il doit ouvrir une usine de repli. C’est le début
de l’ usine de Laval. C’est à son beau-frère Roger Ponroy, (aidé en 1941 de M. Caillerez) que Charles en a confié la
création et la direction. Il en a été le
directeur de 1941 jusqu'à la disparition de l’ usine en 1956. Durant toute la
guerre, il est Président du Syndicat des
Fabricants de Couleurs et Vernis. Par
son activité débordante et ses initiatives heureuses, il fit beaucoup pour l’ approvisionnement
régulier de la Corporation en matières rares.
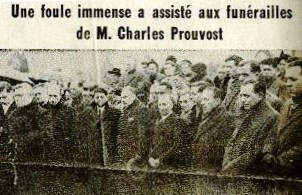
Son oncle,
Antoine Masurel, fit une guerre remarquable : Commandeur de la Légion
d'Honneur, Compagnon de la Libération -
décret du 19 octobre 1945, Croix de Guerre 39/45 (2 citations), Médaille de la
Résistance, Membre de l’ Empire Britannique (GB), Officier de l’ Ordre de la
Couronne (Belgique), Croix de Guerre avec palme (Belgique).Il épousa Anne-Marie Gallant.
Gérard PROUVOST

sous officier d'artillerie; avait fait son service militaire
avec son frère Charles Prouvost et retenu dans un camp en France jusqu'à fin
40; emmené en Allemagne dans un train à wagons de marchandise. Il réussit à
perforer le toit du wagon, à se hisser et à sauter en marche en pleine nuit en
Lorraine. Il traverse à plat ventre le canal gelé de la Marne au Rhin (pour ne
pas couler à pic) en direction d'une lumière sur l'autre rive. Il est sauvé par
le riverain qui va chercher un cordage et lui demande de ne pas faire de bruit
car un allemand loge dans sa maison!! Muni de vètements civils, il regagne
Paris par le train et retrouve avec grand plaisir le 84, rue la Fontaine à
Paris...Évadés de Guerre 1939-1945, Liste de ceux qui, prisonniers
de l’ennemi pour la 1ère et la 2ème guerres mondiales, ont fait acte
d’évasion,ainsi que ceux qui se trouvant sous la domination ennemie ont quitté
le sol national au péril de leur vie pour rejoindre les forces alliés
combattants et aussi ceux qui ont facilité ou aidé au péril de leur vie les
évadés de guerre sur le chemin de la Liberté.
Six fils Lepoutre-Prouvost au service de la Nation.
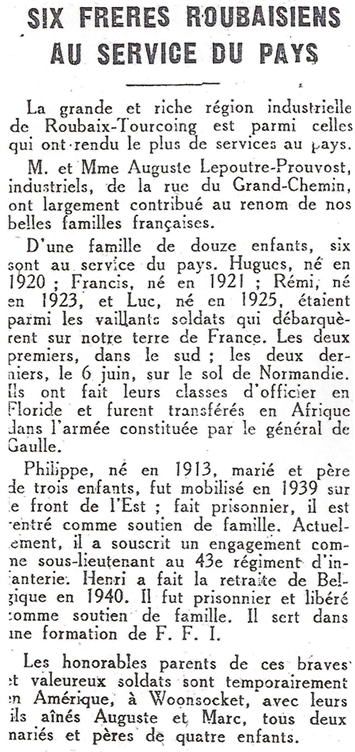
Branche puinée des Liévin
Joseph PROUVOST
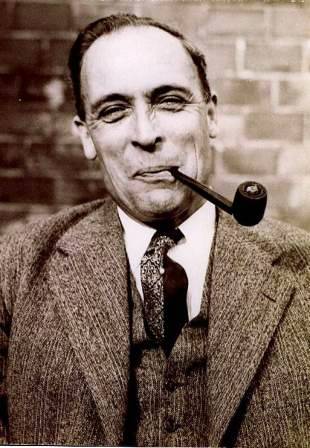
de la branche puinée des Liévin Prouvost, Liste officielle No 97 de
prisonniers français A Paris le 18 mai 1941; né le
6-8-1911 à Sin-le-Noble
serg.
38e Camp
: Stalag XVII A. ALLEMAGNE
 Lieu
: Hohenstein
Lieu
: Hohenstein
Michel PROUVOST
de la branche Liévin Prouvost
Liste
officielle No 83 de prisonniers français A Paris
le 17 mars 1941; né le 3-7-1917 à Meudon 2e
cl. 406e D.C.A. Camp : Stalag XVII B.
ALLEMAGNE Lieu : Hohenstein
Branche des Amédée
Jules-Edouard Desurmont-Prouvost
Eclaireur Skieur
au 18° BCA
Médaille militaire,
Croix de guerre
Blessé le 24 juin 1940,
Mort le 1° avril 1941
fils de Marcelle Prouvost 1893, d’ Edouard
Joseph Prouvost 1861-1933 et Pauline Elisa Fauchille 1865-1954, petit
fils d’Amédée l Prouvost et de de Jules Desurmont, né le 25 juillet 1889 -
Tourcoing de Jules Aimable Joseph Desurmont 1863-1919 et Thérèse Motte
1868, fille d’ Alfred
Motte 1827-1887 et Léonie Grimonprez 1833-1899, marié le 29 juin 1912, Roubaix.
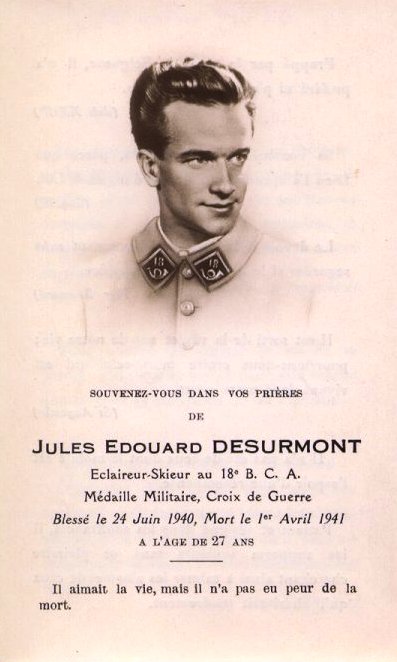
Georges Heyndrickx-Prouvost
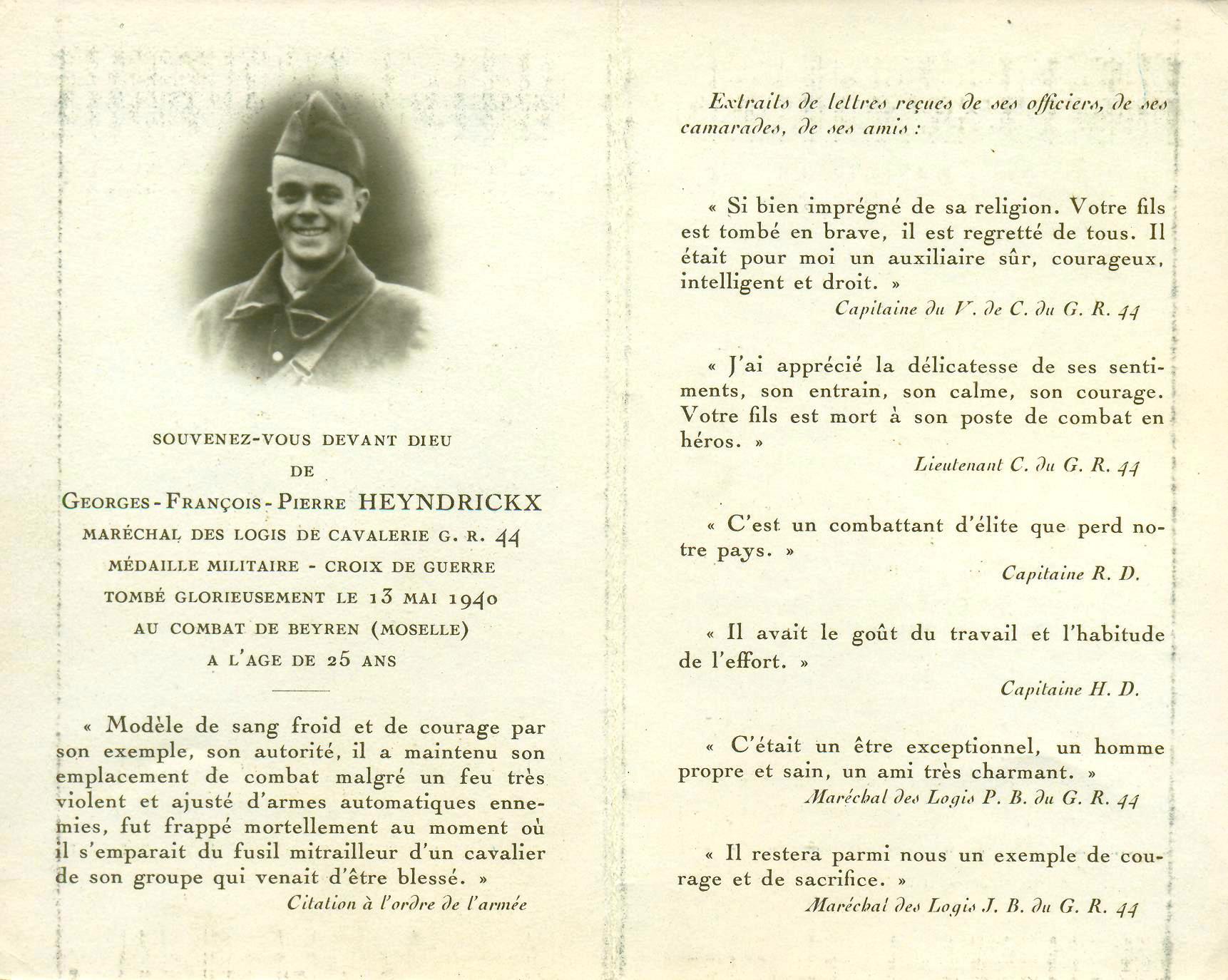
Capitaine Henri Lesur,
époux, le 14 décembre 1931, Lille (Nord), de Simone Dubois-Prouvost 1908-1986,
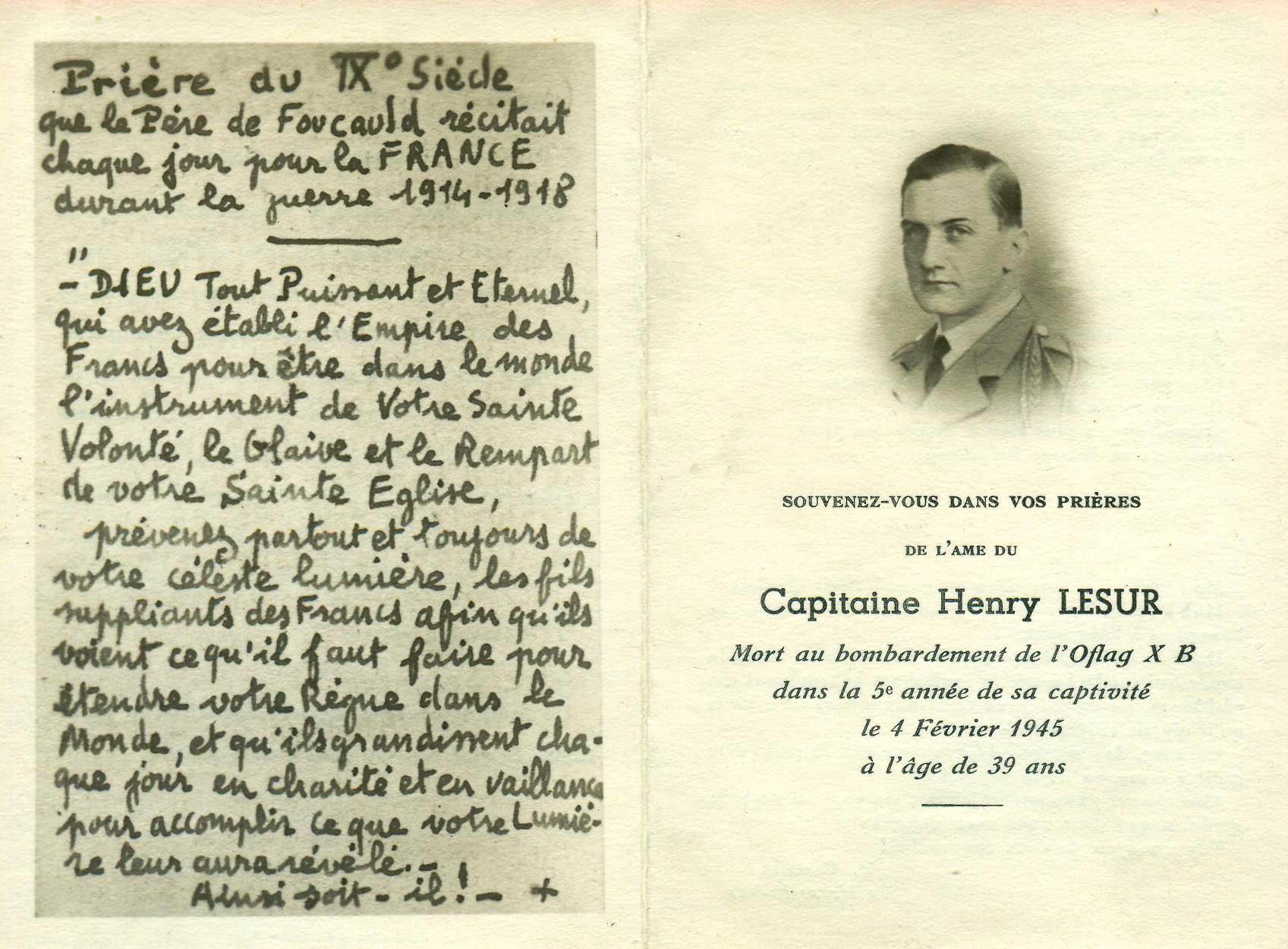
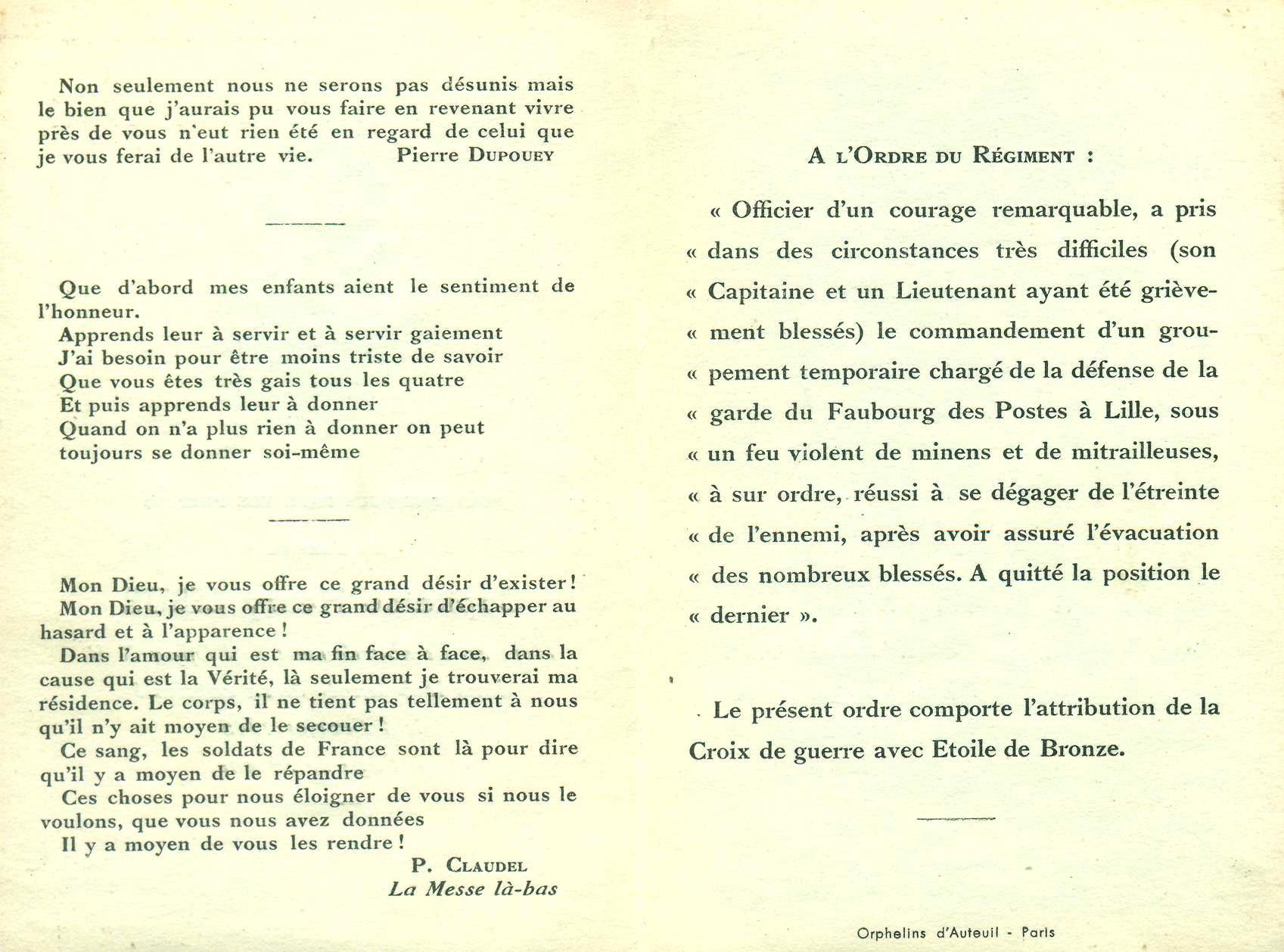
Albert-Eugène Prouvost
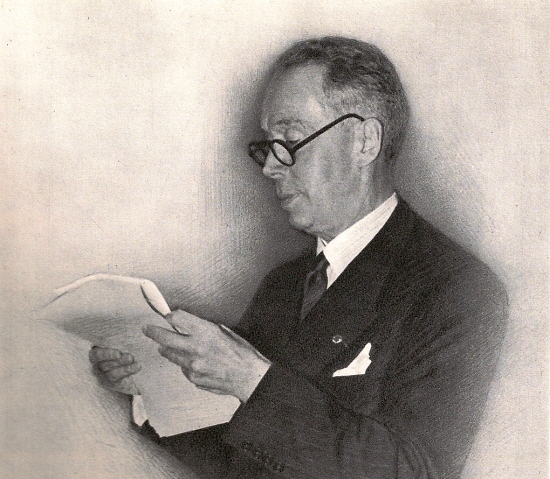
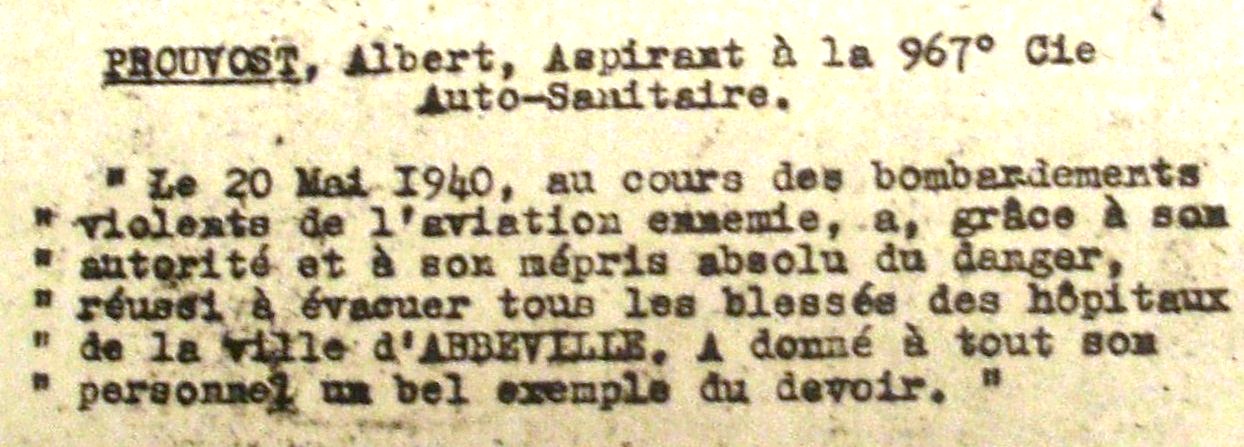
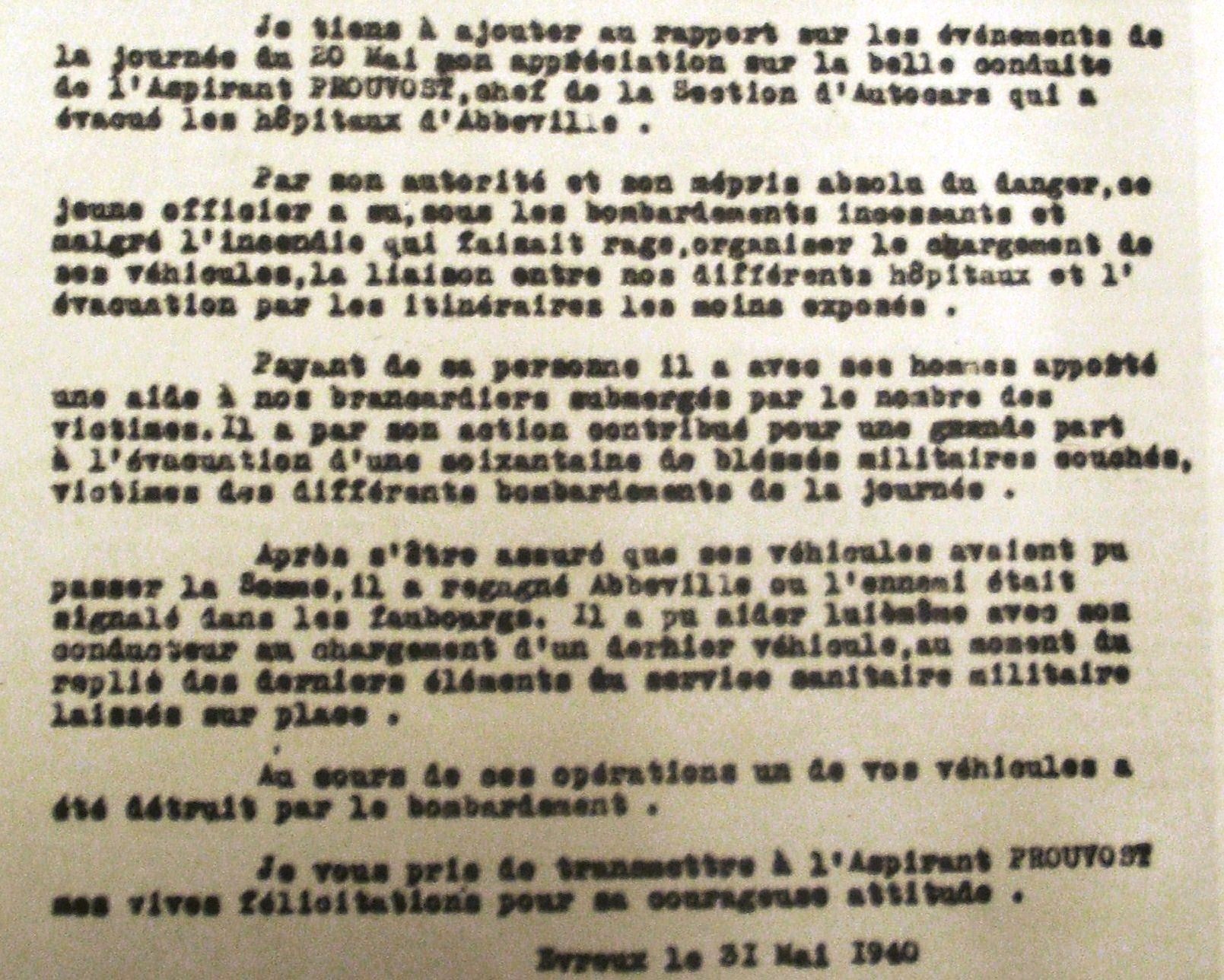
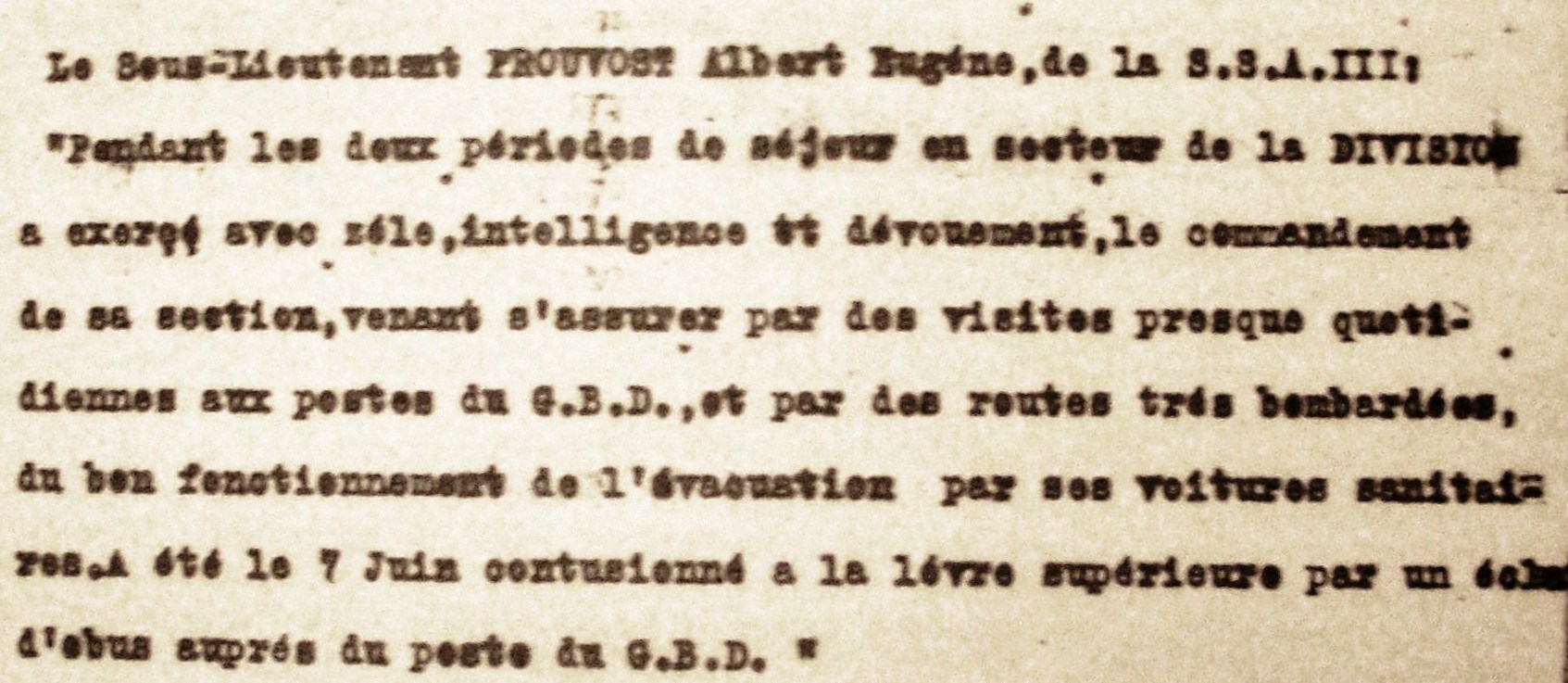
Albert-Auguste Prouvost

« Viscéralement
hostile à l’Allemagne
nazie, Albert-Auguste Prouvost a raconté comment, après
Montoire, il dut
« renier le Maréchal ». Les deux
directrices (protestantes) d’une clinique de La Madeleine
lui
proposèrent de rentrer dans le réseau Syvestre-War
Office. Sa propriété campagnarde
des environs de Lille devint un lieu de transit pour résistants
et aviateurs
britanniques ; il obtenait pour eux des fausses cartes
d’identité du maire
de Roubaix, Victor Provo. Il fit encore installer au peignage
Amédée Prouvost
une imprimerie clandestine qui édita des
« Instructions de combat ».
Il obtint d’amis industriels des fonds au profit de la
Résistance :
Bernard D’Halluin, Jacques Masurel,
Alphonse et Eugène Motte, Alphonse et Jean Tiberghien. Il
participa enfin aux
combats de la Libération, en particulier au lieudit Haut-
Vinage, dans la
commune de Wasquehal. Jean Masurel, cousin d’Albert Prouvost,
combattit, lui,
pour la libération de la capitale et y perdit une jambe. Son
frère Antoine
Masurel (1912-1990) participa en zone sud
à la construction du réseau Phratrie ; en mission
dans le Nord,
emprisonné, il fut délivré par l’avance
alliée du train qui l’emmenait en
déportation. Il se vit décerner le titre de compagnon de
la Libération. «
MN
« N'ayant
jamais sollicite cette distinction, je crois qu'il s'agit d'une plaisanterie.
Pas du tout. A notre retour dans le Nord, j’ouvre une lettre du ministre des
Finances de l'époque, François Ortoli qui me touche vivement. « Cette
exceptionnelle distinction, écrit-il, vient justement récompenser les services
que, avec dévouement, tact et compétence, vous rendez depuis trente-huit ans à
l’économie du pays. Connaissant l'étendue et l'éminente qualité de vos mérites,
il m'a été agréable de proposer au gouvernement de vous élever au grade
d'officier. Je suis heureux de vous en féliciter aujourd'hui. Un tel compliment
me remplit de confusion. J'avais eu la chance, en effet, avant qu'il ne soit
ministre, de le recevoir au Vert-Bois et de le lui faire visiter ainsi que
quelques quartiers résidentiels et logements de cadres qui l'avaient
impressionné. Comment pouvais-je imaginer que la conversation très amicale me
promettait cette promotion ? Je n’oublierai jamais les télégrammes, cartes et
lettres de félicitations qui me parviennent a cette occasion de tous les pays
du monde. N'ayant jamais fait de politique, je ne pouvais deviner qu'un jour je
recevrais des témoignages de sympathie de personnalités et de militants
d’opinions si diverses. »
" "Nous avons appris avec le plus grand plaisir, la nomination au grade de
Chevalier de la Légion d'Honneur, de MM. François Roussel, Albert Prouvost et
Henry Glorieux, tous trois industriels à Roubaix et membres de notre Club ;
qu'ils veuillent bien accepter nos plus sincères et nos plus vives
félicitations. A une époque où la lutte entre les peuples est exclusivement économique,
même quand ils en viennent à 1' « ultima ratio » des amis les grands
industriels représentent et défendent l'honneur national au même titre que les
officiers militaires. Comme eux, sans relâche et non sans péril, ils défendent
pied à pied ou, étendent notre suprématie, portant, au loin le renom."
La lecture des
mémoires d’Albert m’a révélé qu'un sang noble coulait dans ses veines; je
l'ignorais quand, devant sa tombe encore ouverte, j'ai salue le départ d'un
seigneur, généreux avec magnificence, qui ne rougissait ni d'habiter une
demeure historique parce qu'il avait consacre au logement social des années
d'imagination créatrice, ni d’avoir transforme sa maison familiale en musée
parce qu'il l’avait ouverte a tous. Quand la Reine d’Angleterre vint pour la
première fois chez nous en visite officielle, elle fut accueillie par Albert
Prouvost à la porte du peignage Amédée Prouvost. Aussitôt après cette brève
cérémonie, le patron s'éloigna discrètement pour rejoindre, au deuxième rang,
les membres du personnel de l'usine qui avaient appartenu comme lui pendant les
années noires, au groupe de Resistance Sylvestre Buckmaster. Je connaissais
alors Albert depuis dix ans. Jamais il n'avait dit, devant moi, la moindre
allusion à son engagement dans l'armée des ombres. Ce geste avait été discret,
le silence tout naturel; Albert Prouvost était un grand seigneur. Maurice
SCHUMANN de l’Académie Française.
« Le 1er février 1958, le CIL organise
une manifestation d'adieux pour rendre hommage à son fondateur. Je suis très
ému. Sur la scène, le président de l'Union Textile, Bernard d'Halluin, et le
député-maire de Roubaix reconstituent l’historique des faits et donnent le
bilan : 8 000 familles logées et 18 000 enfants qui s’épanouissent dans
des conditions de vie plus décentes et plus confortables. De mon coté, je
termine mon discours par ces mots:
« Si quelqu'un,
après ma mort, veut rappeler mon souvenir, peut-être pourrait-il, dans un des
squares de nos nouveaux quartiers, poser une plaque très simple, cachée dans un
coin de verdure. Si un jour, des enfants, au milieu de leurs jeux, venaient à
le découvrir, ils y liraient, auprès de mon nom, un seul titre - le plus beau
pour moi - « fondateur du CIL».
Le « 1% logement
» selon Lutte ouvrière :.
C’est un
groupement patronal, les patrons du textile du Nord, qui, cherchant à résoudre
le problème des logements pour leurs ouvriers, fut à l’origine de ce qu’on
appelle le « 1 % logement », l’État se ralliant en 1953 à cette initiative
privée.
Albert-Auguste
Prouvost, grand patron à la tête d’un empire industriel textile de la région de
Lille-Roubaix-Tourcoing, héritier de l’une de ces « 200 familles » et plus
grosses fortunes capitalistes du pays, estimait qu’il fallait loger décemment
les ouvriers : tout en soulageant quelque peu la misère, facteur d’agitation
sociale, cela permettrait une meilleure efficacité à l’usine, contribuerait à
baisser le coût du travail et à maintenir les bas salaires. Pour réussir à
construire massivement et pas cher, il était convaincu qu’il fallait trouver un
système qui permette d’attirer les capitaux en leur assurant une bonne
rentabilité. Il fallait concentrer les fonds, construire de façon standardisée
et industrielle, et réclamer l’aide et la garantie de l’État. Il fallait,
disait-il, « inciter l’initiative privée, brimée depuis 25 ans par une
législation néfaste, à retrouver ses fonctions normales de bâtisseur avec comme
condition essentielle de rendre cette construction rentable ». Et en attendant
que le gouvernement lui donne satisfaction et annule, en particulier, le
blocage des loyers, Prouvost organisa avec d’autres patrons du Nord une
cotisation de 1 % sur les salaires, versée à un organisme collecteur sous leur
contrôle, le Comité interprofessionnel du logement (CIL), permettant de mettre
en commun les ressources et de construire des logements dont ils restaient
propriétaires.
Prouvost
expliquait ainsi les avantages de l’opération : « Le
1 % étant intégré dans les
charges pouvait être répercuté en fin de compte sur
les prix de vente,
c’est-à-dire sur les consommateurs ». Il inaugurait,
dès 1946, le paritarisme
dans la gestion du CIL, permettant d’impliquer les organisations
syndicales
ouvrières dans la gestion des problèmes (« Si une
augmentation de loyer est
indispensable, elle sera plus facilement acceptée par les
travailleurs »,
expliquait-il). Par ailleurs, le CIL sollicitait des financements
complémentaires pour construire les logements ouvriers, comme
des subventions
de l’État, des départements ou des communes,
réussissant à faire en sorte qu’en
1950, les fonds collectés ne représentaient plus que 35 %
du coût proprement
dit de la construction. En effet, dès 1947, le patronat du Nord
avait obtenu
que les emprunts à taux réduits de la Caisse des
Dépôts et Consignations lui
soient ouverts et, en 1948, des aides aux ménages pour payer les
loyers (des
allocations-logement) ou pour accéder à la
propriété avaient été
développées.
Pourtant, fin
1950, l’entreprise restait limitée avec seulement 2 500 logements construits.
Mais elle avait gagné du terrain dans les milieux patronaux, avec le ralliement
des industriels de Mazamet, de Belfort, de Reims, qui firent pression sur le
gouvernement afin qu’il prenne des mesures favorables à la construction privée.
Ils réclamaient en particulier que le gouvernement étende à l’ensemble des
employeurs la cotisation du « 1 % logement » en lui donnant force de loi.
« Sous le
pseudonyme de Jean Bernard, il agit sur plusieurs plans. Il aide de nombreux
Résistants et aviateurs anglais à rejoindre Londres. Il se préoccupe aussi du
sort des jeunes requis dans le cadre du Service du Travail Obligatoire. Pour y
échapper, il leur propose de devenir caviste en Champagne, chez Moet et
Chandon, société tenue par les oncles de sa femme. Dans sa propre entreprise,
le Peignage Amédée Prouvost, il installe une imprimerie clandestine. Autre
initiative : une collecte de fonds organisée auprès de ses amis industriels,
Bernard d'Halluin, Jacques Masurel, Alphone et Eugène Motte, Alphonse et Jean
Tiberghien pour financer l'activité des réseaux. » Lutte ouvrière
Quelques jours
avant la libération, Albert Prouvost est au centre d'une négociation entre le
commandement Allemand de la région Nord et la Résistance.Le général Niehoff s'engage
à libérer tous les résistants détenus à Loos, si les maquisards ne s'opposent
pas au départ du dernier convoi allemand. Les responsables du réseau Sylvester
Farmer n'y croient pas une seule seconde, ils savent de quoi sont capables
leurs ennemis. En effet, le 1er septembre 1944, parti de Tourcoing, un dernier
train emmène vers le camp de la mort 900 prisonniers de Loos. Les résistants
wattrelosiens, avec à leur tête Henri Bracaval, essaient bien, à hauteur du
pont des 44, rue du Mont-à-Leux, de l'intercepter mais doivent y renoncer
devant l'importance des moyens mis en place par les Allemands. Bien peu de
prisonniers du train de Loos reviendront vivants des camps de la mort » MN
Yves Masurel-Prouvost
 ,
,
Administrateur de sociétés, né le 29 juin 1918 à La
Saussaye (Eure).Fils d’Edmond Masurel, Industriel textile, et de Mme, née
Marguerite Prouvost.Illustration familiale : son oncle, l´industriel et
éditeur Jean Prouvost .Veuf de Mme, née Maddy Dewavrin (3 enf. : France,
Duchesse des Cars, Yves-Alain,Laurence, Mme Michel Cazeaux Cazalet) et de Mme,
née Anne Paris ; Remarié le 18 janvier 1990 à Mlle Françoise Kine.
Etudes : Collège de Tourcoing, Faculté de droit de
Lille. Dipl. : Licencié en droit. Président-directeur général des
établissements François Masurel Frères (1958-66),Gérant puis
Administrateur-directeur général des Filatures Prouvost-Masurel, de la Lainière
de Roubaix et de Prouvost Masurel S.A. (1966-78), Président-directeur général
(1969) puis Administrateur (1979-83) de la Banque cotonnière et textile
(Bancotex) devenue la Société de banque et de participation (VIA-Banque),
Administrateur du Crédit du Nord (1951-81) et de Lloyd Continental
(1951-99),Membre puis Président du conseil de surveillance de Valeur Pierre 5
(1990-2002).Décor. : Croix de guerre 39-45.
•PROUVOST Edouard Joseph, fils d'Amédée I Prouvost, Chevalier LH le 15/05/1910 Propriétaire agricole en Tunisie
•PROUVOST Gaston Emile, entre 1802 et 1874 Chevalier LH
•PROUVOST Georges Alexandre, Chevalier LH 16/06/1920, Sous Lieutenant au 147° régiment d’infanterie Nord
•PROUVOST Edmond Charles Joseph, de la branche ainée des Henri Prouvost. Chevalier LH le 15/10/1921, industriel Nord
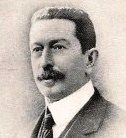
Christian Prouvost
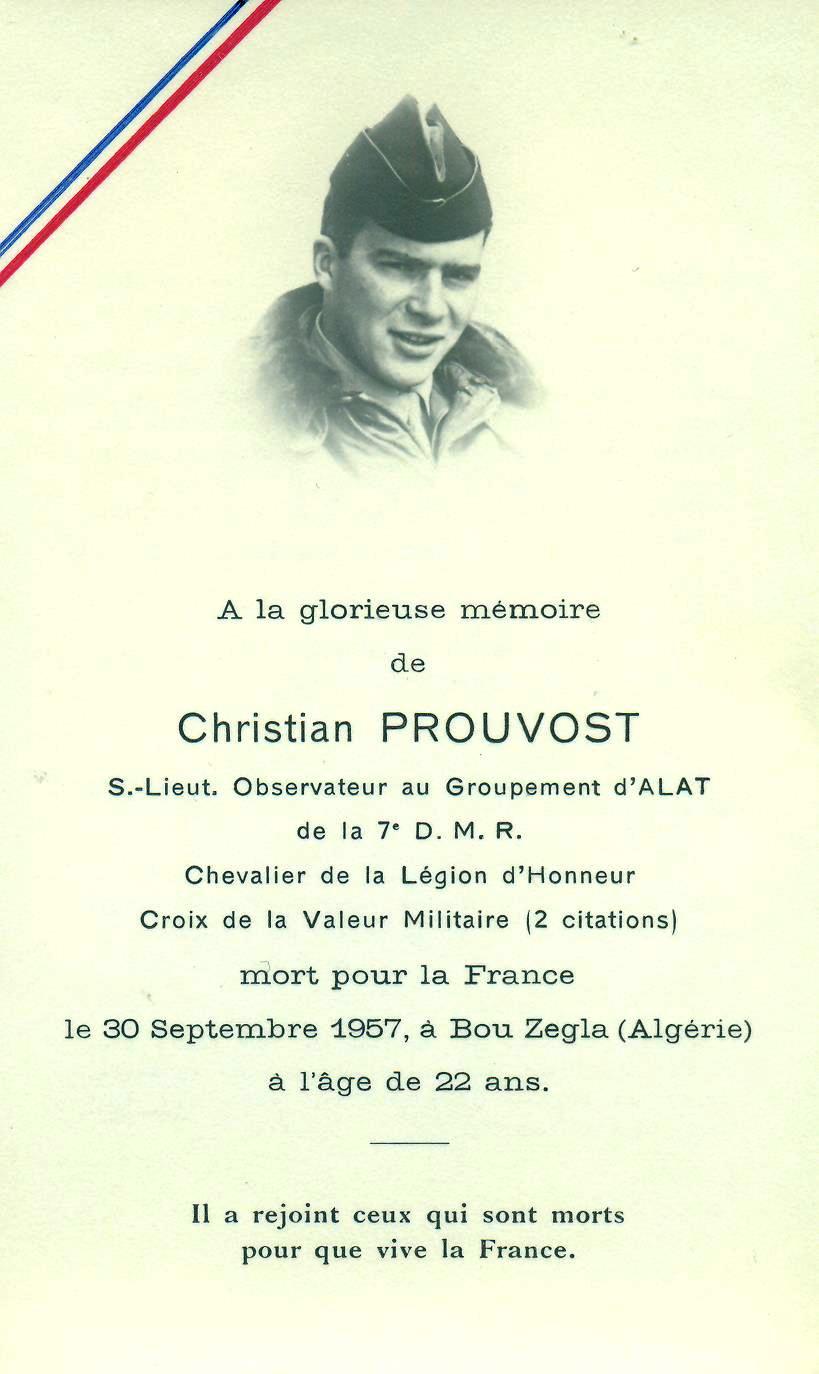
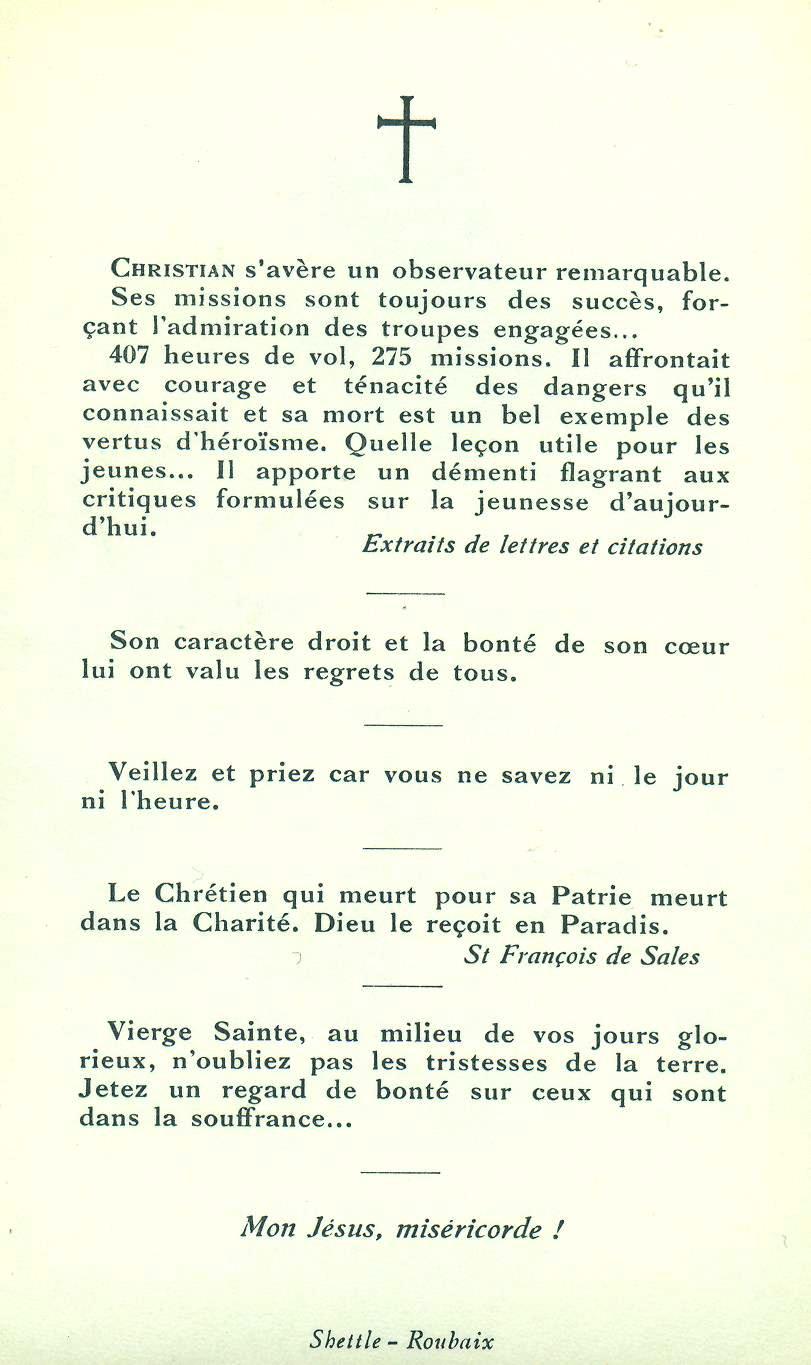
Annuaire
National des Officiers de Réserve
Liste des officiers de réserve de l’Armée de Terre et
de l’Armée de Mer: Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Aéronautique,
Gendarmerie, Troupes coloniales, Chemins de fer, Santé, Justice, Recrutement...
PROUVOST Christian (Charles), né en 1927

7° spahi à Senlis et 1° régiment de spahis
algérien à Médéa.
Capitaine de Cavalerie
fils ainé de Charles Prouvost.
PROUVOST Christian (Charles)
Commandant de Réserve
fils du précédent,

commandant de réserve, médecin
PROUVOST André
fils de Charles, a servi en 1954-55 en Allemagne au 2°
cuirassiers puis au Maroc et en Mauritanie au 43° RI qui est le régiment de
tradition de la ville de Lille.
Il a reçu la médaille commémorative du Maroc. Il est
lieutenant de cavalerie, ayant eu l'honneur de servir à l'école d'application
de l'armée blindée et cavalerie,
EAABC, qui forme les futurs officiers qui sont ensuite
affectés à des régiments de cavalerie pour exercer un commandement.
PROUVOST Bernard

fils de Charles, a servi en 1957-58-59 en Algérie au
20° dragons et au 18° régiment de chasseur à cheval. Il a fait un stage
commando et a reçu la croix du combattant dans la période la plus dure de la
guerre d'Algérie: il est lieutenant.
Jacques Prouvost, fils de Charles, branche ainée,
champion de France de parachutisme et Nicole Béra, son épouse, servirent aussi
l'excellence: Nicole fut
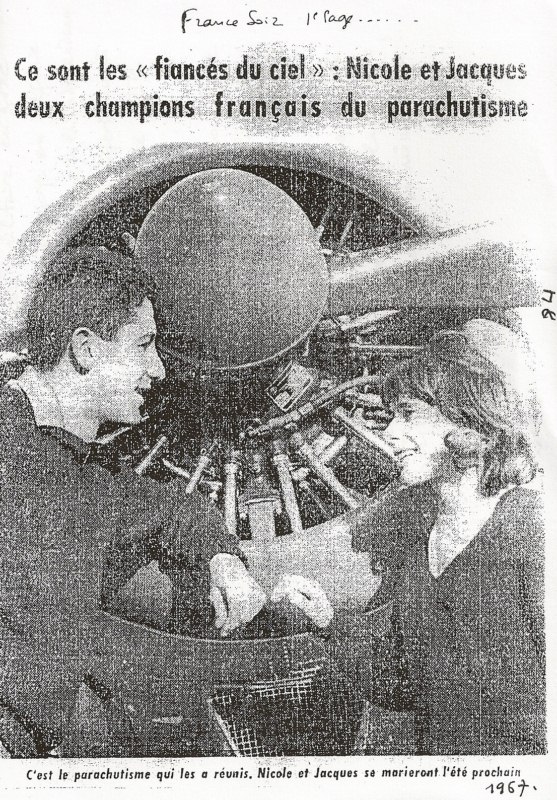
quatre fois championne de France de parachutisme,
championnats du monde de 1962 et 1964 avec deux médailles de bronze, rencontres
internationales: médailles d'or en équipe 1965, Médaille d'or en voltige à
Moscou en 1967; dont Olivier, Karine, Anthony
Henri Dubly
Marié avec Marie HEYNDRICKX (Parents : Georges HEYNDRICKX 1876- &
F Solange PROUVOST 1880- )
Consul général en Lithuanie, conseiller du commerce
extérieur, capitaine de réserve, homme de lettres. Résidant à Paris en 1957,
Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem (Chevalier) (23 janvier 1948).
Prix de l’Académie française 1942 Prix Louis-Paul
Miller, pour son ouvrage: Lyautey le magicien
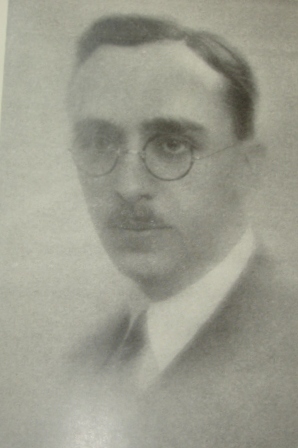
Denise Prouvost-Rasson
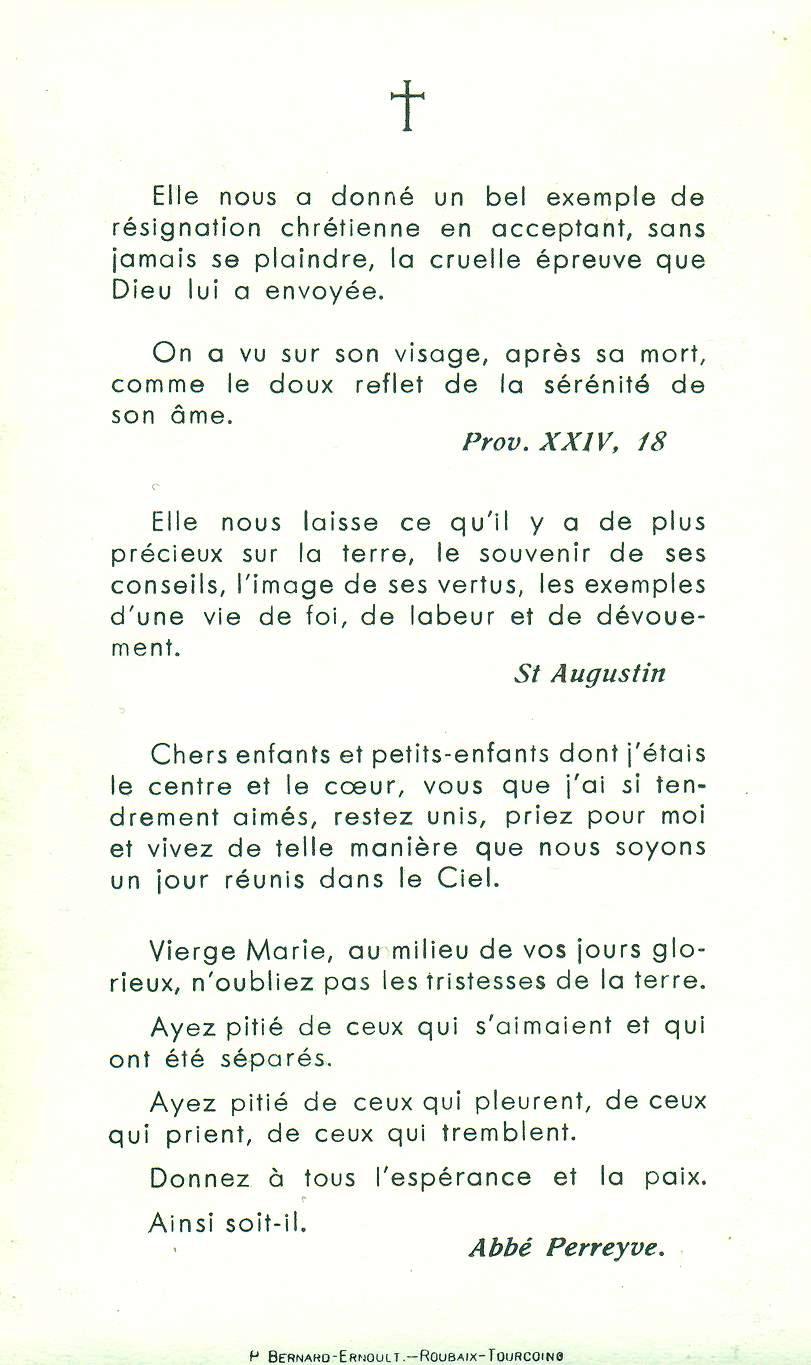
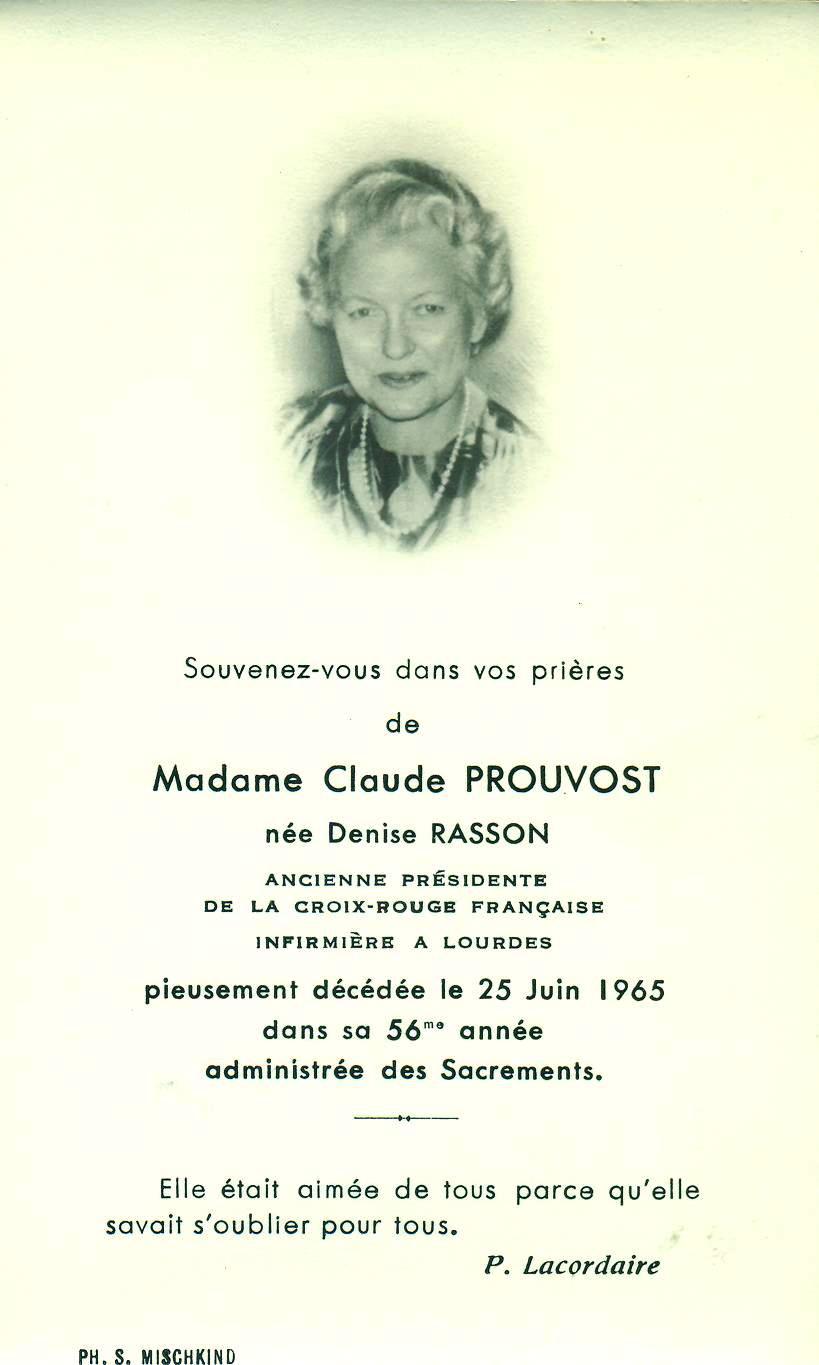
et tous ceux non encore étudiés.
3 La constance du service rendu à la société
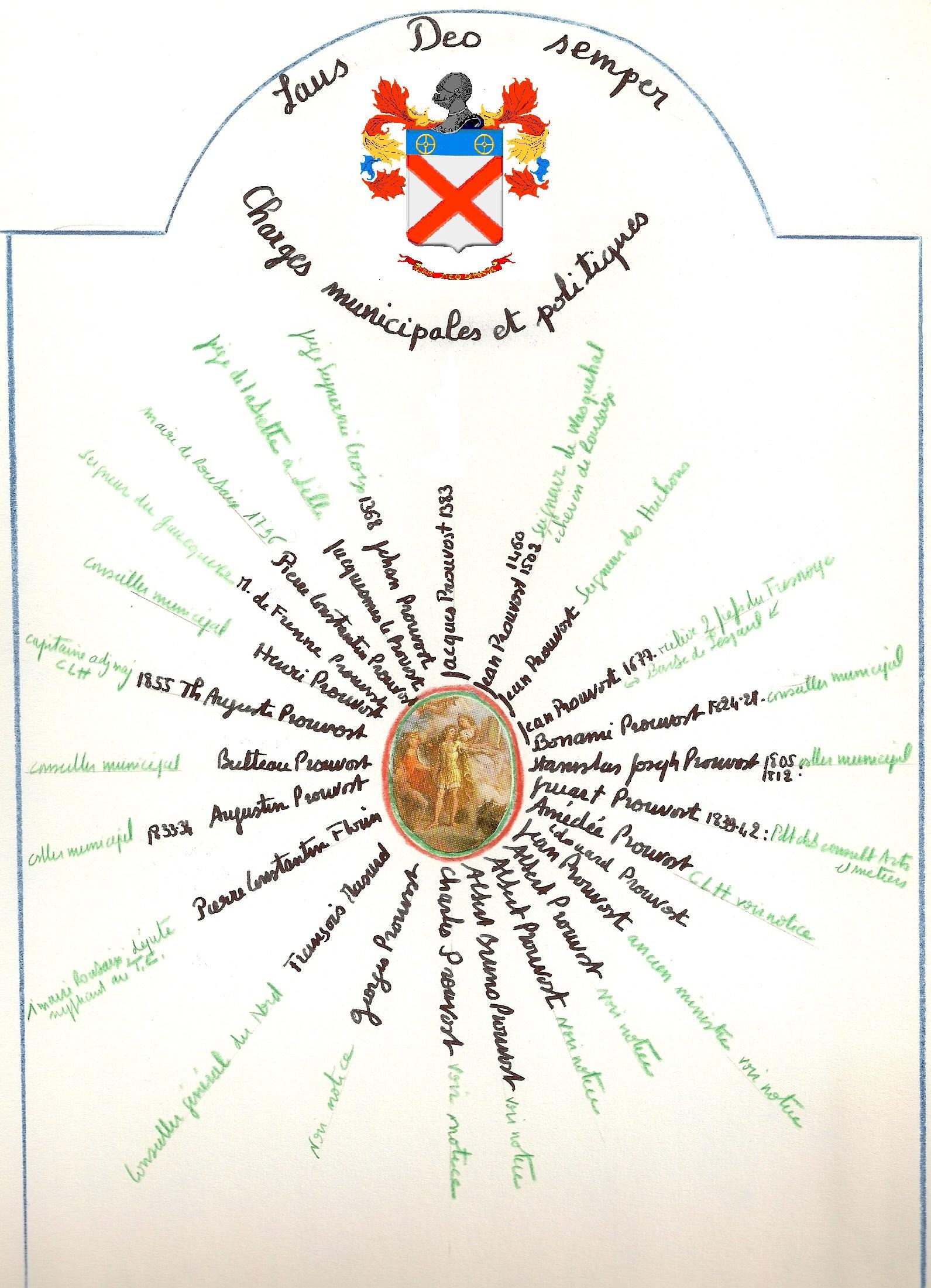
L’ attachement au principe monarchique
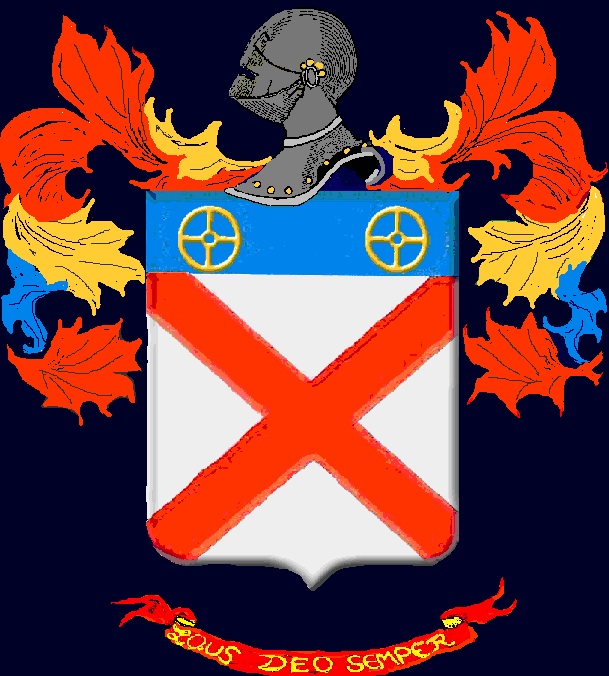
S'ils descendent d'une lignée de propriétaires aisés installée à
Wasquehal (Jehan, fils de Willaume
ci-dessus) et les environs, les Prouvost actuels ont, jusqu'aux travaux d'Alain
Watine-Ferrant en 2012, été reliés, agnatiquement puis maintenant cognatiquement,
aux voisins Prouvost des Huchons du XV° siècle : Jehan Prouvost, échevin de Roubaix, Seigneur
de Wasquehal, à la généalogie suivie des Prouvost, on voit qu'il était le bras
droit de Pierre de Roubaix, proche de Charles de Bourgogne. Ces familles
patriciennes des Flandres étaient au service de leur ville et de leurs
suzerains qu’elles servaient comme un souverain dont on connait le luxe
de la Cour, le talent de leurs peintres (Van Eyck).
Voici un extrait de la lettre que nous avons envoyé en 2011 à Monseigneur
le Prince Louis de Bourbon, Duc d'Anjou, Aîné des Capétiens, Chef de la Maison
Royale de France: « Suite à un parcours long et atypique consacré à cette
recherche à travers l’art, la généalogie, la philosophie, l’histoire, la
théologie, le marché de l’art, le marché de l’immobilier historique à Paris,
j’ai créé, il y a cinq ans, une agence de communication et d’évènementiel : «
Pour vous, les princes » spécialisée dans la communication et les évènements
oniriques dans les plus beaux lieux historiques.
Le nom de cette agence est le fruit de mes études de théologie
et de philosophie au sein du Séminaire traditionnel d’Ecône et il est
synthétisé par la sphère de mon logo : tout être est transcendé par ses
transcendantaux : Un = Vrai = Bien = Beau = Amour = Dieu ; une fois ces
transcendantaux replacés au cœur de
chacun par chacun - en tant que Créature - dans le cadre de son parcours de
vie, alors peuvent s’épanouir les attributs de l’Être ; pour l’être humain, il
s’agit des qualificatifs de Prince ou de Princesse, au sens spirituel du terme,
c'est-à-dire toutes les qualités qu’on peut y observer. La sphère représente
donc l’Être dans sa plénitude.
Il est étonnant de constater que ceci est perçu inconsciemment,
que mes premiers évènements me valurent les plus oniriques photographies dans
les plus belles revues et que chacun entend et interprète le nom de « Pour
vous, les princes », comme il est à l’intérieur de lui-même.
Mais mon œuvre de communication réside dans mes deux importants
ouvrages sur la famille de mon père, les Prouvost et alliés, 1000 pages, et sur la famille de ma mère, les
Virnot-Virnot de Lamissart et alliés, 550 pages ; c’est œuvre d’exhumation,
d’inspiration, de synthèse, et surtout
d’ordonnancement ; vous pourrez en juger en allant vers mes sites :
www.thierryprouvost.com et
www.virnot-de-lamissart.com qui rassemble 90% des textes et illustrations et
que 10.000 internautes fréquentent chaque mois; j’éditerai ces ouvrages comme
des livres d’art luxueux.
Je fais donc l’œuvre que les Monarques n’ont pas fait depuis
deux cents ans, ce qui a laissé les familles orphelines et sans jardinier, la
République ne se considérant pas compétente quant à l’ordonnancement des familles, ceci relevant de la tête ;
exaspéré par cette situation, j’ai franchi impétueusement, il y a trois ans, le
15 août 2008, les terres largement en friche de mes aïeux et alliés et j’ai
commencé, depuis cette même sphère s’élevant par le Souffle, à user de ma formation en contemplant et
étudiant ; alors j’ai pu découvrir la beauté du tracé de ces parcs et de ces
demeures patriciennes à la bourguignonne, à la flamande, à la Française hérités
de mes pères ; j’ai pu distinguer, sous
les mauvaises herbes et les aprioris, la beauté des chênes tutélaires que sont
les grands ancêtres, ces topiaires qui
ne demandaient qu’a retrouver leur sculpteur, la rectitude des allées de
dévouements, de consécrations, de créations, d’inscription dans la cité ou le
charme des dessins plus artistes de l’Art de vivre en société; et, alors, mes
ancêtres réapparurent, un à un, me présentèrent leurs illustrations et donc
leurs apports à Dieu et à la Cité, celles-ci gommant leurs défauts; ils se
rassemblèrent toujours plus nombreux et
commencèrent à collaborer avec moi, m’apportant leur amour, leur fidélité,
leurs œuvres; et chaque jour, c’est un ou plusieurs trésors ; le 15 août 2009,
date du premier anniversaire de mes sites, ils dévoilèrent leurs merveilleuses
et familiales Manufactures Royales du Dauphin dont j’ai repris la marque :
http://www.manufacturesdudauphin.com; aujourd’hui, c’est l’inspiration qu’ils m’apportent pour venir
vous parler.
Ma famille a été représentative des deux voies que représenta la
Grande Révolution : la famille de ma mère était composée, au XVIII° siècle, de
deux frères, très fortunés et influents à Lille et qui incarnent chacune des
deux options : la transcendance en la personne de Charles-Louis Virnot de
Lamissart dont la descendance appartient encore aujourd’hui, par les femmes, à
l’ancienne (puisque non renouvelée) aristocratie et le pragmatisme plus commode
du XIX° siècle qui s’ouvrait en la personne d’Urbain-Dominique Virnot dont la descendance
masculine perdure. La famille de mon père restera très longtemps monarchiste
jusqu’à mon père et moi-même. En voici deux textes qui leur sont consacrés :
celui de Pierre Prouvost dans la généalogie qu'il rédigea en 1748 : « Voila la
description des descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques a la fin de cette
année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans vanité, que lesdits
du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de biens, d’honneurs et de bonne
réputation en la foi catholique apostolique et romaine et les plus notables des
villages qu’ils ont habitez " et le littéraire C. Lecigne, en 1911, au
sujet du poète Amédée Prouvost: " Dès l’âge de cinq ans, Amédée Prouvost
se sentit dépositaire d’une tradition et comme l’héritier présomptif d’une
royale lignée : il apprit un à un le nom de ses prédécesseurs et que chacun
d’eux signifiait depuis quatre siècles et demi, beaucoup d’honneur, de travail
et de foi chrétienne. On ne voulut pas qu’il puisse méconnaître ce passé et,
si, par impossible, il lui arrivait d’être infidèle, qu’il eût l’excuse de
l’ignorance. Un jour le père prit la plume et, sans orgueil, sans autre
prétention que de donner à ses enfants la conscience intégrale de leurs
origines, il écrivit les annales de sa famille. Avant tout, il songea à celui
qui était son premier né, l’espérance de la dynastie ; il s’adressa à lui : «
Je crois utile, mon cher fils, dès tes premiers pas dans ta vie d’écolier, de
t’initier à ce que tes maîtres ne pourront t’enseigner avec autant de
persuasion que ton père, j’entends l’amour de la famille, le respect de ses
traditions d’honneur, un attachement inébranlable aux convictions religieuses
de nos pères, et leur fidélité aux traditions monarchiques. Je considère comme
un devoir de te donner comme modèle
cette lignée d’ancêtres.»
Je ressens la défection de la Monarchie depuis plus de 150 ans
en France tel un orphelin et je regarde la division bicentenaire des deux
branches de la famille royale française comme un Scandale au sens évangélique
du terme : le principe des élites est de SERVIR, a fortiori le Roi et les
princes. J’ai donc appris depuis 54 ans à me servir par moi-même pour servir à
mon tour : j’organise des évènements oniriques puisque la République, malgré
ses indispensables qualités, n’a pas le niveau de transcendance de la Monarchie
démunie pour vraiment enchanter (charme=chant magique) à l’invitation de la
Vie, seule vraie puissance invitante. Le fruit de mes deux ouvrages familiaux est d’avoir ordonné seul cette centaine de
familles patriciennes des Flandres méridionales, personne ni aucune institution
ne daignant les observer avec une juste transcendance ; il y a trois ans, on me
regardait, en tant que membre de ces familles, comme un « fabricant de
chaussettes » ; aujourd’hui, je reçois dans les deux demeures ancestrales
restaurées que sont mes sites et j’ai pu regrouper les caractéristiques uniques
de ces familles depuis sept cents ans au
Patrimoine Vivant de la Civilisation, en facilitant aux hôtes la vue aérienne
des illustrations et des dévouements depuis la sphère."
http://www.thierryprouvost.com/PATRIMOINE%20VIVANT.html
S'ils
descendent d'une lignée de propriétaires aisés
installée à Wasquehal
(Jehan, fils de Willaume ci-dessus) et les environs, les
Prouvost actuels ont, jusqu'aux travaux d'Alain Watine-Ferrant en 2012,
été reliés aux voisins Prouvost des Huchons
du XV° siècle dont les terres se situaient autour du fief des Huchons; Jehan Prouvost, échevin de
Roubaix, Seigneur de Wasquehal, était le bras droit de Pierre de Roubaix, proche de
Charles de Bourgogne. Ces familles patriciennes et terriennes des Flandres
étaient au service de leur ville et de
leurs suzerains qu’elles servaient comme un souverain dont
on connait le luxe de la Cour, le talent de leurs peintres (Van Eyck).
La famille Prouvost s’installa à Lille pendant
100 ans quand Pierre II Prouvost (1648-1691) épousa Marguerite de
Lespaul ; ils faisaient partie des principales familles de Lille et donc
du Royaume de France suzeraine depuis peu dans cette région : et furent
inhumés sous le pavement des principales églises de Lille avant que
soient interdites les inhumations à l’ intérieur des sanctuaires.
La famille était liées aux Manufactures Royales sous la
protection de Charles Alexandre de Calonne, 1734-1802, intendant de
Flandre et Artois à Lille (1778) , ministre et Contrôleur général des finances
de Louis XVI entre 1783 et 1787, et du Dauphin, fils de Louis XVI.
Pierre IV
Constantin Prouvost (1747-1808),
échevin de
Roubaix sous l’ Ancien Régime "Maître de Manufacture" puis maire
de Roubaix le 13 août 1795, l’ un des principaux fabricants roubaisiens
après avoir échappé à la guillotine par la grâce de la "Réaction
Thermidorienne".
L’ attachement
religieux de ces familles conduisait
tout naturellement au légitimisme qui survivra à la chute de Charles X, voire à
celle du comte de Chambord jusqu’aux consignes de ralliement au pape Léon XIII .
Les noyaux forts
du légitimisme sont autour de la famille Bernard et alliés ;
beaucoup restèrent monarchistes sous la III ° République avec des noms comme
les Delobel, Desurmont, Florentin Droulers ; d’autres sont orléanistes : Danel, Delattre,
Motte-Bossut ; enfin des bonapartistes : Henri Loyer, Kuhlmann,
Dansette, Constantin Descat, Mimerel ; mais il y a aussi les républicains : Achille Scrépel, Paul Tiberghien-Toulemonde, Alfred
Motte-Grimonprez contre qui toute la famille vota.
Carlos Masurel,
maire de
Tourcoing (1847-1849), (1853-1855), conservateur et catholique, ayant reçu l’ Empereur
et l’ Impératrice.

Charles I Jérome Prouvost écrivait ceci :


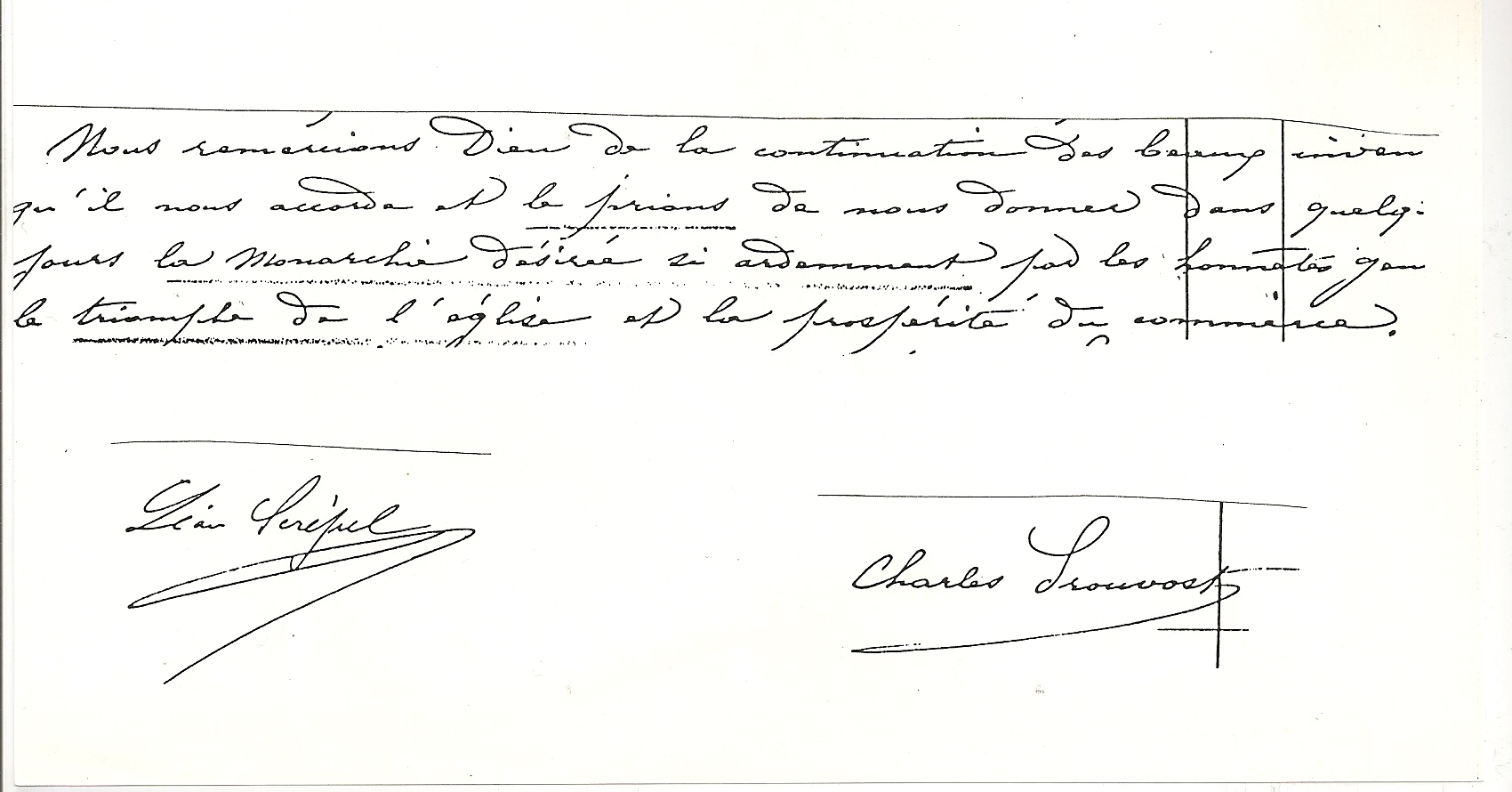

"Ce document
signé par Charles-Jérome Prouvost et Léon Scrépel ne peut dater que de quelques
jours avant le 30 janvier 1875 où le parlement vota, à une voix
près, celle du député Wallon, en faveur de la République, au détriment de
la Monarchie, représentée par le Comte de Chambord qui prit le prétexte de son
attachement au drapeau blanc pour éviter d'usurper le légitime retour des
descendants de Naundorff. Le Président fut le Maréchal de Mac-Mahon." Christian Prouvost père
Charles III Prouvost
incarne la conception monarchiste.
Son Fils ainé Christian Prouvost
(Virnot)
évoque constamment les bienfaits du principe monarchiste
mais critique les divisions légitimistes/orléanistes.
Thierry Prouvost
fut membre de l’ « Association Unité
Capétienne » depuis les débuts ; défenseur du principe monarchique
comme incarnation d’une nation par une famille, mais critique sur ses
éventuelles conséquences négatives.
Amédée II Prouvost :
« le nom de
grand-père à coté de celui de mon
grand-père Toulemonde, cote à cote en 1887 parmi les fondateurs du Syndicat
Mixte de l’ industrie Roubaisienne, le seul mouvement social et chrétien à l’ époque.
J'ai eu aussi la joie de relever dans les archives du Syndicat des Peigneurs
dont grand-père fut président de 1892 a 1919, texte suivant, qui bien que daté
de 1891 par sa critique du libéralisme et son souci du bien commun a un cachet presque moderne. Il s'agit de l’ étude de caisses de secours en
faveur du personnel : « Monsieur Prouvost dit qu'il y a beaucoup à faire dans cet ordre d'idée et
sa conviction est déjà ancienne, puisque depuis longtemps il s'intéresse à ces questions d'économie sociale
dans le but de rapprocher le plus possible les ouvriers et les patrons. En
compagnie de nombreux industriels de la région, il fait partie des syndicats mixtes qui se
proposent ce but. C'est pourquoi il est
amené à formuler quelques réserves sur les principes votés à la réunion
précédente. Sa conviction ancienne et profonde, est que sans un bien commun
supérieur, sans une autorité qui courbe sous la loi de justice idéale et les
ouvriers et les patrons inspirant à chacun sa règle de conduite, il est impossible de faire disparaitre les
malentendus, les suspicions, que les excès du libéralisme suscitent parfois ».
Grand-père, quelques années auparavant, en 1889, avait participé à un pélérinage
à Rome, de dix mille ouvriers et patrons, dont six cent cinquante du Nord,
venus rendre hommage à Leon XIII .
Je ne sais pas grand-chose des idées
politiques de notre cher grand-père. Il fut certainement dans sa jeunesse royaliste et
légitimiste. J'en eus une preuve dans le fait que, quand j'étais enfant vers
1910, il m'offrit un médaillon avec une
photo du Comte de Chambord et les fleurs cueillies sur sa tombe. Il s'était rendu avec son beau-frère Droulers,
aux funérailles du dernier Bourbon de la branche ainée à Göritz en 1883.
Sur ses convictions religieuses, nous sommes
bien mieux renseignés. Il était, comme
sa femme, membre du Tiers-Ordre de Saint-François. Il fit édifier à M'Rira, prés de Tunis, dans un
domaine où il fut associé avec son frère
Edouard, une chapelle qui devint paroisse. Il
contribua à faire édifier près de sa propriété de Mandelieu une
chapelle, N.-D. des Mimosas. Il contribua certainement à la construction du
grand couvent de la Sainte Famille à
Roubaix, rue de Lille, où sa belle-sœur, religieuse, tante Jeanne Bénat, laissa
un très grand souvenir. Pendant la
guerre de 1914-1918, il prit la tête
d'un Comité dit du Vœu de Roubaix, dans le but de demander à Dieu la protection
de la ville , qui fut heureusement épargnée. Le clocher qui manquait à l’ église
du Sacré-Cœur, fut ainsi construit. Il avait de tout temps porté de l’ intérêt à l’ Orient
Chrétien et présidait le comité de Roubaix de l’ Œuvre d'Orient. Son dévouement
à l’ Œuvre d'Orient, lui valut d'être
nommé Commandeur de l’ Ordre du Saint-Sépulcre, et nous avons eu sous les yeux
une photo de grand-père, revêtu d'une cape prestigieuse, dont les mauvaises
langues disent qu'elle a terminé sa carrière comme peignoir de bain de mes
cousins Auger.
C'est pendant la guerre de 1914 que grand-père donna le plus
bel exemple de sa foi patriotique et religieuse. Le 1er mars 1916, il était emmené par les Allemands avec tout ce
que Roubaix comportait de notabilités politiques et économiques, comme otage au
camp
d'Holzminden. Cette captivité, écrit grand-mère dans un petit
opuscule « In Memoriam », fut extrêmêment dure pour lui à cause de sa
santé précaire, de l’ infirmité de sa jambe récemment soumise à une
intervention chirurgicale. J'ai eu des échos de l’ admiration qu'il suscita en se rendant à pied, au lieu de
rassemblement. La captivité - elle devait durer 6 mois bien que dure pour un
homme de 63 ans (hiver terrible, couchage sommaire, promiscuité) ne semble pas
avoir altéré sa bonne humeur et dans ses lettres grand-père ne se plaint pas. Il remercie des photos de famille qui lui ont fait un immense plaisir. « Odette
Lesaffre, sur la photo, m'a semble très jolie et très grande, Claude est-il toujours aussi diable? Merci des lettres de ma chère Betsy et de ses envois, de la
photo de Simone, je ne connais pas ma dernière petite-fille. Henry me ferait
plaisir en me rassurant sur mon Assurance Vie, je ne puis payer les primes.
Solange a été bien gentille pour moi,
j'ai vu les photos de ses enfants, le bon sourire de Georges annonce un heureux
caractère ». En se prolongeant, la captivité lui devenait de plus en plus
pénible. Son cousin et compagnon de captivité, Henri Prouvost, était mort dans
ses bras et cela l’ avait beaucoup affecté. Rien ne manqua à son angoisse, il fut hospitalisé six semaines au lazaret du
camp, à cause d'une grande dilatation de l’ aorte, qui donnait des
complications cardiaques. Il fut en
grand danger. Grand-mère poursuit dans l’ opuscule déjà cité : « Après six mois
de captivité, le retour à Roubaix fut une meurtrissure pour son cœur, trouvant
une maison vide de toutes ses affections et pleine d'Allemands installés en Maîtres
. En outre, par suite d'information erronée, tant à Roubaix qu'à Holzminden, on
s'attendait à ce que les otages libérés fussent dirigés vers la France libre.
Grand-mère et Mimi partirent, en conséquence, pour la France libre, vers
laquelle les Allemands organisaient parfois les trains via la Suisse, et quand
grand-père revint à Roubaix, la maison était vide; Il semble d'après les documents que m'a
communiqués Hubert Dubois et dont grand-mère a donné lecture a ses enfants avec
un admirable courage au lendemain des funérailles de son mari, que grand-père
ait été a nouveau inquiète par les Allemands après son retour de captivité. On
lit en effet en date du 12 novembre 1917:
« En partant au tribunal de guerre, «je ne
cesse de penser à toi, chère compagne, à
mes chers enfants, à mes petits-enfants, et à toute la famille. Si ma santé devait
être ébranlée, et que je succombe dans mon cachot, je mourrai en bon chrétien
et en partant vers Dieu ma dernière pensée , mes dernières bénédictions seront
pour vous. J'ai le cœur qui saigne, mais j'ai l’ âme en paix, je serai
courageux dans mes heures de souffrance, je vous embrasse tous avec affection
et tendresse. P.S. Que mes petits-enfants demeurent de bon chrétiens fidèles à nos traditions familiale s. « Laus Deo
Semper! " C’est dans les mêmes dispositions de foi et de courage qu'Il devait mourir prés de dix ans plus tard.
Le mode économique de ces sociétés industrielles mais
aussi leur environnement artistique à travers les siècles ne peuvent pas être
dissociés du principe royal, ducal, princier.
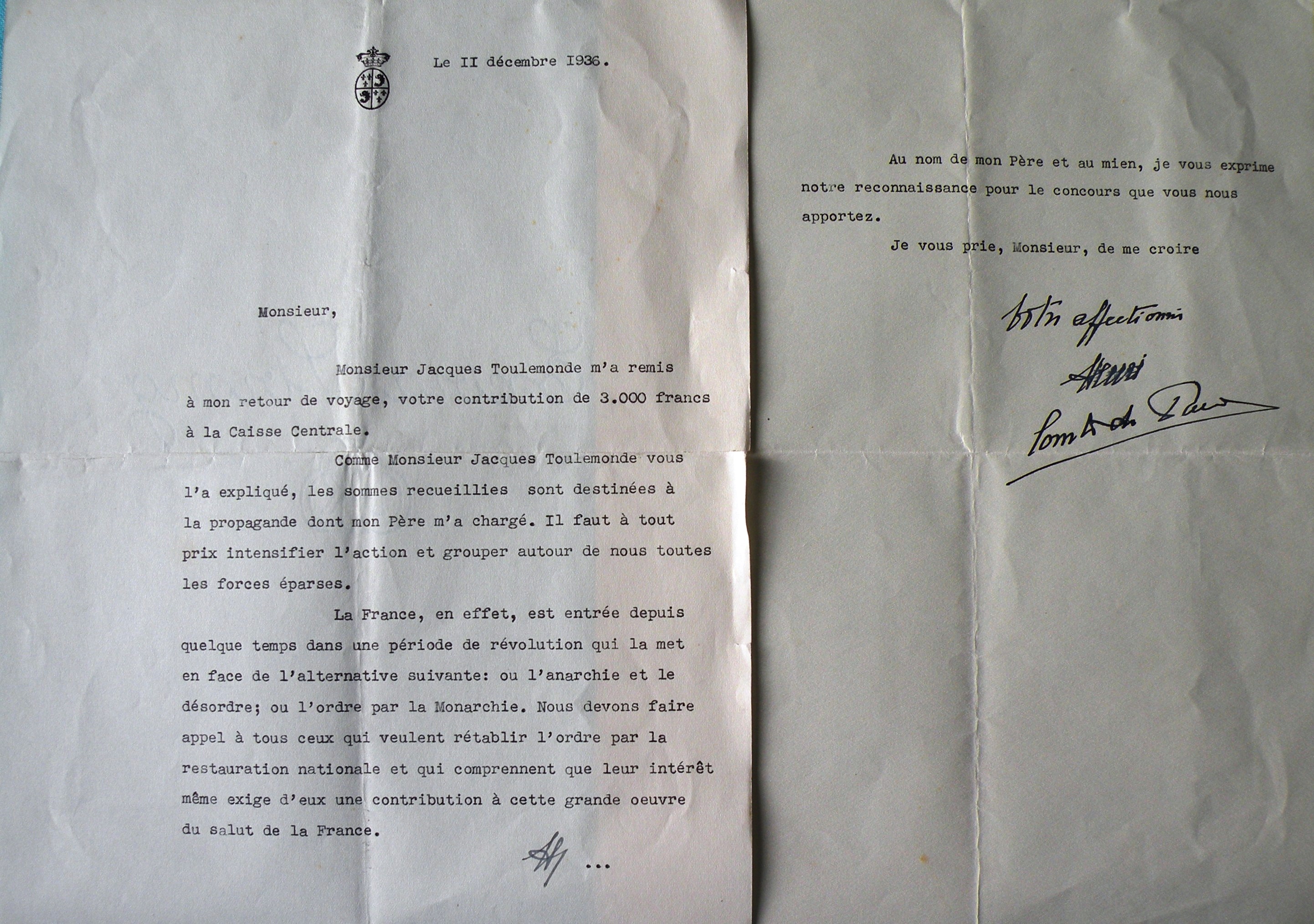
Il y eut, parmi
tant d’autres , Charles Henri Victor Jonglez
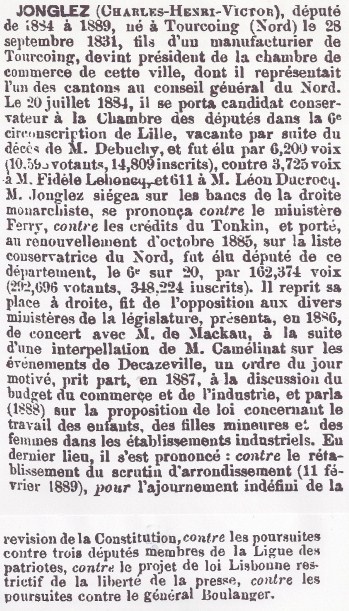
Et Auguste-Louis
Lepoutre :
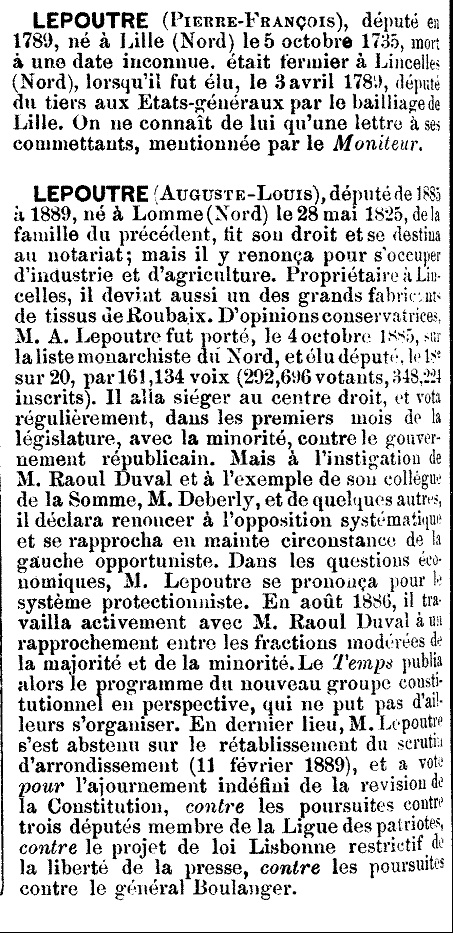
Et Pierre-François et Louis-Henri Dehau de
Staplande
Marie Sophie Cécile PROUVOST, née le 25 juin 1863 -
Roubaix, 59100, Nord, France, décédée le 9 juillet 1935 - Tourcoing, 59200,
Nord, France à l’âge de 72 ans, Infirmière major de la Croix-Rouge, fille de
Charles Prouvost et Marie Scrépel, épouse de Charles Julien FLIPO
1859-1928 marié le 18 avril 1883, Roubaix.
Recensement des Maires
MairesGenWeb
Pierre Constantin Joseph
PROUVOST 13.08.1795 08.11.1795
59 - Roubaix
Jean PROUVOST
1951 1977 41 - Yvoy-le-Marron
Pierre PROUVOST
03.1977 6.03.1983
59 - Roubaix
Elisabeth PROUVOST
1977 1977 41 - Yvoy-le-Marron
François PROUVOST
2001
02 - Bucy-lès-Pierrepont
Olivier PROUVOST
2001 62 -
Bienvillers-au-Bois
4 Diverses décorations
Branche ainée:
PROUVOST Henri Edmond Philippe, chef
de la branche ainée des Henri Prouvost, né le 23/08/1861 à Roubaix.
PROUVOST Edmond
Charles Joseph, de la branche ainée des Henri Prouvost. Chevalier LH
le 15/10/1921, industriel Nord
PROUVOST Christian
Charles Raymond 19800035/624/71793
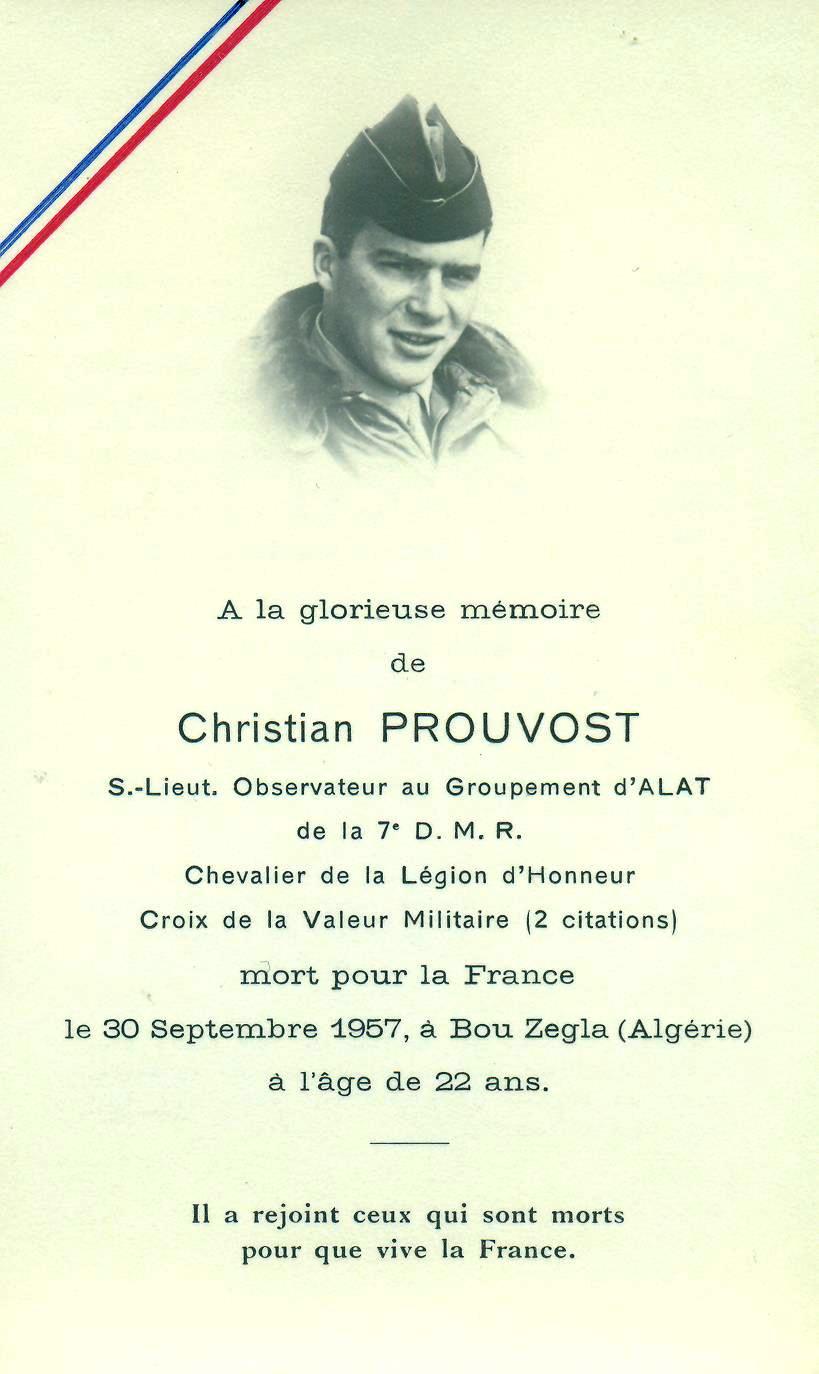
Branche des Amédée Prouvost
PROUVOST Rieule Félix Amédée (I), chef de la branche , né le 30/03/1820 à Roubaix
PROUVOST Amédée Charles 1853/04/13 Nord
; Roubaix LH/2230/22
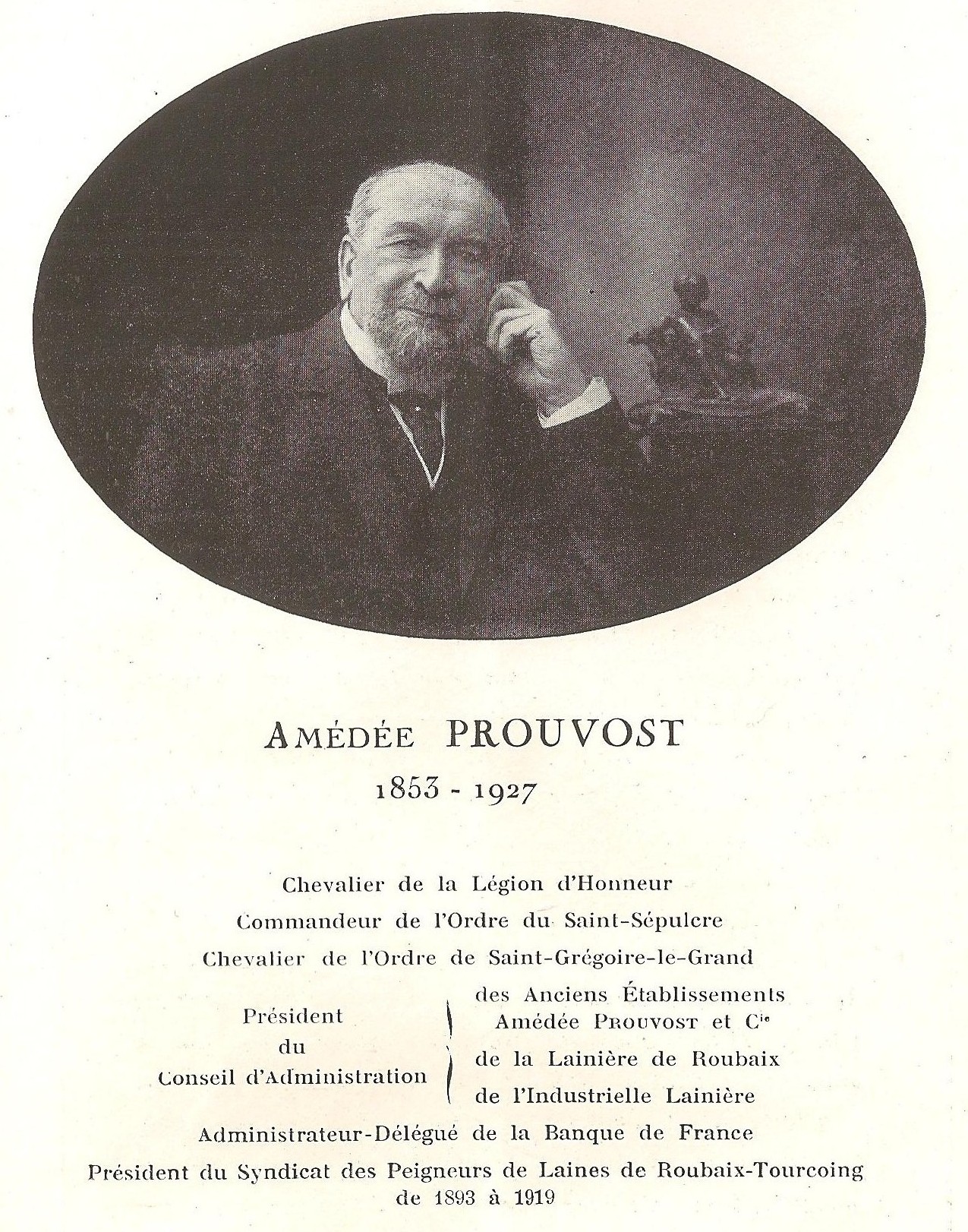
Albert-Félix Prouvost
Président du Tribunal de Commerce de Roubaix
Administrateur délégué du Peignage Amédée
Prouvost et Cie et de la lainière de Roubaix
Vice Consul d’Espagne
Chevalier de la Légion d’honneur

Au sujet de son père: « Monsieur Amédée Prouvost est le type
du grand industriel roubaisien, actif, intelligent, dominant tout un monde par
l’exemple, le prestige de son travail et de son dévouement. Il est, de plus, un
artiste et un lettré ; sa maison est une bibliothèque et un musée d’art. Il
se délasse de ses longues journées de labeur à feuilleter les beaux livres ou à
contempler sa collection de primitifs. A son école, le futur poète apprend le
secrêt d’embellir par l’esprit et le goût les vies les plus austères.
On ne lui dit point mais il voit bien que les
vertus de ses ancêtres revivent en son père. Il salue en lui, avec une
admiration qui grandira sans cesse, un des chefs de l’usine et du foyer dont il
vient de contempler le magnifique cortège. Extrait du livre sur le poète Amédée
Prouvost par Lecigne, Grasset.
« C'est pendant la guerre de 1914 que
grand-père donna le plus bel exemple de sa foi patriotique et religieuse. Le 1er
mars 1916, il était emmené par les Allemands avec tout ce que Roubaix
comportait de notabilités politiques et économiques, comme otage au camp
d'Holzminden. Cette captivité, écrit grand-mère dans un petit opuscule « In
Memoriam », fut extrêmement dure pour lui à cause de sa santé précaire, de
l’infirmité de sa jambe récemment soumise à une intervention chirurgicale. J'ai
eu des échos de l’admiration qu'il suscita en se rendant à pied, au lieu de
rassemblement. La captivité - elle devait durer 6 mois bien que dure pour un
homme de 63 ans (hiver terrible, couchage sommaire, promiscuité) ne semble pas
avoir altéré sa bonne humeur et dans ses lettres grand-père ne se plaint pas.
Il remercie des photos de famille qui lui ont fait un immense plaisir. « Odette
Lesaffre, sur la photo, m'a semble très jolie et très grande, Claude est-il
toujours aussi diable? Merci des lettres de ma chère Betsy et de ses envois, de
la photo de Simone, je ne connais pas ma dernière petite-fille. Henry me ferait
plaisir en me rassurant sur mon Assurance Vie, je ne puis payer les primes.
Solange a été bien gentille
pour moi,
j'ai vu les photos de ses enfants, le bon sourire de Georges annonce un
heureux
caractère ». En se prolongeant, la captivité lui
devenait de plus en plus
pénible. Son cousin et compagnon de captivité, Henri
Prouvost, était mort dans
ses bras et cela l’avait beaucoup affecté. Rien ne manqua
a son angoisse, il fut
hospitalisé six semaines au Lazaret du camp, a cause d'une
grande dilatation de
l’aorte, qui donnait des complications cardiaques. Il fut en
grand danger.
Grand-mère poursuit dans l’opuscule déjà
cité : « Après six mois de captivité,
le retour à Roubaix fut une meurtrissure pour son cœur,
trouvant une maison
vide de toutes ses affections et pleine d'Allemands installés en
maîtres. En
outre, par suite d'information erronée, tant à Roubaix
qu'à Holzminden, on
s'attendait à ce que les otages libérés fussent
dirigés vers la France libre.
Grand-mère et Mimi partirent, en conséquence, pour la
France libre, vers laquelle
les Allemands organisaient parfois les trains via la Suisse, et quand
grand-père revint à Roubaix, la maison était vide;
il semble d'après les
documents que m'a communiqués Hubert Dubois et dont
grand-mère a donné lecture
a ses enfants avec un admirable courage au lendemain des
funérailles de son
mari, que grand-père ait été a nouveau
inquiète par les Allemands après son
retour de captivité. On lit en effet en date du 12 novembre 1917
:
« En partant au tribunal de guerre, «je ne
cesse de penser à toi, chère compagne, â mes chers enfants, à mes
petits-enfants, et à toute la famille. Si ma santé devait être ébranlée, et que
je succombe dans mon cachot, je mourrai en bon chrétien et en partant vers Dieu
ma dernière pensée, mes dernières bénédictions seront pour vous. J'ai le cœur
qui saigne, mais j'ai l’âme en paix, je serai courageux dans mes heures de
souffrance, je vous embrasse tous avec affection et tendresse. P.S. Que mes
petits-enfants demeurent de bon chrétiens fideles à nos traditions familiales.
« Laus Deo Semper! " C’est dans les mêmes dispositions de foi et de
courage qu'il devait mourir prés de dix ans plus tard. »
« Notre père avait insisté vivement
auprès de notre mère pour la décider à quitter Roubaix. Par sa position au
Peignage, son titre de président du tribunal de Commerce, il jugeait que son
devoir impérieux était de rester à son poste » Albert-Eugène Prouvost
Il avait été emprisonné comme notable puis
relaché en sa qualité de Consul d’Espagne, il avait défendu pied à pied nos
usines contre les réquisitions de l’ennemi. Il
était un des dirigeants du Comité général d’aide sous toutes ses formes
à la population ouvrière très éprouvée ; il décéda des suites d’une
opération bénigne après avoir écrit des lettres empreintes des mêmes sentiments
de foi en Dieu et dans une France renouvellée par l’épreuve. Dans les trois
derniers mois, il marque sur ses carnets ceux chez qui il fut invité : les
Emile Masurel, Edmond Masurel, Madame Auguste Vanoutryve, Amédée Prouvost,
henri Mulliez, Ernest et François Roussel, René et Joseph Wibaux, Eugène Mathon ;
le 31 mars : « dîner chez les Edmond Masurel ». Le 5 avril il
succomba à son embolie.
Les élus socialistes pronocèrent des disours
empreints de la meilleure reconnaissance
pour l’œuvre accomplie.
Du Préfet du Nord à M. le Président de la Chambre de la Commerce
de Roubaix. (3 novembre 1882.) « Monsieur le Président, j'ai.l'honneur,
de vous faire connaître que par dépêche du 2 novembre courant, M. le Ministre
des Affaires étrangères vient de m'informer que M. Albert Prouvost a été nommé vice-consul
d'Espagne à Roubaix.
« Esprit droit et éclairé, Albert
prouvost joignait, à une grande largeur de vues, la plus exquise bonté :
les humbles et les grands avaient droit égal à sa sollicitude, et il prenait à
cœur avec le même scrupuleux esprit de justice, la cause la plus obscure et le
procès le plsu retentissant : aussi ses collègues ne se lassaient ils pas d’admirer son
inépuisable patience, qui n’avait d’égal que son inaltérable urbanité.
Il fut avant tout un homme de devoir, et cet
esprit de sacrifice, il le poussa jusqu’au bout lorsqu’aux heures tragiques
d’octobre 1914, où il se sépara de ceux qu’il avait de plus cher au monde,
parce qu’il estimait que son devoir lui commmandait de rester à son poste de
premier Magistrat de la Ville.Il fut de ceux dont on peut dire : «
il a passé en faisant le bien, aussi sa récompense sera éternelle». Discours
d’Henir Eckmann au nom du tribunal de Commerce de Roubaix.
Albert-Eugène Prouvost
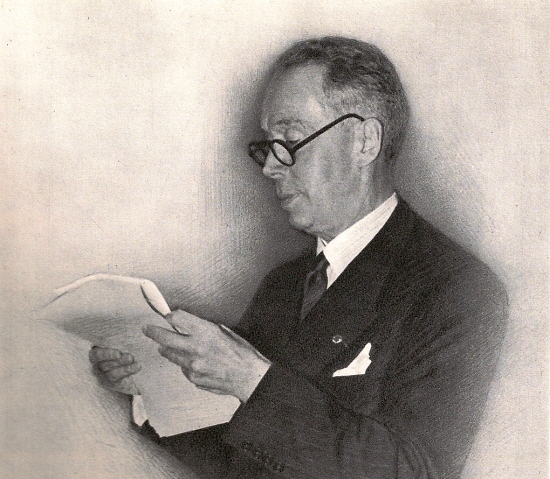
« Pendant la guerre furent tués Paul
Lefebvre, mon beau frère Eugène Motte, Georges Florin ; en juin 1915,à Hébuterne
en Artois, un de nos régiments fut particulièrement frappé : mon cousin
germain, l’héroïsme Abbé Henri Lestienne, André Masurel, François Motte
entr’autres tombèrent au champ d’honneur. Mon beau frère, le lieutenant Jean
Cavrois avait été désigné pour faire partie du corps expéditionnaire en
orient : brave parmi les plus braves, il fut tué en entrainant sa section
à l’assaut sur un champ de bataille de Serbie. »
"" C’est dans les mêmes
dispositions de foi et de courage qu'il devait mourir prés de dix ans plus tard. ».
Les familles du Nord eurent leurs figures de résistance.
Industriel, héritier de la famille des Motte-Bossut, ancien maire de la ville entre
1902 et 1912, Eugène Motte refuse en 1915 de fabriquer pour les Allemands des
sacs destinés, une fois remplis de terre, à la protection de leurs tranchées. «
Nous ne pouvons accepter le rôle de collaborateurs de l’ ennemi. Vous pouvez
réquisitionner nos biens, vous ne pouvez réquisitionner nos personnes. »
Cela lui vaut d’être arrêté puis interné en Allemagne avec 150 autres otages roubaisiens."
Mobilisé le 3 août 1914, je fus chargé
d’utiliser ma voiture et fit pendant six mois l’évacuation de matériel. ;
fin 1915, je m’inscrivis à l’école d’officiiers de beauvais et, au début de
1916, on me confiait, comme sous-lieutenant, le commandement d’une section
Saniataire automobile pour chercher les blessés : je vis de près le courage et la souffarnce.
Un
roubaisien fut particulièrement à l’honneur,
le commandant Bossut. Chargé du transport des malades, je fus
légèrement blessé. Ma Section Sanitaire 111
reçut plusieurs Croix de Guerre :
j’en reçu une : « Le sous-lieutenant
Prouvost, Albert Eugène, de la
SSA : pendant les deux périodes de séjour en secteur
de la division, a
exercé avez zèle, intelligence et dévouement, le
commandement de sa
section » par des routes très bombardées.
Le gouvernement français demanda à mon frère
Jean Prouvost de créer à Elbeuf un peignage qui utiliserait le matériel du
peignage de Reims ; Albert-Eugène reçut un ordre de mission pour se
procurer de la laine brute en Argentine : en janvier 1918, il arriva à
Buenos-Aires avec Rita et mes enfants. Il avait son bureau à l’hôtel Plaza avec
sa secrétaire Rita.
L’immense tragédie nouos avait tous marqués
pour la vie. C’en était fini de notre belle et insouciante jeunesse d’avant
1914. Nos villes et nos demeures avaient été à peu près épargnées ; notre
mère décida de quitter le boulevard de Paris pour rejoindre sa mère au Vert-Bois ;
elles retrouvent le fidèle Clovis et la chère Irma.
Deux amis intimes de mon père, Eugène Mathon
et Joseph Wibaux fondèrent le « Consortium de l’industrie textile »
avec mission de relever le niveau de vie des populations ouvrières, le soutien
des familles nombreuses, avec un sursalaire par voie de compensation
interprofessionnelle. : « Notre région de Roubaix-Tourcoing »
peut revendiquer l’honneur de cette création bénévole qui, peu à peu, s’étendit
aux autres régions de France et fut finalement consacrées par la loi sur les
allocations familiales qui établit la justice sociale entre les familles et est
à la base du relèvement de la natalité de notre pays».
Toutes les Fédérations lainières furent
regroupées, sur l’idée d’Eugène Mathon, en « Comité Central de la Laine,
au 14, rue d’Anjou

à Paris en 1922 présidé par Jules Vanoutryve,
Eugène Motte, Albert Prouvost jusqu’en 1958.
Localement, les peigneurs de laine, bien que
se concurrençant vivement, ont toujours
représenté une groupe d’excellents camarades et amis. Le syndicat fut présidé
par Amédée II Prouvost de 1899 à 1920 puis Albert-Eugène de 1920 à 1933 (étendu à
l’ensemble des peignages français et
puis Eugène Motte de 1933 à 1955.
Mon discours du centenaire du Peignage en
juin 1951 :
Grandes dates :
1919 : Fondation de Prouvost et Lefebvre
1927 : Création du peignage de Wattrelos
et de la centrale Electrique
1924 : peignages des USA : la
branch River wool Combing company et grand voyage aux Etats-Unis.
« Voyage d’Albert, Rita, Marguerite,
Albert-Auguste et Madame Vanoutryve : visite du chantier de l’usine de
Woonsocket,chutes du Niagara, Detroit et les usines Ford, Chicago et les
abattoirs, Colorado Springs et Buffalo Bill, denver et le Pikes Peak, Le grand
canyon de l’Arizona.Salt Lake City et les mormons, San francisco, Santa
barbara, et son tremblement de terre deux joours avant de passer, Hollywood et
ses studios (Marguerite obtient un autographe de Charlie Chapplin), le Texas,
la Noouvelle Orléans, Washington et la Maison Blanche, Philadelphie et
New-York, Manhattan, l’ascenseur de l’Empire State, retour par « l’Ile de
France » au Havre.
PROUVOST Jacques Eugène
Albert 1906/12/15 Nord ; Roubaix 19800035/336/45309
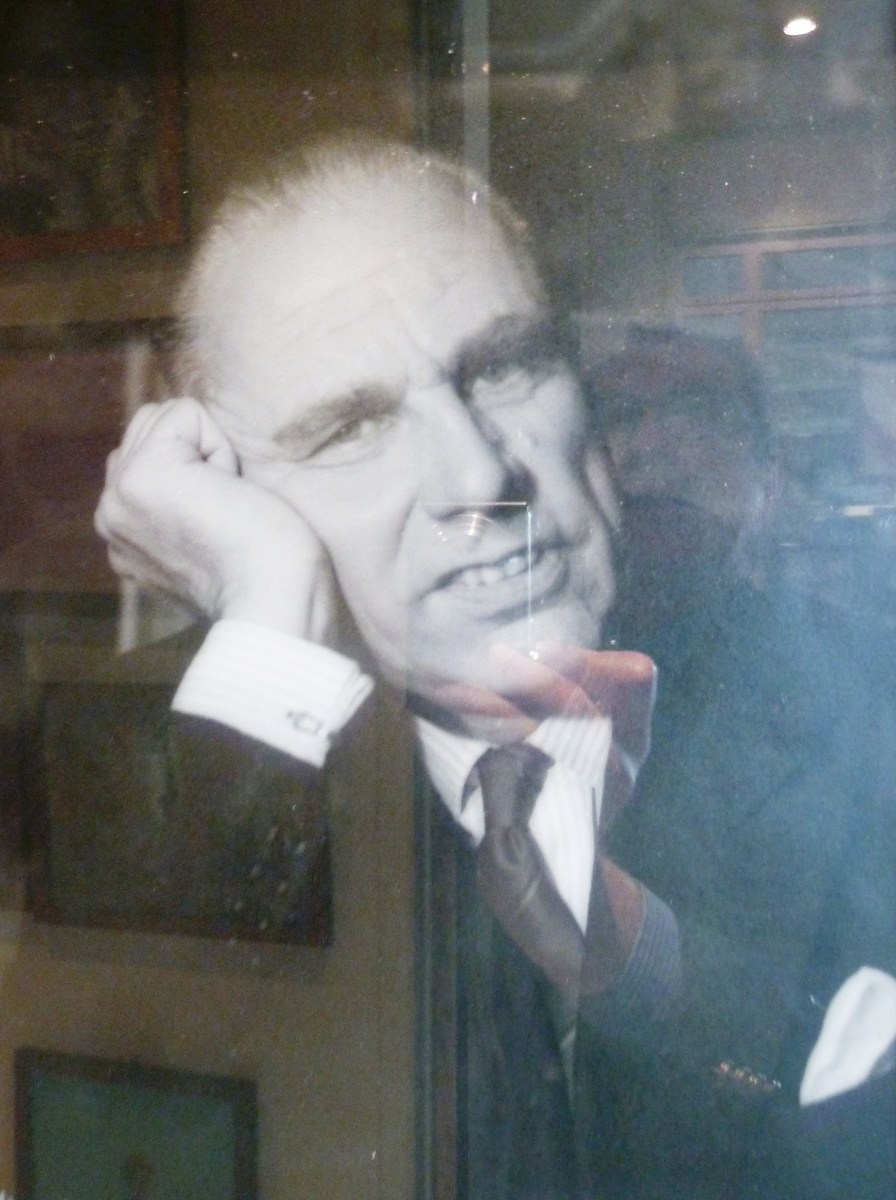
Albert-Auguste Prouvost

« Viscéralement
hostile à l’Allemagne
nazie, Albert-Auguste Prouvost a raconté comment, après
Montoire, il dut
« renier le Maréchal ». Les deux
directrices (protestantes) d’une clinique de La Madeleine
lui
proposèrent de rentrer dans le réseau Syvestre-War
Office. Sa propriété campagnarde
des environs de Lille devint un lieu de transit pour résistants
et aviateurs
britanniques ; il obtenait pour eux des fausses cartes
d’identité du maire
de Roubaix, Victor Provo. Il fit encore installer au peignage
Amédée Prouvost
une imprimerie clandestine qui édita des
« Instructions de combat ».
Il obtint d’amis industriels des fonds au profit de la
Résistance :
Bernard D’Halluin, Jacques Masurel,
Alphonse et Eugène Motte, Alphonse et Jean Tiberghien. Il
participa enfin aux
combats de la Libération, en particulier au lieudit Haut-
Vinage, dans la
commune de Wasquehal. Jean Masurel, cousin d’Albert Prouvost,
combattit, lui,
pour la libération de la capitale et y perdit une jambe. Son
frère Antoine
Masurel (1912-1990) participa en zone sud
à la construction du réseau Phratrie ; en mission
dans le Nord,
emprisonné, il fut délivré par l’avance
alliée du train qui l’emmenait en
déportation. Il se vit décerner le titre de compagnon de
la Libération. «
MN
« N'ayant
jamais sollicite cette distinction, je crois qu'il s'agit d'une plaisanterie.
Pas du tout. A notre retour dans le Nord, j’ouvre une lettre du ministre des
Finances de l'époque, François Ortoli qui me touche vivement. « Cette
exceptionnelle distinction, écrit-il, vient justement récompenser les services
que, avec dévouement, tact et compétence, vous rendez depuis trente-huit ans à
l’économie du pays. Connaissant l'étendue et l'éminente qualité de vos mérites,
il m'a été agréable de proposer au gouvernement de vous élever au grade
d'officier. Je suis heureux de vous en féliciter aujourd'hui. Un tel compliment
me remplit de confusion. J'avais eu la chance, en effet, avant qu'il ne soit
ministre, de le recevoir au Vert-Bois et de le lui faire visiter ainsi que
quelques quartiers résidentiels et logements de cadres qui l'avaient
impressionné. Comment pouvais-je imaginer que la conversation très amicale me
promettait cette promotion ? Je n’oublierai jamais les télégrammes, cartes et
lettres de félicitations qui me parviennent a cette occasion de tous les pays
du monde. N'ayant jamais fait de politique, je ne pouvais deviner qu'un jour je
recevrais des témoignages de sympathie de personnalités et de militants
d’opinions si diverses. »
" "Nous avons appris avec le plus grand plaisir, la nomination au grade de
Chevalier de la Légion d'Honneur, de MM. François Roussel, Albert Prouvost et
Henry Glorieux, tous trois industriels à Roubaix et membres de notre Club ;
qu'ils veuillent bien accepter nos plus sincères et nos plus vives
félicitations. A une époque où la lutte entre les peuples est exclusivement économique,
même quand ils en viennent à 1' « ultima ratio » des amis les grands
industriels représentent et défendent l'honneur national au même titre que les
officiers militaires. Comme eux, sans relâche et non sans péril, ils défendent
pied à pied ou, étendent notre suprématie, portant, au loin le renom."
La lecture des
mémoires d’Albert m’a révélé qu'un sang noble coulait dans ses veines; je
l'ignorais quand, devant sa tombe encore ouverte, j'ai salue le départ d'un
seigneur, généreux avec magnificence, qui ne rougissait ni d'habiter une
demeure historique parce qu'il avait consacre au logement social des années
d'imagination créatrice, ni d’avoir transforme sa maison familiale en musée
parce qu'il l’avait ouverte a tous. Quand la Reine d’Angleterre vint pour la
première fois chez nous en visite officielle, elle fut accueillie par Albert
Prouvost à la porte du peignage Amédée Prouvost. Aussitôt après cette brève
cérémonie, le patron s'éloigna discrètement pour rejoindre, au deuxième rang,
les membres du personnel de l'usine qui avaient appartenu comme lui pendant les
années noires, au groupe de Resistance Sylvestre Buckmaster. Je connaissais
alors Albert depuis dix ans. Jamais il n'avait dit, devant moi, la moindre
allusion à son engagement dans l'armée des ombres. Ce geste avait été discret,
le silence tout naturel; Albert Prouvost était un grand seigneur. Maurice
SCHUMANN de l’Académie Française.
« Le 1er février 1958, le CIL organise
une manifestation d'adieux pour rendre hommage à son fondateur. Je suis très
ému. Sur la scène, le président de l'Union Textile, Bernard d'Halluin, et le
député-maire de Roubaix reconstituent l’historique des faits et donnent le
bilan : 8 000 familles logées et 18 000 enfants qui s’épanouissent dans
des conditions de vie plus décentes et plus confortables. De mon coté, je
termine mon discours par ces mots:
« Si quelqu'un,
après ma mort, veut rappeler mon souvenir, peut-être pourrait-il, dans un des
squares de nos nouveaux quartiers, poser une plaque très simple, cachée dans un
coin de verdure. Si un jour, des enfants, au milieu de leurs jeux, venaient à
le découvrir, ils y liraient, auprès de mon nom, un seul titre - le plus beau
pour moi - « fondateur du CIL».
Le « 1% logement
» selon Lutte ouvrière :.
C’est un
groupement patronal, les patrons du textile du Nord, qui, cherchant à résoudre
le problème des logements pour leurs ouvriers, fut à l’origine de ce qu’on
appelle le « 1 % logement », l’État se ralliant en 1953 à cette initiative
privée.
Albert-Auguste
Prouvost, grand patron à la tête d’un empire industriel textile de la région de
Lille-Roubaix-Tourcoing, héritier de l’une de ces « 200 familles » et plus
grosses fortunes capitalistes du pays, estimait qu’il fallait loger décemment
les ouvriers : tout en soulageant quelque peu la misère, facteur d’agitation
sociale, cela permettrait une meilleure efficacité à l’usine, contribuerait à
baisser le coût du travail et à maintenir les bas salaires. Pour réussir à
construire massivement et pas cher, il était convaincu qu’il fallait trouver un
système qui permette d’attirer les capitaux en leur assurant une bonne
rentabilité. Il fallait concentrer les fonds, construire de façon standardisée
et industrielle, et réclamer l’aide et la garantie de l’État. Il fallait,
disait-il, « inciter l’initiative privée, brimée depuis 25 ans par une
législation néfaste, à retrouver ses fonctions normales de bâtisseur avec comme
condition essentielle de rendre cette construction rentable ». Et en attendant
que le gouvernement lui donne satisfaction et annule, en particulier, le
blocage des loyers, Prouvost organisa avec d’autres patrons du Nord une
cotisation de 1 % sur les salaires, versée à un organisme collecteur sous leur
contrôle, le Comité interprofessionnel du logement (CIL), permettant de mettre
en commun les ressources et de construire des logements dont ils restaient
propriétaires.
Prouvost
expliquait ainsi les avantages de l’opération : « Le
1 % étant intégré dans les
charges pouvait être répercuté en fin de compte sur
les prix de vente,
c’est-à-dire sur les consommateurs ». Il inaugurait,
dès 1946, le paritarisme
dans la gestion du CIL, permettant d’impliquer les organisations
syndicales
ouvrières dans la gestion des problèmes (« Si une
augmentation de loyer est
indispensable, elle sera plus facilement acceptée par les
travailleurs »,
expliquait-il). Par ailleurs, le CIL sollicitait des financements
complémentaires pour construire les logements ouvriers, comme
des subventions
de l’État, des départements ou des communes,
réussissant à faire en sorte qu’en
1950, les fonds collectés ne représentaient plus que 35 %
du coût proprement
dit de la construction. En effet, dès 1947, le patronat du Nord
avait obtenu
que les emprunts à taux réduits de la Caisse des
Dépôts et Consignations lui
soient ouverts et, en 1948, des aides aux ménages pour payer les
loyers (des
allocations-logement) ou pour accéder à la
propriété avaient été
développées.
Pourtant, fin
1950, l’entreprise restait limitée avec seulement 2 500 logements construits.
Mais elle avait gagné du terrain dans les milieux patronaux, avec le ralliement
des industriels de Mazamet, de Belfort, de Reims, qui firent pression sur le
gouvernement afin qu’il prenne des mesures favorables à la construction privée.
Ils réclamaient en particulier que le gouvernement étende à l’ensemble des
employeurs la cotisation du « 1 % logement » en lui donnant force de loi.
« Sous le
pseudonyme de Jean Bernard, il agit sur plusieurs plans. Il aide de nombreux
Résistants et aviateurs anglais à rejoindre Londres. Il se préoccupe aussi du
sort des jeunes requis dans le cadre du Service du Travail Obligatoire. Pour y
échapper, il leur propose de devenir caviste en Champagne, chez Moet et
Chandon, société tenue par les oncles de sa femme. Dans sa propre entreprise,
le Peignage Amédée Prouvost, il installe une imprimerie clandestine. Autre
initiative : une collecte de fonds organisée auprès de ses amis industriels,
Bernard d'Halluin, Jacques Masurel, Alphone et Eugène Motte, Alphonse et Jean
Tiberghien pour financer l'activité des réseaux. » Lutte ouvrière
Quelques jours
avant la libération, Albert Prouvost est au centre d'une négociation entre le
commandement Allemand de la région Nord et la Résistance.Le général Niehoff s'engage
à libérer tous les résistants détenus à Loos, si les maquisards ne s'opposent
pas au départ du dernier convoi allemand. Les responsables du réseau Sylvester
Farmer n'y croient pas une seule seconde, ils savent de quoi sont capables
leurs ennemis. En effet, le 1er septembre 1944, parti de Tourcoing, un dernier
train emmène vers le camp de la mort 900 prisonniers de Loos. Les résistants
wattrelosiens, avec à leur tête Henri Bracaval, essaient bien, à hauteur du
pont des 44, rue du Mont-à-Leux, de l'intercepter mais doivent y renoncer
devant l'importance des moyens mis en place par les Allemands. Bien peu de
prisonniers du train de Loos reviendront vivants des camps de la mort » MN
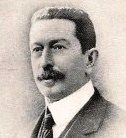
•PROUVOST Edouard Joseph, fils d'Amédée I Prouvost, Chevalier LH le 15/05/1910 Propriétaire agricole en Tunisie
Non rattachés : • PROUVOST Théodore
Auguste, né le 26/04/1826 à Nord - Lille Chevalier de la LH
PROUVOST Gaston Emile, entre 1802 et 1874
Chevalier LH
PROUVOST Georges Alexandre, Chevalier LH 16/06/1920, Sous Lieutenant au
147° régiment d’infanterie Nord
• PROUVOST Benjamin Joseph, né le 12/11/1774 à Roubaix
• PROUVOST Maurice Emile Léon Theodore, né le 11/08/1874 à Saint Rambert L'Ile Barbe (Lyon)
Autres vaillances :
Albert-Eugène Prouvost, fils d'Albert-Félix Prouvost
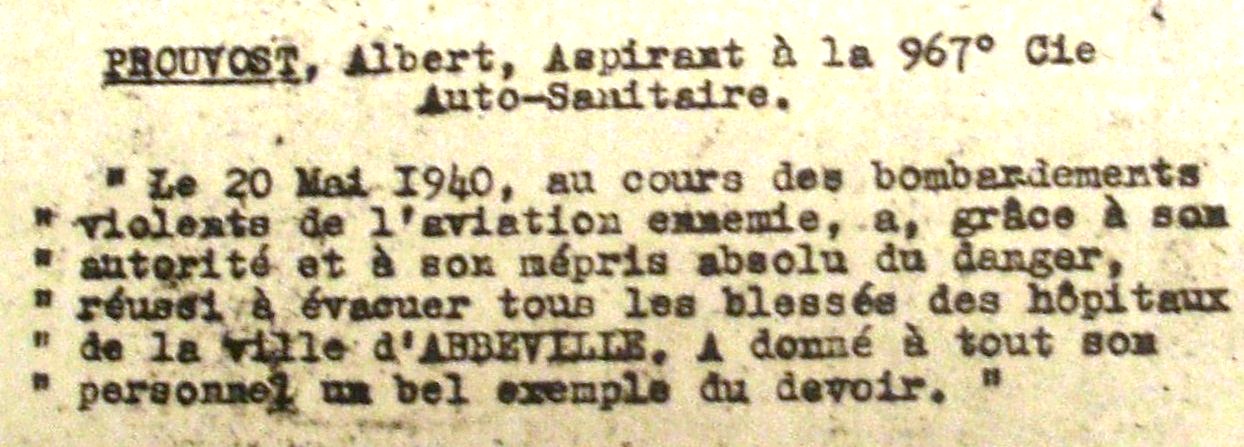
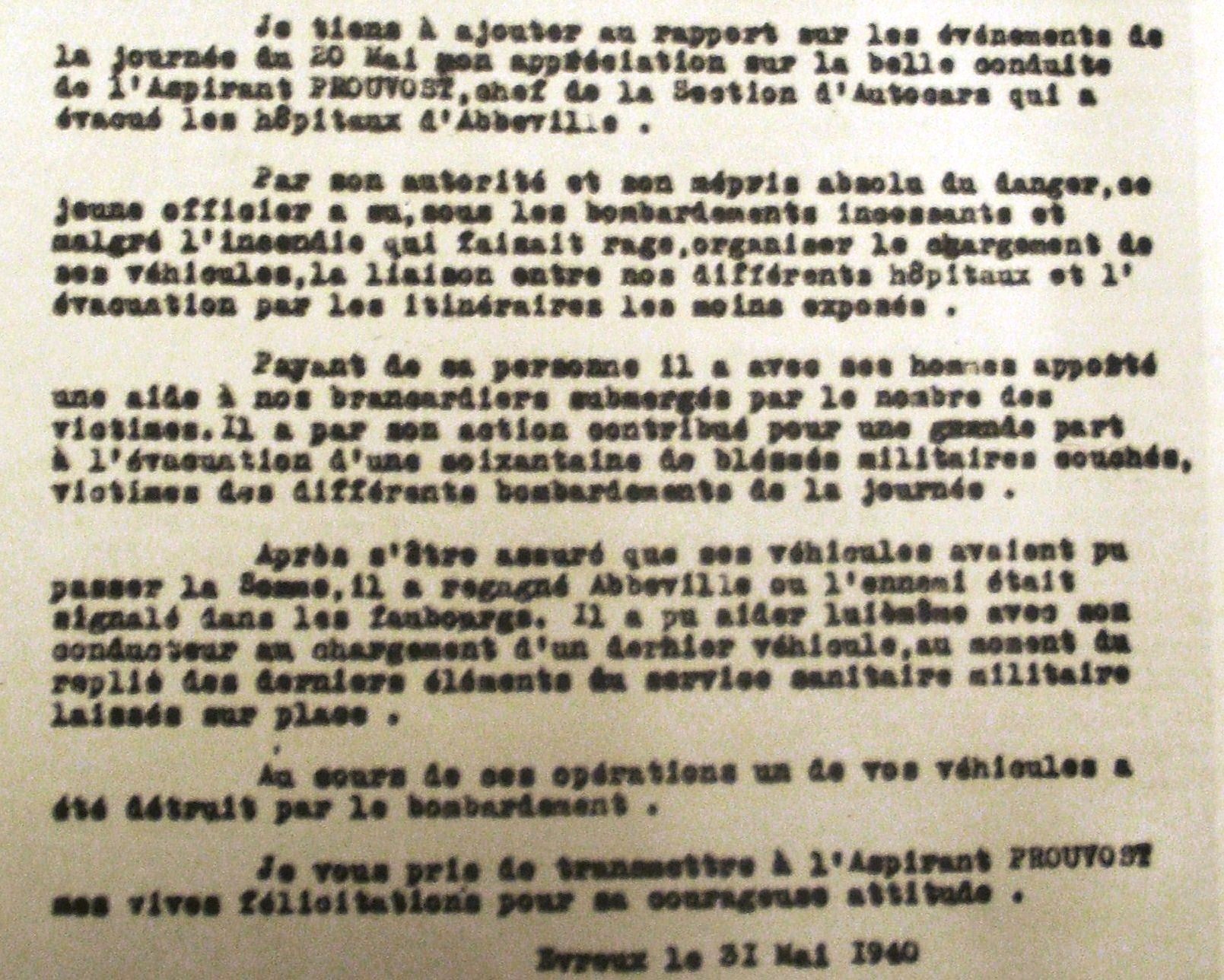
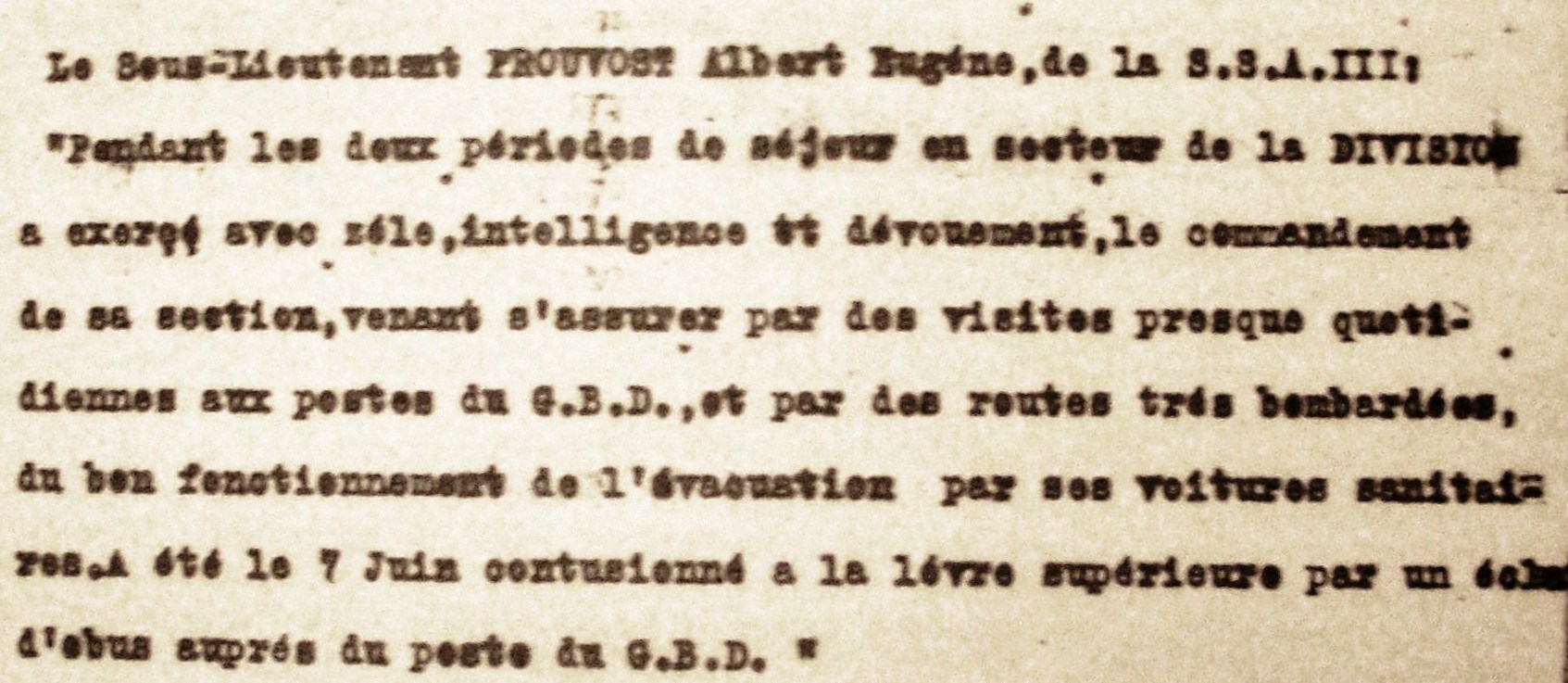
Jean Prouvost, petit fils d'Amédée I Prouvost:
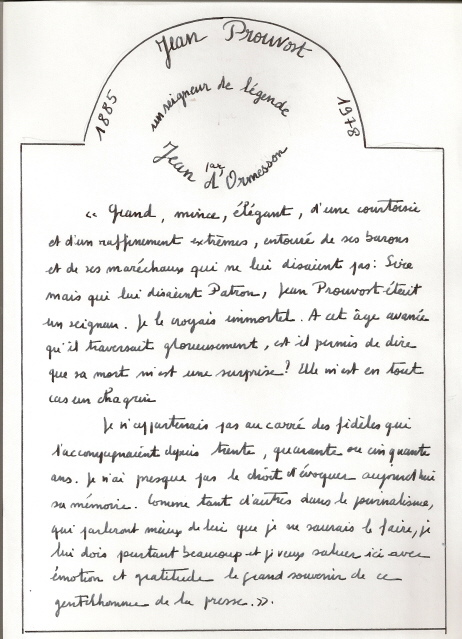
Légions d’honneurs de parents et alliés :
• Masurel Albert Julien Charles, Né le
09/04/1863 à Lille
• Masurel Edmond Jules Joseph, né le 30/03/1857 à Tourcoing
• Masurel Francois Joseph, né le 09/10/1826 à Tourcoing
• Masurel Paul Victor Joseph, né le 16/02/1835 à Tourcoing
• Motte Albert Marie Joseph, né le 06/12/1858 à Roubaix
• Motte Alfred Philippe Ferdinand, né le 30/11/1999 à
• Motte Alfred Philippe Ferdinand, né le 08/08/1827 à Roubaix
• Motte François Etienne Adolphe, né le 16/01/1843 à Honfleur
• Motte Henri Jean Baptiste Joseph, né le 14/08/1872 à Roubaix
• Motte Henri Paul, né le 12/12/1846 à Paris
• Motte Jacques Philippe Pierre Joseph, né le 22/10/1796 à Tourcoing
• Motte Louis François Joseph, né le 25/04/1817 à Roubaix
• Motte Pierre Gabriel, né le 25/02/1774 à Versailles
• Dewavrin Omer Julien Valery, né le 22/10/1837 à Hordain Nord
• Watine Ernest Charles Marie Joseph, né le 02/07/1871 à Roubaix
• Watine Louis Alphonse Francois Joseph, né le 08/09/1814 à Wattrelos
• Wavrin Augustin Thimotee Joseph, né le 12/04/1855 à Douai
• Wavrin Celestin Joseph, né le 30/03/1770 à Sailly Labourse Nord
Florin Séraphin, 1781/07/17
Bonduelle Edmond charles, 1813/06/10
Delesalle Auguste Alfred, 1851/07/04 Nord Marcq en Baroeul
Delesalle Charles Emile, 1850/02/04 Lille
Delesalle Emile Auguste, 1820/06/25 Lille
Delesalle Joseph Aimé,
1792/12/01 Lille
Delesalle Joseph Augustin,
1773/03/22 Royaume des Pays Bas
Scrive Albert Raymond,
1884/07/07 Arques Pas-de-Calais
Scrive Antoine Joseph,
1789/10/02 Lille
Scrive Gaspard Léonard,
1815/01/13 Lille
Scrive Henri Amédée,
1815/01/13 Lille
Scrive Ignace Henri
Scrive Jules
Scrive Léon Fidèle,
1874/01/22 Roubaix
Dalle Isidore, 1751
Linselles
Dalle Jean Baptiste,
1839/03/20
Droulers Florentin Joseph,
1799/02/20 Wasquehal
Lethierry-Virnot Charles
Marie Désiré, 1766/03/26 Lille
Lethierry Désiré, 1791/09/13
Lille Nord
• Barrois Charles
Eugene, né le 21/04/1851 à Lille
• Barrois Félix
Antoine, né le 05/07/1830 à Cambrai
• Barrois François
Joseph, né le 22/03/1759 à Lille
• Barrois Henri Joseph,
né le 27/04/1863 à Burbure (Pas de Calais)
• Barrois Henri
Sylvestre, né le 26/03/1840 à Saint Omer
• Barrois Jean Baptiste
Joseph, né le 22/02/1784 à Lille
• Barrois Jules Henri,
né le 03/09/1852 à Lille
• Barrois Paul Louis,
né le 17/08/1873 à Lille
• Barrois Theodore
Charles, né le 10/02/1857 à Lille
• Barrois Theodore
Urbain, né le 12/05/1825 à Lille
• Derode Alphonse
François Paul, né le 04/03/1855 au Havre
• Derode
Jean Baptiste, né le 02/12/1771 à Pecquencourt (Nord)
• Derode
Jean Marie Emile, né le 30/11/1999 à
• Derode
Lucien Jules, né le 02/11/1850 à Lille
• Derode
Pierre François, né le 19/04/1826 à Pecquencourt (Nord)
• Derode
Prosper Henri Philippe, né le 18/08/1818 à Lille
• Derode
Victor Felix Henri, né le 18/08/1867 au Havre
• Derode-geruzez
Pierre Augustin, né le 20/10/1768 à Reims
5 L'amour de la famille, souvent nombreuse
Médailles
d’Honneur de la
Famille Française
Liste des mères de famille qui ont reçu la
médaille de la
Famille Française et qui ont élevé dignement plusieurs
enfants.
"Les épouses valent les époux ; elles sont la main qui se tend
vers les pauvres et qui répand l’aumône.
Vers 1681, Marguerite de Lespaul, veuve de Pierre Prouvost,
lègue à la paroisse de Wasquehal cent trente livres parisis à charge de prières
« et le reste des revenus à acheter des camisoles pour les
pauvres vieil hommes ».
"Dans la famille Prouvost,
les femmes se haussent facilement jusqu’à l’héroïsme."
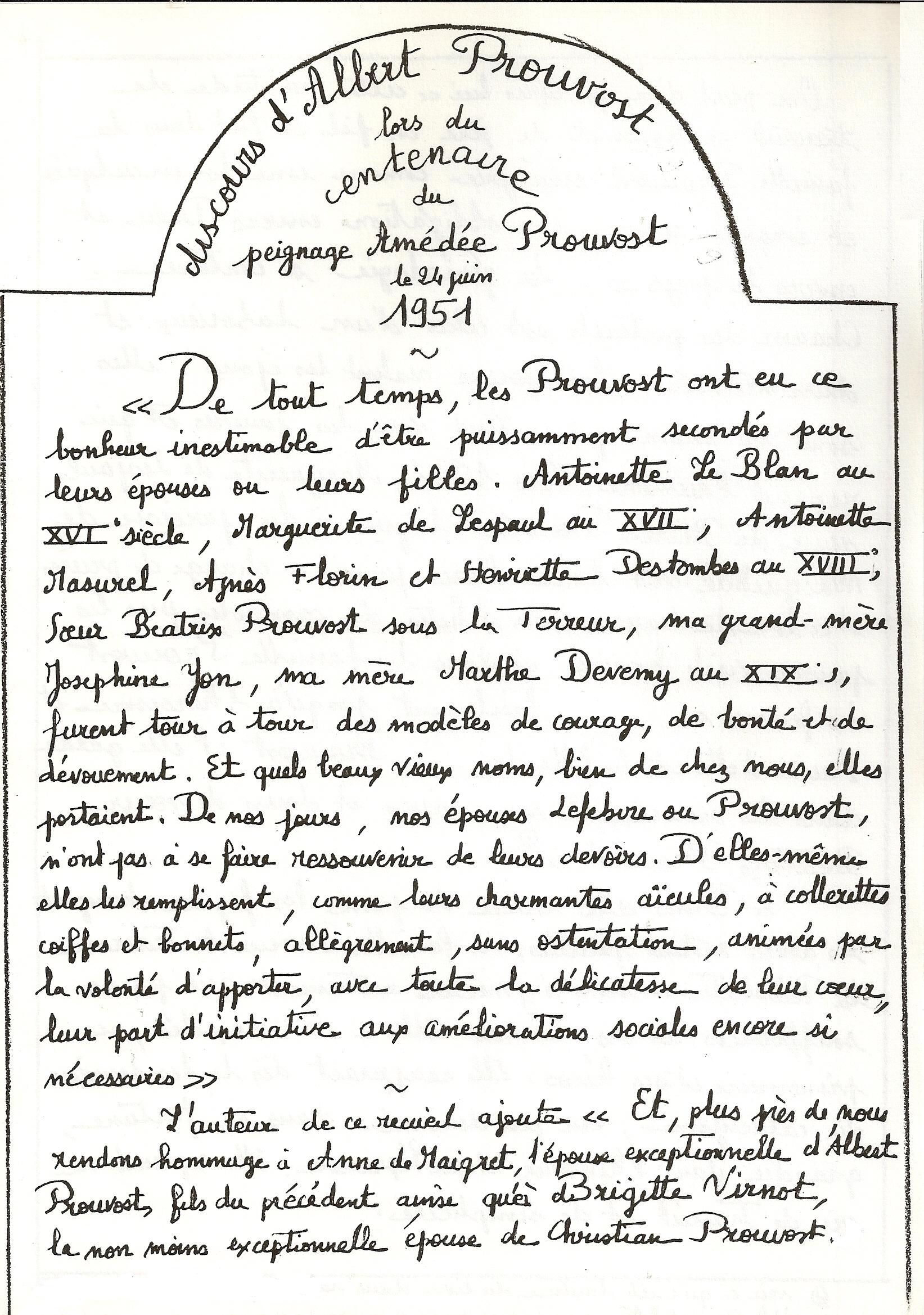
PROUVOST Aline, née Aline Ponroy
5 enfants à Bordeaux; médaille de bronze en 1950
PROUVOST Antoinette,
née Bernard
6 enfants à Tourcoing; médaille de bronze en 1950
PROUVOST Jacqueline,
née Six
5 enfants à Roubaix; médaille de bronze en 1948
PROUVOST Yvonne,
née Leclercq
8 enfants à Tourcoing; médaille d'argent en 1950
PROUVOST Laurence, épouse
Six
6 enfants à Tourcoing;
médaille de bronze en 1948
6 Les Beaux-arts et les lettres:



Demeures Prouvost sous l'Ancien Régime Jehan
Prouvost en 1469 Pierre II et
III 17°-18°



Demeures
Henri Prouvost Manufactures Royales Demeures Amédée
Prouvost
L'art de la tapisserie dans les Flandres Lilloises
Les Amédée Prouvost Les
Scrépel Les poètes et le
Beffroi
Les châteaux de l'industrie
Sophie de Sivry
Prouvost-Dehau Vareilles-Sommière
Hervé Poulain Jean Prouvost
Isabelle Prouvost
Albert-Bruno Prouvost Anne et
Albert Prouvost Ghislain
Prouvost
Jean Masurel Jacques
Masurel
François
Dalle
Denis
Prouvost
Elisabeth
et Françoise Prouvost Bruno de Bayser
Gaëtane Prouvost Les
Virnot Christian et Brigitte Prouvost

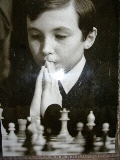
Thierry Prouvost Géry Prouvost
7 L'industrie et l'économie
" Depuis Charles Quint, les mêmes familles
dominent la Fabrique Roubaisienne :
Pollet, Mulliez,
Prouvost, Van Reust (qui devient Voreux), Leclercq, Roussel, Fleurquin, Florin,
Malfait...
Elles assurent la majorité de la production."
Hilaire-Trénard: Histoire de Roubaix"
Jean Buzelain put écrire, en
1625, dans sa Gallo-Flandria, sacra et profana: " Roubaix, bourg ancien et
noble sous beaucoup de rapports: sa dignité de Marquisat, son vieux
chateau, la multitude de ses habitants, ses manufactures de draps, son
église paroissiale,
son hopital, sa forme de ville concourent à lui donner un air de grande beauté
et de richesse." Hilaire Trénard
le curé Jacques Legroux
déclare en 1714 : « le bourg de Roubaix est considérable et ancien ; ses
manufactures le rendent célèbre plus que bien des grandes villes en France, en
Espagne et ailleurs ».
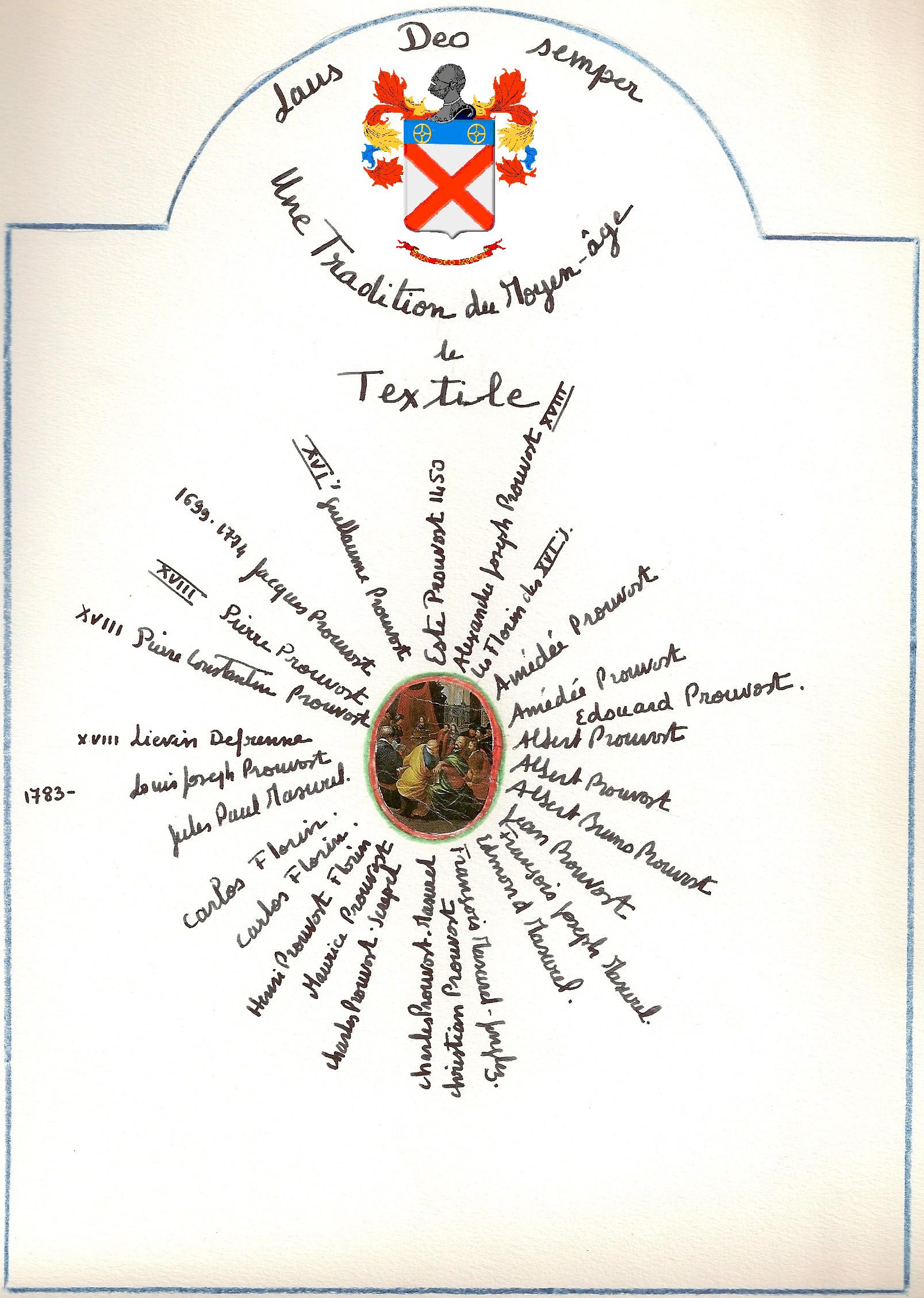
On ne connait pas les fabriques
de l’Ancien Régime; on sait que la fabrication
était le plus souvent réalisée au domicile des
artisans.
Guillaume Prouvost
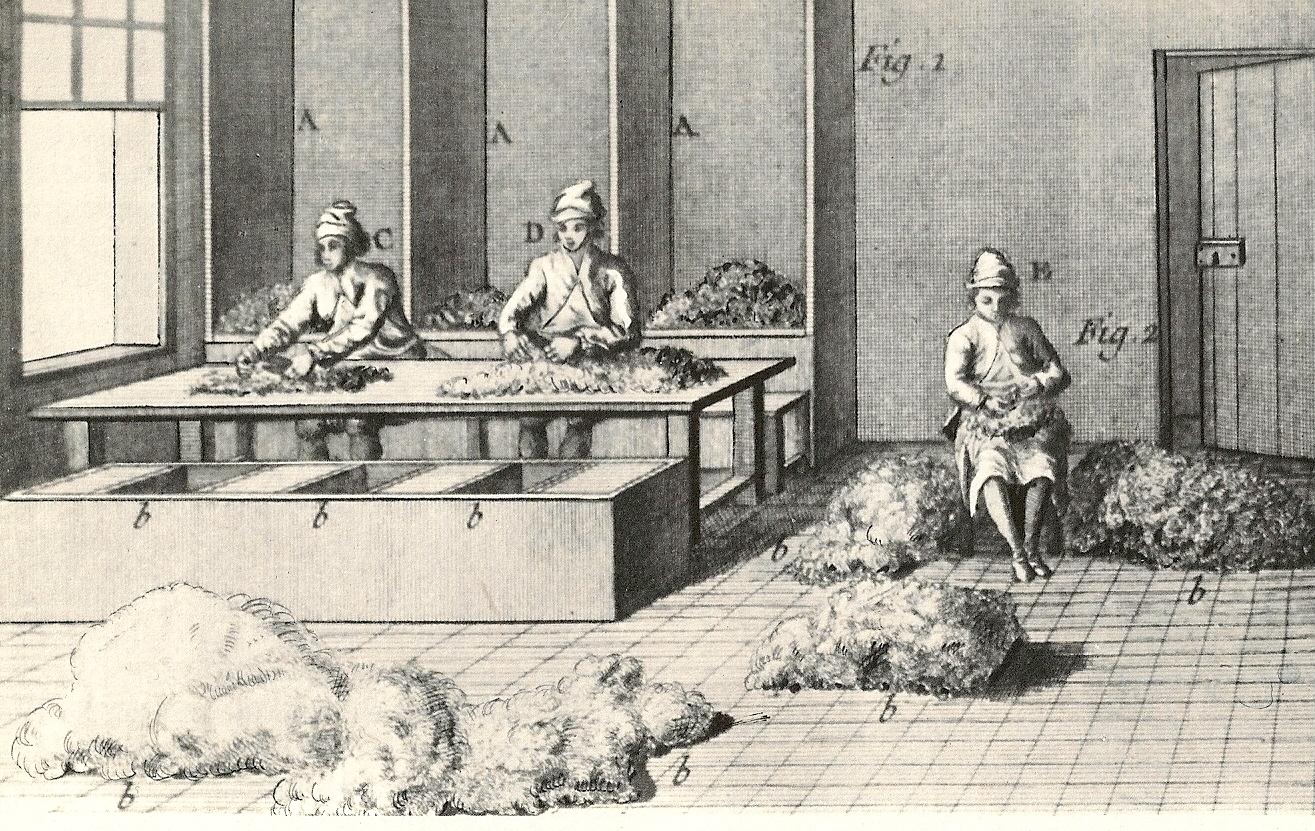
L'Encyclopédie
né
en 1580, censier et laboureur d'une surface importante: à leur
mort,
les partages révélèrent qu’il s
étaient propriétaires de " plus de 26 bonniers de bonnes
terres et de lieux manoirs situés sur
les villages de Bondues, Marc-en-Baroeul, Roubaix et Tourcoing et de
plus de 12.000
florins en capital de bonnes rentes héritières sur des
particuliers solvables;
Ils étaient encore laboureurs d'une de leur fermes qui est
situé entre le Trieu
du Grand Cottignies et la ferme de la Masure audit Wasquehal" (généalogie par Pierre Prouvost de 1748).
Il faisait aussi négoce de filets de
sayettes et de laines peignées qu’il
faisait peigner, blanchir et ensuite filer dans l’Artois où se
trouvaient de nombreuses fileuses au rouet et à la quenouille. Il était l'époux d'Adrienne Wattel, née en 1580,
décédée selon Albert Eugène Prouvost en 1626. Leurs enfants furent Pierre qui
suit ; Marie Prouvost épousa Gilles de le Dicque; Antoinette Prouvost qui épousa Pierre de Courchelle ,
"d'or au chevron d'azur accompagné de
trois trèfles du même". dont Antoinette Prouvost épouse Noël
Masurel, époux d’Antoinette de Courcelles, dont le fils Jacobus Masurel fut
jésuite et les deux fille Antoinette Masurel (inhumée - dans l'église de
Wasquehal avec épitaphe) qui épousa Jacques Prouvost-de Lespaul et Marie qui
épousa Joseph Roussel)
" Guillaume Prouvost fut à la
fois laboureur et chef d'industrie. Il
est le grand modèle de la race.
Il associe ses fils à son labeur et à ses affaires" Lecigne
Jacques II Prouvost (1699-1774)
(1699, baptisé dans l’église de Wasquehal-1774 inhumé dans l'église Saint
Martin de Roubaix),
Maître de manufacture, épouse à Roubaix 1712, Marie-Agnès Florin
(1712-1767), fille de Jean Nicolas Florin, membre de la Manufacture de Roubaix
et administrateur de la table des Pauvres (1686-1737) et Marie Catherine de
Surmont (1692-1744), inhumée dans l'église de Roubaix, soeur de Pierre
Constantin Florin, Député suppléant du Tiers Etat aux Etats généraux de
Versailles et premier maire de Roubaix.(sa petite fille Sophie Florin épousa
Henri II Prouvost) époux de Marie Bacon de Sains,
fille de Philippe et Augustine Macquart(de Terline), de deux religieuses de
l'abbaye de Wevelghem
et d'une des Brigittines; Jacques et Marie Agnès Prouvost vont s'établir à
Roubaix comme négociants et habitent la rue Pellart; n'étant pas fils de
maître, il entre dans la manufacture en 1734 grâce à son mariage avec la fille
d'un maître." RP Louis d'Halluin. Jacques Prouvost, un des cinquante
maîtres de manufactures compris dans le corps de métiers en 1761, taxé à 10
livres d’impots, dans son livre de
fabrique, mentionne les tissus suivants : satains de laine, satains anglais,
les minorques, les prunelles, les satains soie. Mais, dans la région, c’était
l’industrie de la laine qui occupait le plus grand nombre d’ouvriers.
Leur succession en 1775 dénombre leurs biens à Bondues, Tourcoing, Wasquehal, Roubaix, Estaimpuis et Willems. A
l'époque, le voyageur la Force, décrivant la Flandre en 1722, dépasse les
estimations, en affirmant : « Outre les ville s de la châtellenie de Lille,
Il y a des bourgs aussi considérables
que des villes: Tourcoing et Roubaix sont de ce nombre et ne contiennent pas
moins de 12000 âmes chacun. (Histoire de Roubaix:Hilaire -Trénard, p 77) , de
deux religieuses de l'abbaye de Wevelghem (1713 et 1715) et des Brigittines à
Lille (1723).
Pierre IV Constantin Prouvost (1747-1808)
échevin de
Roubaix sous l'Ancien Régime, "Maître de Manufacture" en 1777, puis maire de Roubaix le 13 août
1795,
l'un des principaux fabricants roubaisiens après avoir échappé à la guillotine
par la grâce de la "Réaction Thermidorienne"
épouse, béni par Augustin Prouvost, vicaire de Bersée, Marie
Henriette des Tombes (1747-1798), fille de Jean Joseph des Tombes,
12° du nom, échevin de Roubaix de 1740 à 1751
comme ses oncles Charles et Jean et soeur de Louis-Joseph des Tombes,
échevin de 1783 à 1790 ; « Reçu
"Maître de Manufacture" en 1777, il devint l'un des principaux fabricants
roubaisiens avec Pierre-Constantin Florin et, avant la Révolution, figurait en
tête des habitants les plus imposés de la paroisse. Sa « vertueuse
femme » Henriette Destombes s’alarmait de cette prospérité pour l’avenir
spirituel de ses enfants.
Il habitait rue Saint Georges à Roubaix, «
une maison qu’il avait acheté avec cinq autres
pour la sommes de 530 florins, 13 patars et 5 deniers aux héritiers d’Albert et
Joseph Lecomte. Lorsque
survinrent
les mauvais jours de la révolution, beaucoup de riches
propriétaires, craignant
la confiscation de leurs biens, crurent prudent de les vendre pour les
convertir en assignats faciles à emporter en exil .
Pierre-Constantin vendit la
plupart de ses propriétés. Il peusait
bien que ses opinions pouvaient à tout instant l’obliger
à émigrer ; mais
Il ne put s’y résigner. Il envoya sa femme et
ses enfants dans un
village voisin et se cacha dans une des dernières
propriétés qu’Il avait conservées.
Après le 9 thermidor, le 26
messidor an III (14 juillet 1795), le représentant du peuple
Delamarre notifia
à Pierre-Constantin Prouvost sa nomination comme maire de
Roubaix» AE
Prouvost. Le 22 vendémiaire an
IV, avec le conseil municipal, il leva,
comme maire, le séquestre apposé sur la caisse du précepteur pour
employer les fonds comme secours aux pauvres. "Homme généreux et probe, Il avait proposé à sa commune trois actions
principales. D'abord, venir en aide aux pauvres. Ensuite, protéger les
cultivateurs dont les charrois réquisitionnés les forçaient à négliger les
champs. Enfin, défendre l'hygiène de Roubaix dont les citoyens
laissaient devant les domicIl es des amas de boue et d'immondices
». Le souci des autres pour faire
leur bonheur, déjà." Albert Prouvost, Toujours plus loin " On peut le
considérer comme le fondateur de la fortune industrielle des Prouvost ".
La Manufacture Royale du Dauphin

Catherine-Françoise PROUVOST (1752-1801) épousa, le 30 avril
1782, François Joseph DUROT 1747-1815, fils d’Arnould-François DUROT,
bourgeois de Lille, remarquable exemple de parcours proto-industriel: sa
vie intense a été racontée par Alexis Cordonnier dans son article :
« Une industrie d’art au siècle des lumières : l’indiennerie DUROT
(1765-1790) : il créa ou racheta avec ses enfants Prouvost,
Leperre, de Lagarde les: Manufacture Royale des toiles peintes, indiennes et
papiers peints , Manufacture Royale de Mousselines d’Houplines, Manufacture
Royale de verres, Beau-père de Louis-François LEPERRE-DUROT, fondateur
de la Manufacture Royale de porcelaines de Monseigneur le Dauphin, Il
installa sa manufacture-château au château de Beaupré, à Haubourdin,
propriété du comte de Roncq.
Henri I Prouvost (1783-1850)
Maire
adjoint de Roubaix, de 1821 à 1826, membre du Conseil de
fabrique de
Saint Martin à Roubaix de 1826 à 1847, administrateur des
hospices de 1817 à
1822, Maître de manufacture possédant une manufacture
importante et prospère,
il était aussi négociant, epoux Liévinne
Defrenne (1791-1824), fille de Liévin Joseph de Frenne
(1750-1814), Maître de
manufacture, marchand drapier, administrateur des hospices, " chef de
la
branche ainée de la famille de
Frenne" (Leuridan) et de Clémentine
Dervaux; « cette très ancienne famille
de Fresnes remonte ses preuves de noblesse vers 1340, est connue dans
la
région de Tournai, Roubaix. Cette famille
donne naissance aux seigneurs de Fresnes, du Lobel, de Gaucquier, et
occupe des fonctions échevinales à Roubaix, de lieutenant
de Saulx et du
marquis de Salm à Néchin, bailli de Néchin,
censier de nombreuses terres,
négociants et industriels dans le textile « : plusieurs
générations
d’ancêtres des Prouvost
fabriquaient, aux XVII° et XVIII° siècles,
ces sublimes
tapisseries des Flandres de haute lisse ( Liévin de Frenne 1686
- 1743 et son
fils Liévin Joseph Defrenne-Prouvost,
sieur du Gaucquier, 1728 -1795). Outre Henri, Liévin et
Amédée, ci après,
il y eut aussi Adolphe Eutrope Prouvost (1822-1884)
qui secondera Amédée à la tête de
l'entreprise
familiale , épousa Adèle Virginie Scrépel,
sœur de Louis Jean Scrépel, ici
portraituré par Victor Mottez, dont Marie et Adolphe-Henri qui
continuera.
Les modifications urbaines :
« J’ai pu suivre non sans mal la disparition du château de Roubaix et
des terres qui l’entouraient en grande partie vendues à un marchand de biens
lillois qui a revendu le tout par lots ; la famille Prouvost en a acheté
certains avant d’en revendre une partie après avoir construit plusieurs
demeures familiales rue Neuve devenue rue du Maréchal Foch. La rue de l’Union
et la rue du Château ont été tracées à travers ces terrains ; on y trouvait
également la filature monstre Motte-Bossut et beaucoup de maisons bourgeoises ;
la rue du château arrivait au milieu de la Grand’Place actuelle, en face de la
sacristie de St-Martin, et faisait un
angle avec la Grand’ rue ou plutôt la Place ancienne de Roubaix (la petite
Place ou Place de l’Eglise sur laquelle se trouvaient des maisons anciennes,
dont celle des Egards de la Manufacture, vendue comme bien national en tant que
bien de corporation (acquise fin 19° par ma famille et, entre autres, la maison
de la famille Watine malheureusement détruite il y a peu lors de la
construction du Centre Commercial qui occupe tout le pâté de maisons qui va
jusqu’à l’Hôtel Prouvost de la rue Pellart) ; c’est là que l’on trouvait la
maison de Joseph Rammaert-Vanneste et celle d’Amédée Prouvost qui ont été
démolies au milieu du 19° siècle (les dossiers d’expropriation des
propriétaires et locataires se trouvent aux ADN) : sur l’ancien parking rectangulaire de la
Grand’Place entre St-Martin et l’actuelle Mairie (actuellement terre plain sur
élevé) se trouvaient les bâtiments de l’Hôpital Ste Elisabeth, dont Béatrix
Prouvost a été la dernière prieure (elle a certainement eu en mains le
magnifique Livre d’Heures d’Isabeau de Roubaix, fille de Pierre et petite fille
de Jean, fondatrice de l’Hôpital). Les anciens bâtiments ont été divisés par
baux emphytéotiques que j’espère bien consulter un jour aux ADN en plusieurs
habitations ; sur un bout du quadrilatère à l’entrée de la rue Neuve (Maréchal
Foch), de la rue St-Georges (général Sarrail), de la rue de la Gare (percée fin
19°) et de la rue du Vieil Abreuvoir, se trouvait un bâtiment qui a servi de
1ière Mairie à l’époque de Pierre Constantin Florin-Bacon (dit de Sains) , 1er
Maire de Roubaix, ancêtre de ma femme par les Prouvost-Florin (vos ancêtres) et
par les Scrépel-Florin (ancêtres de Ferdinand Cortyl). Des bâtiments annexes se
trouvant en bordure de la cour devant la Mairie ont été abattus pour former la
place de la Mairie ; la construction de la seconde Mairie, à l’entrée de la rue
Neuve, a provoqué la destruction des anciens bâtiments de l’Hôpital pour réunir
les 2 places et former le début de la Grand’Place ; le début de la rue du
Château et le prolongement de la Grand’Rue ont été rasés pour permettre
l’alignement du fonds de la Place où se trouvait ma maison natale (le riez du
Trichon qui alimentait les fossés du château passait sous cet immeuble
construit par mon arrière-grand-père Rammaert-Jeu et en cas de fortes pluies
provoquait l’inondation des caves). » Philippe A Rammaert

1908, Tissus unis & fantaisie pour
robes,
« Dans la matinée d'hier, un ouvrier tisserand, Henri
Staelen, a frappé de plusieurs coups de couteau M. Pierre Prouvost, associé de la
maison Henri Prouvost, rue du Nouveau-Monde, à Roubaix. Le meurtrier a été
arrêté. Vers neuf heures, M. Pierre Prouvost se trouvait son usine, occupé à examiner, avec un ouvrier,
des arbres de transmission, lorsqu'un ouvrier s'approcha de lui par derrière et
le frappa de plusieurs coups de couteau; puis il s'éloigna rapidement: ouvriers
et employés se précipitérsnt les uns pour porter secours à M. Prouvost, les
autres pour arrêter l'assassin qui se nomme Henri Staëlon et est né à Sweweghen
(Belgique), en 1871. Il n'est pas marié. C'est un grand garçon brun, qui ne
travaille chez M. Prouvost que depuis mercredi dernier. Il n'a pas voulu faire
connaître lo mobile de son crime. M. Prouvost porto à la nuque une plaie
profonde de 3 centimètres. L'arme dont l'assassin s'est servi est un couteau de
cuisine dont la lame est très effilée. La plaie ne parait pas grave à première
vue toutefois les muscles de la nuque qui ont été atteints sont de ceux qui
intéressent la colonne vertébrale. »
Un incendie a détruit hier, à Roubaix, les ateliers de tissage
mécanique Henri Prouvost, rue du Nouveau-Monde. Les dégâts sont estimés à 3
millions. 350 ouvriers sont réduits au chômage. 1922
A propos d'une grève de bobineuses qui s'est
déclarée cette semaine dans l'établissement de M. Henri Prouvost, nous relevons
dans l’Egalité la digression suivante: « Les ouvriers n'ont rien à attendre de
n'importe quel patron, et nous avons grandement raison de dénommer les usines
où l'on exploite odieusement la femme - quand ce n'est pas l'homme- des bagnes
capitalistes ». Nous nous permettons de faire remarquer à l’Egalité que si
les choses ne se passent pas régulièrement dans ce qu'elle appelle les « bagnes
capitalistes» les entreprises socialistes ne valent guère mieux, nous pourrions
même Ajouter : au contraire ; exemple frappant Le V.de Gand et la verrerie ouvrière
d'Albi.
Les dévoués professeurs des Facultés
catholiques continuent dans une salle de la Maison des oeuvres, 84, Grande-Rue,
leurs cours si intéressants à plus d'un point de vue. Nous ne saurions trop
insister près de nos amis pour les engager à suivre ces cours avec assiduités. MICHEL
BEAU VAIS: Le Droit du peuple : Organe républicain
démocratique (Lille) 1898
Usine Prouvost-Screpel
Près de l’usine de cet industriel de drap et de satin de chine,
l’hôtel Prouvost,à Roubaix, classé Monument Historique par arrêté du 12 août
1998, construit en 1878 par Charles Prouvost-Scrépel, , sur l’une des artères les
plus importantes de Roubaix. Il est remarquable par ses décors intérieurs: les
trois salons du rez-de-chaussée : 1 le salon chinois avec son plafond et son
décor de panneaux laqués, 2 le salon central avec son plafond et son décor, 3
le salon de musique avec ses boiseries et le plafond peint de Tony Vergnolet
(1888) ; 4 le hall d’entrée avec ses bras de lumière ; 5 l’escalier d' honneur
et sa cage ; 6 la chapelle située au premier étage (cad. LS 201). L’occupe
actuellement la Caisse d’assurance maladie, le jardin sert de parking, la
façade est, hélas, cimentée. 19, rue du Grand Chemin; 6, rue Rémy-Cogghe.
Usine Prouvost-Dalle

v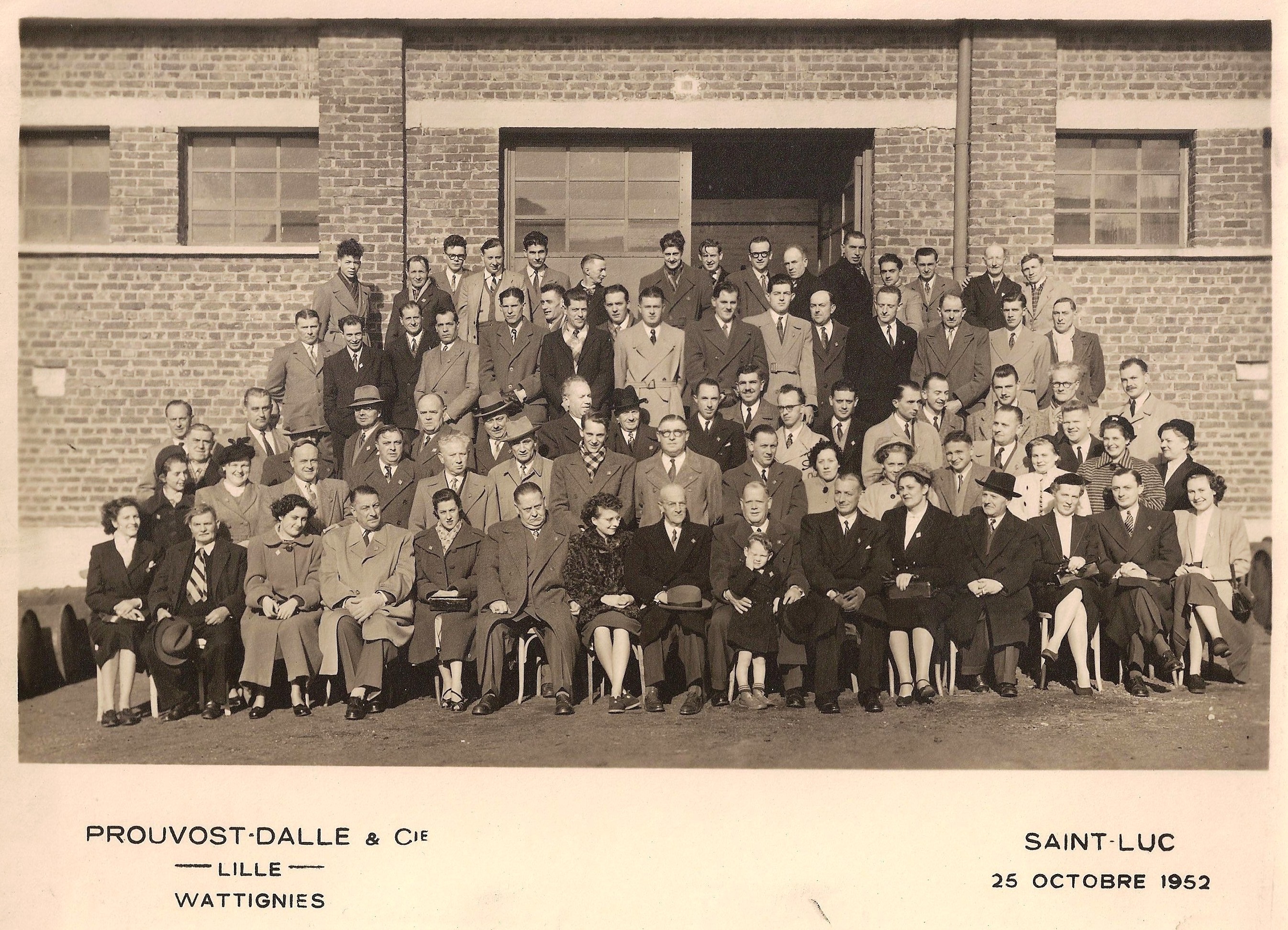
En 1926, au moment de son mariage avec Melle
Hélène DALLE, il reprend en association avec son beau-père, Mr Charles Dalle,
la firme Dubois et Roussel; qui devient la S.a.r.l. Prouvost-Dalle & Cie. A
Thumesnil qu’il habitera 10 ans, il occupera rapidement une place
prépondérante sur le plan social comme sur le plan politique. II est candidat
aux élections municipales cantonales et au Conseil d’Arrondissement. En I936,
désirant donner à sa famille une maison plus vaste, il s’installe à Lambersart,
au grand regret des habitants de Thumesnil. Jusqu’à la guerre de 1940, c’est la
progression continuelle de son entreprise : création d’un dépôt a Marseille,
début de l’usine de Wattignies, extension de plus en plus importante dans la
grande Industrie et les Administrations. Comme officier de réserve, il était
affecté à. un régiment d’active et, de 1926 à 1940, il est souvent rappelé pour
des périodes~ quatre fois entre 1938 et 1939. II se fait, à ce moment-là- de
nombreux amis dans l’armée. Mobilisé en Août 1939, il est, en Avril 1940,
renvoyé provisoirement dans son foyer, comme père de six enfants: il était
accablé de ne pas avoir pu faire son devoir. Sa nomination au grade de
capitaine de réserve, qui fut effective, fut victime d'un bombardement. Avant
l’évacuation, sur ordre du Ministère de l’Air, il doit ouvrir une usine de
repli. C’est le début de l'usine de Laval. C’est à son beau-frère Roger Ponroy,
(aidé en 1941 de M. Caillerez) que Charles en a confié la création et la
direction. Il en a été le directeur de 1941 jusqu'à la disparition de l'usine
en 1956. Durant toute la guerre, il est Président du Syndicat des Fabricants de
Couleurs et Vernis. Par son activité débordante et ses initiatives heureuses,
il fit beaucoup pour l'approvisionnement régulier de la Corporation en matières
rares.
II met en route les usines de Créteil; Marseille, puis Wattignies En 1948, il
entreprend un voyage d’études aux Etats-Unis avec un groupe de confrères et, au
retour, appliquera dans son affaire des idées intéressantes, des conceptions
plus modernes qui avaient attiré son attention. À partir d’I95I, il réalise un
important programme de concentration: vente de l'usine de Créteil et surtout
agrandissement de l’usine de Wattignies où il commence à transférer le siège
social de Lille. La dernière étape de la concentration sur Wattignies était la
construction des bureaux; les plans lui sont soumis en février. Il n’en verra
malheureusement jamais la réalisation.
Tourcoing :usine de préparation de
produits textiles (peignage de laine) Dervaux Lamon, puis Jules Lamon et fils,
puis Lamon Louage, puis Jules Lamon, puis A. Lamon et fils puis usine
d'impression sur étoffes M. C. et R. Prouvost ; actuellement immeuble à
logements et magasin de commerce19e s.;20e s.




Ensemble
textile Amédée Prouvost et Compagnie à
Roubaix
Catégorie : Ensemble textile ; oeuvre située en partie sur la
commune : Wattrelos aire d'étude : Nord
adresse : Oran(rue d')149 ; Cartigny(rue de)154 ;
parties constituantes : filature (étudiée) ; usine de préparation de
produits textiles (étudiée) ; stade ; cité ouvrière ; logement patronal ;
cantine ; époque de construction : 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e
siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle
année : 1852 ; 1865 ; 1892 ; 1911 ; 1927 ; 1951
historique : C' est en 1852 qu' Amédée Prouvost et les frères
Lefebvre-Ducatteau fondent, en créant autour de l' église Saint-Martin de
Roubaix un des premiers peignages mécaniques, la Société Amédée Prouvost et
Cie. En 1865 ils érigent le peignage de la rue du Collège. En 1892, la société
Amédée Prouvost et Cie devient société anonyme et construit les peignages de la
rue de Cartigny et de la rue d' Alger, le long de la voie ferrée amenant laines
brutes et charbon. En 1911 une filature est construite rue d' Oran : la
Lainière de Roubaix. Lors de l’occupation allemande, au début de la Première
Guerre mondiale, toutes les unités sont vidées de leur matériel. L’activité
reprend 8 mois après l’armistice mais c’est seulement en 1920 que l’ensemble
des usines sera remis en état. En 1927, afin de concentrer les activités,
l’unité de la rue du Collège est abandonnée et le Peignage de Wattrelos érigé.
Une centrale électrique est également construite afin d’alimenter cette
nouvelle unité, le Peignage Amédée Prouvost, et la Lainière de Roubaix.
Nouvelle interruption en 1940. En 1951, le peignage dit de Blidah situé à coté
du peignage de Cartigny est reconstruit et fait pendant à celui de Wattrelos
duquel il est séparé par la voie ferrée. Blidah travaille des fibres longues
sur des peigneuses circulaire Lister, le peignage de Wattrelos des fibres
courtes sur des peigneuses rectilignes Heilmann ou Schlumberger. L’oeuvre
sociale des Ets Amédée Prouvost est exemplaire tant par sa précocité que par
son importance. Une première cité de 350 maisons est érigée en 1868, une caisse
de retraite est créée en 1896. En 1923, un stade est inauguré ainsi qu’un
restaurant communautaire en 1926 et une coopérative en 1931. Entre les deux
guerres, plusieurs sociétés d’habitations à bon marché furent créées et
financées par le Peignage et la Lainière. D' autre part, la Lainière assure la
formation des apprentis. Propriété d'une société privée ; type d'étude :
patrimoine industriel date d'enquête : 1996 ; rédacteur(s) : Ramette
Jean-Marc ; N° notice : IA59000488 ; (c) Inventaire général, 1996
Dossier consultable : service régional de l'inventaire
Nord-Pas-de-Calais$Hôtel Scrive - 1, Rue du Lombard 59800 LILLE -
LaCité Amédée Prouvost
, entre le Crétinier et la
Martinoire. Cette cité, également appelée "Cité jardin" date des
années 1930. Sa construction découle des lois sociales à l'initiative du
patronat de notre région. C'est en effet dans notre région qu'ont été créés le
CIL (comité interprofessionnel du logement), les HBM (habitations à bon marché,
puis HLM, habitations à loyer modéré) pour ne parler que des lois sociales en
rapport avec le logement. Ces maisons louées aux employés et ouvriers
disposaient toutes d'un très bon niveau de confort pour l'époque : chauffage
central, baignoire et jardin. Initialement, tous les greniers communiquaient
entre eux, ce qui permit la fuite de quelques résistants lors de la Seconde
Guerre mondiale.
Lainière de Roubaix : plongée au coeur d'un passé encore présent, PAR
WILFRIED HECQUET, Pendant deux heures, les participants ont revécu l'histoire
de la Lainière. L'office de tourisme de Wattrelos organisait hier matin une
visite de deux heures autour de la Lainière de Roubaix. Environ
80 personnes, parmi lesquelles d'anciens employés, se sont passionnées
pour cette plongée dans l'histoire d'un site qui a profondément marqué la vie
des habitants du secteur. Ils étaient environ 80, réunis hier à 10 h devant la
Boîte à Musiques, à la limite de Wattrelos et de Roubaix. Pour les accueillir,
Rita Catena, de l'office de tourisme wattrelosien, qui a mené cette visite en
compagnie d'une mémoire vivante de la lainière : Georges Dubois. L'histoire
personnelle de cet habitant du quartier et ancien employé de la Lainière, est
intimement liée à celle du site.
Hier matin, on s'est d'abord arrêté face à la friche Amédée-Prouvost. C'est de
là que tout est parti, avec la création du peignage Amédée en 1851. Rue du
Fort, d'abord, puis rue de Cartigny en 1893, et enfin vers Wattrelos en 1925.
Aujourd'hui, la partie wattrelosienne a été rasée, mais les bureaux, côté
Roubaix sont toujours debout. « C'est ici que l'on travaillait la laine
après la tonte », nous rappelle-t-on. Cette laine, venue de
Nouvelle-Zélande, d'Australie ou encore d'Amérique du Sud, était donc triée,
puis lavée et peignée avant de partir en filature.
À deux pas de là, justement, sera érigée la filature de la Lainière. C'est Jean
Prouvost, le petit-fils d'Amédée, qui lance l'entreprise en 1911, avec 300
ouvriers. Passée la « parenthèse » de la Première Guerre mondiale, et
l'entreprise va se développer rapidement, jusqu'à atteindre une renommée
mondiale. En 1927, c'est ici qu'est née la fameuse marque Pingouin. Rita Catena
nous confie l'anecdote : ce nom a été choisi par « un collaborateur de
Jean Prouvost, dont le fils lisait une bande dessinée très en voguer à
l'époque, Zig et Puce, dans laquelle figurait le personnage d'Alfred, un
pingouin ».
En 1950, ce sera le lancement des chaussettes Stemm, dont Eddy Mitchell et ses
Chaussettes noires vanteront un temps les mérites. « 750 000 paires
sortaient de l'usine à l'époque, raconte Georges Dubois. Et l'on pouvait
faire 40 fois le tour de la Terre avec la longueur de fil produit chaque jour à
la Lainière. » À force de se développer, l'endroit est devenu « une
ville dans la ville ». « Tout était surdimensionné. Rien que
la filature 51, c'était une salle de 16 000 m² où travaillaient 1 100 personnes
! » La Lainière construisait des usines au Brésil, en Espagne, en
Tunisie...
À Wattrelos, le paternalisme des patrons trouvait
aussi tout son sens, avec la création des cités-jardins, et leurs maisons aux
toits en triangle, particulièrement confortables pour les ouvriers de l'époque.
Un âge d'or qui a pris fin avec les années 1990. Georges Dubois a eu du mal à
encaisser « l'arrêt des machines », en 2000. Il est resté
encore quelques années, pour participer au déménagement jusqu'à la fermeture de
2004.
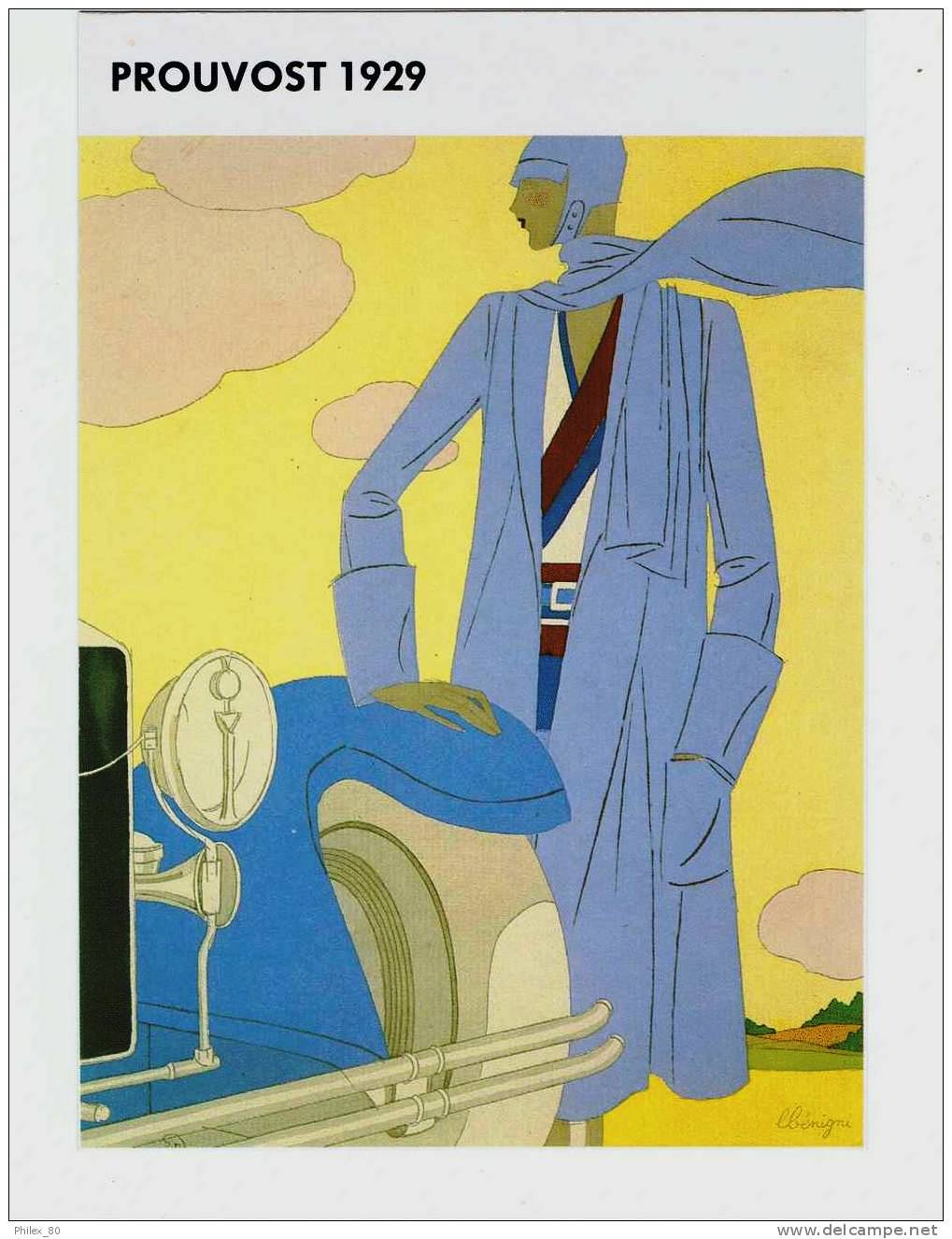
Filature (de laine)
Prouvost et Cie
dite La Lainière de
Roubaix à Roubaix




Catégorie : Filature, oeuvre située en partie sur la
commune : Wattrelos, aire d'étude : Nord, adresse : Oran(rue d')149, édifice
contenant : ensemble textile Amédée Prouvost et Compagnie, parties constituantes
: bâtiment administratif d'entreprise, époque de construction : 1er quart 20e
siècle, année : 1911
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Filature dite La lainière de Roubaix appartenant à l' ensemble d'
industrie textile Amédée Prouvost. La filature La Lainière est fondée à Roubaix
en 1911 par Jean Prouvost, petit-fils du fondateur du peignage Amédée Prouvost.
Elle est reliée au Peignage Amédée Prouvost par le chemin de fer. Prenant
rapidement de l' ampleur elle devient une des plus importantes filatures
françaises produisant laine à tricoter et fil pour tissage sous la marque des
deux béliers à cornes d' or. Pillée pendant la Première Guerre mondiale, la
production reprend au début des années 1919. La petite filature initiale s' est
alors considérablement agrandie. La marque au Pingouin, qui aura un rayonnement
mondial, est crée en 1927. Au début des années 1970, La Lainière gère
vingt-cinq sociétés telles que Pingouin, Stemm, Rodier et Korrigan,
Prouvost-Masurel, les tissages Lepoutre. Elle se transforme en holding en 1973
(groupe VEV) ; elle représente alors 2,4 milliards de chiffre d' affaires. Le
secteur du fil à tricoter entre en crise. En 1980 La Lainière fusionne avec le
groupe Prouvost SA. En 1986. elle ne conserve plus que la branche filature
(fils à tricoter Pingouin, Welcomme). Elle représente encore 1,5 milliards de
chiffre d' affaires. Au cours des années 1980, les ventes de laine à tricoter
accusent des baissent considérables. Malgré des tentatives notamment en
spécialisant ses entreprises dans la confection, le groupe Prouvost SA s'
effondre conduisant à la vente de La Lainière en juin 1993. Des installations
ne subsistent, à l' heure actuelle que le bâtiment des services commerciaux.
La lainière occupe en1951 une surface de 17 ha divisés en 4 grands secteurs par
deux rues couvertes se coupant à angle droit. Les services commerciaux, l'
atelier mécanique, la filature de laine cardée et la retorderie occupe le quart
sud ouest, la teinturerie sur peignée, le calibrage et la préparation, le quart
sud est. La filature occupe la partie nord est. Le long de la voie ferrée, au
nord ouest se trouvent le pelotonnage, le moulinage, la teinture sur fil et l'
atelier de tricotage (chaussettes Stemm). En 1951, l' usine comprend 100.000
broches et emploie 4000 ouvriers en équipes doubles. La
En 1926, au moment de son mariage avec Melle
Hélène DALLE, il reprend en association avec son beau-père, Mr Charles Dalle,
la firme Dubois et Roussel; qui devient la S.a.r.l. Prouvost-Dalle & Cie. A
Thumesnil qu’il habitera 10 ans, il occupera rapidement une place
prépondérante sur le plan social comme sur le plan politique. II est candidat
aux élections municipales cantonales et au Conseil d’Arrondissement. En I936,
désirant donner à sa famille une maison plus vaste, il s’installe à Lambersart,
au grand regret des habitants de Thumesnil. Jusqu’à la guerre de 1940, c’est la
progression continuelle de son entreprise : création d’un dépôt a Marseille,
début de l’usine de Wattignies, extension de plus en plus importante dans la
grande Industrie et les Administrations. Comme officier de réserve, il était
affecté à. un régiment d’active et, de 1926 à 1940, il est souvent rappelé pour
des périodes~ quatre fois entre 1938 et 1939. II se fait, à ce moment-là- de
nombreux amis dans l’armée. Mobilisé en Août 1939, il est, en Avril 1940,
renvoyé provisoirement dans son foyer, comme père de six enfants: il était
accablé de ne pas avoir pu faire son devoir. Sa nomination au grade de
capitaine de réserve, qui fut effective, fut victime d'un bombardement. Avant
l’évacuation, sur ordre du Ministère de l’Air, il doit ouvrir une usine de
repli. C’est le début de l'usine de Laval. C’est à son beau-frère Roger Ponroy,
(aidé en 1941 de M. Caillerez) que Charles en a confié la création et la
direction. Il en a été le directeur de 1941 jusqu'à la disparition de l'usine
en 1956. Durant toute la guerre, il est Président du Syndicat des Fabricants de
Couleurs et Vernis. Par son activité débordante et ses initiatives heureuses,
il fit beaucoup pour l'approvisionnement régulier de la Corporation en matières
rares.
II met en route les usines de Créteil; Marseille, puis Wattignies En 1948, il
entreprend un voyage d’études aux Etats-Unis avec un groupe de confrères et, au
retour, appliquera dans son affaire des idées intéressantes, des conceptions
plus modernes qui avaient attiré son attention. À partir d’I95I, il réalise un
important programme de concentration: vente de l'usine de Créteil et surtout
agrandissement de l’usine de Wattignies où il commence à transférer le siège
social de Lille. La dernière étape de la concentration sur Wattignies était la
construction des bureaux; les plans lui sont soumis en février. Il n’en verra
malheureusement jamais la réalisation.
Tourcoing :usine de préparation de
produits textiles (peignage de laine) Dervaux Lamon, puis Jules Lamon et fils,
puis Lamon Louage, puis Jules Lamon, puis A. Lamon et fils puis usine
d'impression sur étoffes M. C. et R. Prouvost ; actuellement immeuble à
logements et magasin de commerce19e s.;20e s.

 rsalia, 1979
rsalia, 1979
Richard
Klein, spécialiste de Mallet-Stevens, écrit : « Lors de l’Exposition
des arts décoratifs de 1925 à Paris, les industries textiles du Nord
choisissent de présenter leur production dans un pavillon de brique inspiré des
constructions industrielles roubaisiennes (DE Fleure, Coulomb et Laccourège,
architecte). Sur un des cotés du pavillon, un curieux jardin fait scandale :
il est ponctué de provocateurs arbres en ciment réalisés par les frères Martel
et imaginés par Mallet-Stevens. Alors qu’il visitait le pavillon consacré à la
production des tissus et étoffes d’ameublement des villes de Roubaix et de
Tourcoing dans lesquels il présentait les productions de ses usines, Paul Cavrois
fut sans doute séduit par le pouvoir de provocation de ces arbres cubistes, au
point d’interrompre le projet d’habitation qu’il avait confié à l’architecte Jacques
Gréber. L’exposition parisienne des arts décoratifs est donc vraisemblablement à
l’origine e de la commande de paul Cavrois à Robert Mallet-Stevens. Pendant le
temps de la conception de la villa Cavrois, Robert Mallet-Stevens fonde l’UAM
et caresse le rêve qu’une union de l’art et de l’industrie puisse s’épanouir en
France au service de l’architecture. La stratégie
de l’architecte pour atteindre ses objectifs passe par les entrepreneurs, les
commanditaires, un réseau familial et professionnel lié à l’industrie du Nord
de la France. Adrien Auger, l’entrepreneur qui assure la construction du
pavillon du tourisme imaginé par Mallet-Stevens pour l’exposition de 1925,
devient l’un des commanditaires de l’architecte : il lui confie la
conception de son habitation à Ville d’Avray. La femme d’Adrien Auger, Marie
Prouvost est à la fois une des filles d’Amédée prouvost ( 1853-1927), un des
magnats de l’industrie textile roubaisienne, une cousine de Lucie Vanoutryve,
la femme de paul Cavrois, et une cousine de Jean prouvost, le fondateur de la
Lainière de Roubaix, une des plus grandes filatures françaises. En 1930, Mallet-Stevens
élabore un projet de maisons ouvrières pour la lainière de Roubaix alors en
plein développement. Les dessins montrent un ensemble de logements desservis
par une coursive et élevés sur pilotis
qui reprend les thèmes expérimentés avec la maison Trappenard à Sceaux (
1930). Le projet est imaginé au moment où les programmes de logements sociaux deviennent
les meilleurs symboles de la modernité et qu’ils manquent cruellement à l’actif
de Mallet-Stevens. La direction de l’école des beaux-arts de Lille qui est
confiée à Mallet-Stevens entre 1935 et 1940 comble une autre absence, celle du
volet enseignement de l’UAM. Dès son entrée en fonction, l’architecte
transforme la pédagogie de l’ancienne école et tente de développer des relations
avec les industriels. Il projette une école en accord avec le caractère
industriel de la région : un laboratoire
de recherche artistique au service de l’industrie régionale qui dot
donner aux arts appliqués une nouvelle dimension au sein des beaux-arts.
Ce
poste de directeur correspond également
à un autre en jeu : la commande municipale d’une académie des beaux-arts,
destinée à marquer la sortie de la ville vers le grand Boulevard reliant Lille
à Roubaix et Tourcoing. Et à ponctuer le futur boulevard de ceinture. La projet
élaboré par Mallet Stevens en 1936 préfigure la plastique monumentale qui
caractérisa ses pavillons pour l’exposition parisienne de 1937. Ce projet prévoyait
un revêtement de plaquette de briques dans la logique du parement de la villa Cavrois ;
l’exposition du progrès social, montée à Lille en 1939, ambitionnait de montrer
les développements de l’industrie ainsi que les initiatives sociales du nord et
de l’est de la France. Le pavillon de la presse et de la publicité qu’y conçoit
Mallet-Stevens est son ultime production matérielle. Modeste tant par sa taille
que par sa plastique – deux boites de deux niveaux réunis par un des angles de
leur plus petit coté sont articulées par un des angles de leur plus petit coté,
sont articulées par un haut signal vertical- le pavillon est terminé à la hâte
au mois de juin 1939. Cette dernière réalisation est une éphémère et mince
trace des ambitions que Mallet-Stevens
espérait concrétiser. Avec l’abandon du projet de logements ouvriers pour la
lainière de Roubaix et du projet de constriction d’une académie lilloise des
beaux-arts, la villa Cavrois reste donc la principale manifestation qui
subsiste de la présence de Mallet-Stevens dans le Nord de la France et de la
tentative de répandre l’équipement, la technique et l’industrie dans l’espace
de l’habitation moderne » Richard Klein Robert Mallet Stevens : la
villa Cavrois in revue VMF 226, mars 2009

Trois photos issues de l'ouvrage de Richard Klein « Robert Mallet-Stevens, agir pour l’architecture
moderne », éditions du Patrimoine
© Centre
Pompidou, Mnam-CCI, Dist. RMN-Grand Palais. Photo Georges Meguerditchian
La
maquette a été présentée au cours de la deuxième exposition de l'Union des Artistes
Modernes à Paris ; Revue "Art et Décoration", juillet 1931
p.36
Ensemble
textile Amédée Prouvost et Compagnie
à
Roubaix
Catégorie : Ensemble textile ; oeuvre située en partie sur la
commune : Wattrelos aire d'étude : Nord
adresse : Oran(rue d')149 ; Cartigny(rue de)154 ;
parties constituantes : filature (étudiée) ; usine de préparation de
produits textiles (étudiée) ; stade ; cité ouvrière ; logement patronal ;
cantine ; époque de construction : 3e quart 19e siècle ; 4e quart 19e
siècle ; 1er quart 20e siècle ; 2e quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle
année : 1852 ; 1865 ; 1892 ; 1911 ; 1927 ; 1951
historique : C' est en 1852 qu' Amédée Prouvost et les frères
Lefebvre-Ducatteau fondent, en créant autour de l' église Saint-Martin de
Roubaix un des premiers peignages mécaniques, la Société Amédée Prouvost et
Cie. En 1865 ils érigent le peignage de la rue du Collège. En 1892, la société
Amédée Prouvost et Cie devient société anonyme et construit les peignages de la
rue de Cartigny et de la rue d' Alger, le long de la voie ferrée amenant laines
brutes et charbon. En 1911 une filature est construite rue d' Oran : la
Lainière de Roubaix. Lors de l’occupation allemande, au début de la Première
Guerre mondiale, toutes les unités sont vidées de leur matériel. L’activité
reprend 8 mois après l’armistice mais c’est seulement en 1920 que l’ensemble
des usines sera remis en état. En 1927, afin de concentrer les activités,
l’unité de la rue du Collège est abandonnée et le Peignage de Wattrelos érigé.
Une centrale électrique est également construite afin d’alimenter cette
nouvelle unité, le Peignage Amédée Prouvost, et la Lainière de Roubaix.
Nouvelle interruption en 1940. En 1951, le peignage dit de Blidah situé à coté
du peignage de Cartigny est reconstruit et fait pendant à celui de Wattrelos
duquel il est séparé par la voie ferrée. Blidah travaille des fibres longues
sur des peigneuses circulaire Lister, le peignage de Wattrelos des fibres
courtes sur des peigneuses rectilignes Heilmann ou Schlumberger. L’oeuvre
sociale des Ets Amédée Prouvost est exemplaire tant par sa précocité que par
son importance. Une première cité de 350 maisons est érigée en 1868, une caisse
de retraite est créée en 1896. En 1923, un stade est inauguré ainsi qu’un
restaurant communautaire en 1926 et une coopérative en 1931. Entre les deux
guerres, plusieurs sociétés d’habitations à bon marché furent créées et
financées par le Peignage et la Lainière. D' autre part, la Lainière assure la
formation des apprentis. Propriété d'une société privée ; type d'étude :
patrimoine industriel date d'enquête : 1996 ; rédacteur(s) : Ramette
Jean-Marc ; N° notice : IA59000488 ; (c) Inventaire général, 1996
Dossier consultable : service régional de l'inventaire
Nord-Pas-de-Calais$Hôtel Scrive - 1, Rue du Lombard 59800 LILLE -
LaCité Amédée Prouvost
, entre le Crétinier et la
Martinoire. Cette cité, également appelée "Cité jardin" date des
années 1930. Sa construction découle des lois sociales à l'initiative du
patronat de notre région. C'est en effet dans notre région qu'ont été créés le
CIL (comité interprofessionnel du logement), les HBM (habitations à bon marché,
puis HLM, habitations à loyer modéré) pour ne parler que des lois sociales en
rapport avec le logement. Ces maisons louées aux employés et ouvriers
disposaient toutes d'un très bon niveau de confort pour l'époque : chauffage
central, baignoire et jardin. Initialement, tous les greniers communiquaient
entre eux, ce qui permit la fuite de quelques résistants lors de la Seconde
Guerre mondiale.
Lainière de Roubaix : plongée au coeur d'un passé encore présent, PAR
WILFRIED HECQUET, Pendant deux heures, les participants ont revécu l'histoire
de la Lainière. L'office de tourisme de Wattrelos organisait hier matin une
visite de deux heures autour de la Lainière de Roubaix. Environ
80 personnes, parmi lesquelles d'anciens employés, se sont passionnées
pour cette plongée dans l'histoire d'un site qui a profondément marqué la vie
des habitants du secteur. Ils étaient environ 80, réunis hier à 10 h devant la
Boîte à Musiques, à la limite de Wattrelos et de Roubaix. Pour les accueillir,
Rita Catena, de l'office de tourisme wattrelosien, qui a mené cette visite en
compagnie d'une mémoire vivante de la lainière : Georges Dubois. L'histoire
personnelle de cet habitant du quartier et ancien employé de la Lainière, est
intimement liée à celle du site.
Hier matin, on s'est d'abord arrêté face à la friche Amédée-Prouvost. C'est de
là que tout est parti, avec la création du peignage Amédée en 1851. Rue du
Fort, d'abord, puis rue de Cartigny en 1893, et enfin vers Wattrelos en 1925.
Aujourd'hui, la partie wattrelosienne a été rasée, mais les bureaux, côté
Roubaix sont toujours debout. « C'est ici que l'on travaillait la laine
après la tonte », nous rappelle-t-on. Cette laine, venue de
Nouvelle-Zélande, d'Australie ou encore d'Amérique du Sud, était donc triée,
puis lavée et peignée avant de partir en filature.
À deux pas de là, justement, sera érigée la filature de la Lainière. C'est Jean
Prouvost, le petit-fils d'Amédée, qui lance l'entreprise en 1911, avec 300
ouvriers. Passée la « parenthèse » de la Première Guerre mondiale, et
l'entreprise va se développer rapidement, jusqu'à atteindre une renommée
mondiale. En 1927, c'est ici qu'est née la fameuse marque Pingouin. Rita Catena
nous confie l'anecdote : ce nom a été choisi par « un collaborateur de
Jean Prouvost, dont le fils lisait une bande dessinée très en voguer à
l'époque, Zig et Puce, dans laquelle figurait le personnage d'Alfred, un
pingouin ».
En 1950, ce sera le lancement des chaussettes Stemm, dont Eddy Mitchell et ses
Chaussettes noires vanteront un temps les mérites. « 750 000 paires
sortaient de l'usine à l'époque, raconte Georges Dubois. Et l'on pouvait
faire 40 fois le tour de la Terre avec la longueur de fil produit chaque jour à
la Lainière. » À force de se développer, l'endroit est devenu « une
ville dans la ville ». « Tout était surdimensionné. Rien que
la filature 51, c'était une salle de 16 000 m² où travaillaient 1 100 personnes
! » La Lainière construisait des usines au Brésil, en Espagne, en
Tunisie...
À Wattrelos, le paternalisme des patrons trouvait
aussi tout son sens, avec la création des cités-jardins, et leurs maisons aux
toits en triangle, particulièrement confortables pour les ouvriers de l'époque.
Un âge d'or qui a pris fin avec les années 1990. Georges Dubois a eu du mal à
encaisser « l'arrêt des machines », en 2000. Il est resté
encore quelques années, pour participer au déménagement jusqu'à la fermeture de
2004.
production mensuelle
atteint jusqu' à 500 t.
description : Les services commerciaux, seuls vestiges de la Lainière, occupent
un bâtiment de deux étages, en brique, de 18 travées sur 14. Il est couverts de
toits à longs pans à croupe. gros-oeuvre : brique, couverture (matériau) :
tuile flamande mécanique, étages : 2 étages carrés, couvrement : charpente en
bois apparente, couverture (type) : croupe
état : vestiges ; restauré, propriété d'une
société privée, date protection MH
: édifice non protégé MH
type d'étude : patrimoine industriel, date d'enquête : 1996 , rédacteur(s)
: Ramette Jean-Marc
N° notice : IA59000487, (c) Inventaire général, 1996, Dossier consultable
: service régional de l'inventaire Nord-Pas-de-Calais$Hôtel Scrive - 1, Rue du
Lombard 59800 LILLE
à
Roubaix
Usine de préparation de produits
textiles, oeuvre située en partie sur la commune : Wattrelos
aire d'étude : Nord, adresse : Cartigny (rue de)154, édifice contenant :
ensemble textile Amédée Prouvost et Compagnie, parties constituantes :
atelier de fabrication ; atelier de réparation ; cheminée d'usine ;
conciergerie ; entrepôt industriel ; aire des matières premières ; hangar
industriel ; laboratoire ; local syndical ; magasin industriel ; pièce de
séchage ; quai ; réservoir industriel ; station d'épuration ; voie ferrée ;
bureau ; bureau d'études ; passerelle ; centrale électrique, époque de
construction : 3e quart 19e siècle, année : 1892 ; 1920 ; 1927 ; 1951
auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu
historique : Le peignage Amédée Prouvost dit de Cartigny est érigé en 1892.
Pillé lors de la première guerre mondiale, il ne reprend son plein régime qu’en
1920. En 1927 l’énergie lui est fournie par une toute nouvelle centrale
électrique commune au groupe. Nouvelle interruption en 1940. En 1951 l’obsolescence
du peignage dit de Cartigny amène le groupe à ériger à côté de ce dernier, un
nouveau peignage dit de Blidah travaillant les fibres longues sur des peigneuses
circulaires de marque Lister. En 1996 la société est acquise par le groupe
Chargeur.
En 1951, Le peignage couvre, en 1951, une surface de 12 ha scindée, par la voie
de chemin de fer, en deux parties reliées par une passerelle. Sur le territoire
de Roubaix : les peignages dits de Cartigny et de Blidah. Sur celui de
Wattrelos le peignage dit de Wattrelos ainsi que la centrale électrique.
Le peignage emploie 1900 ouvriers. Les trois quarts de la laine brute viennent d’Australie
et de Nouvelle-Zélande, le reste du Cap ou d' Amérique du Sud. Chaque jour,
douze wagons déversent environ 1000 balles de laines de 150 kg chacune. La
laine est triée à la main par 250 ouvriers appelés trieurs, puis débarrassée de
ses impuretés et lavée dans des colonnes de 30 m de longueur, composées de cinq
bacs de lavage. Essorée dans des presses à rouleaux puis séchée, la laine a
perdu 50% de son poids. Elle est alors cardée et peignée. Les fibres longues
seront travaillées sur des peigneuses circulaires Lister, les fibres courtes ou
normales, sur des peigneuses rectilignes Heilmann ou Schlumberger. Les fibres
trop courtes ou blousse, seront rejetées pour être incorporées dans les tissus
de laines cardées ou le feutre. 190 peigneuses circulaires et 80 peigneuses
rectilignes sont en service dans le peignage. La laine peignée est alors
chargée d’électricité statique. Il faut alors l’étirer, la doubler et la
paralléliser, c' est le gill-boxage, puis la retremper dans une solution
savonneuse et l' étirer : c' est le lissage. L’atelier mécanique occupe 126
ouvriers. La centrale composée de 5 chaudières et de 2 turbo-alternateurs de
marque Brown Bovery, occupe 35 ouvriers et transforme en énergie (vapeur ou
énergie électrique) 40000 t de charbon par an.
description : La centrale électrique (G) a 5 étages
carrés, des murs en pans de
béton avec de la brique en remplissage. Le toit comprend une
terrasse, un toit
à longs pans couverts de verre et de tuile flamande
mécanique et surmonté d' un
lanterneau et d' un extrados de voûte ; la cheminée, en
béton, est de type
Monnoyer ; Le magasin industriel (E) et les bureaux (A), dans le
prolongement,
ont 2 étages carrés, des murs en brique. Ils sont en
sheds couverts de tuile
flamande mécanique et de verre ; Le magasin industriel (I) a 2
étages carrés,
des murs en brique et sont couverts de sheds, de tuile flamande
mécanique et de
verre ; Un appentis couvre les accès de
chargement/déchargement sur la voie
ferrée. gros-oeuvre : brique ; pan de béton armé ;
pan de fer ; béton ; couverture
(matériau) : verre en couverture ; tuile flamande
mécanique ; étages : 5
étages carrés ; couvrement : charpente en
béton armé apparente ; charpente
métallique apparente ; couverture (type) : toit à
longs pans ; croupe ;
shed ; lanterneau ; terrasse ; extrados de voûte ;
appentis ; escaliers :
monte-charge ; état : menacé ; établissement
industriel désaffecté ; propriété
d'une société privée
date protection MH : édifice non protégé MH ; type d'étude :
patrimoine industriel ; date d'enquête : 1996
rédacteur(s) : Ramette Jean-Marc ; N° notice : IA59000486 ; (c)
Inventaire général, 1996 ; Dossier consultable : service régional de
l'inventaire Nord-Pas-de-Calais$Hôtel Scrive - 1, Rue du Lombard 59800 LILLE
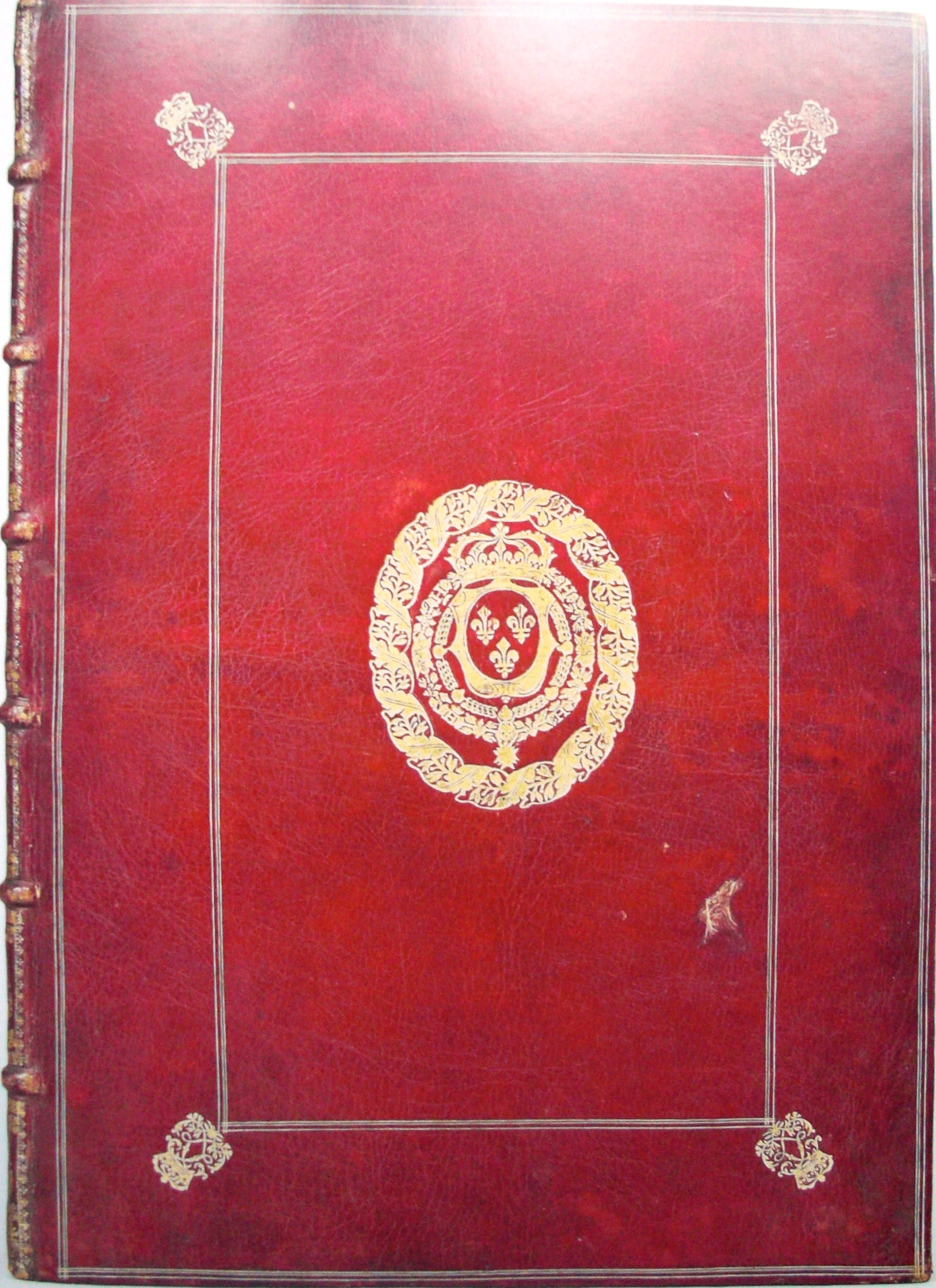
André Félibien : Description de la grotte de Versailles,
Paris, Imprimerie Royale, 1679 ; RELIURE DE l'EPOQUE. Maroquin rouge,
armes royales au centre, filets et fleurons au chiffre royal en écoinçons, dos
a nerfs orne du chiffre royal répété, tranches dorées; Ex-dono gravé: "A Monsieur Albert Eugene Prouvost
à l’occasion du Centenaire du Peignage Amédée Prouvost, les collaborateurs,
employés, contremaitres et ouvriers, en témoignage de leur reconnaissance et de
leurs sentiments dévoues", suit une longue série de signatures manuscrites
à l’encre et au Bic sur Ie recto et le verso du feuillet blanc portant cet
ex-dono. Collection M Ghislain Prouvost, Sotheby’s, 9-12-2005, n°42
Etablissements du
Coq Français
Degrave et Prouvost
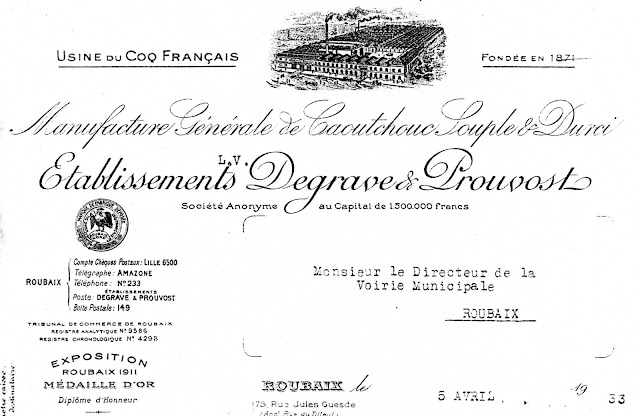
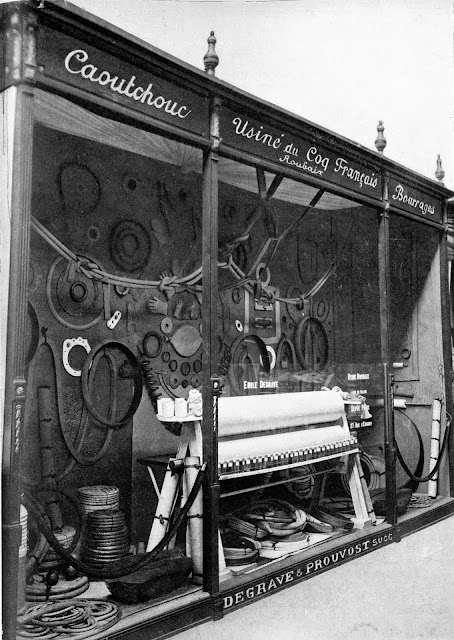
Ici à l'exposition internationale de Roubaix en 1911.
la société Le Joint Français, qui fait partie
du groupe Hutchinson.
« Le
directeur d'établissement, Benoit Hugele, a fourni au préalable quelques
indications sur la société, qui fabrique des pièces en caoutchouc pour
l'industrie. Le groupe Hutchinson comporte 22 000 personnes dans le monde
entier, dont pas loin de 16 000 collaborateurs en Europe et 7000 en France (une
équipe qui « reste stable »). Un noyau « d'argent, de décisions, de compétences
» se trouve en France. Le 1er semestre a été difficile pour l'industrie
automobile. « On tient car on fait beaucoup de choses différentes », a précisé
le directeur. Les intérimaires ne sont que 8 au lieu de 25 l'année dernière,
mais il y a du travail tout le temps, sans périodes d'arrêt. La crise a laissé
des traces, le secteur des cylindres est le plus touché, mais « on a toujours
trouvé quelque chose », a insisté Benoit Hugele.
La société qui existe depuis 1871
(anciennement Degrave et Prouvost), rachetée par Hutchinson en 1976, est
actuellement « une des dernières entreprises industrielles en Centre- Ville »,
son site fait partie du patrimoine industriel de Roubaix. Le Joint Français
fabrique des soufflets pour aéroports depuis 1980, des pièces pour raccorder
les voitures de métro, pour les tramways aussi. Certaines pièces ont servi au
métro de la ville de Mexico : ce fut la 1ére commande export en 2004. » CÉCILE
BRIFFAUT > Correspondante locale.
8 La vie de société
d
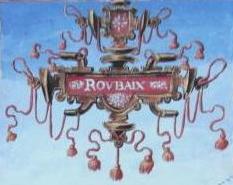
Ayant toujours
appartenu aux familles les plus fortunée de leur région,
les Prouvost eurent le
plus souvent de belles demeures ; si nous les connaissons bien aux XIX° et
XX° siècles, assez bien au XVIII°,
nous constatons que la plupart de celles des siècles antérieurs
ont disparues.
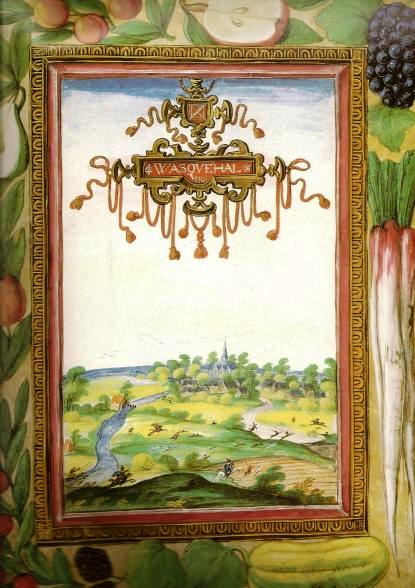
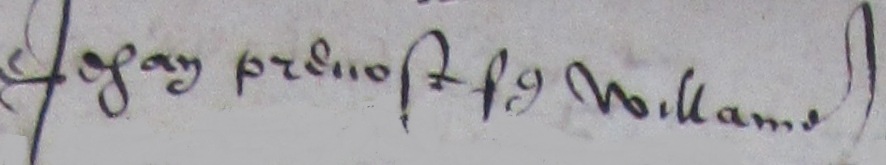
Descendant,
selon Alain Watine-Ferrant, d'une lignée terrienne
installée dès le XV° siècle à Wasquehal
(Jehan, fils de Willaume ci-dessus) et les environs, on peut
imaginer qu'ils eurent des maisons agréables. Guillaume Prouvost, né en
1580, censier
et laboureur d'une surface importante et son épouse: à leur mort, les
partages révélèrent qu’ils étaient propriétaires de " plus de 26 bonniers
de bonnes terres et de lieux manoirs situés sur les villages de Bondues,
Marc-en-Baroeul, Roubaix et Tourcoing et de plus de 12.000 florins en
capital de bonnes rentes héritières sur des particuliers solvables; ils
étaient encore laboureurs d'une de leur fermes qui est situé entre le
Trieu du Grand Cottignies et la ferme de la Masure audit Wasquehal"
(généalogie par Pierre Prouvost de 1748). Il faisait aussi négoce de
filets de sayettes et de laines peignées qu’il faisait peigner, blanchir et ensuite
filer dans l’Artois où se trouvaient de nombreuses fileuses au rouet et à la
quenouille. "
Guillaume Prouvost fut à la fois laboureur et chef d'industrie. Il est le grand
modèle de la race. Il associe ses fils à son labeur et à ses
affaires" Lecigne
Jean Buzelain
put écrire, en 1625, dans sa Gallo-Flandria, sacra et profana: " Roubaix,
bourg ancien et noble sous beaucoup de rapports: sa dignité de
Marquisat, son vieux château, la multitude de ses habitants, ses
manufactures de draps, son église paroissiale, son hopital, sa forme de
ville concourent à lui donner un air de grande beauté et de richesse."
Nous ne connaissons pas précisément quelle fut la demeure
du fils de Guillaume, Pierre
I Prouvost,1606-1681, époux de Péronne Florin (1628-1691), mais nous pouvons constater leur environnement familial.
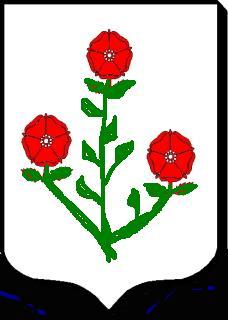
Ils eurent Pierre, ci après, et Marguerite qui épousa Pierre Le Clercq.
Jean Prouvost épousa en 1646 Barbe de Lespaul (dont postérité), et, avec
François «d'Hallewyn », releva les deuxfiefs du Fresnoy à Tourcoing, le 13 juillet 1677; Marie de Hallewin,
petite fille de Pierre, fille d'Antoine,
épousa, le 26 septembre 1621, Pierre de Lespaul de la branche cadette de la
grande famille roubaisienne et lui porta en dot l'un des deux fiefs du Fresnoy
consistant en 10 cents et les deux tiers
d'un cent de terre. Leur fille, Barbe de
Lespaul, s’allia à Jean Prouvost qui, le 13 juillet 1677, releva pour elle ce fief et en commit l'exercice à son fils
Jean Prouvost. Le même jour, François de Hallewin, descendant de Gilles,
relevait le second fief du Fresnoy consistant en 8 cents de
terre à labour sur le territoire de Tourcoing.
A la même
époque, Pierre Prouvost, décédé le 19 février 1697, épousait Philipotte de
Lespierre, fille de Jacques de Lespierre, seigneur de Wassegnies, censier du Fresnes à Croix et d'Isabeau de Lobel; son aïeul Blaise
de Lespierre était seigneur de La Ronderie et de Grimbrie. Leur fille Marguerite
Prouvost épousa Jean-Dominique de Cottignies puis Antoine
d'Espinoy.
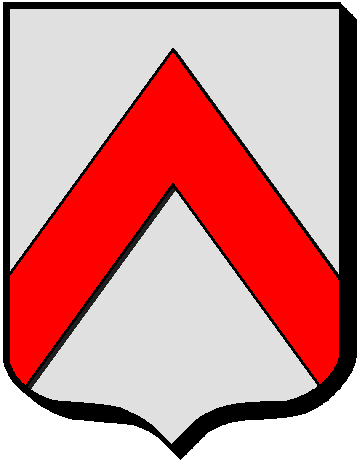

De Lespierre De Lobel
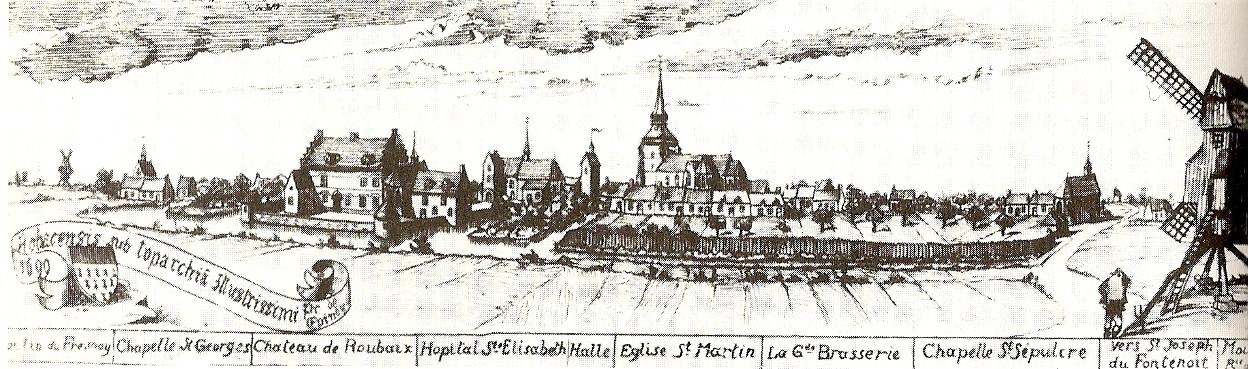
Les demeures furent certainement de qualité pour leur fils Pierre II Prouvost (1648-1691)
échevin de
Wasquehal, (épitaphe à gauche de l'autel Saint Nicolas de l'Eglise de
Wasquehal), époux de Marguerite de Lespaul, (1648-1720, inhumée près de l'autel Saint Nicolas
de l'église de Wasquehal) ,

fille de Jacques de Lespaul, Seigneur du Gauquier à Wattrelos, lieutenant de Roubaix de 1668 à
1672, maître de manufacture, En 1690, il était réputé le plus
riche de Roubaix; ses armes étaient « d’or à un arbre de sinople
sur une terrasse d’azur brochant sur le tout », il habitait le quartier de I'Hommelet. il fit, cette année, un don de 200 livres à la
Table des pauvres et lui remit en outre 900 livres pour capital d'une
rente à charge d' obit. Honorable homme Jacques de Lespaul, seigneur du
Gauquier à Wattrelos, mourut le 4 septembre 1691, âgé de 85 ans, et fut
inhumé dans l’église de Roubaix et Jehanne de le Dicque, fille de Gilles
de le Dicque, Seigneur de la Boutillerie à Watrelos et Marguerite Flameng, dame de la Boutillerie, d'une famille
notable de nombreux échevins et trois religieuses à l'hôpital Sainte Elisabeth.
Le 1° juin 1700, Marguerite de Lespaul. veuve de Pierre Prouvost, passe un
accord avec les religieuses de l'hôpital Sainte-Elisabeth de Roubaix, par
lesquelles deux parties s'interdisent pendant 50 années de planter
des bois montant; le long des héritages aboutissant à la piedsente du
bourg au hamel de Blanchemaille (rue des
Lignes) et à la piésente qui mène de la précédente au chemin de la
croisette du Pret à la rue Nain (rue de l’Hermitage) ; ladite Marguerite se réserve le droit de
planter des baies d'épine. (Archives de Roubaix, CG. 287.) (" Recueil
de généalogies roubaisiennes" de l'abbé Th Leuridan)." Dans le cours
du XVII' siècle, les représentants de cette branche de la famille de Lespaul,
favoris de la fortune, ont quitté Roubaix pour s’établir à Lille, où,
insensiblement, ils ont pris rang parmi la noblesse. Leur départ
était, en novembre 1696, mis au nombre des malheurs publics: " Nous,
lieutenant et gens de loy du marquisat de Roubaix, déclarons et certifions que
ce lieu, quy par ci-devant a este renommé à raison de ses
manufactures et des gens de considération quy l'habitoient, est présentement
tombé en décadence et dépérit par suite de plusieurs événements fatals, à
savoir le feu quy, en 1684, a consommé la plus belle partie du bourg, les
banqueroutes des marchands de Tourcoing et de Lannoy qui en ont causé beaucoup
d'autres a Roubaix, la retraite des
héritiers de Lespaul et des principaux habitans quy ont pris leur
résidence a Lille, les
grandes contributions qu'on a du payer en 1693, la famine arrivée en mesme
tems, quy a mis à la besace 1es deux tiers des habitants, et nonobstant le
secours des autres, plus de cinq cens desdits habitants seraient morts de
pauvreté, de disette et de faim, le manquement de travail des
manufactures ont mis ce bourg à telle extrémité qu'il ne retient
plus rien de ce qu’ils a esté autrefois. Archives de Roubaix, EE. 25, n' 33)
" Leuridan
Ils seront tous inhumés au sein même des différentes
églises de la ville de Lille. Leurs six enfants
furent Jacques qui suit, Marguerite-Jeanne (1671-1744), Pierre III, Marie
(1678-1744):
Marguerite Jeanne Prouvost (1671-1744), inhumée en la chapelle de l'Ange gardien à Saint
Etienne de Lille, qui a épousé Jean du Hamel en 1688; leur succession "était assez considérable"
et vécurent à Paris; ils léguèrent leurs biens immeubles à
son frère Jacques, qui suit, pour un tiers; leur fille Marguerite fut
religieuse au couvent des Pénitentes à Lille.
Leur fils Pierre III
Prouvost, né en 1675, épousa, à Saint Maurice de Lille, le 5
septembre 1712 sa cousine du deux au troisième degré, Marie Claire Trubert de
Boisfontaines (1687-1715 décédée à l'âge de 23 ans neuf mois après avoir reçu
les Saints Sacrements, inhumée dans la grande nef de l'église Saint Pierre
de Lille) , fille de Pierre, receveur héréditaire de la douane et de Jeanne de
Lespaul, après en avoir obtenu dispense en la cour de Rome. il rédigea en 1748
la première généalogie de la famille Prouvost:« Voila la description des
descendants des Prouvost et de ceux qui se sont alliez jusques a la fin de
cette année mille sept cens quarante huit. Et on peut dire sans vanité,
que lesdits du surnom Prouvost, ont toujours vécu en gens de biens,
d’honneurs et de bonne réputation en la foi catholique apostolique et
romaine et les plus notables des villages qu’ils
ont habitez " ; il vivait à Lille, rue du Nouveau Siècle; sa belle-sœur Elisabeth-Julie Trubert de
Boisfontaine, dame de La Vigne, épousa Philippe Emmanuel du Bus, comte du Bus,
seigneur de Moustier, Ogimont et
d'Acquignies ; les deux autres furent religieuses à Argenteuil.


Le château de la Vigne, une des demeures
actuelles de la rue du Nouveau Siècle, tout juste créée à l’époque de Pierre Prouvost
Marie Prouvost, 1678,- 1744 épouse, en novembre 1705, Pierre
Dassonville, greffier de la juridiction consulaire de Lille, fut inhumée au milieu de la grande nef de
l'église Sainte Catherine de Lille: dont François Ignace époux de Marie Agnès
Le Clercq qui vécurent à Paris.
On peut imaginer la qualité de la demeure d’Augustine Élisabeth Josèphe Prouvost, née le 14 février 1731, Roubaix (Nord),
décédée le 12 avril 1801, Roubaix (Nord) (à l'âge de 70 ans), mariée le 21
septembre 1755, Roubaix, Nord, avec Liévin Joseph Defrenne, sieur du Gaucquier,
né le 18 avril 1728, Roubaix (Nord), décédé en 1795, Lille (Nord) (à l'âge de
67 ans), négociant,
fabricant de tapisseries des Flandres en haute lisse, échevin de la Ville de
Roubaix.
Jean Fortunat Prouvost, né le 10 juin 1702, fut censier de La
Grande Haye à Roubaix; il épousa Marie Anne van den Berghe." Il
prit en fermage, en 1744, la cense de la Haye, à Roubaix, qu’il exploita un peu
en seigneur, ayant sa demeure privée sur le territoire d’Hem auquel la
cense de la Haye confine.
A l'époque, le voyageur la Force, décrivant
la Flandre en 1722, dépasse les estimations, en affirmant : « Outre les villes
de la châtellenie de Lille, il y a des bourgs aussi considérables que des
villes : Tourcoing et Roubaix sont de ce nombre et ne contiennent pas moins de
12000 âmes chacun. (histoire de Roubaix:Hilaire-Trénard,p 77) .
Si la demeure n’est pas précisée, on connait
l’état de la fortune de Jacques II Prouvost (1699-1774), (1699,
baptisé dans l’église de Wasquehal-1774 inhumé dans l'église Saint Martin de
Roubaix), Maître de manufacture, épouse
à Roubaix 1712, Marie-Agnès Florin (1712-1767), 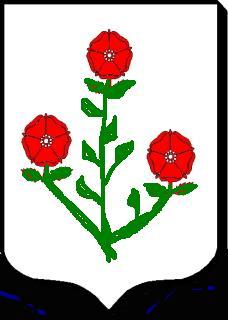 ,fille de Jean Nicolas Florin, membre de la
Manufacture de Roubaix et administrateur de la table des Pauvres (1686-1737) et
Marie Catherine de Surmont (1692-1744), inhumée dans l'église de Roubaix, soeur
de Pierre Constantin Florin, Député suppléant du Tiers Etat aux Etats généraux
de Versailles et premier maire de Roubaix.(sa petite fille Sophie Florin épousa
Henri II Prouvost) époux de Marie Bacon de Sains, fille de Philippe et
,fille de Jean Nicolas Florin, membre de la
Manufacture de Roubaix et administrateur de la table des Pauvres (1686-1737) et
Marie Catherine de Surmont (1692-1744), inhumée dans l'église de Roubaix, soeur
de Pierre Constantin Florin, Député suppléant du Tiers Etat aux Etats généraux
de Versailles et premier maire de Roubaix.(sa petite fille Sophie Florin épousa
Henri II Prouvost) époux de Marie Bacon de Sains, fille de Philippe et
Augustine Macquart de Terline. Jacques et
Marie Agnès Prouvost vont s'établir à Roubaix comme négociants et habitent
la rue Pellart; n'étant pas fils de maître, il entre dans la
manufacture en 1734 grâce à son mariage avec la fille d'un maître." RP
Louis d'Halluin. Leur succession en 1775 dénombre leurs
biens à Bondues, Tourcoing, Wasquehal, Roubaix, Estainpuis et Willems.
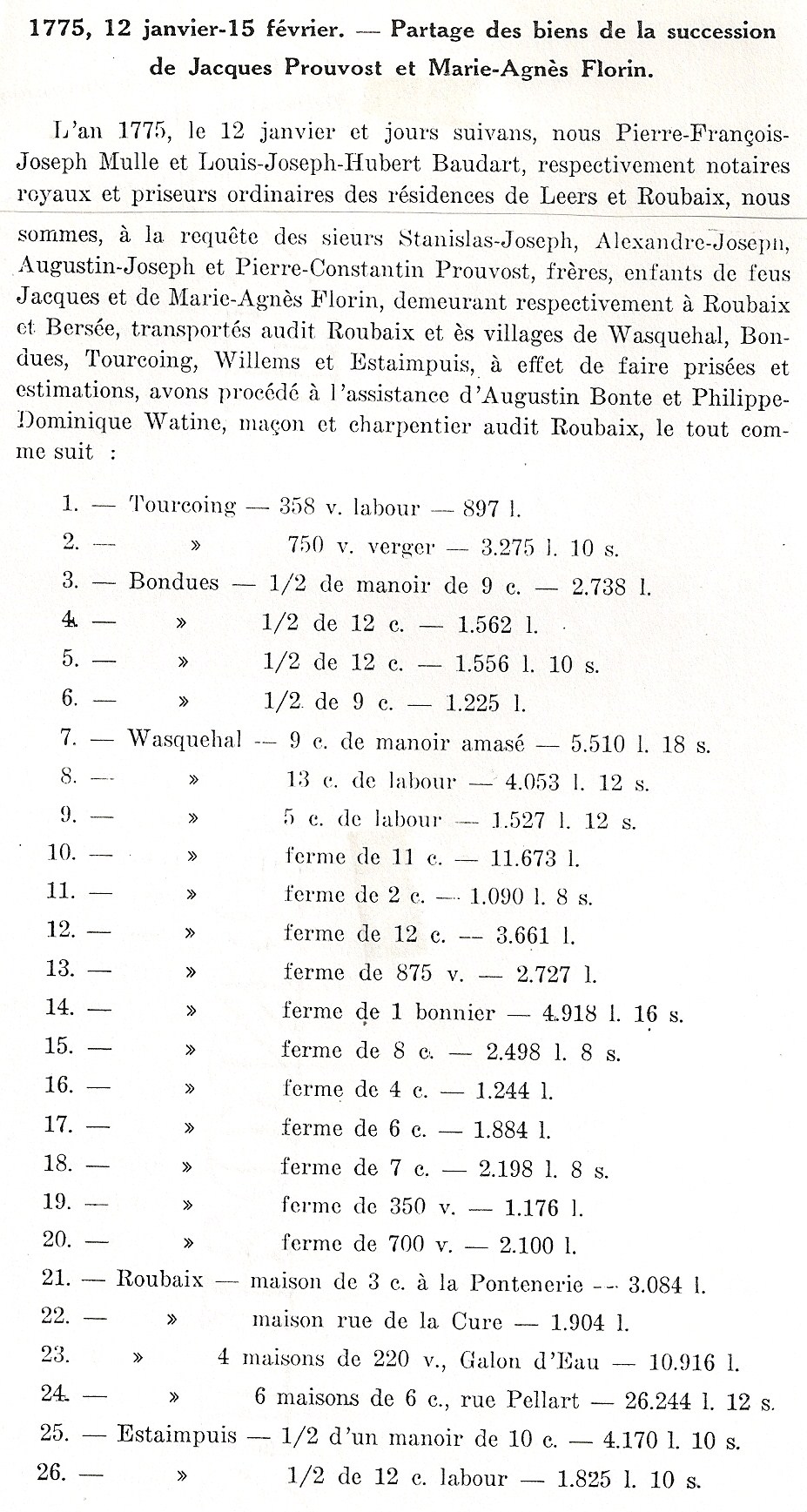
Pierre IV Constantin
Prouvost (1747-1808),
habitait rue Saint Georges à Roubaix, « une maison qu’il avait acheté
avec cinq autres pour la sommes de 530 florins, 13 patars et 5 deniers aux
héritiers d’Albert et Joseph Lecomte. La maison avait un magnifique jardin dont
les murs étaient couverts de vignes de raisins bleus et blancs. En été les
fleurs donnaient un air enchanteur à la propriété, plantée d’arbres à fusées,
dont on cueillait les fruits en juillet ; on y trouvait aussi des beurrés, des
callebasses, l’amande de Suède. Il y avait deux grandes pelouses qui furent la
cause d’un procès entre Constantin Prouvost et son voisin, Pierre Rouzé qui
avait la prétention d’y curer son linge. Constantin Prouvost ne dédaignait pas
les plaisirs de la table. Les faïences de porcelaine de Tournai et de
Lille étaient, à cette époque, d’un usage courant. Il y avait chez lui, de
belles pièces d’argenterie portant la marque des Fermiers Généraux de Lille :
l’alouette volante : parmi ces pièces, on admirait une grande cafetière Louis
XV et un important service à liqueur Louis XVI composé de quatre carafons
garnis de rinceaux et roses et, au centre, une pyramide surmontée d’une grosse
boule d’argent qui représentait, sans doute, une montgolfière, très à la mode,
même dans le ?, à la suite des ballons inventés en juillet 1783. » Ce
journal, Pierre-Joseph Prouvost le tenait sur un ordo de Tournai, diocèse
auquel appartenait Roubaix. Ce Pierre Prouvost, né en 1725, à Roubaix,
avait épousé Marie-Catherine de Ramery, de Mons, en Belgique. Il habitait rue
du Fontenoy. Il était l’un des cinquante maîtres de manufacture de tissus. Il
était imposé à 12 livres. Le document qu’il nous a laissé est bien curieux. Le
2 novembre 1771, écrit il, nous avons mis en bouteilles une pièce de champagne
rouge venant de Monsieur Roussel, de Tourcoing. Nous avons payé 221 florins 15.
Il y avait en cave : Bourgogne, vieux Frontignan, vin de Rilly, une pièce
de champagne à 22 de gros la pièce, une pièce de Macon à 14 de gros. (…)
: Pierre Prouvost reçoit le 20 janvier, la famille : l’abbé Prouvost Philippe
Constantin, son père Pierre Constantin, son oncle, sa sœur Béatrice Prouvost,
qui fut prieure de l’Hôpital sous la Révolution, sa mère Agnès Florin et
d’autres. …) : Le 1° septembre, table ouverte pendant trois jours pour
fêter la dédicace ducate de Roubaix : grande réunion des familles de Fontenoy,
Desmazières, Charvet, Lenôtre, Deldique, Deffrennes, Delannoy. En cette
circonstance, on a bu 27 bouteilles de Mâcon et 25 flacons de champagne.
L’année terminée, on fait l’inventaire de la cave : Pierre Prouvost
constate qu’on a consommé pour l’année 1771-72, en liqueurs, Macon, Rilly,
Bourgogne et Champagne, 187 flacons et 175 bouteilles » .Extraits d’un article
par Ernest Prouvost, le peintre qui oeuvra pour l’Exposition Internationale de
1911 avec Amédée Prouvost, fils de Liévin, auteur de la branche puinée.
Catherine
Françoise Prouvost et l’épopée de la Manufactures Royales de Lille:
fille de Pierre Joseph
Prouvost et Marie Ramery dit de Boulogne, elle épousa, le 30 avril
1782, François Joseph DUROT 1747-1815, fils d’Arnould-François DUROT,
bourgeois de Lille, remarquable exemple de parcours proto-industriel : sa
vie intense a été racontée par Alexis Cordonnier dans son article :
« Une industrie d’art au siècle des lumières. Son train de vie fut
remarqué ; on raconte même l’anecdote qu’il était un des premier à avoir
une baignoire chez lui. Il installa la manufacture-château
familiale au château de Beaupré, à Haubourdin, propriété du comte de Roncq

Si nous ne sommes plus sous
l’Ancien régime, nous pouvons relever et imaginer les inventaires
artistiques et mobiliers dans l’environnement familial du petit-fils de
Catherine-Françoise Prouvost, Alexandre Lauwick, peintre, qui épousa en 1864
Thérèse Riesener 1840-1932, fille de Léon Riesener, élève de son
père Henri-François Riesener et d’ Antoine-Jean Gros et de Laure Peytouraud,
petite fille de Henri-François Riesener (1767-1828),fils du grand ébéniste,
élève de Vincent, puis de Jacques-Louis David, époux en 1807 Félicité
Longrois, dame d'annonce de l'impératrice Joséphine. Arrière-petite fille de
Jean-Henri Riesener (1734-1806), élève de Jean-François Oeben. Il épouse
la veuve de ce dernier, Françoise-Marguerite Vandercruse. Reçu maître en
1768, Françoise-Marguerite Vandercruse est la fille de François
Vandercruse dit La Croix, 1728-1799, ébéniste, flamand d'origine, surnom
emprunté également par son fils, Roger, ébéniste à la Cour, lui aussi, qui
signa ses œuvres R.V.L.C. pour Roger Vandercruse La Croix, célèbre
ébéniste estampillant RVLC ; Thérèse Riesener est la nièce du
peintre Eugène Delacroix, cousin germain de son père Léon Riesener qu’il
portraitura.
Au
XVIII° et sous l’Empire, Aimée-Joseph PROUVOST, épouse de Louis-Urbain VIRNOT de LAMISSART,
vivaient
dans le vaste hôtel Virnot de Lamissart, 52,
façade de l’Esplanade
(angle rue de Jemmapes) Lille. Les parents de Louis-Urbain avaient possédé le superbe
hôtel de Lamissart au
144, rue Royale à Lille. les Virnot recevaient dans
l’hôtel Virnot de la
place Saint Martin ou de la rue de Tournai de Lille et offraient des
spectacles
d’opéra ou de théâte à la famille et
à la société de Lille : « une vaste
salle servait de théâtre de société et de
bal ; Louis Lenglart, élève de
Watteau de Lille y brossait des décors; la jeune et
élégante Catherine Sophie
de Lamissart y était une prima donna délicieuse et on se
rappella longtemps une
représentation de la «Flûte
enchantée»particulièrement brillante» nous dit vers 1930 Charles Le
Thierry d’Ennequin dans son magistral ouvrage sur ces familles. Sur une les
listes d’invités pour la représentation d'Arlequin et des deux Alvarets, on
trouve le nom des cousins Prouvost ; La sœur de Louis-Urbain, Rose-Marie
VIRNOT de LAMISSART (1772-1851) épousa Jean-Baptiste-Joseph PROUVOST.

Hôtel Virnot de
Lamissart-Prouvost, 52, façade de
l’Esplanade (angle rue de Jemmapes) Lille



Hôtel de
Lamissart (Prouvost), 144, rue Royale
à Lille


On observe au XX° siècle deux autres alliances entre les Prouvost et les Virnot; nous pouvons relater
Coté Virnot, nous pouvons imaginer la vie élégante dans les demeures que nous citons :
mentionnons au XVI° les demeures de l’ascendance de Flandres,
le XVII° et surtout la dernière partie du XVIII° pour les Virnot,
ces mêmes époques et surtout la Restauration pour les Le Thierry d'Ennequin et
les Formigier de Beaupuy.
" Le souvenir des réceptions données sous la Restauration par Urbain Dominique
Virnot et son épouse dans leur hôtel de la place Saint Martin perdure :
là, "une vaste salle avait longtemps servi de théatre de société: Louis
Lenglart, élève de Watteau de Lille, brossait les décors.
La jeune et élégante Catherine Virnot de Lamissart épouse de Dominique Virnot,
était une "Prima Donna" délicieuse
et on se rappela longtemps une représentation de la "Flute enchantée"
particulièrement brillante "
nous dit Charles le Thierry d'Ennequin dans sa généalogie de ces familles.
" Charles Marie le Thierry d'Ennequin, écuyer, époux de Catherine
Charlotte Virnot, mademoiselle de Stradin, du nom d'un fief de ses parents,
laissa, après la visite de Charles X, son hôtel familial de la rue A
Fiens à son fils Lucien et alla résider dans celui de la rue Royale(116).
La maison de "Bon papa Thierry" était hospitalière et patriarchale.
Outre ses fils célibataires, se retrouvaient son fils Urbain, Monsieur de
Beaupuy, le plus souvent à Paris, Marie Wallerie de Beaupuy et son époux, le
chevalier de Basserode et Victor Virnot qui en étaient des hôtes assidus.
Dès le retour de la belle saison, avec toute sa famille, il se transportait
dans sa belle propriété de Wazemmes
où, comme son père, il passait tous ses étés. Là, il donnait de grandes
fêtes. "
La tradition des dîners de quinzaine regroupait, jusqu'à une époque récente,
ces familles:
citons les dîners de Félicité Virnot, fille de Pierre et Rosalie de Raismes, en
son hôtel du 84, rue de Tournai, à Lille.


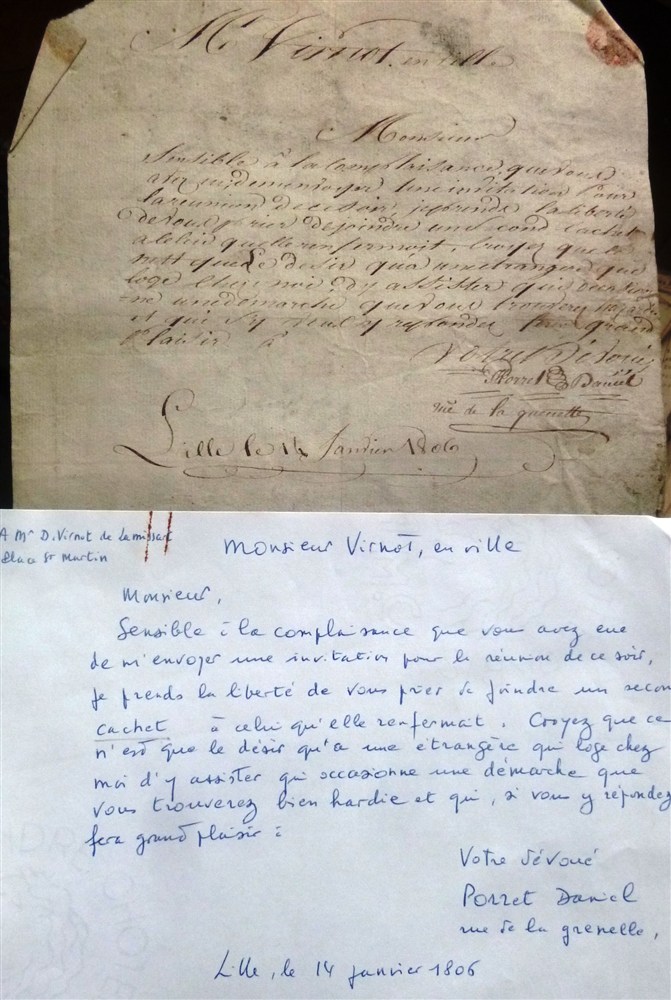
Noms des personnes invitées à la représentation d'Arlequin et des deux
Alvarets ":
on y repère quelques familles:
Virnot de Lamissart, Quecq d'Henriprêt, de Savary du Gavre, de Brigode de
Canteleu (peut être le maire de Lille; ou le beau frère de Catherine Virnot,
Jean Chrysostome de Brigode); de l’Espagnol , de Grimberie, Deprat?, de
la Sozaie, le chevalier de Basserode (auteur de la gravure de la visite de
Louis XVIII dans l’hôtel d'Avelin vendu par Pierre-Urbain Virnot au maire de
Lille, Louis Marie Joseph de Brigode), Quecq de Sevelingue, Danniaux, de
Fosseux (futur maire de la Madeleine), d'Oldenbourg, du Plessis, d'Ennevelin,
de Bourghelle, de Sommièvre. Bonnier, Barrois (le député et maire de Lille,
gendre d'Urbain Dominique Virnot), Capron, Genart, LeThierry, Prouvost, Macquart, famille ascendante des
Florin-Prouvost; Pierre Macquart, seigneur de Caudescure, secrétaire du général
Marescot à l’armée du Rhin, devient enthomologiste distingué tandis que son
frère Philippe fonde le muséum d'histoire naturelle de Lille), Lenglart (le
célèbre collectionneur, frère des deux soeurs Virnot, échevin et trésorier de
Lille, conservateur du musée, député de Lille au sacre de Napoléon Bonaparte,
vice président de la Société de Sciences et des Arts), "ami de Jacques Louis
David" (Trénard). Vanoenacker, Leplus, de Basserode , van
Blarenberghe (la dynastie de peintre et miniaturistes du Roi), Bazire. Leplus,
Alavaine, Mas, Van Brabant, Vogel, Bocquet, Lefebvre, Henry.

Nous
pouvons comparer les portraits familiaux ci dessus avec beaucoup des
dessins des Watteau de Lille, ci-dessous, provenant de la
collection de Charles Lenglart, principal mécène et immédiat parent des
Virnot, Prouvost, Quecq d’Henriprêt,
Lethierry d’Ennequin, Barrois, de Fosseux, de Raismes etc…On peut facilement
imaginer que les modèles appartiennent à ces familles : le tableau ci-dessous
pourrait parfaitement se passer dans un des hôtels familiaux.

"Euphrosne
DUPUI, fille de confiance, depuis 34 ans, chez les enfants de M. Henri
Prouvost, en son vivant, fabricant à Roubaix. Peu de femmes ont une existence
aussi bien remplie que celle d'Euphrosine Dupuis. Placée dans une famille
nombreuse où les besoins d'un grand
commerce absorbaient même la mère de famille, elle se montra digne de la
confiance dont elle était investie. Toujours prête à se dévouer, elle entourait
les enfants des soins les plus délicats et pendant la longue et douloureuse
maladie qui enleva M. Prouvost à l 'affection des sens, elle acquit des droits
éternels à' la reconnaissance de la famille." Mémoires de la Société des
sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. 1829-1931
Madame Charles I Prouvost

«
était gaie, dynamique, avait un caractère optimiste et
elle mettait par son entrain beaucoup d’ambiance dans les
réunions. Charles (Prouvost-Masurel), Jean, leurs fils alors
célibataires, les accompagnaient, leur sœur Gabrielle
avait épousé François Duthoit, frère
d’Eugène, en parlant d’eux on disait : «
c’est le milieu des intellectuels».
Les repas de famille à Roubaix: " Une trentaine de personnes autour d'une table à allonges, à la
nappe blanehe damassée, couverte de corbeilles de fruits, de gateaux, de
bonbons, trois plats au moins de mets recherchés dont on reprend car on les
repasse, fromages, entremets ou petits gateaux de chez trofas, fruits gateaux,
café, liqueurs.
Pendant ces repas, on commente les nouvelles, les faits divers,
la politique surtout. On se scandalise de l’attitude du gouvernement qui
ordonne les inventaires des biens d’église, de celle de l’abbé Lemire qui a
posé à hazebroucq sa candidature à la députation et qui est élu, tante maria,
un certain dimanche, nous fait part d’une invention appelée à révolutionner la
vie : celle d’une machine composée d’un acdre, de deux roues, d’un guidon,
d’une selle. On se tient dessus en équilibre, et, avec les pieds, on fait
marcher les deux pédales. Les hommes l’enfourchent comme un cheval, font de la
vitesse, et les femmes aussi, figurez vous. Naturellement, pour être décentes
en y montant, elles portent des culottes bouffantes. Elles ne mettent pas de
jupes, mais montrent leur molet (...)
Après le repas, les dames passent au salon se chauffer auprès
d’un bon et beau feu l’hiver ou bien elles vont arpenter le jardin en long et
en large l’été. Les messieurs jouent aux cartes et fumenty dans le bureau où
l’athmosphère chargée de fumée devient très vite irrespirable. Les jeunes d’âge
scolaire, eux, sont partis au collège, à trois heures pour assister aux vèpres.
Ces réunions groupent tantôt le coté Watine, tantôt le coté Prouvost.
« Parfois,
je restais loger à Roubaix et j’assistais alors à la prière du soir récitée en
commun. Elle réunissait parents, enfants, domestiques, dans une petite pièce du
premier étage appelé « l’Oratoire ». Des prie-Dieu, des chaises
étaient assemblées devant la cheminée de marbre transformée en autel, avec un
Christ, des statues, des cierges, des fleurs. Bon papa, chef de famille,
récitait les prières, nous y réppondions tous, on y ajoutait les invocations à
saint Joseph en mars, à la sainte Vieige marie en mai, pour le mois de Marie,
au sacré Cœur en juin.» Marie Paule Fauchille-Barrois, Vos aïeux que j’ai connus.
Sophie
BROUE, cuisinière et bonne d'enfants , depuis 33 ans chez M. Prouvost-Scrépel,
à Roubaix. Dévouement sans bornes. Après avoir élevé la famille de Mme Prouvost
avec toute la tendresse d'une mère , Sophie reporte maintenant toute sa
sollicitude sur les petits-enfants , et montre envers sa propre famille un
désintéressement inaltérable.

Les
règles de vivre en famille autant qu’en
société étaient bien inscrites ; on peut citer cet
amusant règlement de la famille Toulemonde dont une fille
épousa Pierre-Amédée Lestienne-Prouvost
Commandement du « Gai Souper » de la Famille TOULEMONDE
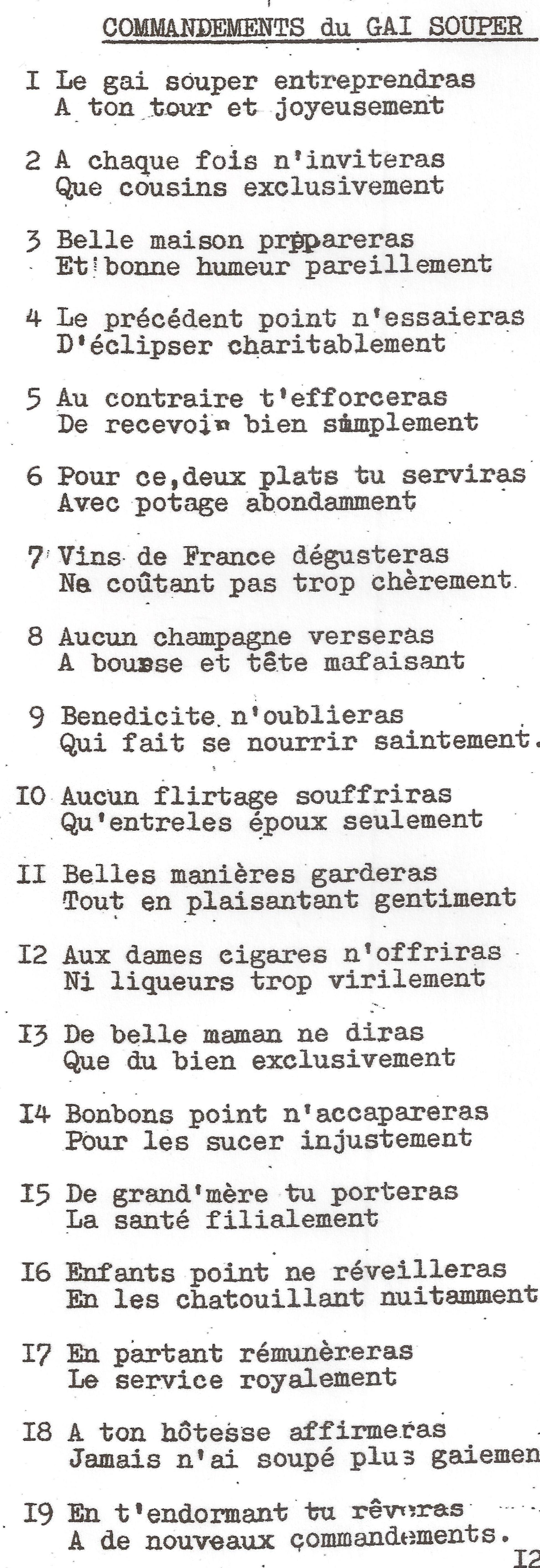
Leur fille, Madame Charles Flipo-Prouvost
laissa son journal de comptes d’une écriture soignée sur un simple cahier
d’écolier à la couverture de molesquine noire ; ils habitaient un hôtel
particulier, rue de Tournai à Tourcoing, en face de l’hospice d’Havré du XVII° siècle ; au sujet du dîner de
fiançailles chez eux de leur fils Charles avec Marie Tiberghien, quelques jours
après celui donné par les parents Tiberghien en 1905: « C’est Monsieur Vaillant
qui en a été chargé pour 11 francs par tête, sauf le vin, le bouillon du soir
et les serveurs qui étaient à sa charge. Il fut parfaitement réussi et ne
laissait certes rien à désirer à celui de Doublé. Le menu se composait du même
nombre de plats que le dîner de Mme Tiberghien, c’était :
Potage Velouté
Truite Saumonée, sauce dieppoise
Filet de bœuf Henri IV
Volailles truffées
Chevreuil Newrod
Garniture parisienne
Faisans bardés
Cailles roties
Parfait de foie gras
Glaces Montmorency et Rosita
Fruits-Desserts (20 assorties)
Les desserts avaient été commandés chez Meert
à Lille. Ma vaisselle était suffisante pour nos 79 convives (nous compris). Je
n’ai dû louer que quelques carafes et bols à bouillon.
Pour le vin, Charles a sorti
3 bouteille de Madère
5 bouteilles de Château-Yquem
10 bouteilles de Château Margaux (Bordeaux)
9 bouteilles de Corton (Bourgogne)
37 bouteilles de Champagne (y compris pour la
soirée)
2 bouteille de Cognacq
2 bouteilles de Chartreuse (seulement pour
passer à table)
et une bouteille de Kirsch pour le fumoir.
Ma cuisinière a servi à 5 heures à tous les
gens de service :
Bouilli froid avec persillade
Rosbif avec haricots et frites
Fromage- 1 verre de vin rouge
ordinaire-café.
Sur la table, il y avait comme lumière 6
candélabres en cristal, dont deux prétés par François. C’était suffisant. Les
fleurs venaient d’un jardinier de la rue Nationale à Lille. J’ai eu 5 surtouts
magnifiques, du feuillage et des fleurs posées en serpentant sur toute
la salle, des fleurs pour garnir mes
vases, un bouquet pour la fiancée et deux bouquets pour les dames du
concert du sooir ; il y avait, en outre, des fleurs et du feuillage dans
les corbeilles de fruit. Le tout pour 130 f.
La petite chambre du balcon était réservée
aux artistes du concert qui avait été organisé pour 1000 F par Mr Stupy. Dès
leur arrivée, on leur offrait du café chaud puis, dans la soirée des tartines fourrées
( au pain spécial), de l’eau sucrée ou du champagne. Le concert a commencé vers
9 heures ½ et s’est terminé à 11 heures ½. Très bien.
Comme fille de service, j’avais 1) au
vestiaire, ma femme de chambre et deux autres filles, 2) pour relaver la
vaisselle, ma cuisinière et une relaveuse ; pour essuyer, les deux filles
du vestiaire.
Ma femme de chambre avait pour mission
d’ouvrir la porte quand on sonnait et de se tenir en permanence dans le
vestibule pour pour éteindre et ralllumer les bougies… faire parvenir un peu de
fraicheur dans les appartements en ouvrant la lucarne du vestiaire, les portes
du salon etc… et de se tenir à la disposition des Dames qui auraient pu être
souffrantes. Dans la soirée, elle devait introduire et servir les artistes, aider
les actrices à s’habiller, placer sur la scène les objets nécessaires à la
comédie etc… etc… J’ai payé 6 F les deux filles de service (Mélanie et
Anna-Honoré) venues dès le matin. L’autre fille (Félicie) venur seulement à 1
heures ½ n’a reçue que 5 F.
Comme pourboire à la cuisine, Mr Tiberghien a
donné simplement 10 F. quelques jours après, venant en visite, elle s’est
excusée et a rendu encore 10F. ». Le mariage eut lieu au Cercle Saint
Joseph de Tourcoing pour 207 invités en dîner assis :
« on a dansé tout le temps : voici l’ordre des danses : Polka,
Valse, Pas des Patineurs, Valse, Quadrille, Valse, Berline, Lanciers,
Casquette, Valse, Pas de Quatre, Mazurka, Valse. La corbeille offerte par les
parents de Charles à Marie Tiberghien comprenait, un mouchoir de dentelle
acheté à Bruxelles, un missel, un porte-cartes, un porte-monnaie, un éventail
de dentelle et peinture, une broche émail, un meuble de corbeille, un pendentif
or ciselé et perles fines, une bague de fiançailles, perle et brillant, un
bracelet perles fines, brillant et rubis, une paire de brillant d’oreilles, un
collier de perles et brillants » : ces derniers en milliers de
francs-or.
Lors de la demande officielle, contrairement
aux usages établis, la fiançée était présente dès le début de notre visite,
alors qu’elle ne doit paraître qu’au bout d’une dizaine de minutes lorsque ses
parents la font appeler ; Charles Flipo-Prouvost était en habit, Marie en
robe de soie et gants blancs.
Le futur marié mourut pour la France à Verdun
en 1916 à 32 ans ; Marie Flipo-Prouvost mourut à Tourcoing en 1936 à 73
ans avec ferveur et grande croyance en la vertu des indulgences. Leur neveu,
l’abbé Joseph Flipo consacra une bonne partie de son importante fortune de fils
unique à l’agrandissement et à la modernisation du collège de Tourcoing dont il
fut directeur …de l’économat et, accessoirement professeur d’anglais.
Charles Flipo-Prouvost céda « en grand
seigneur, ses parts dans l’affaire familiale à ses cousins mais fonda les
établissements Charles et François Flipo qui eurent 500 ouvriers en 1912.
La sœur de Charles, Marguerite Flipo fut
religieuse Bernardine à Lille sous le nom de Dame Marie-Julie, décédée à La
Cessoye en 1974 à 82 ans.

« En 1948, les sœurs Bernardines firent
l'acquisition du château de La Cessoye de Saint-André. Ce château, de style
néo-classique, bâti en 1908, est l'oeuvre du Tourquennois Jean-Baptiste
Maillard (1857-1930), un architecte réputé qui construisit de nombreux hôtels
particuliers et des maisons bourgeoises à Tourcoing. À l'origine, La Cessoye
était un fief tenu du châtelain de Lille. Il comprenait un manoir assis sur une
motte appartenant aux seigneurs du lieu. En 1389, Jacques Gommer en était
propriétaire. En 1422, Jean Marquant, dit de Saint-Venant, roi de l'Épinette,
hérita du domaine. Antoine de Tramecourt, chevalier, qui le possédait en 1685,
le vendit à Simon Vollant, le collaborateur de Vauban qui construisit la
citadelle de Lille. Puis, il appartint à Pierre-Joseph Rouvroy, dernier
seigneur de la Cessoye, et à son gendre Dulac de Fugères, maire de Lambersart
de 1857 à 1861. Il fut ensuite loué à Albert Mabille de Poncheville, maire de
Lambersart de 1829 à 1835, avant que ce dernier ne fasse construire sa villa
Saint-Yves à Lille. Il appartenait au Lillois Gustave Dubar-Villaret, le
propriétaire du journal Le Grand Echo du Nord - Pas-de-Calais, qui le fit
démolir en 1908 pour le remplacer par le château d'aujourd'hui. » Ils y
avaient le portrait de Charles et Marie-Anne Lenglart, grands collectionneurs
et mécènes du XVIII° siècle à Lille, par Heinsius, peintre des filles de Louis
XV. »

Occupé par les Allemands lors des deux
guerres mondiales, il était tellement abîmé qu'il eut besoin d'une sérieuse
restauration. Finalement, il fut vendu en 1948 par Jean Dubar-Motte aux
Bernardines qui en firent le siège de leur congrégation, un lycée
d'enseignement professionnel et une école.
Pendant ce temps, une communauté continuait
l'oeuvre scolaire à Armentières. En 1964, une nouvelle construction vint
agrandir l'ensemble, au coin de la rue Lamartine et de la rue Denis-Papin. Mais
le nombre des religieuses ne cessait de diminuer, comme dans toutes les autres
congrégations d'ailleurs. Et d'autre part, l'enseignement en France devenait de
plus en plus exigeant, ce qui était difficilement compatible avec leur vie de moniales.
La solution était alors de laisser les établissements scolaires à d'autres
congrégations et de retirer la communauté. Les Bernardines quittèrent alors les
écoles de Saint-Bernard et de Notre-Dame en 1967, et l'Institut Familial en
1969, et furent remplacées par les soeurs de la Providence de Rouen. » •
ALAIN FERNAGUT
Les vacances d’été de Charles II et Eugénie Prouvost
se
passaient à Cannes, au châlet des Syrphes, chemin du Petit
Juas .



Charles Prouvost-Masurel et sa fille Simone à Cannes vers 1906 ou
1908 Madame Charles
Prouvost- Masurel et sa fille Simone
Les familles du Nord ont toujours recherché
le soleil méditerranéen.
Charles III et Hélène Prouvost

Réunions
Prouvost-Scrépel à Roubaix, après-guerre
organisées par Charles et Hélène Prouvost
organisaient, dans les années 1950, des
réunions de famille Prouvost-Scrépel à Roubaix. Habitant une
maison moderne au 355, avenue de
l’Hippodrome à Lambersart, les Prouvost recherchaient une demeure plus grande
pour leurs sept enfants. Ils logeront à la Roseraye jusqu’au début de l’année
1957. La vie y était intense : sept enfants, onze personnes pour le
service, les réunions de famille, les nombreuses activités associatives :
Charles Prouvost était en effet industriel, administrateur du Crédit
immobilier, ancien Président de la jeunesse catholique de Tourcoing, Président
de la Confrérie du Saint Sacrement, ancien président du conseil paroissial et des familles nombreuses de Thumesnil
, membre du conseil paroissial
et des œuvres de la paroisse Sainte Callixte, président d’honneur du Patro-club
et de la chorale, président d’honneur de la Musique du Centre et du club des
Cinq.
Eux aussi avaient leur propre personnel de
maison. Robert était à la fois le concierge du lieu et le jardinier. Jeanine,
l’épouse de Robert était femme de chambre. Denise était la gouvernante de la
maison. Léon, le maître d’hôtel, et sa femme Paulette étaient tous deux logés
au château : Léon était connu pour ses gaffes ; alors que les Prouvost
recevaient, il demanda, suffisamment
audible dans le salon, à la maîtresse de maison: « dois-je mettre le
très bon vin, le bon vin ou le vin de tous les jours ? » ; Charles
Prouvost répondit avec un grand éclat de rire partagé par ses invités:
« mais le meilleur vin, mon cher
Léon ».
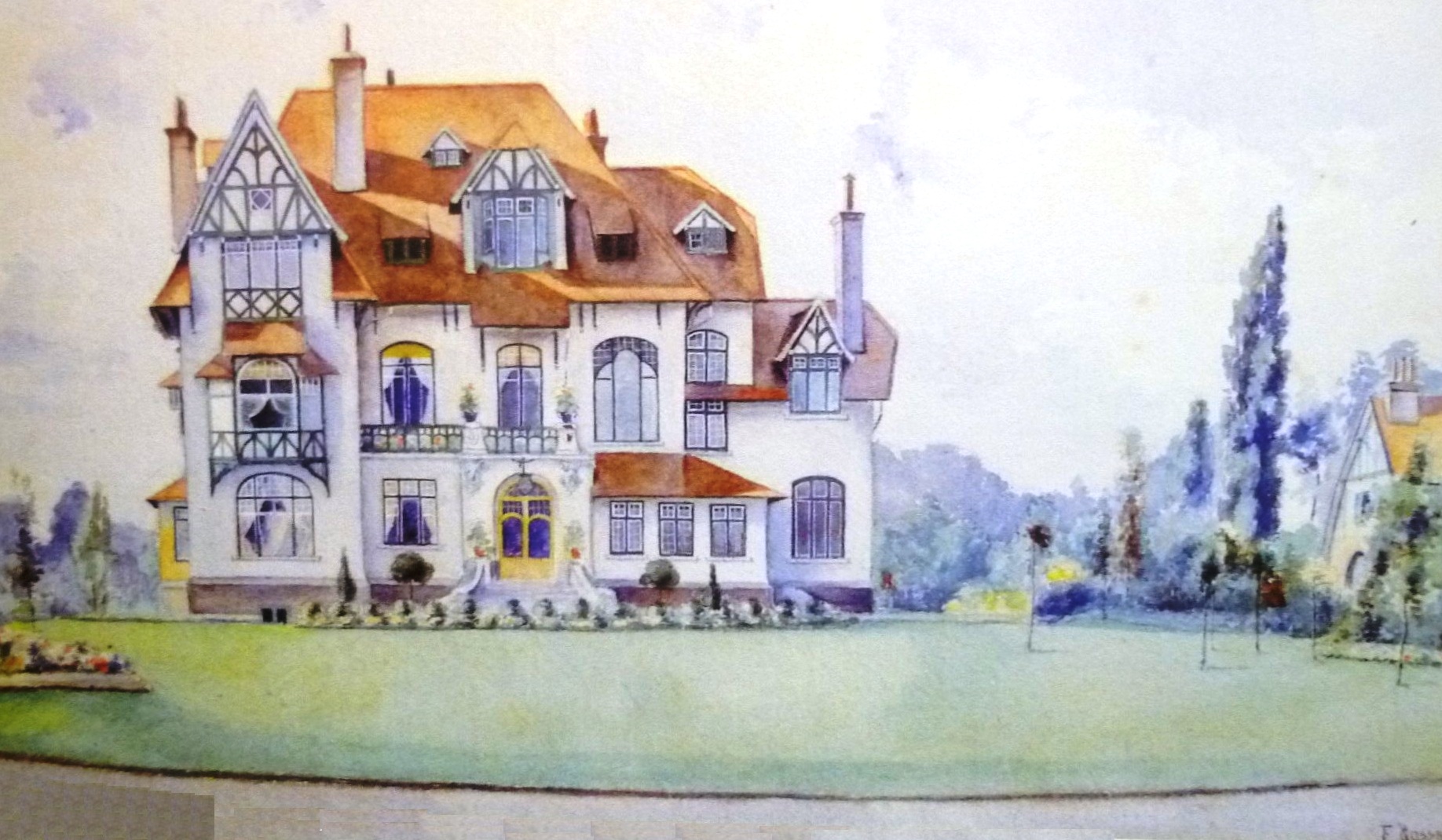
L'élégance chez Christian et Brigitte Prouvost-Virnot
Le 52, rue de Bourgogne à Paris
Cette enfilade de salons est dans un immeuble
historique du XVIII° siècle, construit pour l'intendant du
Prince de Condé, Rue de Bourgogne,
au cœur de l’historique Faubourg Saint Germain, 7°
arrondissement de Paris, à quelques pas du Musée Rodin,
du Palais Bourbon, du Musée d’Orsay, .
Ouvrant par 9 fenêtres sur une élégante cour
classée, arborée et pavée, cette
enfilade comprend : le Vestibule d’honneur, un Cabinet de
curiosité, la Grande Salle à manger,
le Salon Bleu (orné de boiseries d’époque Louis XV rechampies bleu).
Gaëtane Prouvost
Son
brillant parcours de violoniste soliste ne
l’empéche pas d’être aussi une maîtresse
de maison attentive et elle fait vivre
avec élégance le château des Barres dans
l’Yonne dont hérita son mari,
Charles de Couëssin; chaque été, ils contribuent au
développement du festival de la Puisaye et les salons des Barres
retrouvent la tradition des réceptions et des concerts, certains
composés des musiciens de la famille.
Thierry Prouvost
A
fondé l'agence d’évènementiel et de
communication "Pour vous, les princes" qui a pour
spécialité d’ouvrir des demeures historiques
privées
pour les faire vivre, le temps d’un évènement,
à l’optimum de ce pourquoi elles
ont été concues.

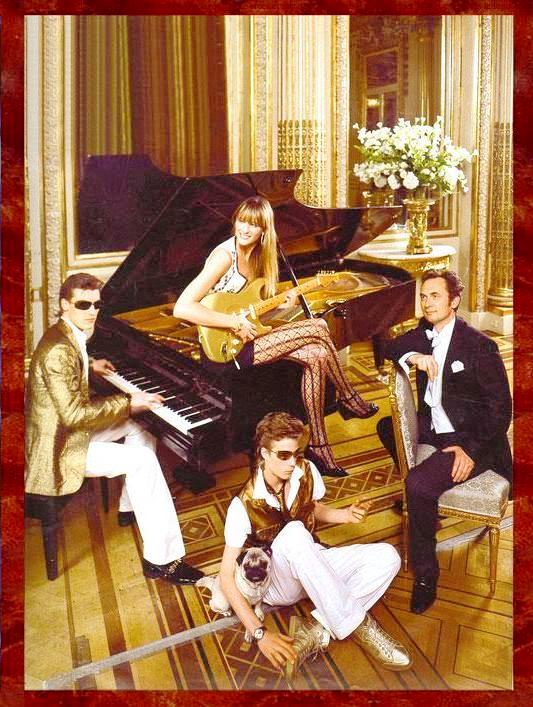


Chez les Georges Prouvost,
on sut garder la tradition des spectacles de société ;

François Lefebvre, Marie Maës-Prouvost,
Félicie Prouvost-Dehau, un prêtre, ?, puis Charles Prouvost-Dalle et d’autres membres
de la famille écoutant un poème.
On se souvient de la merveilleuse fête donnée par Sophie de Sivry, fille de
Renaud de Sivry et Gisèle Prouvost, et sa cousine Maxime Frapier, fille de Denis
Frapier et Martine Prouvost, au château de Neuville près de Paris, dans les
années 1980, sur le thême de « Masques et
bergamasques», un hommage musical du XX° siècle du monde des fêtes
galantes du XVIII° siècle par Gabriel Fauré (1845–1924).

Madame Amédée I Prouvost
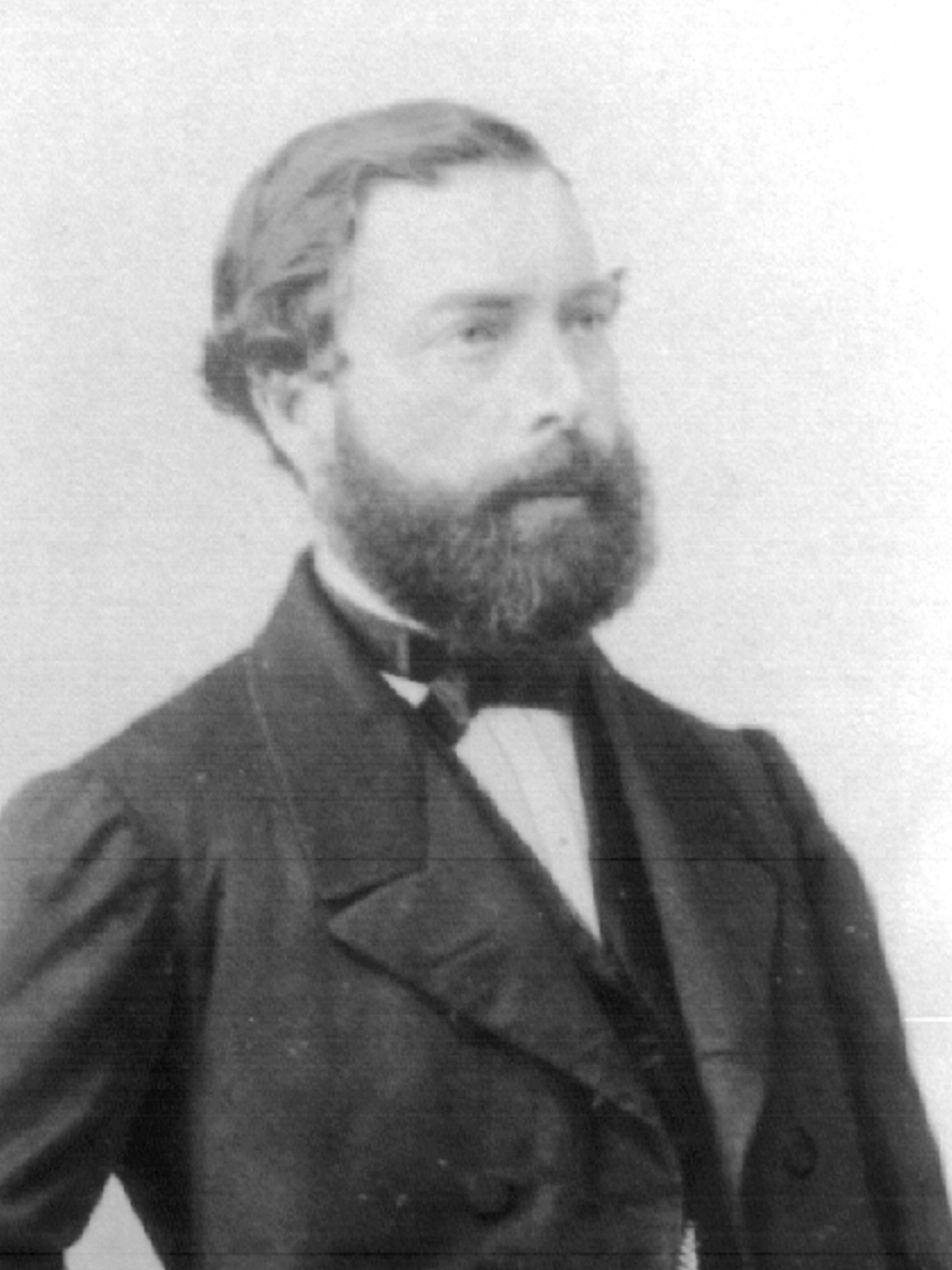

au château d'Estaimbourg
« ne mettait aucune
prétention ni aucune recherche dans ses soins de maitresse de
maison, cependant
rien ne manquait jamais à l’ordonnance des repas ni
à la bonne tenue des
appartements ; elle était elle-même l’enseignement
vivant : savoir se plier aux
circonstances et de se contenter de ce que vous offre le
présent. Avec une
inaltérable aménité elle était à
même de supporter les mécomptes, les contretemps,
les déconvenues sans laisser paraitre en aucun cas le plus
léger mouvement
d'humeur. Sa maison était toujours en ordre, ses serviteurs lui
étaient
attachés, pas d'observations encombrantes et humiliantes, mais,
le mot
d'encouragement nécessaire. A Roubaix, les œuvres de
charité prenaient grande
place dans la journée de Mme Prouvost qui fut pendant de
nombreuses années
présidente de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Que
dire de sa grande
charité pour soulager toutes les misères? Les visites
chez les pauvres étaient
quotidiennes ; elle se faisait une joie de donner chaque jour un diner
a une de
ces familles nécessiteuses dont un membre venait chercher la
part à midi et
démon était accoutume à voir sous le porche
attenant à la cuisine des femmes ou
des enfants assis sur un banc attendant l’ audience de leur bien
fautrice qui,
de l’ air le plus calme et le plus souriant, les recevait
toujours avec bonté,
les encourageait, les exhortant et leur glissant la piécette
blanche qui était
la terminaison heureuse de l’ entretien. Cette femme de bien avait au coeur une tendresse douce et une
sollicitude toujours attendrie pour ses enfants. »

« Ces capiatines d’industrie eurent tous
en commun la puissance de travail, la sobriété, une droiture et une honnêteté
rigoureuse. Leur parole était sacrée et un négociant pouvait retenir sans
preuve écrite la cargaison entière d’un navire sur la foi de son seul engagement.
La vie familiale de ces grands clans demeura
simple, presqu’austère au milieu d’une aisance financière imposante. Les
dépenses frivoles étaient bannies comme le luxe ostentatoire. Mais tout était
mis en œuvre pour le confort et l’opulence de la maison. En témoignent les
demeures baroques, souvent appelées châteaux, ces vastes villas à tours,
pignons, bow windows et cariatides construites entre 1880 et 1910. Ces demeures
imposaient des frais d’entretien tellement élevés qu’elles furent toutes
détruites. Elles se truvaient souevnt à coté ou dumoins très proches de l’usine
et des « courées » où vivaient des ouvriers sans qu’aucune des deux
parties ne se plaignent du voisinage.
Les distances n’effrayaient pas ces pionniers
qui parcoouraient à cheval, tel mon arrière grand père Masurel, les immenses
prairies du Nouveau Monde pour s’approvisionner en toisons de moutons.
Alfred Motte, le fondateur de la célèbre
dynastie, comme d’autres chefs d’entreprise du XIX° siècle, arriivait à l’usine
à 5h30 pour vérifier l’entrée du personnel.
Le rôle des femmes fut aussi primordial dans
l’ascensoion des familles. La Tradition voulait que les fils des grandes
familles épousent des roubaisiennes grand teint qui devaient savoir ce que le
mariage imposait.
Les alliances des fabricants entre eux
allaient former ce bloc social d’où se détacheront les noms des grandes
familles qui, pendant plus d’un siècle, feront l’histoire de Roubaix et de
Tourcoing.
« Les lettres échangées entre mon grand-
père, ma grand-mère Amédée Prouvost et leurs six enfants témoignent d’un
attachement fondamental aux vertus essentielles de notre race du Nord de la
France, consacrées par des siècles de luttes et d’épreuves. S’aimer,
s’entr’aider, travailler dans la loyauté et l’honneur à créer chaque joour un
peu plus de bonheur pour toous, être prudents dans le succès, courageux dans
l’adversité, tels étaient les enseignements traditionnels de nos familles,
transmis dans un grand esprit chrétien. ».
Suivant le vœux de leurs parents, les enfants
ont maintenus jusqu’au dernier jour de leur vie une union indéfectible.
Dès mon plus jeune âge, j’ai été séduit par
leur finesse d’esprit, leur délicatesse de pensée et par-dessus tout leur
bonté. Ils nous ont appris l’indulgence envers les autres, le refus de la
médisance. Leur enthousiasme devant toutes les formes de la beauté leur donnait
d’immenses satisfactions qu’ils faisaient partager à leurs enfants. La musique
en famille, l’amour des lettres allaient entrainer des vocations poétiques dont
une, celle du porteur du cher prénom « Amédée » devait avoir un
brillant destin.
Au château d’Estaimbourg, « ne mettait
aucune prétention ni aucune recherche dans ses soins de maitresse de maison,
cependant rien ne manquait jamais à l’ordonnance des repas ni à la bonne tenue
des appartements ; elle était elle-même l’enseignement vivant : savoir se plier
aux circonstances et de se contenter de ce que vous offre le présent. Avec une
inaltérable aménité elle était à même de supporter les mécomptes, les
contretemps, les déconvenues sans laisser paraitre en aucun cas le plus léger
mouvement d'humeur. Sa maison était toujours en ordre, ses serviteurs lui
étaient attachés, pas d'observations encombrantes et humiliantes, mais, le mot
d'encouragement nécessaire. A Roubaix, les œuvres de charité prenaient grande
place dans la journée de Mme Prouvost qui fut pendant de nombreuses années
présidente de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Que dire de sa grande
charité pour soulager toutes les misères? Les visites chez les pauvres étaient quotidiennes
; elle se faisait une joie de donner chaque jour un diner a une de ces familles
nécessiteuses dont un membre venait chercher la part à midi et démon était
accoutume à voir sous le porche attenant à la cuisine des femmes ou des enfants
assis sur un banc attendant l’ audience de leur bienfaitrice qui, de l’ air le
plus calme et le plus souriant, les recevait toujours avec bonté, les
encourageait, les exhortant et leur glissant la piécette blanche qui était la
terminaison heureuse de l’ entretien. Cette femme de bien avait au coeur une tendresse douce et une
sollicitude toujours attendrie pour ses enfants. »


Pierre Lestienne-Prouvost photographiant ses
petits enfants.; réception écclésiastique dans l’hôtel
Lestienne-Prouvost à Roubaix.
Madame Amédée II Prouvost

"Si
nous voulions lui faire plaisir, nous la
mettions sur le chapitre des bals au Palais Royal chez le Duc
d'Orléans, seule
fête d'ou elle fut rentrée au petit jour, et ou elle vit
Paris, sortant de sa
léthargie nocturne ou aux Tuileries sous Louis-Philippe. Elle
assistait assez
souvent aux grandes réceptions où le Roi faisait
volontiers le tour des salons
». Son grand père, le Général
Frédéric Morvan: De 1845 à 1848, il fut
inspecteur général de son arme en Algérie et en
France. Il semble que Frédéric
Morvan ait conservé bon souvenir de cette époque, de
Louis-Philippe et de sa
famille, Le général Morvan, qui avait été
souvent admis aux réceptions intimes
du Roi, n'avait jamais contemplé sans admiration le spectacle
qu'offrait la
Reine toujours entourée de ses filles, travaillant avec ardeur
à des ouvrages
destinés à des loteries de bienfaisances. La duchesse de
Montpensier toute
jeune mariée, jetait un regard à la
dérobée sur l’horloge, impatiente de quitter ce
cadre un peu pesant, pour une
promenade incognito au bras de son mari, ou une soirée au
théâtre. ». « le
général Morvan reçut les félicitations du
Conseil des Ministres. Ses rapports
avec le Prince-Président puis Empereur, furent plus tendus
qu'avec la famille
de Louis-Philippe. Il fallait bien de
temps en temps paraitre aux jeudis de l’Elysée ; une fois
qu'il avait salué le
Prince-Président, il se tenait à l’ écart
dans un des salons soit causant avec
un camarade, soit observant seul le coup d'œil du Palais. Un soir
Louis Napoléon
faisant sans doute l’appel des invités qui formaient
déjà sa cour, aperçut
Morvan dans le coin d'une galerie, dérobé par ses filles
et plusieurs autres
personnes. Il le reconnut et l’interpella: « Eh bien,
général Morvan, vous êtes
bloqué! » Morvan s'inclina seulement sans
révéler un mot que d'autres auraient
pu trouver blessant. A une autre occasion, Napoléon III eut tout
loisir de
connaitre la loyauté de Morvan envers ses camarades.
Sollicité par l'Empereur
de critiquer une attitude à Rome du maréchal Vaillant, il
répondit au Souverain
que le maréchal étant sur place, était
le meilleur juge de ce qu'il fallait faire. La seule intrusion de notre
ancêtre
dans les affaires fut un poste d'administrateur des Forges de
l'Aveyron. II s'y
lia avec le Duc Decazes qui en était le président et chez
qui il dinait
souvent. II y rencontrait M. Thiers et différents hommes
politiques. En 1852, le général Morvan, qui
habitait alors
rue Godot-de-Mauroy, fut mis a la retraite et en 1854 nomme grand
officier de
la Légion d'Honneur."
Et voici un tableau d'intérieur qui est fait
pour charmer les regards d’Amédée
III Prouvost :

Concert avec sa mère au piano, ses trois soeurs dans un des salons du 113, boulevard de Paris à Roubaix.
Photos tirées de l'album personnel d'Amédée III grâce à Hervé-Toulemonde

Reconstitution du concert du poète avec Gabriel et Adélaïde de Couëssin-Prouvost.
il eut une âme charmante et une vie harmonieuse. Son enfance fut
nourrie de tendresse. 1l avait sept sœurs qui l'appelaient « le petit roi ». II
fut élevé par des prêtres (et cela se devine dans ses vers, a certaines
inflexions). Il voyagea. Il vit l'Orient. Cet homme du Nord était amoureux de la lumière et du soleil. Il
fit un mariage d'amour, à la fois romanesque et raisonnable. Il eut deux
enfants. II travailla gaiement dans l'usine familiale ; et, comme c'était
une âme ouverte à tout, il sut comprendre la phobie de la Cité noire et la
sombre beauté des machines ... II aimait la musique, et les arts, et toutes les
formes de la beauté. »
« On
menait une vie très simple dans la bonne petite ville de Roubaix dont les
habitants, voués par vocation et tradition à la vie de famille et au travail se
contentaient de ces habitudes toutes patriarcales. Les maisons avaient de
grands jardins plantés d'arbres fruitiers, aux allées bordées de buis où
fleurissaient au printemps pervenches et muguets, tulipes de Hollande, œillets
flamands et roses de Chine. Dans le fond se trouvait la pelouse où s’étendaient
à certains jours le beau linge de fine toile de Cambrai et de Flandre dont la
lessive était un des grands soucis des bonnes ménagères du temps. Ces richesses
se transmettaient de génération en génération, contenues dans de grandes
armoires de chêne massif aux panneaux sculptés… Au foyer, un jour ne se passait
pas pour ainsi dire sans qu’on apprit par cœur une ou deux maximes des livres
saints, et ces éternelles lois sociales étaient la matière d’un enseignement
domestique positif et solide. On travaillait beaucoup, on lisait peu, et
c’était surtout dans les livres saints que l’on puisait les vérités maîtresses.
Dans cet intérieur qui a des aspects de sanctuaire se dressent des chefs de
famille auxquels il ne manque que l’éloignement de la perspective pour avoir la
majesté des patriarches. Ce sont les derniers portraits de la galerie. Elle se
termine par Amédée I°. " "Amédée Prouvost" par C. Lecigne,
éditions Bernard Grasset, 1911
« La vie à Estaimbourg
était très monotone, point n'est besoin de le dissimuler, et quoique ces
souvenirs n'aient le droit d’évoquer aucune satire, il est avéré qu'on
cherchait l’ ombre du parc pour parer aux inconvénients du soleil, puis le
soleil pour se réchauffer de la
fraicheur de l’ ombre, qu'on y discutait avec un esprit charitable et plein de
douceur de I’ opportunité d'un salon au nord ou au midi, qu'on y cherchait avec
une inaltérable patience le bien -être des marmots chéris qu'il fallait tenir
un peu éloignés et qu'on emmenait de temps en temps pour ne pas trop fatiguer
les oreilles maternelles. On parlait aussi pendant les repas des recettes
culinaires les plus agréables au palais. Au moins la médisance était éloignée
de ces conversations. Le soir enfin, on s'endormait en remerciant la Bonne
Providence de tant de joies goutées dans une paix si profonde. On ne se
plaignait cependant pas de la monotone des jours. L'influence très bien faisant
de Mme Prouvost se faisait sentir très douce à tous, grands et petits. Avec
l’âge, elle était devenue encore plus indulgente, plus peleuse si possible,
toujours souriante de ce bon sourire qui désarmait les moins bien intentionnés. On la sentait recueille dans
une profonde ferveur, et qui aurait ose exprimer une plainte, manifester un
mécontentement? Elle se faisait toute a tous et ne se réservait que de longues
stations à l’église si proche du château que la grille du parc séparait
seulement. L'église était, grâce à ses soins, toujours bien tenue et ornée de fleurs. »

Les Albert I Prouvost


C’est en janvier 1879, agé de 24 ans, qu’Albert Prouvost franchit
pour la première fois le Vert-Bois où il se maria avec Marthe Devemy 1860-1937,
le lundi 26 mai 1879 : arrivèrent landaus, coupés, victorias, cabriolets et
surtout breaks ; « vous voyez d’ici les solennelles redingotes des messieurs,
leurs moustaches frisées et souvent leur barbes imposantes, les toilettes
compliquées des dames, les chapeaux hauts
et volumineux arborés par les deux
sexes. Toutes les recherches vestimentaires se ressentaient encore en 1879 de l’
influence des modes du Second Empire, bien loin de celles d’aujourd’hui.

Photo Pierre
Lestienne-Prouvost
" menaient une existence mouvementée de jeune
ménage: nombreux voyages à Paris, mondanités très astreignantes : tous les
soirs un diner, à l'exception du vendredi, jour d'abstinence et du
dimanche consacré traditionnellement à la famille. Un dimanche sur deux était
réservé au Vert-Bois, l'autre au déjeuner et au diner de la famille Prouvost
chez la bonne-maman, rue Pellart.Vous pouvez vous
en rendre compte en feuilletant l'album de famille, ma mère était une jeune
femme d'une resplendissante beauté, mon père avait très grande allure; tous
deux attiraient l'admiration et l'amitié par leur bienveillance et leurs gouts
raffinés. Les réceptions, 50 Boulevard de Paris étaient brillantes, la table
réputée. Mes parents
consacraient dans leurs voyages à Paris une large place au théâtre et
spécialement à la Comédie Française. L'un et l'autre très lettrés, ils étaient
spécialement assidus aux représentations des classiques. Connaissant à fond le
répertoire, ils n'allaient pas au Français entendre le Cid Phèdre ou
Bérénice, mais applaudir les acteurs qui en étaient les grands interprètes. A
cette époque Rachel avait termine sa triomphale carrière, mais Sarah Bernhardt,
Bartet, Mounet-Sully, les Coquelin étaient au zénith de leur gloire éphémère.
Le théâtre du boulevard avait aussi de très belles troupes : les noms les plus
appréciés étaient ceux de Réjane et Jeanne Granier, Brasseur, Baron, Guy,
Lavallière aux Variétés.
Le 50, Boulevard
de Paris comportait au dernier étage un immense grenier inutilisé. Dans leur
passion du Théâtre, mes parents eurent l'idée d'y construire une petite scène
et d'y jouer la comédie entre amateurs. Naquit donc vers 1892 ce qu'on nomma
par la suite « le Théâtre Albert ».
Pour
l'inauguration du grenier-théâtre, des acteurs de Paris furent engagés,
notamment Prince qui devait acquérir une grande notoriété de fantaisiste, les
sœurs Mante, danseuses étoiles de l'Opéra. Les décors étaient charmants, la
soirée fut sensationnelle.
A partir de
cette date, chaque année mes parents s'ingéniaient à découvrir une bonne pièce
nouvelle en un acte et s'attaquaient en trois actes aux pièces à succès du
moment, le théâtre de Scribe, Augier ou Labiche. Les amateurs de notre région y
furent étonnants de brio. Parmi eux, outre mes parents qui jouaient chaque
année, les plus fêtés furent la belle Madame Félix Ternynck et son mari, Albert
Masurel, René Wibaux. Mes parents prirent tellement au sérieux leur rôle
d'acteurs improvises qu'ils demandèrent des conseils a deux célèbres
Sociétaires de la Comédie Française, Le Bargy et Georges Berr, afin de
perfectionner leur technique forcement sommaire.
Plus tard, entre
1900 et 1910, de nouveaux jeunes premiers accédèrent aux planches du théâtre
Albert.
Trois de mes
cousins germains y furent particulièrement appréciés : Amédée Prouvost, Léon
Wibaux et Charles Droulers. Ils y jouèrent la comédie, puis en association
écrivirent chaque année une petite revue, dans laquelle ils montraient autant
de verve que d'esprit: Ces revues étaient le clou de la soirée « théâtre
Albert» du 1" janvier. L'un après l'autre tous les cousins et toutes les
cousines de tous âges (y compris mon frère, mes sœurs, ma femme et moi-même)
ont tenu un rôle dans ces revues ou joue la comédie. Aucun de nous n'a perdu le
souvenir des joyeuses répétitions et des émotions - quelquefois du trac - de la
générale et de la grande première. Ces soirées de l’An nouveau réunissaient
dans la joie parents et enfants.






Les Grandes Familles
"Les Grandes Familles" est une suite romanesque
de Maurice Druon publiée en 1948 aux éditions Julliard et ayant obtenu le Prix
Goncourt la même année ;
en découla un film français, en noir et blanc, de
Denys de La Patellière sorti en 1958 qui évoquait l’histoire des Béghin et de
sa sucrerie ainsi que le groupe Prouvost
Pour le personnage de Noël Shoulder, Maurice
Druon s'est inspiré de Jean Prouvost, industriel dans le textile, également
patron de presse (Paris-Soir et Match, l'ancêtre de Paris-Match) ;
La
Patellière confia le rôle à Jean Gabin ; il règne en maître sur la
"Grande Famille" fortunée, composée de gens illustres, représentants
des différentes instances: un médecin, un militaire, un ecclésiastique...
. http://labruttin.blogspot.fr/2013/08/les-grandes-familles-1958-de-denys-de.html



Albert-Eugène
Prouvost (II): 1882-1962
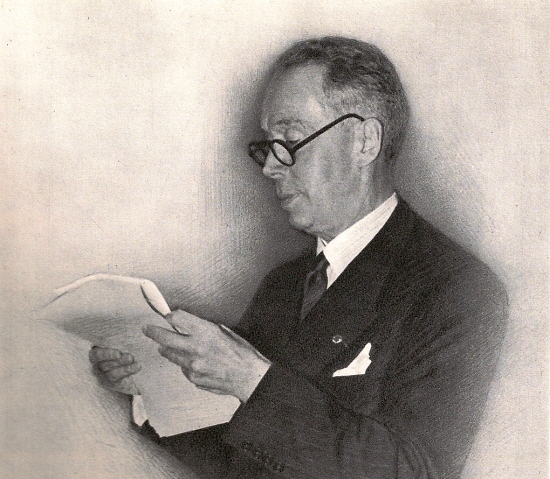
Comme celle de tous
les jeunes ménages de tous les temps, -notre existence de 1906 à 1914 fut intensément
active : diners, soirées dansantes, voyages fréquents à Paris, puis en aout
longues vacances. Rita animait par son entrain toutes ces réceptions et une
semaine sur deux, nous passions un large weekend dans la capitale. L'élégance
de la tenue était à cette époque le souci majeur des Messieurs comme des Dames.
Pour vous donner une précision, il était de règle, a partir de onze heures du
matin, de porter sur les Boulevards le chapeau haut de forme et des gants, au
moins tenus a la main. Les snobs y ajoutaient un monocle et une canne. Les
grands rendez-vous de la société « chic» étaient en fin de matinée l'Avenue
du Bois et surtout la partie de l'Avenue de Longchamp dénommée «
Avenue des Acacias » ou par antiphrase « les sentiers de la vertu ». Que de cavaliers
et d’amazones! Le soir dans les restaurants ou les salles de spectacle, l'habit
et le chapeau claque étaient de rigueur; dans les petits théâtres le smoking
était toléré. Les dames étaient en robes largement décolletées: leurs chapeaux
de dimensions extravagantes étaient couverts des plumes des oiseaux les plus
rares, notamment des aigrettes. L'hiver c'était un déploiement de fourrures,
d'étoles de zibeline, d'hermine ou de chinchilla.

Comme mes
parents j'aimais le théâtre: Rita aussi: nous allions souvent voir les auteurs
contemporains et redécouvrir les classiques. A chaque week-end parisien nous
assistions a trois ou quatre représentations.
Entre 1906 et 1914,
nous n'avons jamais manqué la pièce annuelle d'Henry Bataille, Maurice Donnay,
Porto-Riche, Henry Bernstein, Alfred Capus, Flers et Caillavet, Sacha Guitry,
les grands chefs de file, qui ont connu des succès considérables et dont aucune
production ne laissait un spectateur indifférent. Le public était alors plus
restreint, mais plus cultive que celui de nos jours. Ses réactions étaient
vives, passant d'un enthousiasme sans retenue a une sévérité extrême devant un
texte ou une interprétation de valeur discutable. Dans les premières
représentations, d'une pièce à succès, les entractes - actuellement moroses -
étaient brillants : on y retrouvait de nombreux amis et des personnalités
marquantes de la politique, du turf, du monde ... ou du demi-monde.
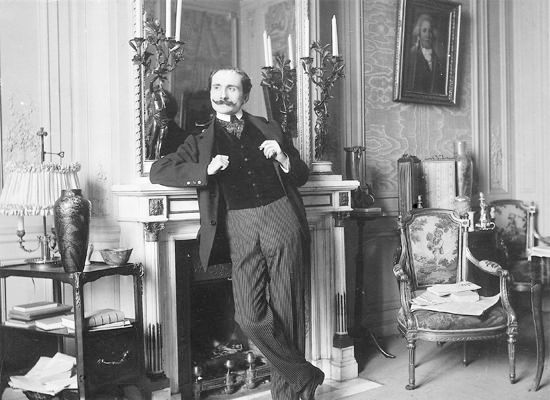
Un auteur
dramatique affaibli par la maladie, qui ne produisait presque plus, était
auréolé d'une gloire sans seconde : Edmond Rostand. Le triomphe en 1897
de « Cyrano de Bergerac " demeure l'un des grands souvenirs de
ma jeunesse. Un acteur de génie, Coquelin, créa le rôle. A la veille de la
première, l’auteur et ses interprètes se demandaient comment le public
accueillerait ces cinq actes en vers évoquant le XVIIe siècle. Ce fut du
délire. Notre pays portait encore moralement le poids de l'humiliation de 1870:
ce coup de cymbales, le panache du héros et aussi le cote sentimental cher au
Français, provoquèrent un choc de fierté nationale. Dans la même veine, en
1900, Edmond Rostand nous donna « l'Aiglon », avec la grande Sarah-Bernhardt,
dans le rôle du Duc de Reichstadt.
En 1910 fut créé
« Chantecler ». Edmond Rostand avait confie à Coquelin le
rôle du coq. Celui-ci mourut subitement et « Chantecler » fut joué par Lucien
Guitry. La pièce, riche en vers magnifiques, fut discutée sur le plan scénique.
Ce demi -échec fut très sensible à l'auteur. On organisa alors, en son honneur,
sous le couvert d'une fête de charité, une matinée au théâtre Sarah Bernhardt
ou des extraits de son œuvre théâtrale devaient être interprétés par les meilleurs
artistes de Paris. Rita et moi, étions au grand rendez-vous de ses admirateurs.
En apothéose finale, on obtint qu'Edmond Rostand monte sur le plateau et dise
plusieurs poèmes dont l'hymne au soleil de « Chantecler ». Avant qu'il put
commencer, la salle debout l'acclama pendant plus de dix minutes. Cet hommage
d'une sincérité bouleversante est demeure l'une de nos grandes émotions de
théâtre. »
« Souvenirs
de famille » Par Albert-Eugène Prouvost, 1960
En 1902, Albert
Prouvost-Devémy se rendit acquéreur d’une automobile Mors qu’il conduisait
lui-même pendant que certains de ses pairs se faisaient conduire par un
chauffeur.
Chaque été,
vacances dans les villes d’eau : Evian, Royat, Luchon et surtout
Vichy. ; à Evian, ils connurent intimement la Comtesse Greffulhe

( La Comtesse Greffulhe est la petite fille d'Emilie Pellapra, veuve de Louis de Brigode, chevalier de Brigode
et de l'Empire,
comte de Brigode
et de l'Empire
(1er), né le 21 octobre 1776,
Lille, décédé le 22 septembre 1827,
Bourbonne-les-Bains (à l'âge de 50 ans), conseiller général du nord, maire de
Lille (1802), chambellan de l'Empereur, pair de France (17/8/1815),apparenté aux Prouvost par les Lenglart. et les Virnot. Riche et belle, Emilie Pellapra se remaria le 30 août 1830
avec le prince Joseph de Riquet de Caraman
(1808-1886), 17e prince de Chimay, dont elle eut quatre
enfants dont Joseph, père de la Comtesse Greffulhe.)



et les Brancovan
dont la jeune princesse alait plus tard s’immortaliser sous le nom d’Anna de
Noailles.

Là, promenades à
cheval ou à bicyclette le matin,courses de chevaux ou concours hippiques
l’après-midi ; un abonnement au théâtre et aux grands concerts nous permettaient d’occuper
les soirées avec tout l’éclat souhaité. Après la saison d’eau, avant le retour
à Bondues, nous faisions le voyage de l’année ( en France et en Europe) :
Au Vert-Bois,
deux grandes parties de chasse en septembre,
deux en battues –plaies et bois- faisans et lièvres et lapins en novembre.
Principaux
invités : nos voisins d’Hespel, de la Serre, de Pas, des Rotours,
Boselli-Scrive, Henry Bossut, Jules Masurel, Gustave et Georges Watine, René
Wibaux.
La saison de
chasse terminée, « mes deux grands parents se concentraient à nouveau sur
leur bibliothèque, revenaient à leurs chers livres. »
Vers 1890, fut
engagé au Vert-Bois un jeune valet de chambre, agé de 16 ans,Clovis Hennebel.
Il devait y demeurer presque jusqu’à sa mort pendant sixante années, montrant
en toute occasion, à mes grands parents puis à mes parents et à moi-même un
indicible dévouement. Ce fut mon premier grand ami.
Tous les ans, nous donnions deux conférences
, un jour à Lille, un jour à Roubaix,par l’Université des Annales de 1922 à
1933, créé par Madame Adolphe Brisson, fille de Francisque Sarcey : nous
fimes venir avec un très grand succès Paul Géraldy, Roland dorgelès, André
Maurois, Marcel Achard, Paul Morand, Georges Duhamel, Léon Gillet, Gérard Bauer
etc. Nous fumes invités chez elle, un soir il y avait Louis Barthou, Reynaldo
Hahn, Robert de Flers, Françis de Croisset, Maurice Donnay.
Nous formâmes une société de chasse et
trouvâmes un territoire de grande classe à Pétrieux, près de Tournai: 600
hectares de plaines et au centre un bois de 120 hectares et un château. Six
associés : Edmond Lefebvre, Paul Cavrois, Jean Segard, Eugène Rasson,
Jules Desurmont, Albert-Eugène Prouvost.De 1923 à 1937, Jules et Marcelle y
présidaient merveilleusement. Nos plus fidèles invités furent Jules Masurel et
Françoise, Robert Motte et Marie, Eugène Watine et Madeleine ; Paul
Géraldy vint, expérience peu concluente pour lui ; en juin, les jeunes
venaient avec un orchestre de jazz pour des dîners par petites tables : ce
furent là que Marguerite Prouvost rencontra Jacques Segard pour la première
fois.
Ayant découvert le soleil de la Côte d’Azur
après des été bretons pluvieux, nous louâmes de 1929 à 1939 la « Vierge
Noire », près de sainte maxime. : nus y reçumes beaucoup dont
Germaine et Jacques Prouvost, les René Toussin et leurs filles, les Paul Cavrois,
les Eugène et Philippe Motte, les Jacques Boyer-Chammard, Manette Masurel,
Odile Motte, Loteley Gouin.
En 1929, nous arrivâmes à Sainte maxime avec
un « despujol » : « la Pinta », 15 m de longueur qui
nous obtint en 1930 le Grand Prix de l’élégance à Cannes. Paul Géraldy fut un
des premiers à adopter les vacances dans le midi. : il fit construire à
Beauvallon, la Colline » : nous voisinions entre Sainte Maxime et
Beauvallon ; un jour lui ayant proposé du planking (ancêtre du ski
nautique, il débutat très bien puis tomba et ne lacha pas la corde ce qui le
rendit quasi noyé, mais il s’en sortit fort bien.
Passé la crise, entre 1929 et 1933, je louais
à Lady Granart un appartement 22, rue Barbet de Jouy ; entre 1933 et 1939,
j’achetais en vente à Drouot et à la galerie Charpentier, au tiers du prix
d’avant 1929, des tooiles d’impressionnistes : Renoir, Pissaro, Sisley,
Boudin, Redon, Bonnard, Vuillard.
Depuis
1930, le succès de Jean Prouvost fut considérable ; Albert y eut une participation,
Jacques et Marguerite Segard l’ont augmentée.
Trois fois par an (fêtes de l’An, pâques,
Juillet-août) les familles se retrouvaient à Pibonson que Rita décorait
touojurs plus et Au Cap Bénat qu’Albert et Anne venaient d’acquérir en
1953. ; nous avions d’excellents voiliers : l’Iska pour les Jacques
Segard, la Pinta pour les Albert-Auguste.
« Nous avons en commun et par
atavisme le désir d’ajouter chaque année au patrimoine artistique de nos
intérieurs quelques meubles de qualité, de beaux tableaux, de jolis bibelots.
N’est ce pas, sur le plan sentimental, une des joies de la vie que de pouvoir
retrouver chaque jour, dans un ensemble d’objets attachants, des souvenirs
témoins à travers les générations, d’un beau passé ? »
En avril 1949, voyage au Maroc centre et sud,
à quatre automobiles : les Eugène Motte, Alfred Breuvart, rené Toussin,
Albert Prouvost.
Mariage
le 6 juillet 1949 de Martine Segard
avec Paul Lehideux-vernimmen aus solides qualités
d’intelligence et de
cœur : fut reçu à son doctorat de Droit avec
la mention très bien. En
septembre 1944, s’engage dans l’armée
Leclercq ; en novembre, il est
blessé et cité à l’ordre du Corps
d’armée signée par le Général
Leclerc. Les
Lehideux-Vernimmen sont une famille de banquiers parisiens. Le couple
s’installera au 51, boulevard Beauséjour.
Une
tumeur fut découverte chez Rita : une longue suite d’interventions en
France et aux Etats-Unis, de chûtes et de rémissions : elle démontra une grande
foi et un magnifique amour pour son mari et ses proches. Elle repose au
cimetière de Bondues.
Albert-A ne nous a donné que des joies :
il a mené de front les réalisations sociales et industrielles (CIL,
cités-jardins) et, en association intime avec Françis Lefebvre, a abouti à nous
placer comme réputation au premier rang des peignages en France, aux etats-Unis
et en Afrique du Sud.
Jacques Segard peut être fier : en
trente ans, il a fait de Segard et Cie une des plus importantes maisons de
négoce de laines, possédant en outre des participations industrielles
considérables. Nous avions en commun et en toute amitié ce peignage du Cap de
Bonne Espérance qu’il a repris
directement en main.
« Sans phrases, je termine en vous
assurant, ma chère Marguerite, mon cher Albert, que jusqu’à mes derniers
moments, je vous unirai, vous et ceux qui sont nés de vous, dans mes pensées et
dans mon cœur. Vous avez été le bonheur de notre vie. »
« Tout démontre que la
génération de nos enfants conservera entières les traditions que nous leur
léguns comme le bien le plus précieux. »
« Souvenirs
de famille » Par Albert-Eugène Prouvost, 1960
La Lainière, « c'était une ville dans la
ville, une cathédrale textile ; lors de la fusion entre La Lainière et
Masurel, il y avait plus de 9 000 personnes dans l'entreprise. Il y avait de
tout dans l'usine, une véritable vie sociale...
On se souvient du couloir de la brasserie, avec une coopérative. On allait
prendre les commandes dans les ateliers. » On était dans l'exacte illustration
du patronat paternaliste, avec la coopérative, les logements, le stade « un des
plus beaux de France » et surtout cette Maison de l'enfance, devenue
aujourd'hui centre social dans ce quartier qui porte encore la marque de l'ère
Prouvost. »
Jean Prouvost : 25
ans de festivals à Yvoy Le Marron

« Roubaisien
par ses racines, Parisien par goût, Jean Prouvost s'installera pour ses loisirs
dans une petite commune de Sologne de 500 habitants, Yvoy Le Marron. Il en sera
maire de 1951 à 1977 et prendra très à coeur ses responsabilités.
Le village
d'Yvoy le Marron a encore le souvenir de Jean Prouvost venant là tous les
week-ends; il fait son tour dans le village, avec son teckel, sur le bras ou
sur les genoux (la mascotte d'Intexa !). Il participe au banquet des Anciens …
Un maire attentif pendant 25 ans.
Sa propriété,
Saint Jean, dâte de la guerre 14 ou des soldats canadiens installés dans la
région pour couper des sapins, ont construit une maison “Saint Jean” qui
ressemble à un chalet de leur pays.
Il y a deux
festivals par an. En juin, le festival lui même et en septembre, la fête des
fleurs avec son feu d'artifice, le tout est public. Pour cet événement, Jean
Prouvost fait toujours venir les équipes de Paris Match (son magazine) et
attire les meilleurs artistes. Le chapiteau contient 4 à 5.000 places.
Les reportages
montrent en juillet 1966, Jean Prouvost, dans une prairie, face à Guy Lux qui
anime le jeu des vachettes.
En septembre
1968 les vedettes sont Marie Laforêt, Richard Antony. L'après midi, on regarde
le tournoi de catch. Jean Prouvost est au premier rang. Il suit les Jeux de
Midi aussi, c'est un reportage Evelyne Pagès. Autour d'eux les gens du village
regardent avec tendresse et un peu fascinés, le “Patron”, heureux et élégant
comme d'habitude, abrité sous un parasol.
Les meilleurs
artistes ou sportifs interviennent : les Harlem Globe Trotters en juin 1971,
Thierry Le Luron, qui imite Jean Nohain, Adamo, Darry Cowl, Claude François,
Johnny Halliday, comme le premier ministre Chaban Delmas. La chanteuse Séverine
figure au programme (un grand prix de l'Eurovision un peu oublié), SIM est là
aussi pour la fête des fleurs.
On ne se lasse
pas de parcourir les éphémerides du Festival et ses autres têtes d'affiches :
en juin 73, à St Jean, une photo de groupe rassemble Gérard Lenormand, Mireille
Mathieu, Thierry Le Luron, Mike Brant. Le spectacle est réalisé par Gilbert
Carpentier. Cette année-là : le bal du Moulin Rouge, les jeux de la case trésor
RTL, le Rugby à XV et le Rugby à VII avec Walter et Claude Spanghero !
En 1973 aussi,
les Frères Ennemis, Dalida, Julien Clerc, … en 1974, un baptême de l'air en
Hélicoptère et des vedettes toujours : Yves Lecocq, Michel Sardou, Stone et
Charden, Carlos, Fabrice ...
En juin, 1975
les Blue Bell Girls du Lido. En juin 1976, Patrick Sébastien, Dave, Gilbert
Bécaud, Les “Parisiennes”.
En 1977, c'est
la fin des festivals, Jean Prouvost décède en novembre 78 » Stéphane
Mathon, du 06/11/2009.
Le Domaine
St-Jacques du Couloubrier :

Jardin
remarquable créé en 1950, par le paysagiste de renommé international, Russell
PAGE, à l’initiative de Jean Prouvost. Longtemps laissé à l’abandon, il renaît
en 2005 par la volonté de ses nouveaux propriétaires qui s’attachent à une
restitution fidèle. Sur cette base restituée, le jardin ne cesse d’évoluer par
l’intermédiaire du chef jardinier actuel, par de nouvelles créations et
l’enrichissement végétal constant. Ainsi les cultures des plantes à parfum sont
présentes : Rose centifolia, jasmin de Grasse, verveine, citronelle, tubéreuses
etc…On trouve également une culture d’agrumes : koumbawa, cédra, orangers
amers, poncirus et autres agrumes ainsi que plus d’une trentaine de chênes
supportant le calcaire, bientôt un conservatoire des rosiers Nabonnand déjà
bien avancé. On découvre aussi d’autres particularités : des variétés de
Glycines, de bulbes, et de tant d’autres espèces végétales, sur une base d’Oliveraie
de 250 sujets,le tout sur un domaine de 8 hectares dont la configuration
géographique et le relief varié rend possible cette diversité botanique.
Albert-Auguste
et Anne Prouvost :
La Méditerranée
est aussi le point de départ pour de nombreuses croisières familiales pour les
Prouvost. Les époux adorent la mer. Ils achètent un huit-mètres, le Cantabria,
construit initialement pour Sa Majesté le roi d'Espagne Alphonse XIII. Puis
plusieurs douze-mètres qu'ils baptiseront chaque fois, La Pinta, en souvenir
d'un lainier de La Corogne, lointain ancêtre d'Albert-Auguste, qui finança la
caravelle de Christophe Colomb. «Nous avons eu des passagers illustres, évoque
Anne Prouvost. Le grand-duc Jean de Luxembourg venait accompagne de sa' fille
Marie-Astrid, petite princesse était un marin extraordinaire. Le roi
Carl-Gustav de Suède est un vrai Viking à la barre: il se révélait a bord un
très joyeux compagnon. »
Simplicité
sportive bien loin des mondanités. Mais les Prouvost sont aussi con vies aux
grands bals d'après-guerre. Elégance raffinée chez Violette de Pourtalès au
Palais rose où toutes les femmes sont parées de plumes extravagantes.


Fastes éclatants
a l'hôtel Lambert, sous la houlette d'Arturo Lopez, très lie alors avec la
princesse Ghislaine de Polignac, amie d'Anne .
Je me souviens
surtout du bal donne par Guy de Rothschild en 1959, dit-elle. Une
extraordinaire fête princière.
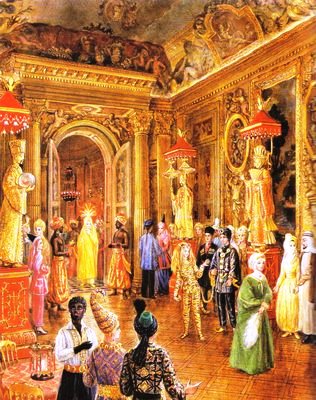
Le couple offre
des réceptions plus intimes dans son appartement parisien de la rue Barbet-de-Jouy,
dans le VIIe arrondissement. Les fenêtres s'ouvrent sur le jardin du musée Rodin : «Nous
nous efforcions de créer des tables animées en mélangeant le plus possible nos·
invites, raconte Mme Prouvost. J e m'y amusais plus qu'aux grandes réceptions
et il était loin de m.'être désagréable que les hommes me fassent un brin de
cour.»
La vie. est loin
toutefois de se passer uniquement dans un tourbillon de fêtes et de diners.
Famille d'abord : au foyer Prouvost, Nathalie, Ghislain, Olivier et Laetitia
sont nés a la suite d'Albert Bruno. Et la bonne marche de l'entreprise accapare
le plus clair du temps d'Albert-Auguste Prouvost; «l'homme pressé», comme
l'appellent ses collaborateurs. «Dans le Nord, au moment des vœux, chacun a
coutume de se souhaiter de la santé, de l’ouvrage", sourit Anne Prouvost:
croyez-moi, mon mari avait en effet bien besoin de sa robuste sante de sportif
pour mener a bien les taches qui lui incombaient.


Le versant
plaisant de cette vie trépidante d'homme d'affaires reste malgré tout les
voyages. Contacts commerciaux, contrats, implantations d'usines, le patron de
la société Prouvost sillonne sans cesse les cinq continents. Son épouse
l'accompagne toujours. «Nous avons été de vrais voyageurs, explique Mme
Prouvost. Pas seulement par le nombre extravagant de nos périples à l'époque ou
se déplacer était encore une aventure, mais aussi par l'insatiable curiosité
qui nous animait.». Albert-Auguste Prouvost entend aussi mener sa carrière
d'industriel sans égoïsme : il n'a de cesse que d'amé1iorer le niveau de vie
des plus défavorisés. Le logement est son cheval de bataille.«J'étais un petit
garçon révolté par les "courées", écrit-il dans ses Mémoires. Je suis
devenu un patron héritier d'une tradition sociale mais convaincu aussi de la
nécessité d'innover.» En effet, le logement du personnel a toujours été un
souci des industriels du textile du Nord de la France. Une préoccupation
répondant aux nécessites économiques des entreprises mais aussi à l'esprit
caritatif qui anime cette bourgeoisie catholique. Mais Albert-Auguste Prouvost.
veut aller plus loin. Il lance le fameux
1 % patronal, cotisation versée par l'entreprise et destinée a !a construction.
Il participe aussi a la mise en place de l'allocation logement. Avec
l'installation d'un véritable partenariat social, il crée le Comite
interprofessionnel du logement qui, des 1958, aura relogé plus de huit mille
familles dans de réelles conditions de confort. En 1950, d'ailleurs, il offre a
cet organisme le château de sa grand-mère, a la limite de Roubaix et de
Tourcoing. Dans le parc de sept hectares, a la place de la grande demeure jetée
bas, s'élèvera une cite de cent cinquante-quatre logements.
Mais
l'industriel a aussi le culte de sa
demeure de famille. Dans le château du Vert Bois, cet homme
d'action retrouve
ses racines. Sur la commune de Bondues,
toute proche de Roubaix se tient en effet une des dernières
belles maisons de la région. André-Joseph Druon de
Wazières fit construire en 1743 une folie dans le gout de
l'époque sur
l'emplacement d'un édifice du XVIII° siècle
bâti par un négociant en sayettes
de laine lillois. L'arrière-grand- mère d'
Albert-Auguste, Marguerite Devémy,
ne quittera pas un instant cette propriété qu'elle habite
dès 1869, elle la
défendra contre les Prussiens pendant la guerre de 1870.
Contrainte et forcée,
elle y recevra» le kronprinz pendant lai Première Guerre
mondiale. Le Vert Bois
est resté le berceau des Prouvost. Tous les enfants à
l'exception d
'Albert-Bruno, y sont nés: Ce dernier, après avoir
longtemps secondé son père,
était logiquement appelé a lui succéder à
la tête du groupe. Le destin en a
décidé autrement. Ses cadets ont pris des voies
différentes. Nathalie, la fille
ainée, après avoir fréquente l'atelier du
célèbre' peintre Mac Avoy, exerce ses
talents comme restauratrice de fresques. Ghislain a fait
ses armes dans le textile en Espagne et en Australie, mener sa
carrière
d’industriel sans égoïsme.
Olivier a repris
l'entreprise de construction navale Wauquiez. II allie ainsi la
tradition
industrielle au gout de la voie héritée de ses parents.
Quant a Laetitia, fidèle au Vert Bois, elle gère
les
soixante hectares de 1'exploitation agricole qui entoure le domaine.
Albert-Auguste
retire des affaires, il ne reste sans doute plus aux Prouvost qu'a
cultiver l'art
d'être grands-parents. Mais le couple ne peut se résoudre
a une douce activité.
Ils vont se consacrer pleinement à leur amour pour la peinture.
Egalement ,une histoire
de famille. Des 1920, Albert-Eugene Prouvost achète en effet des
Renoir, des
Bonnard; des Pissaro; II transmet a son fils la passion de la
collection. Anne
partagera avec son époux les riches émotions de la
découverte' artistique. IIs achètent leur
première toile à la galerie
Maeght de Cannes pendant leur voyage de noces. Un Geer Van Velde qui
inaugure une profonde amitié avec le
couple de galeristes. Grâce à eux, ils rencontreront
la plupart des grands artistes du XX° siècle. En
1969, dans les locaux de l'ancienne ferme du Vert Bois, les
époux Prouvost
créent la Fondation d'art Septentrion. Chaque année, les
expositions se
succèdent dans cet espace aux lignes sobres largement ouvert sur
la campagne
environnante: Chagall, Bonnard, Dufy; Rouault ,Picasso, Laurens,
Braque, pour
parler des plus prestigieuses. Albert-Auguste Prouvost se
dépensera sans
compter pour cette fondation si chère à son cœur:
J’ai gardé intact notre enthousiasme; dit avec
chaleur
Mme Prouvost. Avec Septentrion, j'ai le sentiment profond de faire
vraiment
œuvre utile.
_____________________________________________________________
Les liens avec le Rond-Point des Champs Elysées à Paris


Ce
rond-point sur la plus prestigieuse
des avenues parisiennes a été tracé dès
1670, mais il n’a été aménagé que
vers
1815. Un jet d’eau y est placé en 1817, appelé
« La gerbe ». Une statue
équestre de Louis XV est envisagée en 1828, mais les
événements de 1830 font
capoter l’entreprise. A la place est édifiée une
grande fontaine, en plein
milieu du carrefour. Incompatible avec l’augmentation du trafic
hippomobile,
elle est détruite en 1854. Six bassins et leurs fontaines sont
placés sur les
côtés de la place, dont le centre est offert à la
circulation. En 1935, les
fontaines sont remplacées par des œuvres d’art du
maître verrier et bijoutier
René Lalique. Elles disparaissent en 1958, remplacées par
des modèles réalisés
par le maître verrier Max Ingrand.
« L'élégance de la tenue était à cette époque le souci
majeur des Messieurs comme des Dames. Pour vous donner une précision, il était
de règle, a partir de onze heures du matin, de porter sur les Boulevards le
chapeau haut de forme et des gants, au moins tenus a la main. Les snobs y
ajoutaient un monocle et une canne. Les grands rendez-vous de la société «
chic» étaient en fin de matinée l'Avenue du Bois et surtout la partie de
l'Avenue de Longchamp dénommée « Avenue des Acacias » ou par antiphrase « les
sentiers de la vertu ». Que de cavaliers et d’amazones! Le soir dans les
restaurants ou les salles de spectacle, l'habit et le chapeau claque étaient de
rigueur; dans les petits théâtres le smoking était toléré. Les dames étaient en
robes largement décolletées: leurs chapeaux de dimensions extravagantes étaient
couverts des plumes des oiseaux les plus rares, notamment des aigrettes.
L'hiver c'était un déploiement de fourrures, d'étoles de zibeline, d'hermine ou
de chinchilla. Comme celle de tous les jeunes ménages de tous les temps,
-notre existence de 1906 à 1914 fut intensément active : diners, soirées
dansantes, voyages fréquents à Paris, puis en aout longues vacances. Rita
animait par son entrain toutes ces réceptions et une semaine sur deux, nous
passions un large weekend dans la capitale.» Albert-Eugène Prouvost: 1882-1962
N° 3 : Hôtel d'Hautpoul :


Photo Ferdinand Cortyl
Robert
et Thérèse Prouvost vécurent de 1920
à 1936 dans cet immeuble du 3, Rond-Point des Champs
Elysées, aussi situé au
60, avenue Montaigne à Paris, au 3° étage, cet
hôtel ayant
appartenu aux La Bédoyère-Bucaille.En
1936, ils ne donnèrent pas suite à la location car
extrèmement cher et s’installent
dans le 16°, 56, boulevard Flandrin en 1935 jusqu’à sa
mort.
Nathalie Droulers- La Caze, née à Paris 8ème, arrière petite fille de Joséphine
Prouvost 1845-1919, mariée en1982, Milan (Italie), avec Serge Huchet de La
Bédoyère, né le 10 mai 1950, Paris VIIIème, décédé
en avril 2004, inhumé le 7 avril 2004, Paris (53 ans),
agent de change. Famille originaire de Bretagne. D'ancienne extraction en 1427,
elle fut maintenue noble le 7 octobre 1668. Honneurs de la Cour en 1784. Comte
de l'Empire en 1815. C'est le Général Huchet de La Bédoyère qui ouvrit les
portes de Grenoble à Napoléon 1er au moment des Cent-Jours.

No 7 : Hôtel d'Espeyran :

Hôtel particulier construit en 1888 en style néo-Louis
XV par l'architecte Henri Parent pour Félicie Durand (1819-1899), veuve de
Frédéric Sabatier d'Espeyran (1813-1864), d'une riche famille de négociants et
propriétaires originaires de Montpellier, qui s'installe à Paris avec leur fils
Guillaume (1850-1938) après le décès de son mari. Abrite aujourd'hui le siège
de la maison de ventes aux enchères Artcurial.

Imaginé
par Liliane Bettencourt et François Dalle en 1975, Artcurial a eu
pour vocation de faire connaître l'art contemporain en le "démocratisant
". François Dalle (né le 18
mars 1918 à Hesdin - décédé le 9 août 2005 à Genève en Suisse) transforma une
PME fondée par Eugène Schueller en numéro un mondial des produits cosmétiques :
L'Oréal. La personnalité hors du commun de François Dalle a fait de lui l'un
des plus grand capitaine d'industrie du XXe siècle et un visionnaire hors pair.
Il est le cousin germain de Madame Charles Prouvost-Dalle.


Hervé Poulain est
commissaire-priseur depuis 1969, associé de la maison de
commissaire-priseur Artcurial au Rond-Point de Paris.. Il a épousé
Isabelle Prouvost, petite fille de Jean Prouvost.
Figure familière du monde de l’art, Il
orchestre avec brio et esprit des ventes de toutes spécialités depuis plus de
trente ans. C’est
en mêlant ses deux passions, l’art
contemporain et la vitesse, qu’il a inventé le concept de
« Art Cars » : Lors
de ses onze participations aux 24h du Mans il a confié la
décoration de ses
voitures à des artistes de renom comme Calder, Lichstenstein,
Stella, Arman,
Warhol ou César. Il fait autorité, entre autres, sur le
marché des Automobiles
de collection et du Design. Hervé Poulain est le
Président fondateur du SYMEV
(Syndicat National des Maisons de ventes aux enchères) et du
CNMA (Conseil
National du Marché de l’Art). Hervé Poulain est
aussi l’auteur de cinq ouvrages
dédiés à l’art : L’art et
l’automobile (1973), Un siècle de peinture
française
(1976), Une collection d’avance (1986), L’art, la femme et
l’automobile (1989),
Mes Pop Cars (2006).
Quelques
immeubles plus loin, sur ce coté
de l’avenue Montaigne, on se souvient d’avoir
été chez François Prouvost, fils de Georges et
Marthe Prouvost-Virnot, branche ainée.
No 12-14 : Hôtel Bamberger :

À l'origine, l'hôtel particulier situé à cette adresse fut édifié pour le
financier belge Henri Bamberger (1826-1910), directeur de la Banque de crédit
et de dépôts des Pays-Bas et l'un des fondateurs de la Banque de Paris et des
Pays-Bas, qui « avait installé dans ce palais tous les signes de sa fortune et
l'infortune de sa singulière laideur [...] Entre autres disgrâces, une
difformité, qui l'avait fixé pour toujours dans l'attitude du chasseur prêt à
tirer, lui avait fait donner, dans la société où il avait tenu à s'imposer, le
sobriquet de Couche-en-joue. [...] Il paraît qu'il avait jeté son dévolu sur
une demoiselle Minnie David. Mais celle-ci préféra devenir Mme Paul Bourget.
[...] Finalement, Couche-en-joue fut agréé par Mlle de Moracin, fille du baron
de Moracin, et cette alliance avec une catholique n'alla pas sans soulever
maints commentaires [...] »16 M. Bamberger voulut faire don de son hôtel au
Jockey Club de Paris lorsque celui-ci chercha un nouveau siège en posant pour
seule condition d'y être admis, mais le cercle déclina hautement la proposition
et s'installa rue Scribe. L'hôtel abrita ensuite le quotidien Le Figaro à l’époque
de Jean Prouvost ; il n’y allait pas beaucoup. Siège de la maison de
couture Jean Dessès après 1958.


Jean Prouvost ; Jean d'Ormesson dans son bureau au Figaro, à l'époque
du Rond-Point des Champs-Élysées. Crédits photo : Rue des Archives/Credit: Rue
des Archives/AGIP.
Jean d'Ormesson a épousé la fille de Ferdinand Béghin. « Ma plus
grande impression parisienne. le jour où suis entré au Figaro. On m'a montré
mon bureau, dont le balcon offrait un large point de vue jusqu'à l'Étoile. Je
me suis dit. À nous deux Paris. Je n'ai pas eu le temps d'être grisé par
l'orgueil car je devais préparer ce jour-là un discours sur Jules Romains. »
_______________________________________________________MARIAGES
PROUVOST DANS le 7° A PARIS
SAINT
FRANCOIS XAVIER
« C'est
en présence d'une élégante assistance qu'a
été célébré avant-hier, en
l'église
Saint-François-Xavier, le mariage de Mlle Odile Desurmont, fille
de M. Jules Desurmont
et de Mme, née Marcelle Prouvost, avec M. Claude
François-Marsal, fils de M.
François-Marsal et de madame, née Duroch. La
bénédiction nuptiale a été donnée
aux jeunes époux par le R. P. Decarreau, qui a prononcé
une allocution des plus
élevées. Les témoins étaient, pour la
mariée M. Robert Prouvost et M.
Jules-Edouard Desurmont. Ceux du marié Mme des Isnarts et M.
Thierry de Bocard.
La jeune mariée portait une robe de style en satin, au corsage
très ajusté,
fermé devant par de petits boutons de fleurs d'oranger. Le voile
de tulle, posé
sur la nuque et maintenu par un nœud de satin formant la
coiffure. Cette
toilette ravissante était une création de Maggy Rouff.
«
Figaro 1938/10/27 (Numéro 300).

Monsieur
et Madame Jules Desurmont- Prouvost



Claude
François-Marsal, décédé le 11 mai 2001 était le fils de Frédéric
François-Marsal1, né le 16 mars 1874 à Paris et mort le 20 mai 1958 à Gisors,
homme politique français dont la carrière a culminé avec son bref passage à la
présidence du Conseil en 1924.Après des études au lycée Louis-le-Grand, puis à
l'école militaire de Saint-Cyr, il commence une carrière d'officier en
Indochine. Attaché au cabinet de Paul Doumer, gouverneur de l'Indochine
(1900-1904), il travaille dans différentes banques : fondé de pouvoir puis
directeur général de la Banque privée industrielle, commerciale et coloniale à
Lyon (1906) puis à Paris (1913), administrateur de la Banque de l'Union
parisienne (1919).Spécialiste des questions financières, il est attaché au
cabinet de Georges Clemenceau, président du Conseil, responsable des questions
économiques (1917-1918), expert financier près la délégation française à la
conférence de la paix (1919). Ce technicien commence ensuite une carrière
politique. Il est ministre des Finances dans les cabinets Alexandre Millerand
(20 janvier - 24 septembre 1920), de Georges Leygues (24 septembre 1920 - 16
janvier 1921), et de Raymond Poincaré (29 mars - 9 juin 1924). Il a exercé les
fonctions de président du Conseil des ministres et de ministre des finances du
8 juin 1924 au 10 juin 1924 (voir gouvernement Frédéric François-Marsal) et
assura l'intérim du président Alexandre Millerand après sa démission (du 11 au
13 juin 1924).. Il fut sénateur du Cantal de 1921 à 1930. Yvert Benoît
(dir.), Premiers ministres et présidents du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné
des chefs du gouvernements en France (1815-2007), Paris, Perrin, 2007, 916
p. » Wikipedia

Mariage à
Saint François Xavier
d’ Albert III Prouvost et
d’Anne de Maigret le 14 juin 1941.
Et d’Anne de Maigret,
fille du comte Bruno de Maigret, proche parent du comte Bertrand de Maigret, le
conseiller de Paris, gendre du prince Michel Poniatowski, ministre d'Etat
et de l'Intérieur du gouvernement Chirac.


Mariage à
Saint Louis des Invalides de
Carole
Prouvost avec Bruno Toulemonde

« Mercredi prochain 26
octobre, à midi précis, en l'église Saint-Louis des Invalides,
sera célébré le mariage de Mlle
Jacqueline Lenglart,
fille de M. Jacques Lenglart et
de madame, née Prouvost, avec M. Henry de Maintenant, lieutenant aux affaires
indigènes (Maroc),
décoré de la croix de guerre des
T. O. E.,
fils du lieutenant-colonel de Maintenant, officier de la Légion d'honneur,
croix de guerre, et de madame, née du Passage. » Figaro 1932/10/24 (Numéro 298).

Amédée 2
Charles Prouvost 1853-1927
Epousa
Marie Bénat en l’église Sainte Clotilde le 2 février 1875 ;
les
orgues étaient tenus par César Franck.
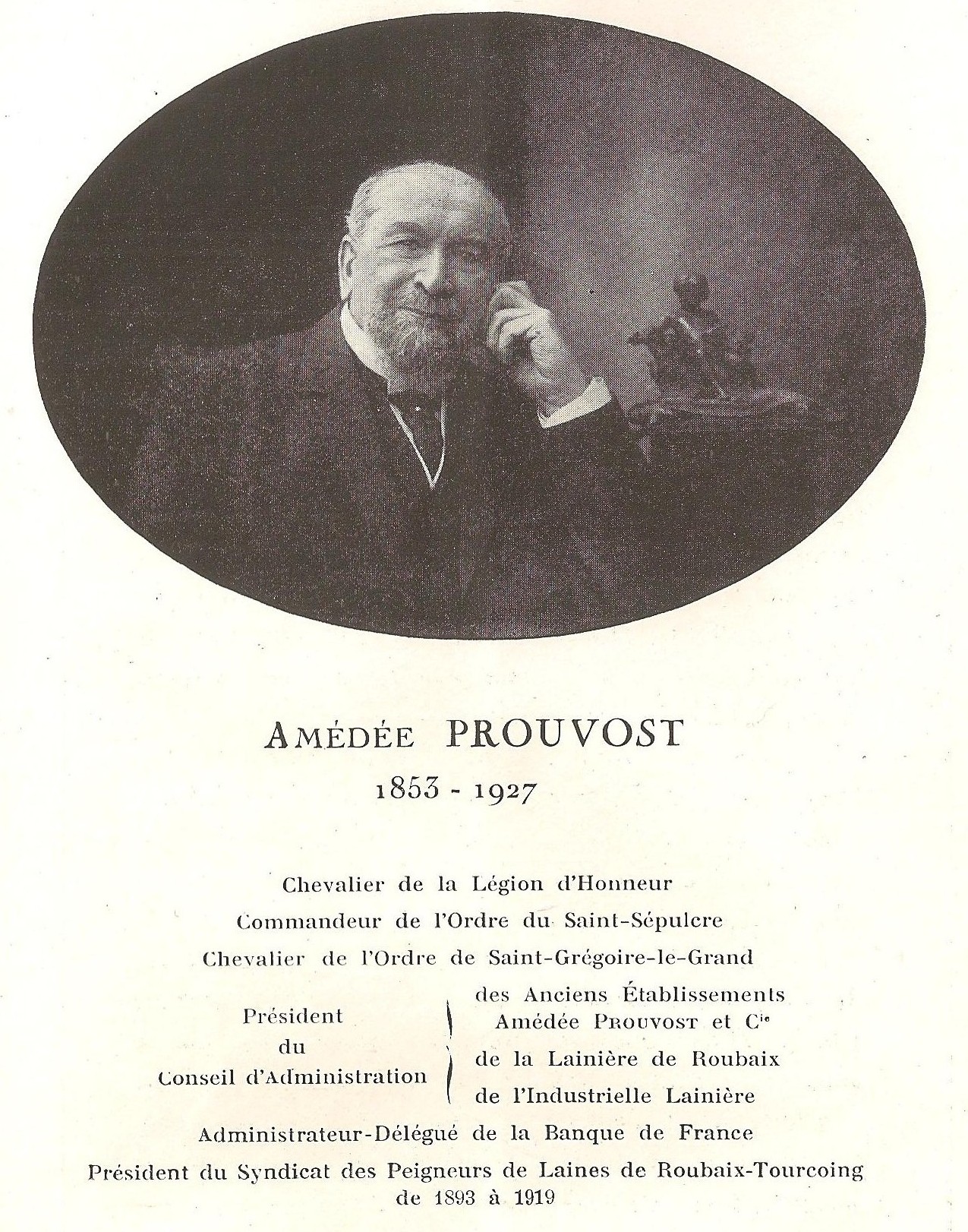



« C'est
avec une grande affection et un vrai respect que j'ai cherche à évoquer les
souvenirs de mes grands-parents, dans quelques pages de mon cru. Ils nous ont
laissé un inoubliable souvenir. C'est un hasard qui les a fait se rencontrer
mais un divin hasard si j'ose dire. J'ai toujours entendu dire qu'ils
attendaient tous deux devant le confessionnal de la chapelle des Etrangers, rue
de Sèvres à Paris, et que grand-père ému par la beauté de Celle qui devait
devenir sa femme, chercha par la suite à la rencontrer. Le mariage fut célèbre
à la basilique Sainte Clotilde, le 2 février 1875. Les orgues étaient
tenues par César Franck.
Nos
grands-parents formeront pendant 52 ans le plus uni, le plus
charmant et le plus chrétien des ménages. Ceci est illustré par le
testament du grand-père que m'a communique Hubert Dubois: « Je remercie ma
femme du bonheur qu'elle m'a donné, de ses bontés sans nombre, de sa vertu qui
m'a soutenu, encourage et fortifie. Je lui demande pardon des peines et des
offenses que j'ai pu lui faire. Qu'elle soit indulgente, prie beaucoup et fasse
prier beaucoup pour son époux qui l’a tant aimée ».
Monsieur
Amédée Prouvost est le type du grand industriel roubaisien, actif, intelligent,
dominant tout un monde par l’exemple, le prestige de son travail et de son
dévouement. Il est, de plus, un artiste et un lettré ; sa maison est une
bibliothèque et un musée d’art. Il se délasse de ses longues journées de labeur
à feuilleter les beaux livres ou à contempler sa collection de primitifs. A son
école, le futur poète apprend le secrêt d’embellir par l’esprit et le goût les
vies les plus austères.
On ne lui
dit point, mais il voit bien que les vertus de ses ancêtres revivent en son
père. Il salut en lui, avec une admiration qui grandira sans cesse, un de ces
chefs de l’usine et du foyer dont il vient de contempler le magnifique
cortège » Lecigne, Amédée Prouvost, Grasset, 1911
Joséphine
Prouvost, Madame Charles Droulers
Née le 13 août
1845 à Roubaix, décédée le 21 janvier 1919 à l'âge de 73 ans




Le
30, rue Saint Dominique, Paris Joséphine Prouvost Sainte
Clotilde
On nous annonce la mort de
Mme Droulers-Prouvost, présidente de la Croix-Rouge), section de Roubaix,
décédée 30, rue
Saint-Dominique, à Paris. Elle était la mère de MM. Charles Droulers, René
Wibaux et MM. Eugène Wattinne.
Ses obsèques seront
célébrées, en l'église Sainte-Clotilde, le vendredi courant, à neuf heures et
demie.
Elle est la cousine
germaine de Charles Jérôme Prouvost 1837-1906.
MARIAGES EN L’EGLISE SAINT PIERRE DU GROS CAILLOU
« En l'église
Saint-Pierre du
Gros-Caillou, mardi,
a été célébré, en présence d'une élégante assis- tance, le mariage de Mlle Odile Desurmont, fille de M. Jules Desur- mont et de madame, née Prouvost,
avec M. Claude François-Marsal,
fils de M. François-Marsal et de madame, née Duroch. La bénédiction nuptiale a été don- née par le Père Decarreaux, qui transmit aux jeunes époux la béné- diction péciale que le Souverain Pontife avait daigné leur envoyer. Les témoins étaient, pour la ma- riée M. Robert Prouvost et M. Jules-Edouard Desurmont pour le marié Mme d’ Avrillé des Essarts et M. Thierry de Boccard ».
Figaro 1938/10/28 (Numéro 301).
Claude est le petit fils
de Cyprien Fabre, né le 16 février 1838, Marseille (13, Bouches-du-Rhône),
décédé le 8 mars 1896, Cannes (06, Alpes-Maritimes) (à l'âge de 58 ans),
fondateur de la Maison de
Commerce C.F. Fabre & Cie, fondateur de la Compagnie Française de
Navigation à Vapeur Cyprien-Fabre & Cie, président de la Chambre de
Commerce de Marseille.
· 
MARIAGE
d’Evelyne Paul-Reynaud,
fille de
Paul Reynaud et Dominique Jacques Demey,
petit
fils de Suzanne Prouvost-Toussin


|
|
|
|
|
Suzanne Prouvost 1892
& René Toussin 1882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paul Reynaud 1878-1966
Président du Conseil (1940-1940)
Avocat, homme politique, président du conseil
Ministre des Finances (1938-1940),
Ministre des Affaires Etrangères (1940), Ministre des Affaires étrangères
(1940),
Ministre de la Justice (1932 et 1938),
Ministre de la Guerre (1940)
Né le 15 octobre 1878 - Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence)
Décédé le 21 septembre 1966 - hôpital américain, Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine)
Inhumé en 1966 - cimetière du Montparnasse, Paris (75) - 14e arrondissement
&1949 Christiane Mabire +2002
|
|
|
Annette Toussin
& Jacques Demey +
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evelyne Paul-Reynaud
|
|
|
Dominique-Jacques Demey
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evelyne
Demey, Paul Reynaud, Mon Père, Annexe correspondance de
Charles De Gaulle à Paul Reynaud, Paris, Plon, 1980.
|
|
Hier a
été célébré, en l'église Saint-Sulpice,
le
mariage de M. Charles Droulers-Prouvost,
docteur
en droit, fils de Charles Droulers et de Joséphine Prouvost
avec Mlle
Thureau-Dangin, fille du membre de l'Académie Française.



•
Hier a été célébré, en l'église Saint-Sulpice, le mariage de M. Charles
Droulers, docteur en droit, fils de feu M. Droulers, ancien président du
tribunal de commerce de Roubaix, avec Mlle Thureau-Dangin, fille du membre de
l'Académie française. La bénédiction nuptiale leur a été donnée par le R.
P. Mussy, dominicain, parent de la mariée.
Les
témoins étaient, pour le marié : M. René Wibaux, son beau-frère, et M. Amédée
Prouvost, son oncle ; pour la mariée : MM. François et Jean Thureau-Dangin, ses
frères.
La quête
a été faite d'un côté par Mlle Droulers et le lieutenant Pierre Thureau-Dangin,
de l'autre par Mlle Thureau-Dangin et M. Amédée Prouvost.
Reconnu
dans la nombreuse assistance, outre les membres des deux .familles : MM.
Brunetière, duc d'Audiffret-Pasquier, Gréait Lavisse, Boissier, Theuriet, comte
Vandal, Oppert, comte et comtesse de Lasteyrie, M. Henri Houssaye et comtesse
Houssaye, M. et Mme Henry Cochin, M. et Mme Paul Leroy-Beaulieu, M. et Mme
Anatole Leroy-Beaulieu, M. et Mme Gamard, marquis de Vogué, Mme Cavaignac, M.
et Mme Coppinger, M. et Mme Gabriel Dufaure, comte et comtesse de Rambuteau,
comtesse de la .Ferronnays, comtesse de Beaumont, MM. César Caire, Paul
Boudarie, Mme Massieu, comtesse François de Franqueville, Mme Daroy, M. et Mme
Jean Darcy, baron de Baulny, baronne Cochin, comte et comtesse de Vaux
Saint-Cyr, M. et Mme Thome, général baron de Randal et baronne de Randal, M.
Alexandre Sénart, M. Emile Senart, vicomte d'Avenel, M. et Mme de Piépape, M.
d'Indy, M. et Mme Camille Bellaigue, baron et baronne de Meaux, M. Buffet,
comtesse Delaborde, comte et comtesse François Delaborde, marquise de Forbin,
comte et comtesse-Maxime de Germiny, comte et comtesse Frémy, général et Mme
Humann, M. et Mme René Frémy, M. de Kermaingant, M. Louis Dailly, Mme Batereau,
M. et Mme Germain Lefèvre-Pontalis, M. et Mme Pierre Leroy-Beaulieu, M. et Mme
de Saint-Maurice, M. Daumet, vicomte de Ribemont, M. Louis Paul Dubois. M. et
Mme Pages, etc., etc.
Les
Thureau-Dangin étaient propriétaires du petit hôtel de Nivernais, à proximité,
11, rue Garancière. C’est le duc de Nivernais, qui édifia les bâtiments du 10
bis, rue de Tournon et ceux du 11, rue Garancière, Petit-hôtel de Nivernais.


A l’exposition
de Roubaix de 1911

 ures de cire, exposition 1911
ures de cire, exposition 1911

Metropolis de Fritz Lang , 1927
8 Vision et génie international partagés
des "familles du Nord"
et de Roubaix en particulier


Au XIXe et
une partie du XX° siècle, Roubaix a été une
capitale mondiale du textile, abritant même la bourse de la laine
(aujourd’hui située en Australie). « L’
Europe a un axe majeur
d’échanges entre l’ Italie et l’ Europe du Nord; Les Flandres méridionales
en font partie. Comme le montre Braudel, on trouve dès le Moyen Âge des
premières manifestations du capitalisme commercial en Italie et aux Pays-Bas.
Le commerce maritime avec l’ Orient, a enrichi les cités italiennes à la suite
des croisades, tandis que les Pays-Bas, à l’ embouchure du Rhin, font le lien
entre l’ Italie et l’ Europe du Nord dominée par la ligue hanséatique. Dans les
grandes cités, les marchands de draps et de soieries adoptent des méthodes de
gestion capitalistes. Ils effectuent des ventes en gros, établissent des
comptoirs et vendent leurs produits dans l’ ensemble des grandes foires
européennes. Ils se fournissent en matières premières aussi bien en Europe
qu'au Levant. Dans cette époque troublée du Moyen Âge, ils règlent leurs paiements
par lettres de
change, moins dangereuses
que le transport de métaux précieux. C'est donc
logiquement que se développeut,
en parallèle du capitalisme commercial, les premières
activités bancaires du
capitalisme financier : dépôts, prêts sur gage,
lettre de change, assurance
pour les navires. Venise est le centre d'une «
économie-monde » à la fin du
Moyen Âge. Ces capitalistes s'enrichissent si bien qu'ils
étendent leur emprise
économique sur l’ ensemble de l’ Occident
chrétien, créant ainsi ce que Braudel
appelle une « économie-monde ». Dans son analyse,
Braudel distingue l’ «
économie de marché » du capitalisme, ce dernier
constituant une sorte de «
contre-marché ». Selon lui, l’ économie de
marché (c’est-à-dire l’ économie
locale à cette époque) est dominée par les
règles et les échanges loyaux, parce
que soumise à la concurrence et à une relative
transparence, le capitalisme
tente de la fuir dans le commerce lointain afin de s'affranchir des
règles et
de développer des échanges inégaux comme nouvelles
sources d'enrichissement.
Dans les grandes villes spécialisées d'Europe, l’
artisanat, tourné
essentiellement vers l’ exportation, est dominé par les
grands négociants et
drapiers, si bien que les rapports économiques entre artisans et
marchands
s'apparentent à du salariat. Les négociants
contrôlent à la fois l’ apport de
matières premières en amont et la vente des produits
finis en aval. La
population urbaine se différencie déjà en
plusieurs classes économiques
distinctes, riches pour certaines, pauvres pour d'autres . La ville de
Florence
en est le parfait exemple : on y trouve très tôt des
banquiers qui développent
des succursales à travers l’ Europe et asservissent
l’ industrie à leur
recherche du profit. Parmi eux de grandes familles , telle celle des
Médicis,
créent les premiers rapports « privilégiés
» entre le monde des affaires et le
monde politique. »
On voit cette vision internationale par cet exemple du
XIII° siècle : le flamand « Guillaume de Rubrouck ou de Rubroeck, dit
Rubruquis (1215-1295), voyageur né près de Cassel vers 1220, mort vers 1290.
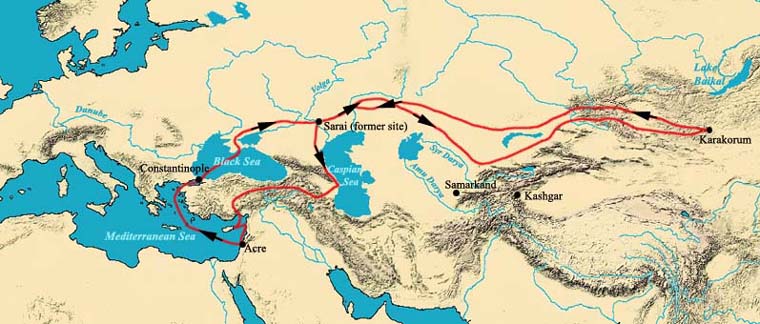
Il entra dans l'ordre des frères mineurs, et
se trouvait en 1252 à Saint-Jean d'Acre (Les Croisades), lorsque le roi de
France Louis IX lui confia la mission de s'assurer si le bruit de la conversion
du grand khan, Ilchi-Khataï, au christianisme, était fondé. La nouvelle était
fausse, et la mission n'obtint aucun des résultat politique ou religieux qu'il
escomptait, mais Rubruquis rapporta de ce voyage, qui dura plus de deux ans,
une série de renseignements qui contribuèrent à éclairer ses contemporains sur
l'histoire, les moeurs et le pays des Mongols. Après s'être rendu à Karakoroum,
capitale du grand khan, par la Crimée et le Turkestan, il revint par le
Caucase, la Syrie et l'Arménie. Il aurait, semble-t-il, établi d'une manière
irréfutable le bien fondé de l'assertion d'Hérodote, que la mer Caspienne était
un véritable lac, tandis que les Européens la croyaient généralement en
communication avec l'Océan glacial. Il rédigea pour Louis IX une relation
latine de son voyage, dont il existe un exemplaire manuscrit à Leyde : De
moribus Tartarorum. Itinerarium Orientis.
En 1624, des Roubaisiens avaient
exprimé leur ouverture au monde : sous la conduite de Jean de Lannoy, ils abordèrent l’ Ile de Manhattan encore occupée
par les indiens Manhatte et Iroquois; ils
naviguent dans le navire « le
« Nieuw Netherland » ; parmi eux Philippe Mathon, de
Tourcoing, sa femme et ses cinq enfants ; l’ île est rachetée aux indiens
60 florins. Quelques années plus tard, d’autres
familles des Pays-Bas viennent dont les enfants de Jesse de Forest,
ancêtres de F.D. Roosevelt. Mais l’ île
est bien précaire ; en 1652, une colonie hollandaise arrive. La
« Nouvelle Flandre » est appelée « New Amsterdam »; en
1664, les anglais s’emparent de l’ île et la rebaptisent
« New-York ». (Le duc York est le frère du roi Charles II ). En 1961,
l’ Ambassadeur des Etats Unis a accepté d’être parrain du nouveau carillon de
Tourcoing en souvenir du tourquennois Philippe Mathon qui fut l’ un des
fondateurs de New-York. Son descendant, Eugène
Mathon a bien compris que l’ économie est mondiale. En dehors de Tourcoing,
d'abord, il possède une filature de
laine peignée à Anor "les Anorelles" et un tissage à Avelghem en
Belgique, mais surtout il dispose
d’agences dans tous les continents: 24 en Europe. 4 en Asie, 3 en Afrique. 2 en
Amérique 12 en Amérique Centrale, 12 en Amérique du Sud. 4 en Océanie.

Les Virnot
Tôt dans l’ Ancien Régime, les négociants
nordiste commerçaient avec l’ Europe, par les mers et par le grand axe européen
Flandres-Italie: au XVII° siècle, Urbain II Virnot, né le 25 Avril 1651, Conseiller du Roy,
Contrôleur des Guerres à Hondschoote, à
l’origine de la chambre de commerce de Dunkerque, ancêtre des Prouvost-Virnot, d’une
famille lilloise venue du val d’Aoste par ce même axe européen, commandita Jean
Bart pour accompagner ses deux navires : « la Sorcière « et
« la Serpente » pour
aller à Cadix; elles partent le 5 mai 1680. Sur la route du retour, Jean Bart,
qui commande la Sorcière, rencontre un pirate Barbaresque de Salé, armé de 24
canons. Il revire dessus, avec une décision telle que l'autre intimidé par
cette manoeuvre, prend le parti de la suite." Lesté de sel, il rentre à
Dunkerque, le 24 août, avec des balles de laines et 3.000 écus pour son armateur." G. de Raulin: Jean
Bart, Corsaire du Roy

Urbain Dominique Virnot, juge et consul, directeur de la chambre de
commerce de Lille, dans la 2° partie du XVIII ° siècle, commerçait avec des
destinations lointaines le sel et les épices. Sa belle mère, une Carpentier,
appartenait à une famille liée à l'industrie de la dentelle depuis plus de 200
ans: "à l'époque de Louis XVI, Carpentier donne du travail à un millier de
dentellières, et ses bénéfices lui permettent de mener grande vie dans son
hôtel décoré à la française"
Trénard: histoire d'une métropole. On peut imaginer le caractère
international de la distribution d’une aussi importante production de dentelles.



La famille Carpentier par Jacops, peintre de la guilde d'Anvers en 1602

Les Virnot par Heinsius, peintre des filles du Roi.
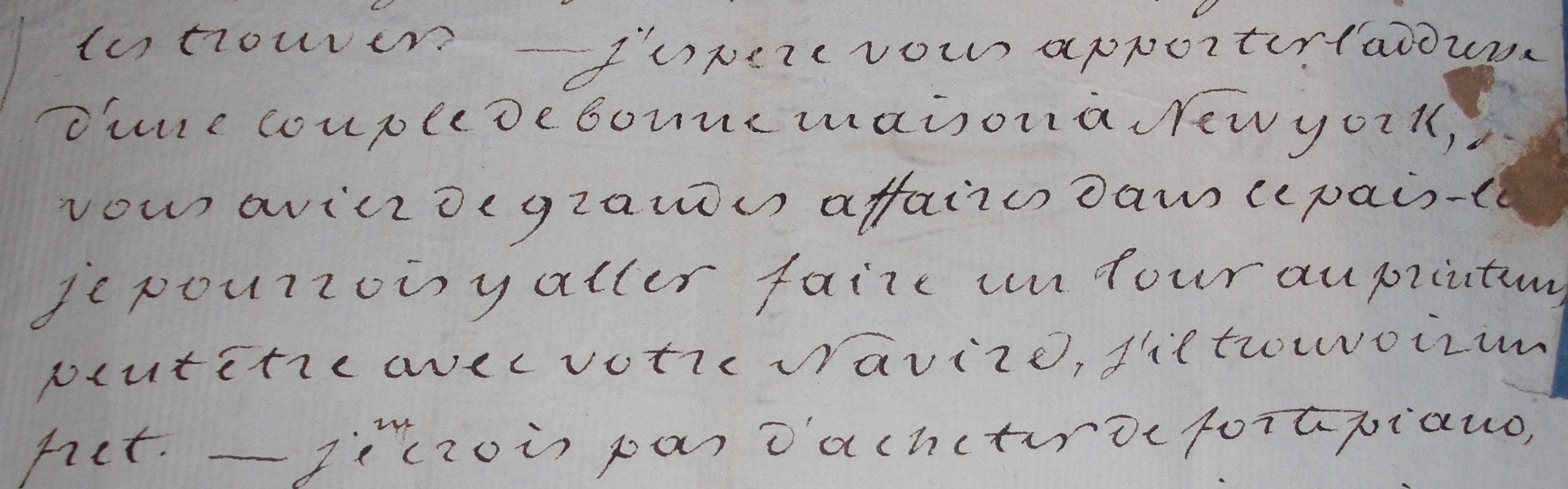
Lettre de Pedro Virnot à ses parents depuis Londres en 1788
et son gendre, François Barrois-Virnot, futur maire de Lille et député, voyageait
pour ses affaires. Président de la Chambre et du Tribunal de Commerce,
Conseiller Municipal en I807,adjoint en I8I8,puis Maire de Lille par ordonnance
royale du 12 Août I830, Député du Nord en 1824 et en 1831, il fut l'un des
principaux actionnaires-fondateurs du chemin de fer du Nord et des Mines de
Lens. Il raconta un voyage d’affaire en Italie dans ses mémoires « le
caducée et le carquois».

La Manufacture Royale du Dauphin

créée le 13 janvier 1784, place des
Carmes, à Lille, marque au « Dauphin couronné » et « A Lille », innova en
employant la houille pour chauffer les fours et fabriquait de la porcelaine
dure. En 1786, avec la protection de M.
de Calonne, elle obtient le patronage du Dauphin. Une pièce du musée est
marquée « cuit au charbon de terre en 1785 ». Puissance innovante à vocation
exportatrice.
« Charles-Désiré
Le Thierry d’Ennequin,
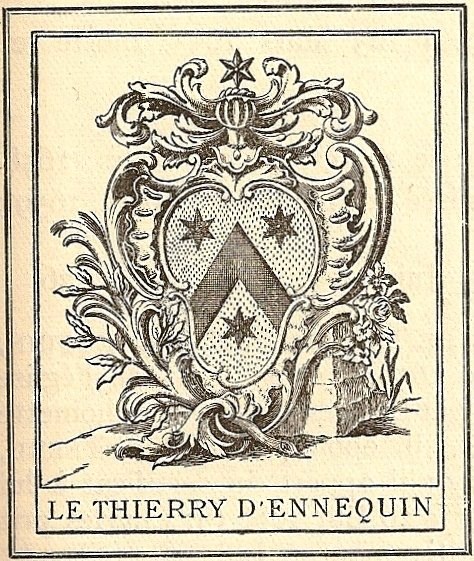
petit
fils de Désiré Le Thierry d’Ennequin -Delebecque, né à Lille le 6 janvier 1860,
11, rue des Buisses, dans une ancienne maison datant de 1727, précédemment
habitée par Henri Deleruyelle, le 6/01/1860, licencié en droit et sculpteur,
mort à Paris le 14/06/1929 et inhumé à Flers-Les-Lille, avec ses
ancêtres, dans un caveau de style grec qu'il avait fait ériger. Sa mère était
la fille de l'éminent maire et héros de Lille, Jean Baptiste Smet, Chevalier de
la Légion d'honneur, dont voici le château du Recueil à Flers près de Lille qui
restera dans sa descendance jusqu'aux années 1980.Après avoir acquis quelques
notions d'astronomie, de paléontologie, et soigneusement scruté les textes
bibliques, les Beaux-arts et l' archéologie furent l'objet de ses études et de
ses voyages. Cité par Lavignac comme fervent Wagnérien, M. LTE contribua de ses
deniers à faire connaitre en Octobre 1899, à Paris l’opéra de Tristan et
Yseult, fréquenta les musées d'Europe, des Etats-Unis et du Japon.
Au Musée de la Ville de Lille, il laissa par testament plusieurs œuvres
décoratives inspirées par ses séjours répétés aux Indes, en Grèce, en Palestine
et en Egypte : le Rishi l’ancêtre en prière, Pasiphaé, Némésis (le titre
en grec chypriote de droite à gauche), Danaé, la harpie, cires perdues ;
Judith devant Holopherne, statuette en ivoire ; Moïse, qui, après avoir
emprunté aux égyptiens leurs vases d’or et d’argent, pour les en dépouiller,
entraîne le peuple de Dieu à la conquête des terres des Cananéen, marbre jaune
de Sienne ; Salomé dansant, cire perdue ; Jean Baptiste Smet,
maire de Lille, son grand père; Le colonel Albéric Smet à Sedan, cire perdue;
le duc Philippe de Bourgogne, Cupidon, La sorcière, statuettes en bleu turquin,
en marbre Savarezza, en ivoire ; Persée délivrant Andromède, pendentif
pectoral en or émaillé par Tourette ; des vases, des plateaux, des
lampes ; de l’orfèvrerie, des bijoux etc; il eut le rare bonheur de
pouvoir étudier sous leurs formes diverses et jusque dans la mélancolique
poésie de leurs ruines, tous ces rêves de beauté dont tant de civilisations ont
parsemé le Monde, et notamment les temples de Bijanagar dévastés en 1564, de
Khajurao, de Magda, du Guzrat, de l'Orissa" d'Angkor, de Boroboudha que
l’indifférence et l’abandon ont voués à la mort. Sur les Merveilles
architecturales, éparses dans les brousses de l'Orient. V. FERGUSSON, History
of indian and eastern architecture. LEBON: La civilisation de l'Inde (1887). La
peste et le choléra qui ravageaient les Indes à ces époques, il les affronta
deux fois impunément, mais pas tout à fait la cruelle maladie coloniale qui
avait déjà emporté son cousin Carlos Barrois. De Charles Le Thierry d'Ennequin
à 25 ans, il existe un buste en bronze par Samain, artiste belge, Prix de
Rome.
Roubaix fut capitale mondiale de la laine
O cité, ton renom s'étend à l'univers
Et je veux exalter ta grandeur en mes vers,
Ville des artisans, ô ma ville natale.
Amédée III Prouvost le poète. 1877-1909
Concernant Roubaix, " Dès 7 heures
du matin, le 15 du mois de novembre 1469, le bailly Jean de Langlée, les
échevins Jean de Buisnes et Jean Prouvost, dit des Huçons, les deux lieutenants
Jean Fournier et Guillaume Agache, se rendirent au château de Roubaix
construit par Pierre de Roubaix
(1415-1498), premier chambellan de
Charles, duc de Bourgogne, pour lui témoigner la reconnaissance de ses
sujets pour avoir obtenu la charte de
Roubaix qui donnait à la ville le droit de faire draps de toute laine. "
(Histoire de Roubaix, Trénard) . Et
" depuis Charles Quint, les mêmes familles dominent la Fabrique
Roubaisienne : Pollet, Mulliez, Prouvost, Van Reust (qui devient Voreux),
Leclercq, Roussel, Fleurquin, Florin, Malfait. Elles assurent la majorité de la
production." Hilaire -Trénard: Histoire de Roubaix".
Panckoucke disait au XVIII° siècle :«
Beaucoup de ville s ne valent pas le bourg de Roubaix tant dans la beauté des maisons du lieu que
dans le nombre de ses habitants ».
« Ces familles patriciennes,
riches en enfants et en idées, ont généré les meilleurs «entrepreneurs», allant
des industries, maintenant traditionnelles de cette belle région, aux créations
les plus avant-gardiste. Qu’ils prirent leur cheval, leur navire ou, plus tard,
leur avion ou le Net, ils fondèrent, en France ou à l’autre bout du monde, des empires
dont le siège était à Roubaix, longtemps capitale mondiale de la laine. Tout
est à l'honneur, de la politique à la religion, de l’armée aux beaux-arts, de
la presse aux capitaines d’industries, des explorateurs aux ingénieurs, mais
aussi de véritables Saints et Saintes aux dévouements incommensurables. J’ai
été frappé de voir combien, à chaque génération, la véritable notion de «
Servir» prime les intérêts moraux ou financiers. C’est là le secret et la
réussite de ces familles qui vont pendant des siècles être au premier rang de
ce que « le Nord » a produit de meilleur. » Pierre de Bizemont
« Dans chacune de nos cités des Flandres
–maritime et wallonne- l’Eglise nous enseigne la fidélité aux traditions
religieuses, le Beffroi affirme l’attachement aux libertés communales, toutes les productions
des lettres et des arts nous démontrent le respect de la foi jurée, le culte du
beau, l’amour du bien, la fierté du devoir accompli. » Albert-E Prouvost
« Les lettres
échangées entre mon grand- père, ma grand-mère Amédée Prouvost et leurs
six enfants témoignent d’un attachement fondamental aux vertus essentielles de
notre race du Nord de la France, consacrées par des siècles de luttes et
d’épreuves. S’aimer, s’entr’aider, travailler dans la loyauté et l’honneur à
créer chaque jour un peu plus de bonheur pour tous, être prudents dans le
succès, courageux dans l’adversité, tels étaient les enseignements
traditionnels de nos familles, transmis dans un grand esprit chrétien.
».Jacques Toulemonde
« Tout ce qu’il y a de meilleur dans nos traditions roubaisiennes : la foi,
l’attachement au devoir d’état, le culte des parents, l’union des frères et
sœurs, la joie des réunions de famille, nombreuses et prolongées, le goût du
travail et
de l’initiative, l’esprit
d’entreprise, le génie industriel, particulièrement
mélé, dans le milieu où
grandit l’abbé Lestienne-Prouvost, à un goût
artistique très éclairé et très
sûr.»
Roubaix : «
ville unique, où tous travaillent dès l’ âge légal, jusqu’à la tombe, où
chaque réfractaire est montré du doigt comme frappé de la lèpre, (..) où la
concurrence loyale et excitant pique de son aiguillon les flancs d’une jeunesse
jusque là intrépide, où les carrières libérales sont quasi inconnues ou
d’importation, où nul ne jette un œil
d’envie ou de concupiscence sur le fonctionnarisme, où par surcroît
chacun s’accommode de familles nombreuses, parce que chaque nouveau venu est
considéré pour l’ avenir comme un capital en bourgeon, bientôt en fleurs, et en
rameaux ombragés, où viendront s’abriter des générations laborieuses
d’artisans, trouvant emploi de leurs bras, leur unique capital, et parce que
ces nouveaux venus sont de plus dans le présent pour les parents, ferments
nouveaux d’énergie et d’entreprises plus vastes. » Eugène Motte
Mais le Nord industriel prit une importance
économique de premier plan au XIX° siècle qu’a exposé avec brio Pierre
Pouchain dans sa magistrale somme « les Maîtres du Nord ».
Les grands fondateurs d’industries sentent le
monde nouveau apparaître :
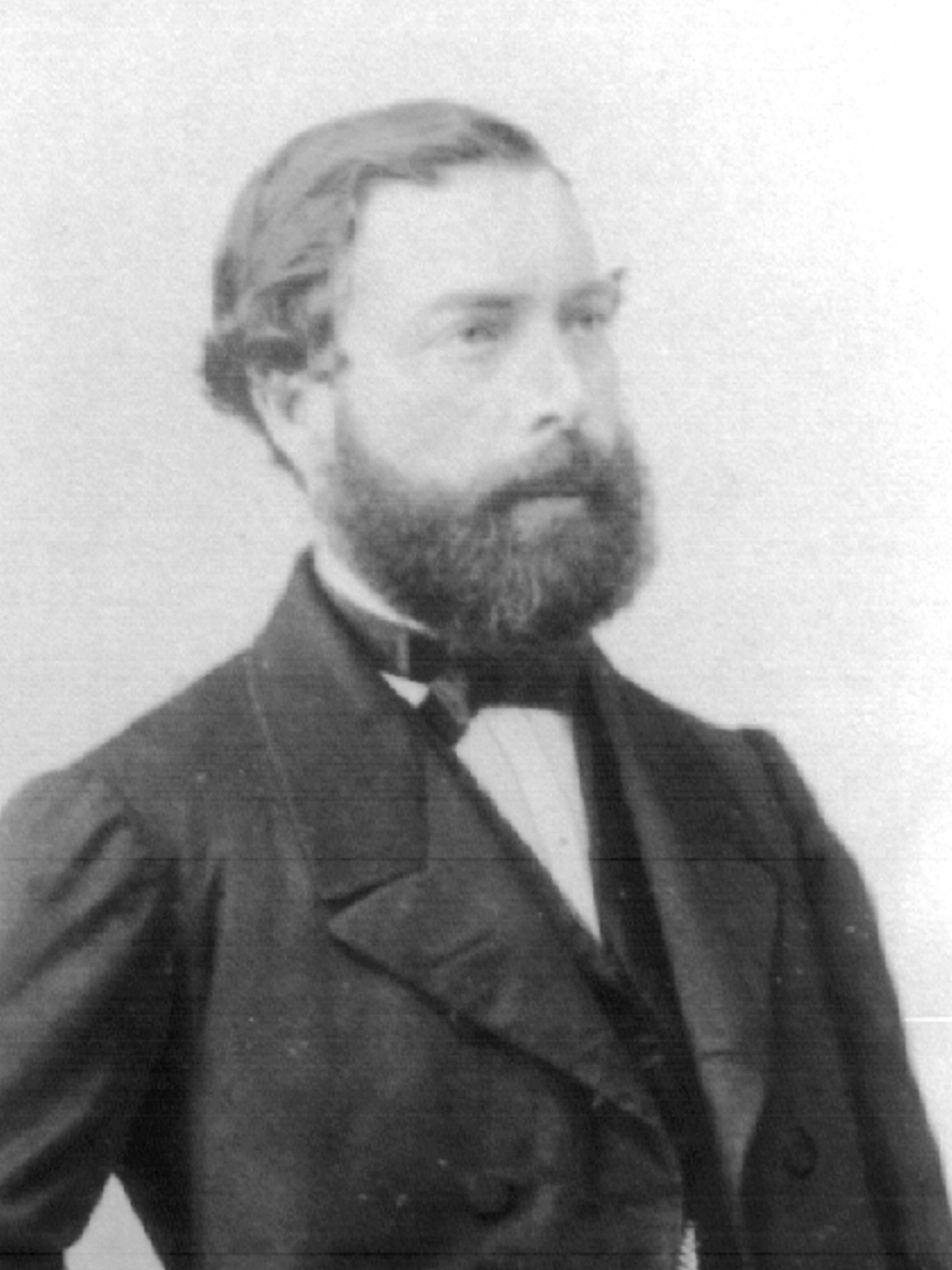


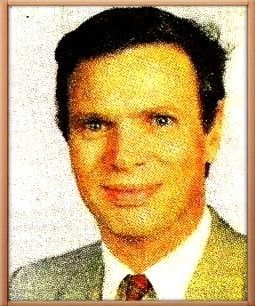
Amédée I, Jean, Jacques, Albert-Auguste, Albert-Bruno Prouvost
Dans la famille Prouvost, Amédée
I Prouvost, 1820-1885, « fut dans
sa jeunesse un infatigable voyageur : la lente et banale diligence lui déplaisait : un beau jour, il monta à cheval, il partit, il
parcourut toute la France, s’extasiant devant les paysages, s’arrêtant à
la porte des usines, mêlant dans son carnet des impressions d’artiste et des
notes d’affaires, exemplaire inédit du roubaisien à la fois aventureux et
positif. Se horizons se sont élargis dans ce contact avec le monde et les
industries diverses. Il est revenu, l’
âme accueillante à toutes les initiatives, fidèle aux traditions du passé, mais
incapable de les confondre avec la routine. Il crée à Roubaix le peignage
mécanique de la laine. »« La
Lainière de Roubaix était une entreprise française du secteur du textile qui a
ouvert en 1912 pour fermer le 17 janvier 2000. Elle était un fleuron de
l’empire Prouvost.
Évolution du
nombre d’employés : février 1957 : 7 800;
janvier 2000 (à sa fermeture) : 212.Usine annexe à Cambrai comptant
jusqu’à 1 300 ouvriers. Bâtiments à Roubaix et Wattrelos sur seize hectares.Produits
lancés (entre autres) : la pelote de laine Pingouin en 1926 ; les chaussettes Stemm en 1948 (avec
parrainage du groupe de rock Les Chaussettes Noires en 1961).
Anecdotes :À
son apogée (années 1960), le fil produit par l’entreprise en une journée aurait
suffi à faire quarante fois le tour de la Terre.L’entreprise fut visitée par
Élisabeth II et Nikita Khrouchtchev.
La Lainière crée en 1975 la revue Mon Tricot, mensuelle, vendue jusque
dans dix pays. Le groupe d'Eddy
Mitchell, Les Chaussettes Noires, initialement baptisé Five Rocks, a vu son nom
modifié parce qu'Eddie Barclay (leur producteur) avait conclu un accord
commercial avec la Lainière de Roubaix.
Bibliographie : article Le fil rompu in La Vie no2838 de la
semaine du 20 janvier 2000.Jean Prouvost eut des méthodes innovantes:
"Il introduit des méthodes qui ont
fait leurs preuves aux États-Unis. Il recrute les meilleurs journalistes (dont
Pierre Lazareff, Paul Gordeaux et Hervé Mille) et s’assure la collaboration
occasionnelle de grands noms de la littérature : Colette couvre les faits
divers ; Jean Cocteau fait le tour du monde pour le journal ; Georges Simenon
enquête sur des affaires criminelles retentissantes. Il utilise comme correspondants
de guerre Blaise Cendrars, Joseph Kessel, Antoine de Saint-Exupéry, Paul
Gordeaux. A l’ occasion les envoyés spéciaux sont Maurice Dekobra, Pierre
Mac-Orlan, Pierre Daninos. De 70 000 exemplaires en 1930, le tirage de
Paris-Soir monte au chiffre considérable de 1 700 000 en 1936. Jean Prouvost
constitue bientôt un véritable empire comprenant Marie-Claire, magazine féminin
racheté en mars 1937, et Match (journal sportif), en 1938."
Albert-Auguste Prouvost, né
le 15 juillet 1909 à
Roubaix, décédé le 6 septembre 1991 à
Bondues et Anne de Maigret: " Le versant plaisant de cette vie
trépidante
d'homme d'affaires reste malgré tout les voyages. Contacts
commerciaux,
contrats, implantations d'usines, le patron de la société
Prouvost sillonne
sans cesse les cinq continents. Son épouse l'accompagne
toujours. «Nous avons
été de vrais voyageurs, explique Mme Prouvost. Pas
seulement par le nombre
extravagant de nos périples à l'époque ou se
déplacer était encore une
aventure, mais aussi par l'insatiable curiosité qui nous
animait.». Albert-Auguste
Prouvost entend aussi mener sa carrière d'industriel sans
égoïsme : il n'a de
cesse que d'amé1iorer le niveau de vie des plus
défavorisés. Le logement est
son cheval de bataille."
Albert IV-Bruno Prouvost-1942-1987, époux de Corinne
Grimonprez, fille de René Grimonprez 1913-1972
et Marcelle Masurel 1919-2010, dont Albert-Nicolas, Eléonore et Barbara. Cinquième
descendant en ligne directe d’Amédée Prouvost, fondateur du groupe en 1851, il
était l’héritier d’un des plus grands groupes du monde. Un manager mais aussi
un homme exceptionnel. Albert-Bruno faiasait partie de la nouvelle génération
des chefs d’entreprises tout en cultivant la tradition familiale et tooutes les
qualités impliquant l’une et l’autre caractéristique. Grand sportif-
comme son père d’ailleurs- il pratiquait régulièrement le squash et le ski. La
condition physique qui était la sienne a d’ailleurs longtemps fait espérer en
ses chances de survie. Mais il était aussi ami des arts ; le
peignage Amédée était toujours décoré dans ses bureaux de peintures d’artistes
contemporains. l assistait régulièrement aux concerts en compagnie de son
épouse, administratuer du festival de Lille. Dans sa vie
professionnelle ; il était, sans conteste, un des meilleurs dirigenats
d’entreprise du moment. Il avait certes fait l’école Polytechnique mais c’est
aussi le travail sur le terrain qu’il détenait son sens de la direction des
hommes et d’un groupe comme celui des peignages de Prouvost SA avec 2.200
personnes en France, en afrique du Sud, en Australie, au Brésil. Mais Albert
bruno n’ent tirait pas vanité. C’est d’ailleurs un des traits essentiels du
caractère : la modestie. Jamais il ne s’attribuait le mérite du succès de
ses peignages (…) Monsieur Prouvost était aussi un homme de communication cmme
iul en existe peu. Avec Albert Bruno Prouvost, Roubaix perd aussi un de ses
principaux défenseurs. » Extraits de la Voix du Nord
le 55, rue Royale à Lille, entre cour d’honneur et jardin, qui fut illustré par
Albert-Bruno et Corinne Prouvost.Cette année 1987, notre fils ainé,
Albert-Bruno, projette de construire un peignage de laine dans le sud de
l’Argentine. Homme pressé comme son père, il loue un petit avion de tourisme
conduit par un très bon pilote pour gagner un temps précieux. Is décollent et
sont pris dans une tempête. L’appareil s’écrase sur les collines du Chubut.
Après cette tragique disparition, mes enfants cèderont leurs intérêts dans
l’entreprise de leurs ancêtres.
Les Masurel
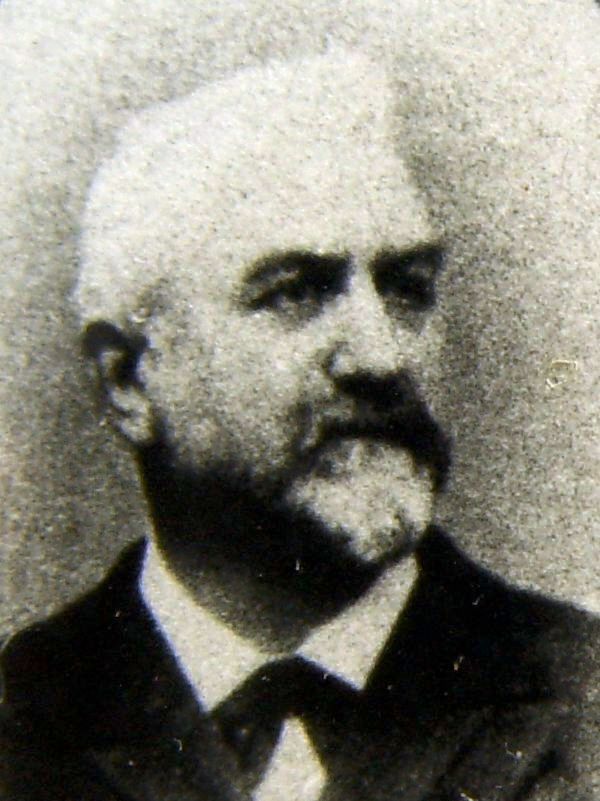
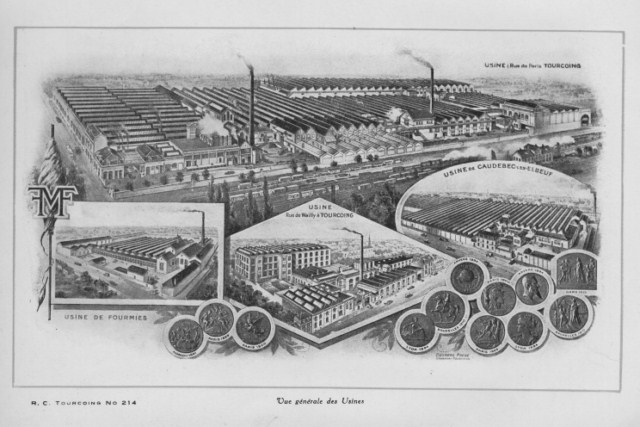
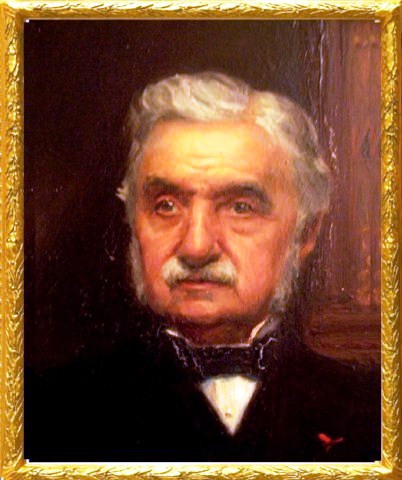
Jules Paul Masurel 1841-1925, " Par ses voyages a travers le monde, il
créa de nombreux comptoirs d'achat de laines et vécut des aventures
extraordinaires. Car à cette époque - en 1860 - on voyageait a cheval et il
parcourt de cette façon la pampa argentine et les déserts d’Australie. Il s'y fit, peu a peu, une situation
prépondérante et avait étendu son action a la planète entière car il achetait et vendait des laines, non seulement
d’Amérique du Sud ou d’Australie mais aussi de Nouvelle Zélande et d’Afrique du
Sud à tous les lainiers du monde, achetant des haciendas en Argentine, des
propriétés en Afrique du Sud, créant des comptoirs en Australie, en Nouvelle
Zélande, Bolivie. Sa maison, Masurel fils , était l’ une des plus grandes
firmes du négoce international. Dès
1889, la maison Masurel-frères obtenait une médaille d’or à l’ exposition de
Paris Commissaire général de la section française de l’ exposition de Chicago,
Vice-président de la caisse d’épargne de Tourcoing,
Jacques Henri Masurel-Lepoutre, frère
d’Eugénie Prouvost-Masurel était adjoint au maire de Tourcoing, administrateurs des établissements François
Masurel frères, vice-président de la foire commerciale de Lille et vice-président
de la foire Internationale textile , président de nombreuses sociétés
régionales et locales et fondateur des amis de Tourcoing.
Le voyage se développa, souvent lié à l’ agrément :
« En 1890,
Albert et Marthe Prouvost s'étaient liés d'amitié, à Vichy, avec le général
russe Annenkov. Celui-ci les invita à venir visiter ses propriétés d’Asie
centrale. Le couple Prouvost, accompagne d'Edmond Ternynck et de son épouse, de
Mme Jean Scrépel et de sa fille , et de deux neveux, tous s'en allèrent donc,
par la Turquie et la Géorgie, vers le Turkestan. Ils visitèrent les cités
mythiques de Boukhara et Samarkand, et retrouvèrent le général Annenkov dans
ses terres, proches de la frontière chinoise. C'est la qu'Annenkov montra plus
que le bout de l’ oreille: leur présentant ses immenses troupeaux de moutons, il fit valoir à ses hôtes tout l’ intérêt que
présenterait pour eux la possession de terres sur lesquelles paitraient les
ovins dont la laine alimenterait leurs usines roubaisiennes. Les voyageurs,
conscients de leur devoir de déférence envers leur hâte, consentirent à acheter
certaines de ces terres. Mais le Tsar refusa de ratifier le contrat, estimant
que la terre russe ne pouvait être cédée à des étrangers. Peut-être en furent-ils
secrètement soulagés? « Pierre Pouchain Les Maîtres du Nord, Perrin page 167
« Voyage d’Albert, Rita, Marguerite,
Albert-Auguste Prouvost et Madame Vanoutryve : visite du chantier de l’
usine de Woonsocket,chutes du Niagara, Detroit et les usines Ford, Chicago et
les abattoirs, Colorado Springs et Buffalo Bill, Denver et le Pikes Peak, le Grand Canyon de l’ Arizona, Salt Lake City
et les Mormons, San Francisco, Santa Barbara, et son tremblement de terre deux
jours avant de passer, Hollywood et ses studios (Marguerite obtient un
autographe de Charlie Chaplin), le Texas, la Nouvelle Orléans, Washington et la
Maison Blanche, Philadelphie et New-York, Manhattan, l’ ascenseur de l’ Empire
State, retour par « l’ Ile de France » au Havre. Chaque année de 1924
à la guerre, nous allions par mer pendant
trois semaines à Woonsocket et Boston, profitant de l’ été indien. »
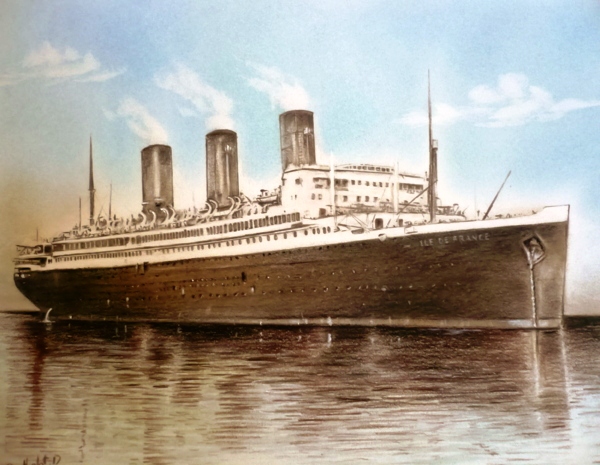
Industriel,
Charles II Prouvost « créa avec
François Motte , mais aussi avec Victor Dazin, Floris Lorthiois, Léon
Vernier-Leurent, quatre sociétés : l’ une d’elle, la Société Industrielle de
Pologne, ne se limita pas aux activités pétrolières ; elle prit aussi des
participations dans une filature à Sosnowiec, dans un domaine agricole à Brody
(ville natale de l’ écrivain Joseph Roth), dans la banque industrielle de
Pologne etc. Les trois autres gérèrent
des concessions et prirent d’autres
participations, centrées sur les gisements galiciens.
Mais la Société
industrielle de Pologne fut mise en veilleuse en 1925 » MN
Son fils, Charles Prouvost, le troisième, fit un voyage
d'étude aux Etats-Unis en 1948 avec des confrères.
Les Motte

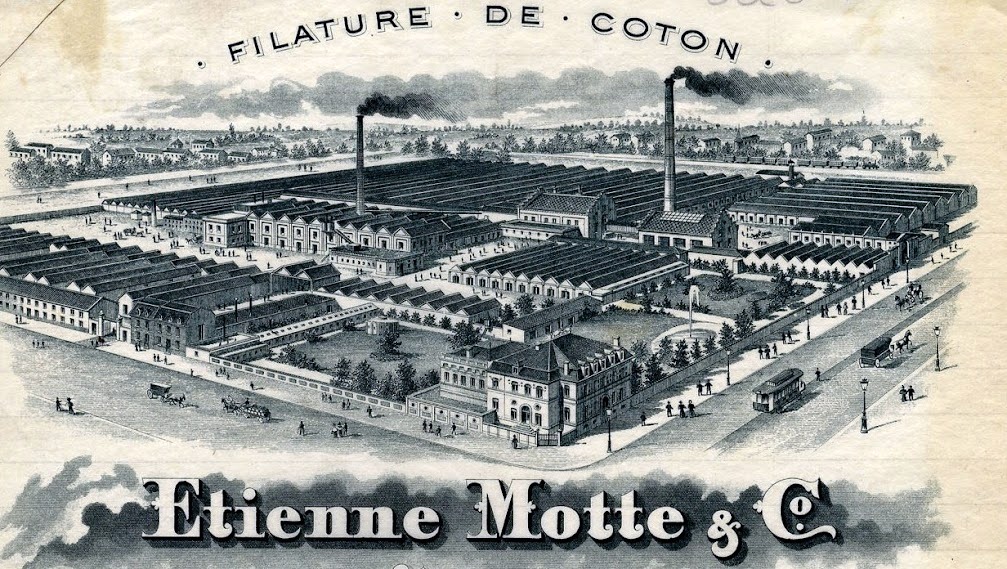
Louis Motte , né en 1817, fils aîné du couple Motte-Brédart, disposant
des fonds venus de son père et de la dot de sa femme, est plein d’ambitions.
Il ne veut pas continuer la filature traditionnelle avec les mule-jenny.
En 1841, il fait un long voyage d’étude
en Angleterre, patrie de la révolution industrielle. Il découvre les fabriques
de Manchester et de Bradford. Les Motte s’établirent en Pologne, Russie avec leur
cousin Gillet, à Lodz en Pologne, Odessa, Haute Silésie, Roumanie Allemagne. De
même pour les Gratry en Russie. Henri
Maquet 1876-1943, achetait des lins à Riga vers
1900, voir « les Maîtres du Nord » Certains négociants du Nord, Edouard
Crépy, Jean Dalle de Bousbecque,
Eeckman, Ernest Hespel, Leroy-Crépeaux, mais aussi les Scrive, Wallaert,
Barrois, firent commerce avec « Les pays de l’ Europe du Nord: Riga, Mêmel, Vilna, Reval, Pskov, Saint
Pétérsbourg, voire Smolensk ou Arkhangelsk » MN
Les Pollet
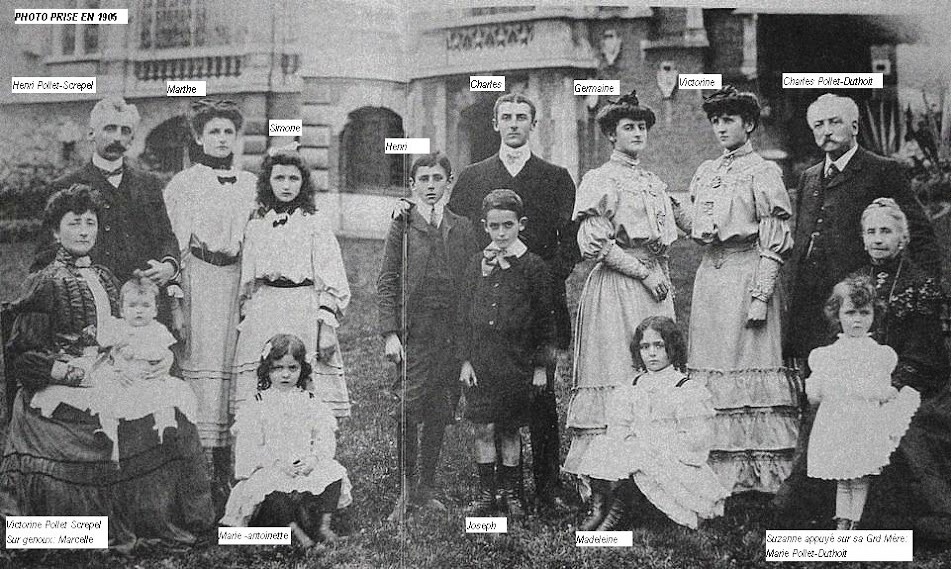
créent en
1831-32 un tissage de coton, puis de
laine, à Roubaix; c’est au 20° siècle que la vente par correspondance remplaça
la production textile jusqu’à l’ OPA
amicale: le Printemps détient plus de 50% du capital de La Redoute. 1991.
Rachat du vépéciste britannique Empire Stores. 1994. Fusion-absorption de
Pinault-Printemps-Redoute. 1995. Livraison gratuite et garantie en 24h chrono.
Création du premier catalogue Somewhere sur CD-Rom et du site Internet
(http://www.redoute.fr). 1997. Rachat du vépéciste scandinave Ellos Gruppeu. »
Les Tiberghien
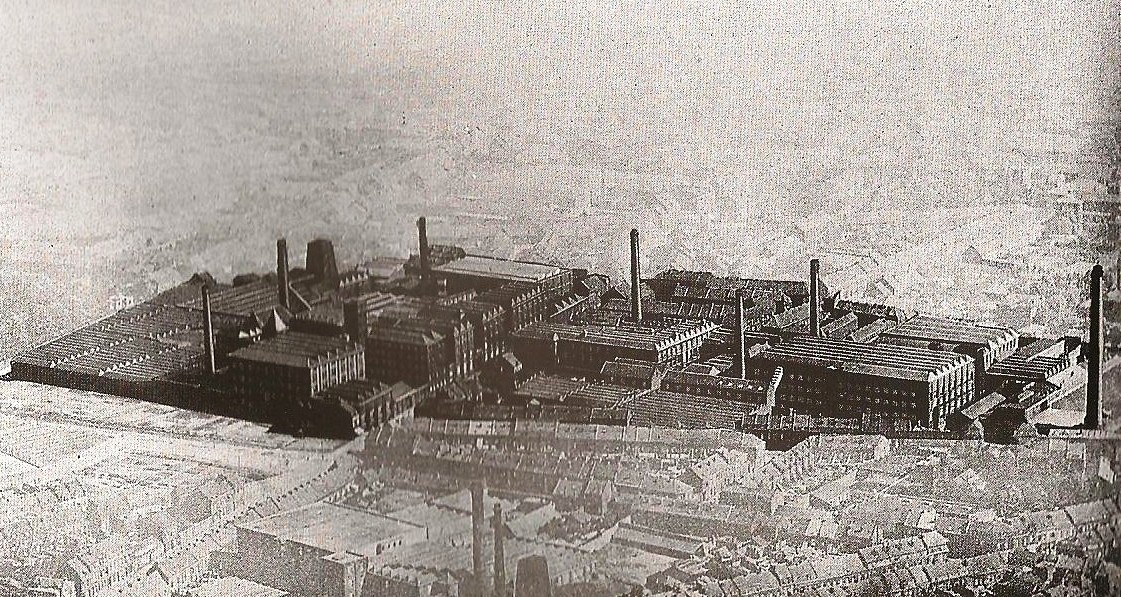
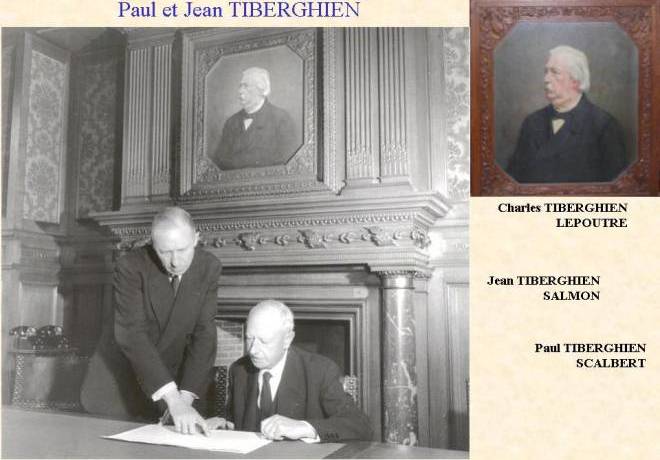
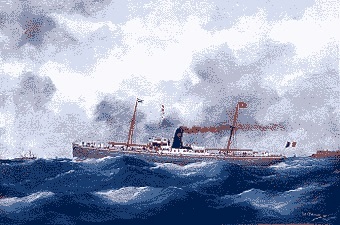
Louis Auguste Joseph Tiberghien, 1781 – Tourcoing, 1863 –
Tourcoing, 81 ans, continua le commerce de la laine, achetant des toisons en
Flandre, en Picardie, en Hollande ; au retour avec cinq ouvriers, il trie, lave et peigne la laine que les fileuses,
chez elles, tournent au rouet. Il
s’associe avec Monsieur Libert et s’intéresse au machinisme : deux
chevaux entrainent les douze métiers de cent broches de la filature ; que les
chevaux fassent défaut et c’est la
manufacture qui s’arrête. Il fut le
premier industriel de la famille et
réalisa son ascension sociale; mais divers évènements dont la Révolution de
1848 l’ empêchèrent de réussir jusqu’au moment où son fils Charles lui prouva
le contraire.
Charles Tiberghien 1825-1907 réussit ; il épousera Elise Lepoutre en 1858 ; En
1860, il monte un tissage de cent
métiers puis un autre de deux cents ; il
met en oeuvre un procédé technique utilisé avec succès à Reims ; en
1873, l’ entreprise comprend 300 métiers à tisser et 3.500 broches à filer. On
achète une usine aux Francs. Les établissements Tiberghien frères obtiennent la
médaille d’or à l’ Exposition Internationale de 1878. L’ ensemble des usines
devient si important -1000 métiers mécaniques, 5000 broches, un peignage- qu’on
le sépare en deux. Charles et ses Fils se trouveront à la tête d’un peignage de
50.000 broches à filer, 20.000 à retordre, 1200 métiers à tisser, une
teinturerie et, par surcroit, de deux navires chargés du transport des
marchandises. Il prouvera toute sa vie
une grande générosité. Outre sa famille, il
viendra au secours de son beau-père, Auguste Lepoutre ; pour le
relever, il risque la moitié de ses
biens, lui envoie une partie de son personnel et de ses clients. Les ateliers
de cette usine située rue Fin de la guerre couvrent une superficie de 10 ha.
Il s'agit d'une société qui a pour
filiation la société " Charles Tiberghien et Fils " fondée par deux
frères en 1853. En 1914, la filature comptait 52000 broches, la retorderie
15000 broches, le tissage 1050 métiers à tisser. Le peignage fournissait chaque
semaine 40 000 kilos de laine peignée dont la majeure partie est absorbée par
les deux filatures. Les établissements Paul et Jean Tiberghien possédaient
leurs propres comptoirs d'achats directes de laine aux pays d'origine (Australie-
Argentine). A noter : l’ apparition des camions automobiles sur ce dessin sont
le signe d'une modernisation.
French Worsted, importante société textile française établie à
Woonsocket, appartenait à la société de Charles Tiberghien et les Fils de
Tourcoing. Son Président était Charles Tiberghien. La société avait déjà des
usines en Autriche et la Tchécoslovaquie quand il a construit un grand complexe à 153 Hamlet
avenue. Avant 1910, la société employée plus de 400 personnes. Charles
Tiberghien est resté le président de French Worsted pendant 40 ans, bien qu'il ait passé très peu de temps dans Woonsocket.
Cependant, la société a fait une contribution énorme à la ville et est restée
dans l’ opération jusqu'aux années 1960
La Société Tiberghien a connu un essor
considérable. Elle a la volonté de contrôler l’ ensemble de la filère laine,
depuis les régions de production jusqu'au négoce. Elle disposait ainsi de
bureaux d'achat dans les pays d'origine et de deux navires de flotte marchande
dont le " Charles Tiberghien ", du nom du fondateur de cette
Société
en 1853. source : C.H.L
Les Vanoutryve
Félix Vanoutryve,
1834-1912, d’une intelligence et d’un jugement exceptionnel, avait créé et
développé une affaire de tissus d’ameublement qui devint la plus importante de
France. Tous lui étaient très attachés ; il connaissait presque tous ses ouvriers, les conseillait
et les soutenaient matériellement avec la plus grande largesse. Il avait fait construire une grande maison de
style 1880 qu’il avait fait construire boulevard de la République dans un parc
proche de son usine.
Les Agache

Édouard Agache, né le
16 juillet 1841, Lille, décédé en 1923 (82 ans), filateur et tisseur de lin à
Lille, industriel chimiste, fondateur de la S.A. des Ets Agache-Fils,
administrateur de la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, présidents des Ets Kuhlmann.
Donat Agache a créé, en 1824, un négoce de lin à Lille, dans le quartier
Saint-Sauveur. Quatre ans plus tard, Il
s'établit en tant que fabricant dans le même quartier. En 1848, les
révolutions de février et juin entraînent une crise économique. À Pérenchies,
la filature Le Blan ferme. Donat Agache s'empresse de la remettre sur pied. Et
Pérenchies va devenir le fief de la dynastie Agache. La ville se développe en
même temps que l’ usine qui devient la plus importante entreprise française de
lin. Agache, lui, fait fortune. Donat Agache a plusieurs enfants dont un fils,
Édouard, qui reprendra l’ entreprise à la mort de son père. Il bâtira un
véritable « empire » du lin.
Les Dewavrin

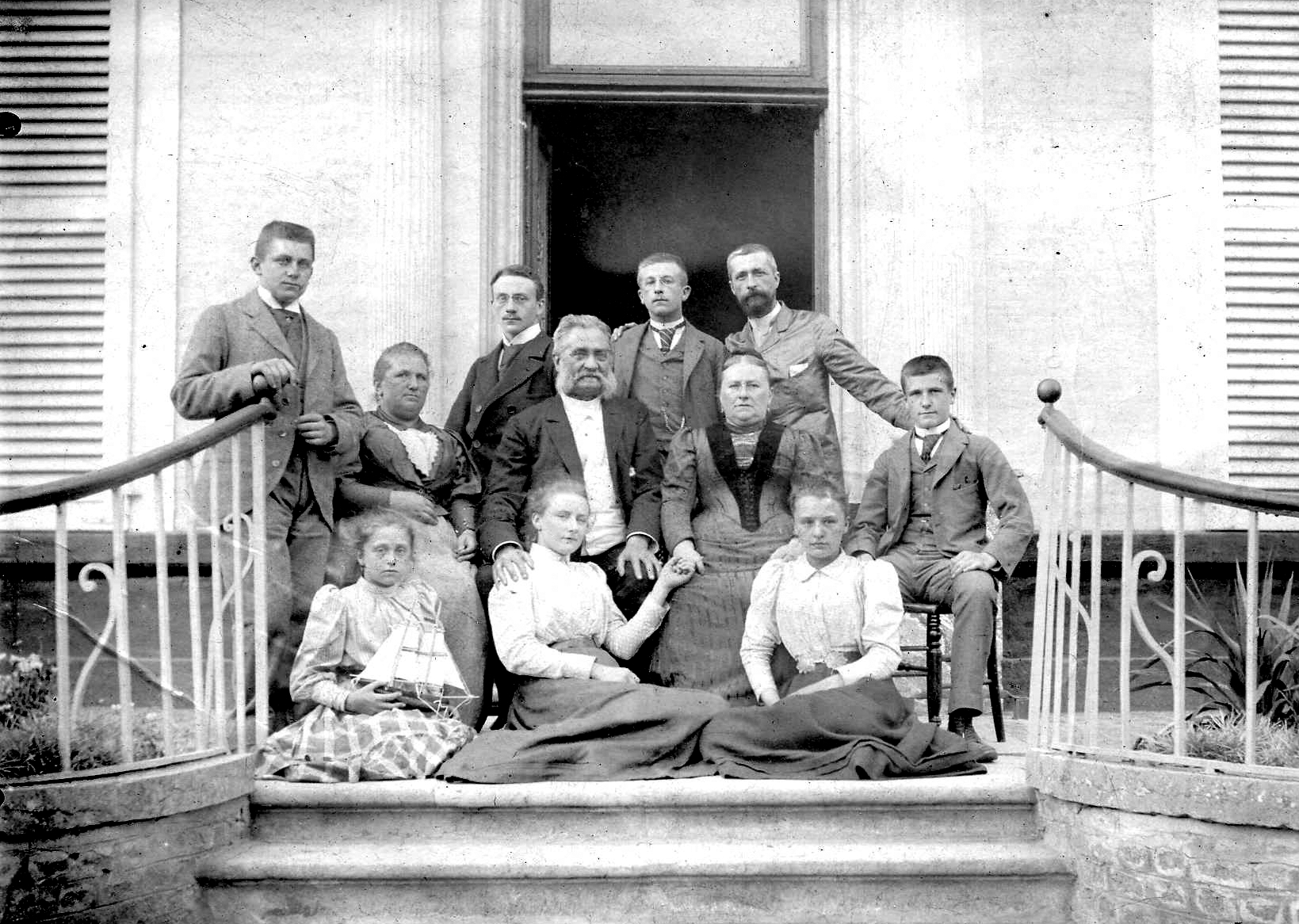

Photo Gonzague Lemaître
Anselme Dewavrin-Herbaux (1834-1896) , qui prit la suite de ses affaires, s'avisa en
1892 (comme d'autres négociants) qu'il serait plus profitable de se procurer
les laines sur les lieux de production;
il ouvrit en 1892 un comptoir d'achats a Sydney;
ses descendants en établirent un second en 1911 en Afrique du Sud. Mais
l'irrésistible ascension de la firme Dewavrin se produira après la Deuxième Guerre
Mondiale. L'idée d'aller chercher les laines dans leur pays d'origine (et donc
de court-circuiter Londres en évitant le paiement de commissions) n'était pas
nouvelle.
Le groupe fondé par Anselme
Dewavrin, que développèrent ses descendants. Ceux-ci, en 1955, se séparèrent en
deux branches autonomes.
La branche Anselme redémarre
l’activité traditionnelle de négoce sous la raison sociale Anselme Dewavrin
Père et Fils, puis Simptra Dewavrin. Il rachète parallèlement le Peignage de La
Tossée et le Peignage Alphonse Six, animés par Anselme Dewavrin Pollet. Il
développe une diversification dans la vente par correspondance : Le Vert
Baudet et Willems France. Ultérieurement, l’activité négoce a été rachetée par
le groupe américain Standard Tobacco. Cette même firme, gros négociant
producteur de tabac aux Etats-Unis, en 1995, après avoir tenté de vendre sa
division Laine à Chargeurs et d’autres, l’a tout simplement arrêtée.
L’autre branche, la famille Henri
Dewavrin Masurel, animée par Jacques Dewavrin Constant et ses frères, développe
parallèlement l’entreprise de négoce de laine sous le nom ADF. De négociant, la
famille devient industrielle en créant en 1963 à Auchel, dans la région minière,
un peignage de laine dont la capacité sera doublée en 1974. Ce peignage en son
temps a été le plus moderne au monde et le premier à être doté d’un système de
dépollution totale. En 1970, ADF rachète une autre affaire très connue de
négoce : la firme Emile Segard, qui disposait principalement de bureaux
d’achat en Amérique Latine. Le groupe rachète ensuite la Filature Française de
Mohair à Péronne dans la Somme à la famille le Blan et la Filature Van Den
Berghe à Roubaix. Ils s’associent avec les Prouvost dans le négoce / carbonisage
de sous-produits du peignage en rachetant la firme Comtex.
Jacques Dewavrin, époux de
Manette Constant, sœur d’Eugène, rachète en 1969 les Tissage Eugène Constant,
propriété de son beau-frère, puis la firme Dickson, qui fusionnent par la suite
sous le nom de Dickson Constant. Dickson était une société fondée en 1798, dans
la région de Dunkerque, par David Dickson, un Ecossais, qui se consacra, a
l'origine, a la filature du lin et au tissage des toiles destinées aux voiles
des navires. Dickson était une affaire cotée en bourse, propriété de la famille
Fremaux. Par la suite, le Groupe Dewavrin a cédé le Groupe Dickson à la firme
américaine Glen Raven Mills, propriété de la famille Gant.
Face
à la concurrence chinoise, à un euro
fort, aux contraintes environnementales et aussi aux changements de
générations
avec le cortège des droits de succession et des ISF, le Groupe
actuel a réussi
à assurer sa pérennité en s’étant
diversifié dans un pôle Lanoline / Cosmétique
/ Dermato-Pharma, animé par Christian Dewavrin et son cousin par
alliance
Ronald de Lagrange, époux de Christine Dewavrin.
L’autre branche de la famille Henri Dewavrin
Masurel a fait prospérer l’entreprise Pomona, leader français de la
distribution de fruits et légumes, animée par Henri et Jean Dewavrin.
Aujourd’hui leurs enfants ont repris avec succès le flambeau. Un autre cousin,
Olivier, avait fondé l’entreprise Surcouf, supermarché de distribution
informatique, aujourd’hui cédée au
Groupe Pinault.
Daniel
Dewavrin, fils d'André Dewavrin (Colonel Passy), à la
parenté pas vraiment établie avec les Dewavrin, cet
ancien élève de l'École polytechnique (X 1958,
SupAéro), diplômé du Centre de
perfectionnement dans l'administration des affaires et de Harvard
Business
School, est ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de
l'aéronautique. Il fut
ingénieur de l'armement au ministère de l'Air avant
d'accéder aux plus hauts
postes de direction de diverses sociétés, dont
Ratier-Figeac, Luchaire,
Bertrand Faure et EBF.
De 1999 à 2006, il fut le président de
l'UIMM-Union des industries métallurgiques et minières, la principale
fédération de l'organisation patronale MEDEF. Un poste de première importance
dans l'univers syndical patronal français.
En 1991, Avec 2.200 salariés et 3,5 milliards
de francs de chiffre d'affaires dont les trois-quarts dans le négoce-peignage,
le quatrième groupe textile français multiplie les lauriers: numéro deux
mondial en peignés, numéro deux européen en mohair.
Il est en outre l'heureux propriétaire de Dickson
Constant, évoqué ci-dessus, numéro un mondial en toiles de stores. En 1992, A.
Dewavrin fils et Cie fêtera le centenaire de sa présence en Australie. Un
privilège réservé aux meilleurs, même si le marché de la laine est entré dans
des zones de turbulences début février.
Daniel Dewavrin est
Commandeur de la Légion d'Honneur.
Les Lepoutre
ont eu un empire textile en Europe, Amérique
du Nord et du Sud.
Les usines et comptoirs Lepoutre dans le Monde:

Photo Jean Pierre LEPOUTRE
Jacques
Lepoutre (1893-1956) was born in Roubaix, France in 1893. He was son of
Auguste (1861-1932) et Jeanne Lepoutre (1869-1946) and nephew of Louis Lepoutre - owners of
Lafayette Worsted in Woonsocket and Auguste Lepoutre et Cie in France. After
distinguished service in World War I, Jacques married and moved to Woonsocket
in 1920. In the years between 1920 and 1922, Jacques built the Verdun Mill at 413 Manville Road. The mill carried on all
phases of textile manufacturing. It was the only French owned textile mill in
Woonsocket that actually wove cloth. By 1948, theVerdun employed 170 people.
Unlike the other French industrialist, Jacques Lepoutre lived much of his life
in Woonsocket. In 1922, he built a beautiful neo-classical mansion for himself and his bride off Roberts Street in
Bernon Heights. In the 1920's and 1930's, this house was the scene of many
elegant social affairs. He was a religious man who was active in his local
parish, Precious Blood Church, and in the development of Mount St. Charles
Academy. Jacques was President of the Verdun Mills from the day they opened
until his death in 1956. He is buried
in the Precious Blood Cemetery. This page utilizes information from: Woonsocket, Rhode Island - A
Centennial History 1888 - 1988 published by the Woonsocket Centennial
Committee in 1988. Woonsocket - Highlights of History 1800-1976 written
by Alton Pickering Thomas, MD and published by the Woonsocket Opera House
Society in 1973. For Woonsocket residents, both books are available at the Woonsocket Harris Public Library. Jacques Lepoutre s'installe à Woonsocket
(Rhode-Island) USA pour contourner les lois protectionnistes américaines sur
les filés de laine.A Brabant (Pierre Pouchain "les Maîtres du Nord")
9.05.06
French-Canadian Culture
Rhode
Island's connection to France and French culture dates to 1524 when French
explorer Giovanni de Verrazano explored the area around Block Island and
Newport. By the end of the seventeenth century, French colonies in the new
world extended from the St. Lawrence River to the mouth of the Mississippi
River. These colonies prospered by trading timber, furs and fish. After the
English defeated the French in the French-Indian War in 1763, "'la
survivance" - the perpetuation of French language and culture - became a
major priority for the French population in the new world.
Woonsocket had its first contact with
French culture in the late eighteenth century when the Ballous and Tourtellots,
French Huguenot families, settled in the area. The Ballous, especially Dexter and George, were pioneers in Woonsocket's textile
industry. As the textile industry in Woonsocket grew, so did the need for mill
workers. The first French-Canadian families were recruited from Quebec to work
in the mills of Woonsocket in the 1840's. Once started, this migration would
continue for almost a century.
The life of the French-Canadians in
Quebec was largely agrarian. It was a system where each household grew,
produced or bartered for everything the family needed to survive. As the
population grew and family farms could no longer support succeeding
generations, many left behind this self-sufficient life style for one based on
wage labor in the mills. Eventually, one third of Quebec's population left
Canada for mill villages in New England where they gathered in close-knit
ethnic communities. By 1900, sixty percent of Woonsocket's population was
French-Canadian and Woonsocket was the most French city in the United States.
In Woonsocket, these immigrants were
textile workers instead of farmers, but everything else remained the same.
French was the language that they spoke and life centered on family and the
Roman Catholic Church. The first French-Canadian parish in Woonsocket was
"Precieux Sang" - Precious Blood Church - established 1872. Eventually,
Woonsocket had five French-Canadian parishes - Precious Blood, St. Anne, St.
Louis, Our Lady of Victories and Holy Family. Through the church,
French-Canadian heritage and traditions were passed down to succeeding
generations and "la survivance" thrived in Woonsocket.
The French-Canadian focus on spiritual
rather than material wealth was a godsend for mill owners. Even in the best
times, life in the mills was difficult and unhealthy. The workday was long. The
air was full of flying lint particles that often caused respiratory disease. It
was cold and drafty in winter, hot and humid in summer; dirty, noisy, and
uncomfortable at all times. While labor strife was common in textile cities
across New England at the turn of the century, Woonsocket remained relatively
calm. It was not until the 1930's with the collapse of the area's cotton
industry and the arrival of skilled trade unionists from Belgium that labor unions became and active force in the
community. Even then, these workers continued to define themselves first as
French-Canadians, and second as industrial workers in American society.
Today, French-Canadians are still the
largest ethnic group in Woonsocket and the city is proud of its French-Canadian
heritage.
This page utilizes information from:
Steeples
and Smokestacks - A Collection of Essays on the Franco-American Experience in
New England edited by Claire Quintal and published by the
Institute Francais, Worcester, 1996.
A History
of Rhode Island Working People edited by Paul Buhle, Scott Molloy, and
Gail Sansbury and published by Regine Printing Co., Providence, 1983.
Triomphe
et Tragedie: A Guide to French, French Canadian and French-Huguenot Sites in
Woonsocket written and published by Robert Bellerose,
Slatersville, RI.
Woonsocket - Highlights of History
1800-1976 written by Alton Pickering Thomas, MD
and published by the Woonsocket Opera House Society in 1973.
Lafayette Mills (The mill in the back later become part of the Argonne
Company) Hamlet Avenue

The President of Riverside Worsted from
1935 until it ceased operation in 1952 was Eugene Bonte. Bonte and his family
moved to Woonsocket from France in 1928. When Riverside Worsted closed in 1952,
Bonte purchased the assets and reopened the company as Bonte Spinning Company.
The Bonte family operated the mill until 1974.

|
Riverside Worsted Mill, Fairmount
Street, (c. 1907), Industrial
family reunites in Woonsocket
|
|
|
Saturday, 11 July 2009, Industrial family reunites in Woonsocket By JOSEPH B. NADEAU
|
|
WOONSOCKET — The
corner of Florence Drive and Hamlet Avenue has experienced radical change in
the past year while becoming a future entry point to the city’s new middle
school complex.Construction of the new school buildings just off Hamlet erased
most of the old mill complex that occupied the location but there are still
plenty of people who remember when the Lepoutre family helped push the city
to the height of its success in the New England textile industry. The
Lepoutres also remember their role in that city era and decided to hold a
family reunion at the Museum of Work and Culture recently while visiting
local sites remaining from the family’s role as leading textile
manufacturers. “This means a lot to be able to gather the family back
where it has its roots, it really does,” Catherine Lepoutre, one of the
returning family members said while taking a tour of the Museum. The
Museum has displays telling the story of French Canadian farmers making their
way south to work in Woonsocket’s mills and how they lived here once they
arrived. The Museum also holds information on the city’s ties to France
during the world wars with displays such as the Merci Boxcar and the arrival
of industrial investors like the Lepoutres. The boxcar, now used for multimedia
presentations, was once part of a trainload of French gifts of gratitude for
each American state France after the war ended.The Lepoutres did not
establish Woonsocket as a major manufacturing center situated on an s-curve
of the Blackstone River but they did bring a new look to its industry upon
their arrival from France at the turn of the 20th century.
The Lepoutres were initially encouraged to bring their manufacturing
operations to the city by Woonsocket resident and Governor of Rhode Island
Aram J. Pothier, according to Raymond Bacon, co-curator of the Museum with
Ann Conway.
Pothier was a named a U.S. representative to the Paris Exhibition of 1899 and
during his visit invited French manufactures to relocate some of their
operations to the city as a way to avoid import tariffs they would otherwise
pay to do business in the United States, Bacon said. Brothers Louis and
Auguste Lepoutre responded with the founding of the Lafayette Worsted Mfg.
Co. off Hamlet not long after. The mammoth complex would eventually be split
into two companies, the Lafayette Worsted Spinning Co. and the Argonne
Spinning Co., Inc. which operated until the textile industry began to move
out the city or shutdown in the 1950s.
The Lafayette mill buildings were converted to other production uses
under ACS Industries and Miller Electric in later years and were ultimately
leveled by two major fires and the wrecking crane making room for the city’s
soon to be finished $80 million middle school project.
Today only the Layfayette mills office building on Hamlet and the small
guard shack up the street remain of the sprawling complex. The new schools
rise just three stories compared to old mills’ four and five stories but do
hold some architectural features such arches atop some of their windows to
recall the history of the district.
Auguste Lepoutre’s son Jacques Lepoutre also came to Woonsocket to
found a textile plant after he completed his service with the French Army
during World War I.
Jacques Lepoutre, a native of Roubaix, France, received the Legion of
Honor Medal and many other tributes for his war service. He was wounded by
the explosion of a shell in the war but recovered.
In Woonsocket, he founded the Verdun Mfg. Co. at 413 Manville Road, a
textile plant that later became the Ocean State Dye house on Manville Road.
Above the plant, Jacques constructed the family mansion, a large
building dominating the Bernon Heights area and known as a city show piece.
The mansion would later become home to the Club Canadien and the Mercy
Hospital, the forerunner of Fogarty Hospital in North Smithfield. Today it is
part of Mount Vernon Apartments off Roberts Street.
While used as a home, the mansion had a tunnel running up to Mount St.
Charles which allowed the Lepoutre to go to school without having to suffer
inclement weather, family members recalled during their visit.
Monique Lepoutre, 80, a resident of France and the wife of Louis’ son
Roger, came to Woonsocket to visit her relatives initially back in 1930s and
returned several times over the years.
On her most recent trip she brought along her son, Jerome, and his family to
learn of their family’s role in the local textile trade.
“It was very wonderful. We can just imagine what was going on here but it was
more than that. It was nice to experience a welcome home from our family
members,” Jerome said.
Monique said her home city is similar in many ways to the faded textile
town of Woonsocket. The mills that once made fabric there have also moved
away to other countries and the struggle is to find new industries to replace
them.
The family members were given an overview of the Lepoutre contributions
to the city’s textile industry by Bernard Fontaine, a former finance employee
of the Verdun Mill family business and now a volunteer at the Museum, and
also took a tour bus ride see old family properties and other sites in the
city.
The Verdun mill employed more than 300 textile workers at the height
of its success and made top-quality worsted materials such as its blue serge
used in men’s suits and later a khaki cloth used in military uniforms after
the start of World War II. “They were wonderful to work for,” Fontaine said
while recalling the busy textile manufacturing business that remained in
operation at the site until 1963. The plant’s three shifts did every thing
from making and coloring the woolen thread to weaving and finishing the cloth
it sent out to customers, he noted.
Jean-Luc Lepoutre of Salem, Mass., had lived in Woonsocket while his
father, Raymond Lepouture, ran one of the mills. To this day he remembers it
as a nice place to work and one where people knew each other and their
community.
There was also a sense that an era was ending. “We knew at that time we
were not going to be working in textile industry much longer and we were
going to have to find something else to do,” he said.
George C. Lepoutre of Bethel, Conn., had also lived in Woonsocket
during those years while his father, George E. Lepoutre worked in the plants.
He recalls the three large mills of the Lafayette complex were still be
standing when he visited the city several years ago and was surprised by the
recent changes.
“The changes have been very dramatic,” he said of the demolition
project that cleared the site for new schools.
Catherine, who toured the sites with her sons, Richard and Clement,
said it was sad to see the change from the old industrial use but also good
to know the area would be put to a new use.
“I think we have to think of the general of today. The children are the
future of the United States and they have to get a good education,” she said.
Richard Lepoutre of Old Saybrook, Conn., can still remember of the
smell of wet wool from when he would enter his grandfather’s old textile
plant as boy and cherishes the family history he has learned over the years.
His grandfather, Jacques, had joined the army two years before the start of
World War I and had been proud of his service later in life.
“I still have my grandfather’s Kepis helmet from World War I and his
ornamental sword,” he said. “He survived the Battle of Verdun and that’s why
he named his plant here the Verdun mill,” Richard Lepoutre said.
http://www.woonsocketcall.com/content/view/94818/1/
|
Les Thiriez
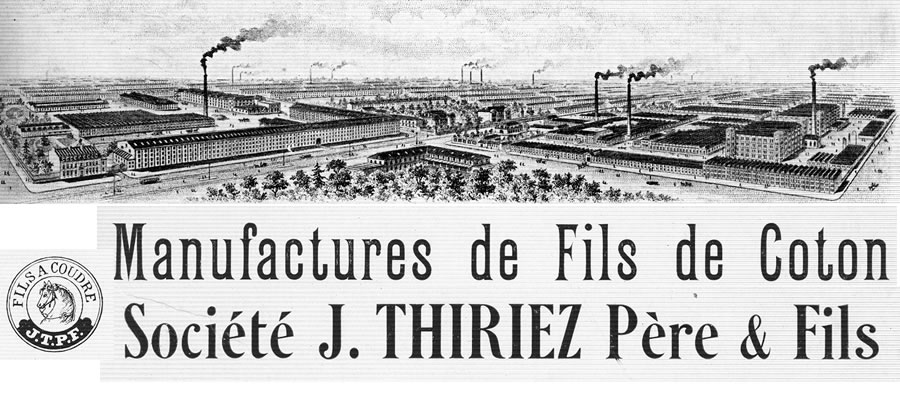
fut la 1ère société en France à fabriquer
les fils pour machine à coudre et dépose un brevet pour une machine à glacer
les cotons fins inventée par un THIRIEZ, avec sa femme, dans leur cuisine, à
partir d'une sauce permettant de glacer le fil de lin. La machine à vapeur a
une puissance de 1.000 chevaux-vapeur. L’ usine d'Esquermes s'étend
progressivement sur 6 hectares, en partie sur l’ ancienne ferme Plattel. Des
bâtiments de 4 étages et 12 m de large s'étendent sur 142 m route de Béthune et
46 m rue de l’ Epinette. Les cotons sont achetés aux Etats-Unis à Andrew Law
& Co, à Savannah. Le transport pouvait prendre 5 mois. 1863 : visite de l’ Empereur
Napoléon III aux ateliers d'Esquermes.
L’ usine de Parvomaï employait 150 personnes. En 1922, DMC est cotée à la
bourse de Paris. En 1961, elle fusionne avec la société lilloise Thiriez et
Cartier-Bresson. L’ entreprise mulhousienne garde sa raison sociale mais
remplace son logo, une cloche, par celui de Thiriez, une tête de cheval. Dans
les années 1960, le groupe va compter jusqu'à 30 000 salariés. Xavier Thiriez
fonde en Colombie, en association avec la famille Médina, la filiale Satexo (Compania Textil Colombania SA), avec une usine de fil à coudre à Itagui (Médellin) et un réseau de
six dépôts régionaux. SATEXO, avec Léon Thiriez, développe ses activités
industrielles en amont et en aval. 20 ans plus tard, la société comprendra 1400
personnes et 30.000 broches, avant la crise du textile Colombien des années
1980. Dans les années 1960, Xavier Thiriez développera ses ventes au Panama et
au Salvador.
Ce sera la seule
implantation de TCB à l’ étranger.
Les Desurmont
Jules Desurmont and
Eugene Bonte, The next of the French industrialist to set up operation in
Woonsocket was Jules Desurmont. Desurmont founded Jules Desurmont Worsted
Company, later Riverside Worsted Company, in 1907. Like the Lafayette Worsted
and the French Worsted, the corporate headquarters remained in France and
Desurmont speut little time in Woonsocket. The company built a massive mill at
84 Fairmount Street, across the street from the Alice MIl l. Built of concrete with a brick veneer, the building
was virtually fire proof. Desurmont Worsted spun yarn using the french
process" and employed 350 people in 1910. The company was reorganized in
1935 and its name was changed to Riverside Worsted Company. It was still owned
and controlled by Jules Desurmont et Fils of France.
Les Flipo
Jean François Flipo
1792-
1867, filateur , Conseiller général, fondateur de la fortune de la
famille qui créera pendant 140 ans des milliers et des milliers d’emplois;
crée sa filature, utilise une des toutes premières machines à vapeur, délaisse
le négoce de son père pour une filature, s’installe dans une grande maison au
99, rue de Tournai à Tourcoing, épouse
Adélaïde Cécile Holbecq,-1803-1892).
Les Charles Julien Flipo, (1859 Tourcoing 1928,
Tourcoing), filateur de coton époux 1883 avec Marie Sophie Prouvost. Dès 1882, il prend à 23 ans la succession de sa grand-mère
Holbec chez Flipo Fil s ainé (ses deux frères Romain et Joseph, créeront rue du
Touquet à Tourcoing la filature de laine Flipo frères ; il préfèrera céder toutes ses parts à ses
cousins et créera avec son frère François une autre fil ature en 1892 ; en
1912, elle comptait 500 ouvriers ; peu avant la première guerre mondiale,
son enteprise était équipée de 62.000 broches à filer et 20.000 à retordre.
A l’apogée du système, les entreprise de
peignage de la laine de la circonscription produisaient 85% de la production
française de laine peignée ; les étoffes vont porter la réputation de la
région dans le monde entier pour ses étoffes de luxe et de pure laine peignée.
Les Wibaux
Désiré Hippolyte Wibaux 1787-1848, épouse en 1811 Félicité Hyacinthe Florin 1790-1847: « Industriel, il avait considérablement amélioré les
techniques de filature et deux ans avant sa mort, il inaugurait rue Saint-Antoine, une immense
usine qui employa jusque 1.200 ouvriers
en 1910, qui était dotée d'une salle d'allaitement, qui fut par la suite
intégrée à l’ empire Lepoutre avant de devenir l’ hôtel d'entreprises familier
de tous les habitants de la Fosse aux Chênes. Désiré Wibaux possédait également
un hôtel particulier au Fontenoy que ses descendants léguèrent à la Ville et
dont l’ emprise est aujourd'hui le parc de Cassel. Un de leurs fils , Théodore Louis Wibaux
participa à l’ évangélisation de la Cochinchine et construisit le Grand Séminaire
de Saïgon. Il est enterré depuis
1878 à Saïgon. Son neveu Théodore Wibaux, le fils de Willebaud Wibaux-Motte,
fut zouave pontifical et jésuite.
Pierre Achille Valéry Wibaux né le 12 janvier 1858
à Roubaix décède le 21 mars 1913 à Chicago Fondateur de Wibaux city dans le Montana, éleveur de 50.000 têtes de bétail,
ami du futur président Roosevelt son voisin, président de deux banques
fédérales des USAs. le 13 mars 1884 à Douvres épouse Mary Ellen Augustine
Cécile Cooper
10-2-2-1 dont un fils Cyril Wibaux né à Glendive le 23 septembre 1885 meurt
vers 1920 sans descendant.
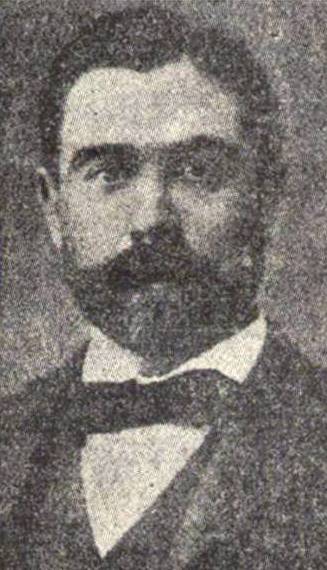
Éleveur de bétail aux USA, fondateur à Miles City de la State National
Bank, né en 1858 – Roubaix et décédé en 1913 - Chicago (USA) : on était 12
miles au nord de la ville de Wibaux et là il s'est étendu 60,000 tête de
bétail. Après un début échoué, son bétail s'est finalement étendu sur la terre
de 1883 à 1886. Après sa mort en 1913, homesteaders coupe (diminution) dans ses
tenues de terre et champs (domaines) de blé énormes établis et
agriculture(élevage) déplacée en avance d'élevage de bétail.
Il y a une statue de neuf pieds consacrée à lui à son gravesite.
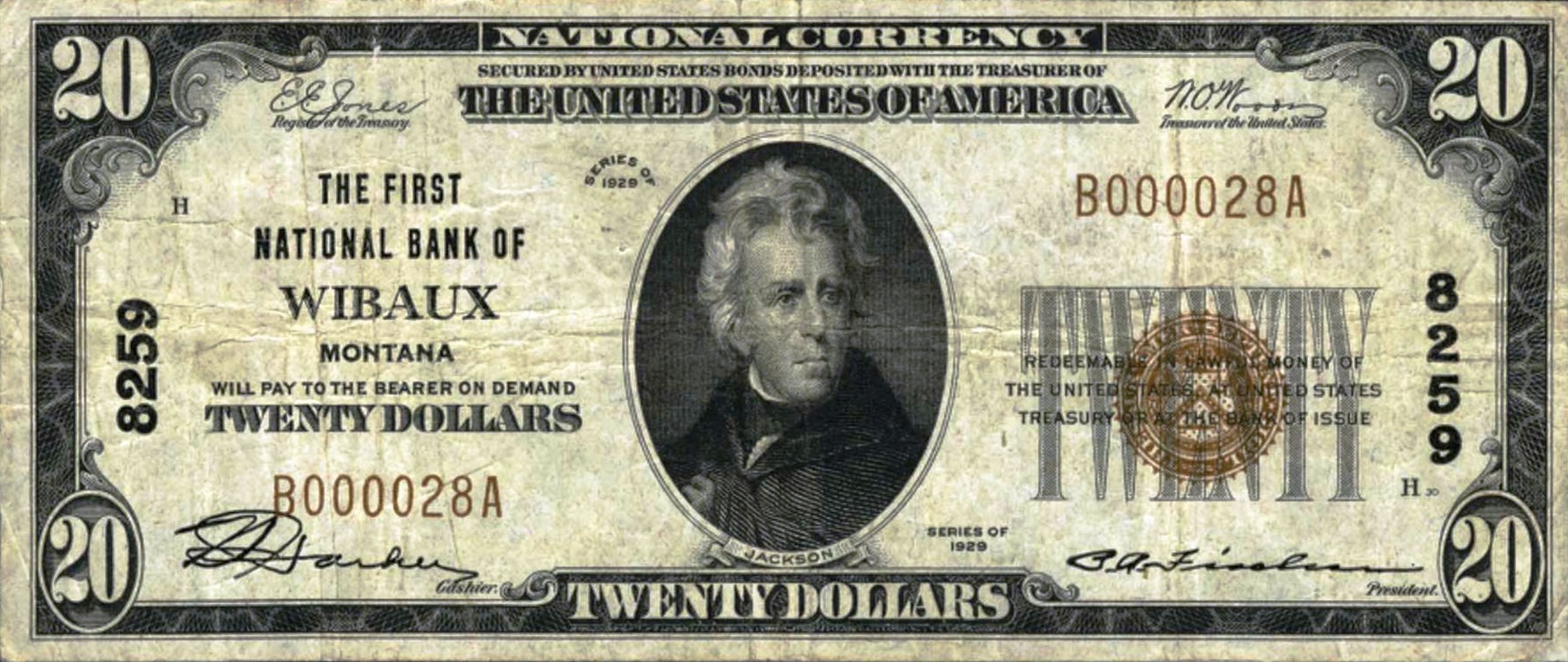
Photos Ferdinand Cortyl
Les Lestienne
Firmin Lestienne, fils
de Voldemar, cousin germain de Pierre-Amédée Lestienne-Prouvost, fut président
Fondateur de La Licorne en 1907, administrateur de la Compagnie des Mines de
Campagne, a eu une usine de coton dans le Nord de France ; il racheta
l’usine CORRE; une bombe atteint l'usine le 31 décembre 1943.



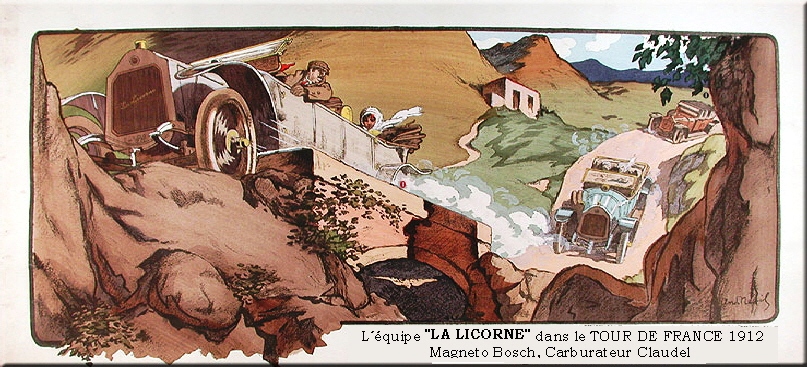
N0.14 Firmin Lestienne sur Corre-La
Licorne
Il a fait travailler ses deux
fils : Robert ; et Waldemar qui aurait été ingénieur aux études
chez Corre, puis fondateur de La Licorne (avec son père) en 1907, Membre du
Conseil d'Administration de La Licorne à partir de 1907, également Président du
Conseil d'Administration de la Compagnie des Verreries et Manufacture de Glace
d'Aniche ; Directeur de la Compagnie des Mines d'Aniche, Censeur à la Banque de
France. CORRE & LA LICORNE auront réalisé 187 modèles différents, et
produit un peu plus de 38.000 véhicules de 1901 à 1949. http://www.la-licorne.de
http://corre-lalicorne.com/FR%20Corre-La%20Licorne.html#France
L’
Exposition Internationale de Roubaix du 30 avril au 6 novembre 1911
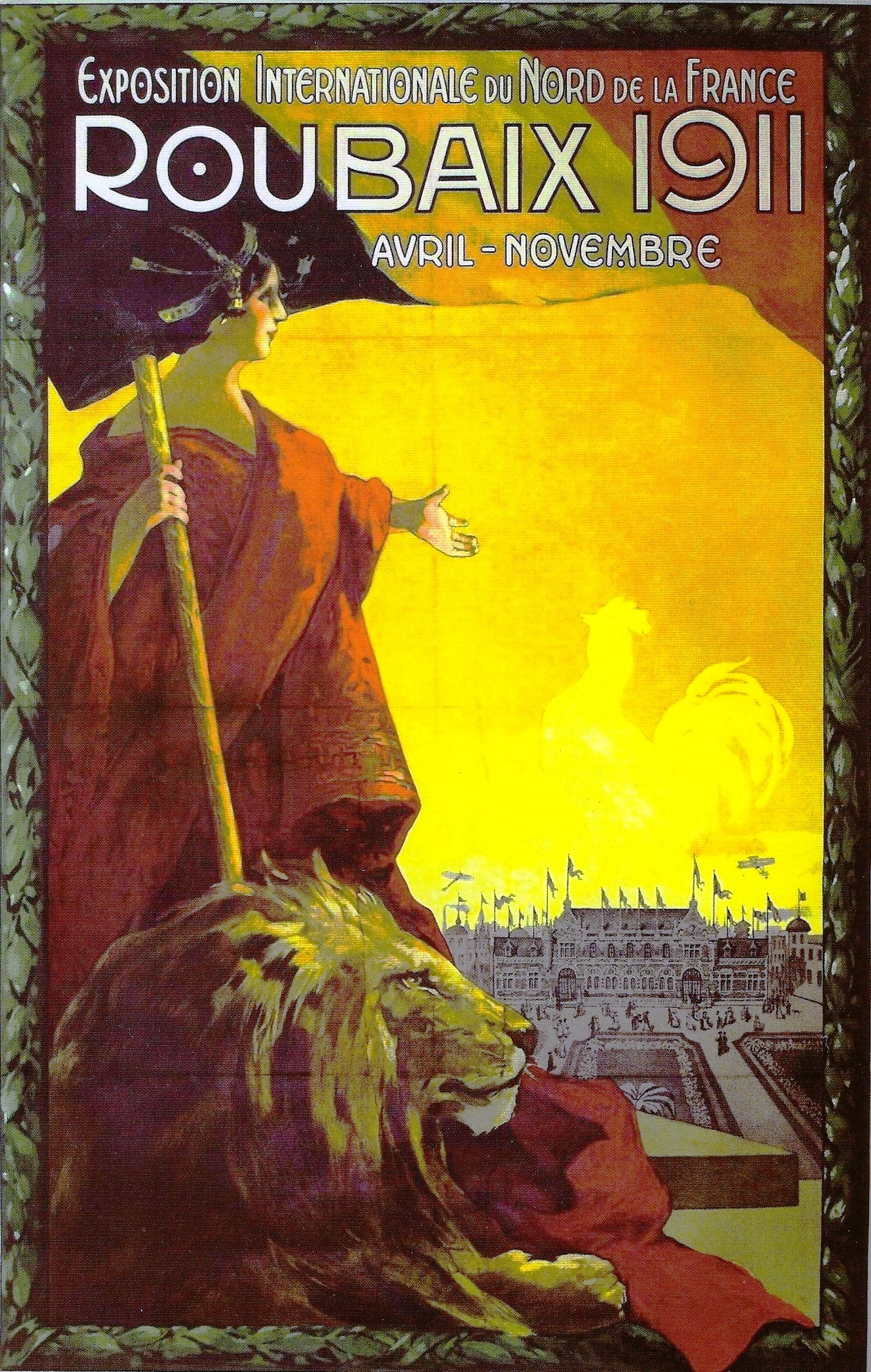
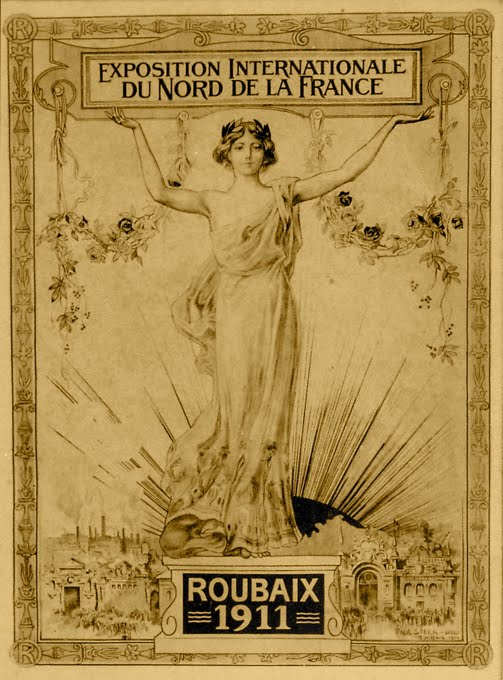
L’ Exposition
Internationale du Nord de la France s'est déroulée à Roubaix du 30 avril au 6 novembre 1911. Pendant six mois, dans le Parc de Barbieux, Roubaix vivra au rythme de son exposition visitée par
deux millions de personnes. L’ historien Philippe Waret raconte.
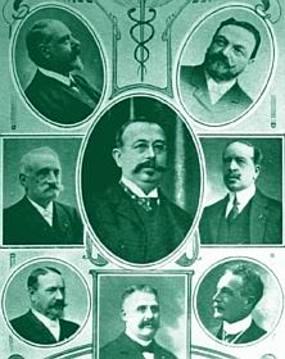
Eugène Motte et
François Roussel.
Eugène Mathon,
Florent Carissimo et Albert Prouvost.
Edouard Roussel,
Félix Chatteleyn et Gilbert Sayet.
Le 30 avril 1911, après
avoir inauguré l’hôtel de ville, et après un banquet dans les locaux de la
chambre de commerce, le ministre du Commerce, M. Massé, s’en va visiter
l’exposition. Le voici à son arrivée sur les lieux accueilli par Eugène Motte,
maire de Roubaix
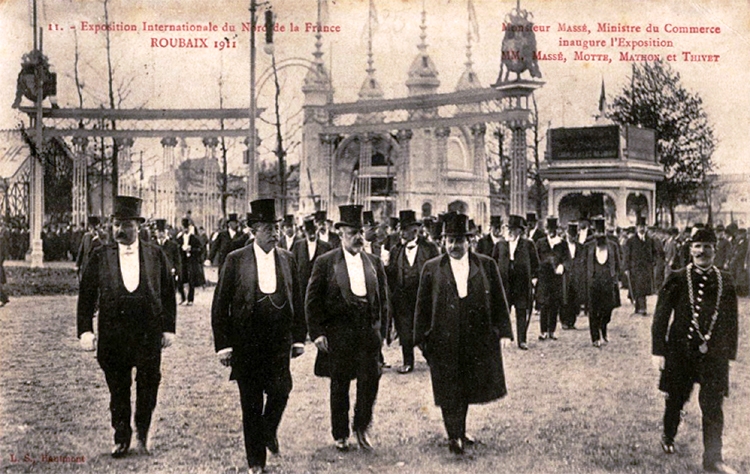
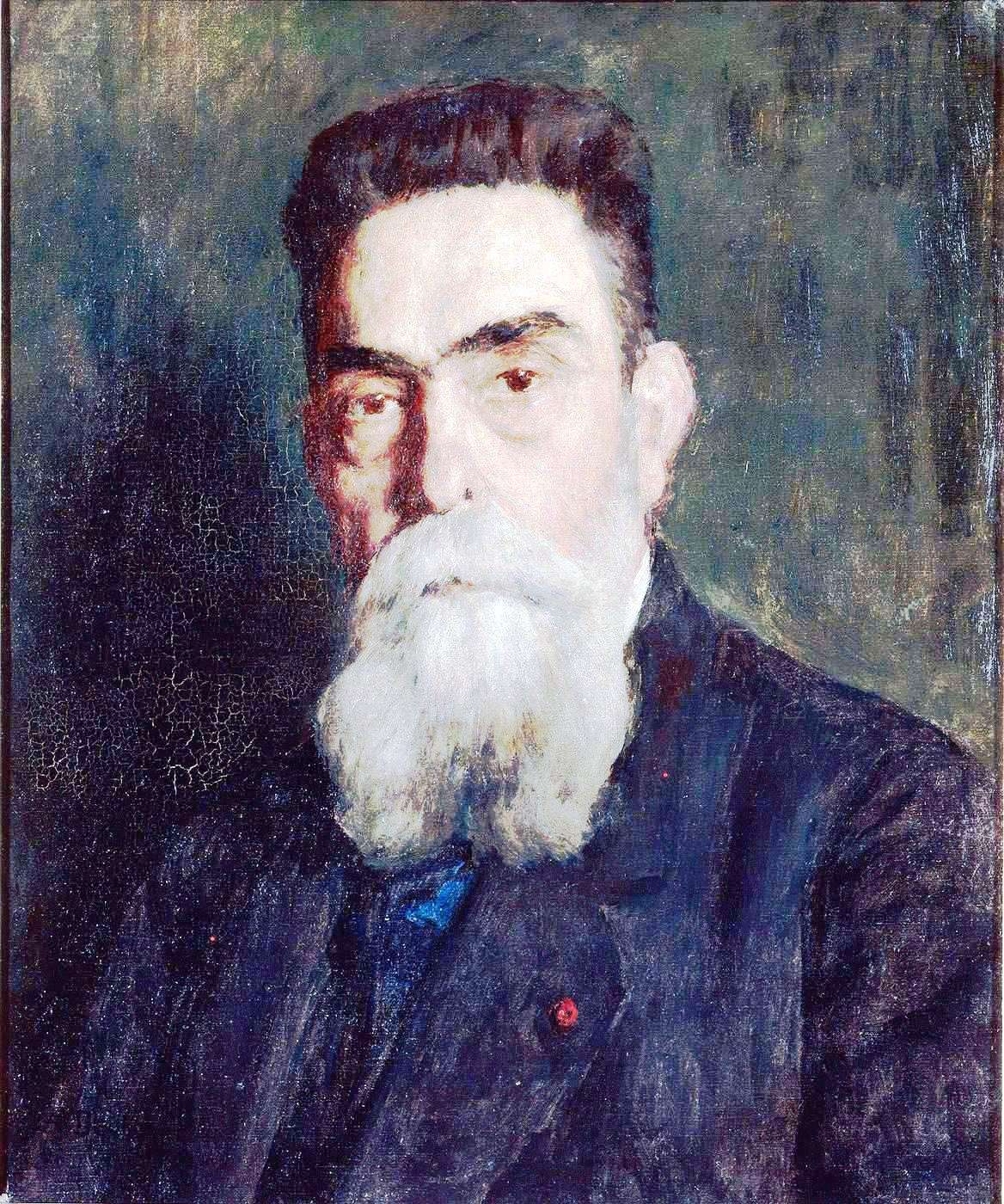
L’architecte Victor Laloux ici portraituré par le peintre Louis Adolphe DESCHENAUX dit DÉCHENAUD, mena à bien la construction de l’hôtel de
ville et conçut les plans de l’exposition internationale de Roubaix.
« Victor-Alexandre-Frédéric Laloux
(Tours, 15 novembre 1850 - Paris, 13 juillet 1937) est un architecte français.
Il est l'élève de Louis-Jules André à l'École
des Beaux-Arts de Paris à partir de 1869. Ses études sont interrompues par la
guerre franco-prussienne de 1870. Il remporte le premier grand prix de Rome en
1878. Le sujet de l'épreuve finale s'intitule « Une église cathédrale ».
Le jeune lauréat devient pensionnaire de
l'Académie de France à Rome, de janvier 1879 au 31 décembre 1882. Son envoi de
quatrième année sur Olympie lui valut une médaille d'honneur au Salon de 18851.
Bras droit, puis élu successeur d'André, à la
mort de ce dernier en 1890, il mène à son tour de nombreux élèves au grand
prix. Il est élu membre de l'Académie des beaux-arts en 1909. Comme praticien
et professeur, Laloux devient l'un des représentants les plus marquants de
l'académisme triomphant de la Belle Époque. Il participe à de nombreux jurys
officiels et préside plusieurs sociétés d'architectes et d'artistes (par
exemple Société des artistes français ou la Fondation Taylor). Il conserve la
direction de son atelier jusqu'en 1936, date à laquelle il passe le flambeau à
son élève et ami Charles Lemaresquier.
Fervent utilisateur du métal, il choisit
prudemment de le dissimuler derrière des façades de pierre à l'ordonnancement
classique, à l'instar de ses contemporains Henri Deglane, Albert Louvet et
Albert-Félix-Théophile Thomas pour le Grand Palais. Il réalise ainsi :
Les hôtels de ville de
Roubaix et Tours.
La basilique
Saint-Martin à Tours.
Les gares de Tours et
d'Orsay (1900) à Paris (actuel musée d'Orsay).
Le siège central du
Crédit lyonnais, à Paris, entre le boulevard des Italiens et la rue du
Quatre-Septembre.
L'ambassade des
États-Unis, avenue Gabriel à Paris, en collaboration avec l'architecte
américain William Delano.
Villa des bambous, 65
boulevard de la Croisette à Cannes vers 1888 (détruite)
Monument aux morts,
jardin du Plateau des poètes à Béziers en 19253
Pour le décor de ces
bâtiments, il fit appel à différents sculpteurs et peintres tels que Henri
Martin, Jean-Paul Laurens, Fernand Cormon, Pierre Fritel etc » Wikipedia
Le 26 février
1909, le maire Eugène Motte

soumet en conseil
municipal un projet d'exposition, dans le genre de celles d'Arras,
Tourcoing, Bordeaux, sous le patronage de la Ville de Roubaix, de la Chambre de
Commerce, et sous l’ égide du gouvernement français. Ce sera une Exposition
textile et industrielle, mais elle célébrera également les oeuvres sociales,
les beaux arts... L’ opposition réagit : « Qu'en est-Il du projet de Lille ? Quel sera l’ emplacement
de l’ exposition ? Les commerçants roubaisiens en profiteront-Ils ? » Eugène
Motte répond que Lille a accepté de
s'effacer en bonne camarade, et que l’ emplacement fera l’ objet d'une étude.
Après quelques débats vigoureux, le principe de l’ exposition est adopté à l’
unanimité, fait rare dans les délibérations municipales de l’ époque.
Le 19 mars 1909,
Gilbert Sayet présente l’ avancement du projet. L’ Exposition se déroulera dans
le cadre du parc de Barbieux, bien desservi par les tramways.
Le programme
prévoit quatorze groupes d'exposants, des attractions, des fêtes et des
congrès, qui auront des répercussions sur le commerce local.

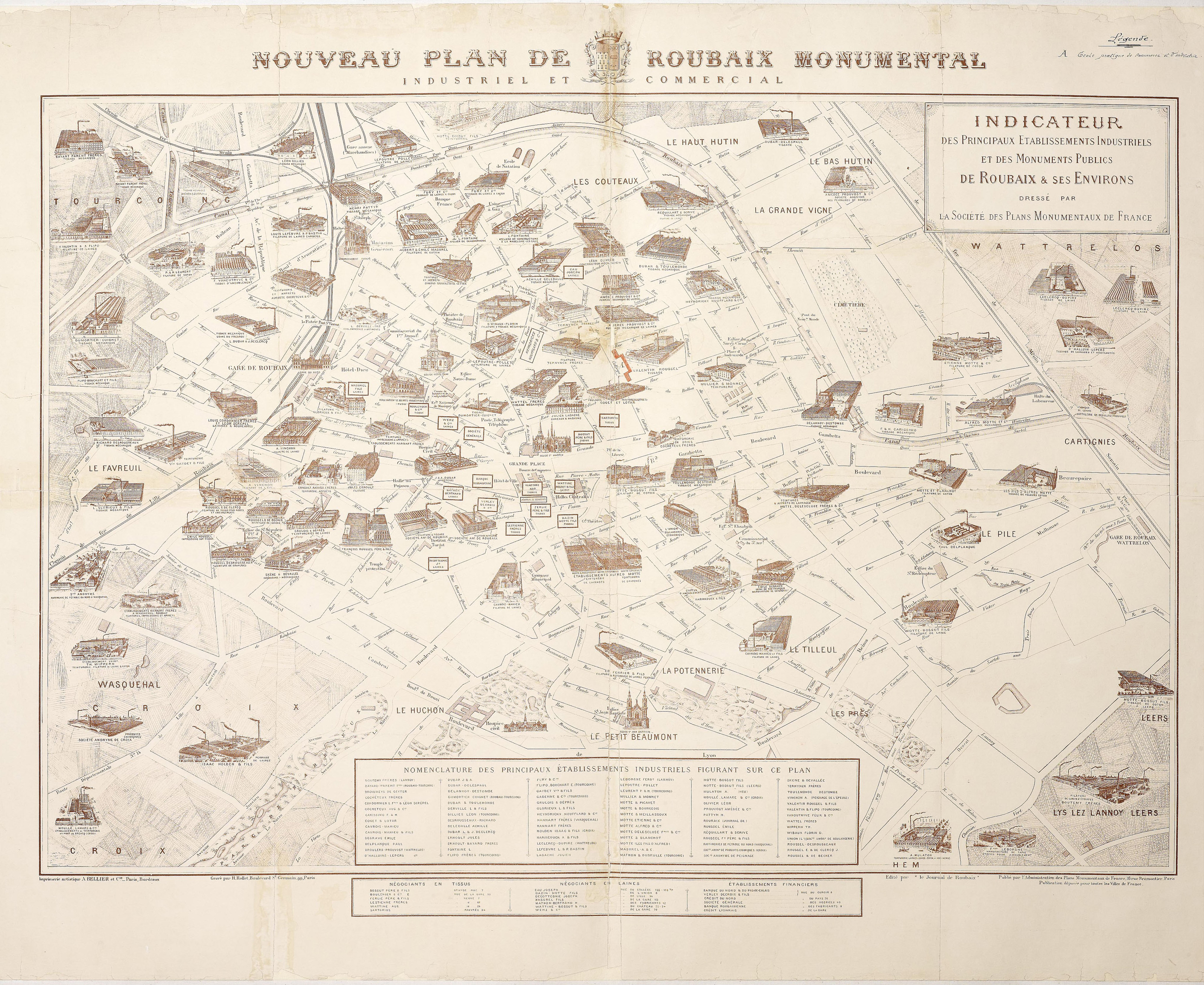
Contre-proposition
La minorité
collectiviste fait une contre-proposition avec les terrains de Maufait, avec un
éloge appuyé de la rue de Lannoy et de ses commerces.
Cette
proposition est rejetée. Pour Eugène Motte, le premier objectif à atteindre
c'est la réussite de l’ Exposition. « Quand la réputation de l’ Exposition sera
bien assise, vous pouvez être certains (...) que tout le commerce roubaisien en
tirera grand profit », déclare-t-Il .
Jean Lebas pose
alors la question du budget, on lui répond que le bénéfice n'est pas le but de
l’ exposition, ce serait un excellent résultat que d'équilibrer dépenses et recettes. Eugène Motte surenchérit : « les
Expositions ne sont pas des entreprises classiques, c'est l’ inconnu, c'est un
peu le jeu du tirlibibi, ou comme pour la pêche à la ligne, on ne peut avoir
une certitude absolue du succès. » Le projet est adopté à l’ unanimité, sauf
sur la question de l’ emplacement, qui fait l’ objet de l’ abstention de la
minorité.
Le
4 mai 1909,
un comité d'initiative est constitué : le
Président est Eugène Mathon,
beau-frère d'Eugène Motte, et ce comité regroupe
la majorité des grands noms du
textile roubaisien. Un directeur général
d'expérience est nommé : Il s'agit d'E.O Lamy qui a
déjà travaillé pour
les expositions internationales d'Arras et de Tourcoing. Le 27 mai
1909, une
délégation roubaisienne se rend à Paris, et elle
obtient l’ appui du
gouvernement. Le mois précédent, une présentation
du projet a été applaudie
lors du banquet annuel de la chambre syndicale des tissus et
nouveautés de
France. Le 1er septembre, les Chambres de Commerce de Paris, Lyon,
Marseille ,
Rouen, Bordeaux, Reims, Orléans apportent leur soutien aux
roubaisiens. Le 29
octobre, MM. Motte, Mathon et Lamy sont à Bruxelles pour
solliciter la
participation belge. Le 11 novembre, les voici à Paris, en
visite chez les
personnalités du commerce de l’ industrie et des syndicats
parisiens. Le 25
janvier 1910, Eugène Mathon informe la presse que « la
surface prévue a déjà
augmenté, qu'il y aura des pavillons coloniaux,
un parc d'attractions, un grand palais textile de 14.000 m²...
» Le 3 avril 1910,
Eugène Motte planche avec succès devant l’ union
des syndicats patronaux
textile s à Paris. Il semble bien que l’ Exposition
internationale de Roubaix
fasse l’ unanimité. Petit bémol, le 1er octobre
1910, le maire de Roubaix
n'obtient du Conseil Général que la
moitié de la subvention attendue. Mais cela n'altère pas
l’ avancement du
projet. »
Chroniques:
Soutiens et comités

Eugène Mathon
« Le 4 mai
1909, c’est donc décidé, l’ Exposition sera implantée dans le cadre du parc de
Barbieux, auquel on ajoutera huit hectares de location. Un comité d’initiative
de quatorze membres est alors constitué. On y trouve des hommes de compétence :
le président du tribunal de commerce Eugène Mathon, les industriels Florent
Carissimo, Albert Prouvost, Georges Motte, César Pollet, les adjoints Roussel,
Chatteleyn et Sayet, le président du syndicat des fabricants Joseph Wibaux, le
directeur de l’ union des teinturiers Gaucher, le constructeur Louis Delattre,
l’ entrepreneur Henry Glorieux et l’ ingénieur Vandamme-Carissimo. On se trouve
là en famille. Soit par les liens de famille, Eugène Mathon est le beau-frère
d’Eugène Motte, Georges Motte-Delattre son cousin. Les liens du textile et de
l’ industrie, Florent Carissimo, Albert Prouvost, César Pollet sont les grands
noms du textile roubaisien, sans oublier l’ appartenance politique, les compagnons
de l’ Union Sociale et Patriotique, Roussel, Chatteleyn et Sayet.

E O Lamy
Un
directeur
général d’expérience est nommé :
Il
s’agit d’E.O Lamy qui a déjà travaillé
pour les expositions
internationales d’Arras et de Tourcoing. Parallèlement, il
s’agit aussi d’aller solliciter des soutiens
et des engagements. Le 27 mai 1909, une délégation de la
municipalité de
Roubaix se rend à Paris. Elle est présentée par le
sénateur du Nord Trystam au
ministre du commerce M. Cruppi. Ce dernier promet l’ appui et le
concours du
gouvernement. Le mois précédent à Paris, dans les
salons Marguery, une
présentation de l’ équipe des organisateurs de
l’ exposition de 1911 a été
applaudie lors du banquet annuel de la chambre syndicale des tissus et
nouveautés de France.
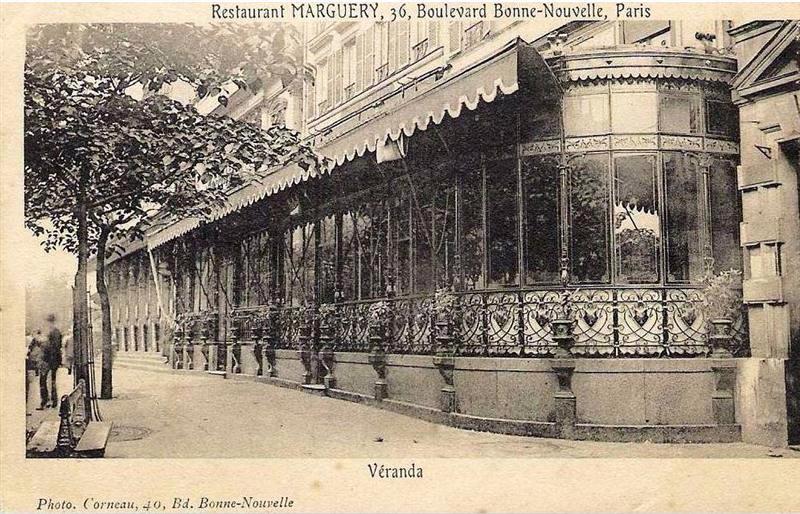
« Le restaurant du grand
chef Jean-Nicolas Marguery fut, jusqu'à la mort de son créateur en 1910,
l'épicentre de la vie parlementaire et mondaine parisienne. Outre ses deux
vérandas sur le boulevard, il disposait d'une entrée discrète sur la rue d'Hauteville.
Des salles égyptiennes, flamandes, gothiques ou mauresques voyaient se croiser
des députés, des sociétés savantes et des mondaines dans une ambiance joyeuse.
Certains de ces salons existent encore; on ne peut, hélas, pas les voir car ils
sont occupés par une banque. »
Le 22 juillet
1909 est institué par arrêté municipal un comité consultatif pour l’
exposition, dont la mission est d’étudier les questions soumises par le comité
d’initiative et le commissariat général. Le recrutement est ciblé : le Président
est Henry Ternynck, qui est le Président de la société industrielle de Roubaix.
Il est assisté par cinq vice-présidents,
eux-mêmes présidents de chambres de commerce. Les membres de ce comité sont des
professionnels, présidents de syndicats industriels, commerçants, professions
libérales. On cite également Georges Lehoucq, ancien adjoint au maire, mais
inspecteur de l’ enseignement technique.
En août 1909, le
Journal de Francfort fait une présentation assez documentée des préparatifs de l’exposition,
rappelle les relations suivies entre Mulhouse et Lille Roubaix Tourcoing,
annonce la participation allemande, et se place en concurrence directe avec l’
industrie exportatrice anglaise.
Le 1er
septembre, les Chambres de Commerce de Paris, Lyon, Marseille , Rouen,
Bordeaux, Reims, Orléans apportent leur soutien aux Roubaisiens. Le même mois,
le ministère des affaires étrangères apporte son soutien au projet, et prend
les dispositions concernant les agréments diplomatiques pour les participants
étrangers.
Le 29 octobre,
MM. Motte, Mathon et Lamy sont à Bruxelles pour solliciter la participation
belge auprès de M. Hubert ministre du travail et de l’ industrie.
Le 11 novembre, les voici à Paris, en visite
chez les personnalités du commerce de l’ industrie et des syndicats parisiens.
Lors du déjeuner à l’ hôtel Continental, Eugène Motte laisse parler son lyrisme
habituel : nous sommes de bonne race, des purs sangs et nous fournirons bon
parcours en portant vos couleurs, nos couleurs. Puis présentant Roubaix : ville
unique, où tous travaillent dès l’ âge légal, jusqu’à la tombe, où chaque
réfractaire est montré du doigt comme frappé de la lèpre, (..) où la
concurrence loyale et excitant pique de son aiguillon les flancs d’une jeunesse
jusque là intrépide, où les carrières libérales sont quasi inconnues ou
d’importation, où nul ne jette un œil d’envie ou de concupiscence sur le
fonctionnarisme, où par surcroît chacun s’accommode de familles nombreuses,
parce que chaque nouveau venu est considéré pour l’ avenir comme un capital en
bourgeon, bientôt en fleurs, et en rameaux ombragés, où viendront s’abriter des
générations laborieuses d’artisans, trouvant emploi de leurs bras, leur unique
capital, et parce que ces nouveaux venus sont de plus dans le présent pour les
parents, ferments nouveaux d’énergie et d’entreprises plus vastes.
Puis évoquant l’
Exposition : nous voulons mettre sous les yeux des artisans de ce merveilleux
essor, une vaste leçon de choses, que balbutiera la jeunesse ouvrière, que lira
avec ardeur la puissante démocratie en action dans nos centres , et qui soit
pour les vieux artisans, occasion de fierté, car ils ont été eux aussi les
collaborateurs de cette grande œuvre. Ce n’est pas une simple exposition
textile (…) c’eût été trop spécial, non nous convions toutes les forces vives
de l’ énergie de la région pour former la synthèse de nos merveilleux
arrondissements : métallurgie, houillères, fabriques de sucre, distilleries,
produits chimiques, amidonneries, sections d’électricité, constructions navales,
machines à vapeur, électricité, automobiles, alimentation, et tant d’autres ,
que j’oublie, car je ne puis réciter les litanies de l’ activité humaine.
Il annonce une façade de 500 mètres –la future avenue des Palais- et 20.000 mètres
carrés déjà adjugés à la location. Les remerciements de son début d’allocution
permettent de savoir où en sont les démarches : à Jean Dupuy, ministre du
commerce, qui poursuit l’ engagement de son prédécesseur Cruppi, aux sénateurs
et députés du Nord présents et au Préfet du Nord, M. Vincent, représentant de
l’ Etat et de la république, qui soutiennent le projet. Motte remercie
également Emile Dupont, Président du
comité français des expositions à l’étranger, les représentants de la
république argentine, M. Saint Germain sénateur d’Oran, garants de la
participation internationale et coloniale, les représentants des chambres de
commerce déjà citées sans oublier la presse. Il
poursuit son intervention en faisant appel à la participation parisienne
: apportez nous votre contingent de grâce, de lumière, d’harmonie, de justes
proportions en toutes choses….et il
termine sur un grand couplet patriotique sur la France, notre alma
mater.
Le 25 janvier
1910, il est procédé à l’ installation
officielle du comité consultatif, subdivisé en comités par groupes et par
classes. Eugène Mathon fait une communication à la presse sous la forme d’une
première description de l’ exposition, indiquant que la surface prévue a déjà
augmenté, qu’il y aura des pavillons coloniaux,
un parc d’attractions, un grand palais textile de 14.000 m². Le 3 février 1910,
est publiée la longue liste des personnalités qui formeront le comité
d’honneur. Il y a bien entendu le Préfet
Vincent, le maire Eugène Motte, le sénateur Trystam, l’ abbé Lemire, mais aussi
des représentants des grandes sociétés Agache, Kuhlmann, Compagnie Suez, Union
textile de France, des consuls et des présidents de sociétés. On y trouve aussi
les adjoints et les conseillers municipaux. Le 3 avril 1910, Eugène Motte
planche avec le même succès devant l’ union des syndicats patronaux textiles à
Paris. Il semble bien que l’ Exposition internationale de Roubaix fasse l’unanimité.
Petit bémol, le
1er octobre 1910, le maire de Roubaix n’obtient que 25.000 francs au lieu des
50.000 attendus au Conseil Général.
Mais cela n’altère pas l’ avancement du projet. L’ heure des chantiers est à
présent venue. »
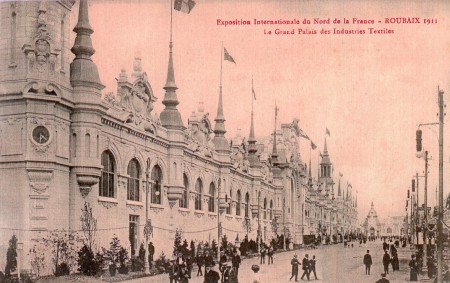
Edouard Joseph Prouvost, fils d’Amédée I Prouvost
et Joséphine Yon, Chevalier Légion d’honneur le 15/05/1910, propriétaire
agricole en Tunisie, né en 1861, décédé en 1933 (72 ans), marié
avec Pauline Elisa Fauchille , née le 26 juin 1865, Lille ,
décédée le 13 octobre 1954, Paris (89 ans) ; il était le
cousin germain de Charles Prouvost-Scrépel.
« Je vous ai dit la grande amitié qui
unissait les trois frères Amédée, Albert, Edouard Prouvost. Je voudrais
souligner surtout celle qui liait étroitement mon père et mon oncle Edouard.
Assis l’ un en face de l’ autre dans le même bureau, ils échangeaient à tout
instant non seulement leurs points de vue sur les affaires, mais leurs pensée s
intimes. Cette communauté de mutuelle et chaude affection entre les deux frères
a eu un prolongement naturel entre leurs enfants.
Le cadre de vie était la Tunisie, M’Rira,
Estaimbourg, Pecq, le Molinel, Pétrieux, Pampelone, les Charmettes.
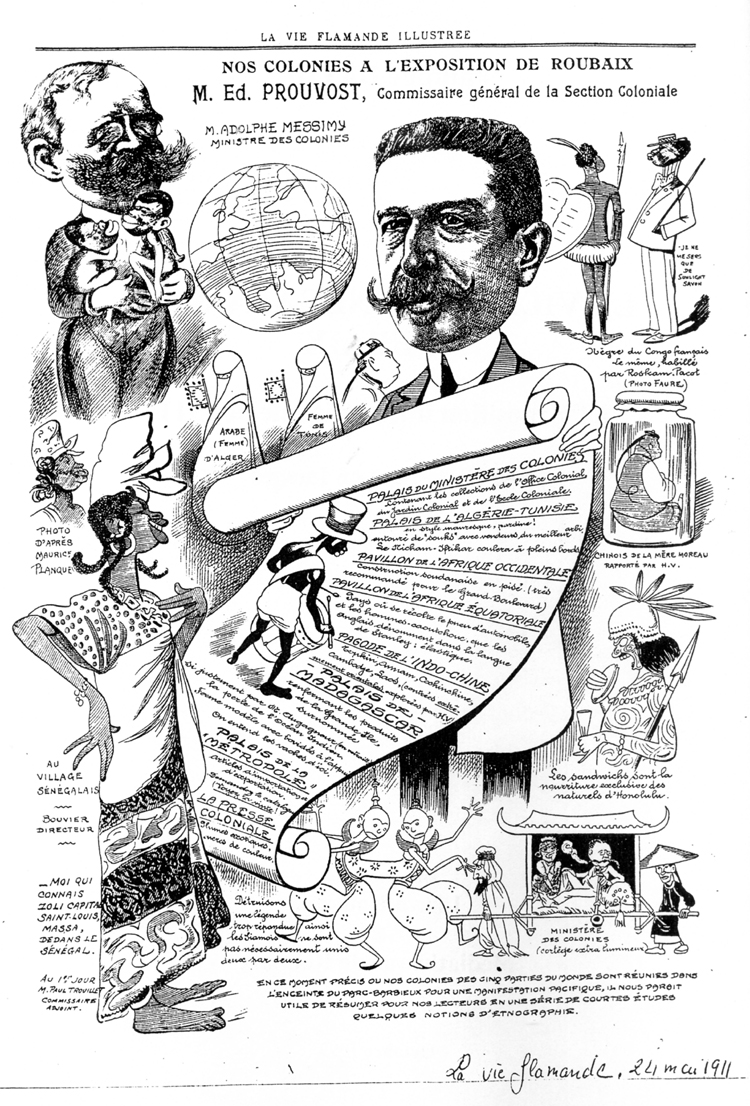
Édouard Prouvost, commissaire général des
colonies de l’ Exposition,
croqué par la presse avec l’ ensemble de son
œuvre. (Extrait de la vie flamande)

La Porte Monumentale se
situe au débouché du boulevard de Paris à l’ entrée principale du parc de
Barbieux. Elle est constituée par une grille de fer forgé de style Louis XVI de
seize mètres de haut et par un portique
où sont installés les guichets d’entrée. Juste derrière cette porte démarre la
partie coloniale de l’ Exposition.
De style mauresque, le palais du ministère
des colonies est consacré à la présentation générale des colonies : dioramas,
affiches, graphiques, documentation sont proposés aux visiteurs par l’ Office
Colonial.

Le palais de l’ Afrique Occidentale française
est une construction soudanaise en pisé, dont le vaste hall présente les
produits agricoles, les matières premières et les produits de l’ industrie
extractive des pays de l’ Afrique Noire. Un diaporama reproduit les scènes de
la vie africaine.
L’ Afrique Occidentale française est composée
du Haut Sénégal, du Niger, de la Guinée française, de la Côte d’Ivoire, du
Dahomey et d’une partie de la Mauritanie. Une exposition présente les arts et
coutumes des différentes tribus de ces pays.
Le palais de l’ Algérie et
de la Tunisie est composé de deux parties reliées par une galerie. La partie algérienne présente des produits
d’exportation (liège, vins, céréales, huiles). Le visiteur peut y admirer de
magnifiques panoramas du pays : Alger, Biskra et Ghardaïa…

La partie tunisienne propose des produits
agricoles et des échantillons des minerais de son sol (fer, plomb, calamite,
galène).
On y voit des vues de la propriété proche de
Tunis de M. Édouard Prouvost, commissaire général des colonies françaises à l’
Exposition.
Le pavillon de Madagascar qui n’a rien de
typique avec son mirador original, présente beaucoup d’objets de fabrication
indigène (armes locales, sagaies, bijoux, broderies), et des produits agricoles
(céréales, cacao, manioc, vanille, café, tabac). On peut y admirer des vues de
Madagascar.

Le pavillon de l’ Indochine française
représente une pagode entourée de colonnes soutenant un toit de tuiles roses
garni aux angles de cornes de buffle et de flammes.

L’ intérieur du pavillon de l’ Indochine
française est un véritable petit musée: meubles incrustés de nacre, bois
sculptés, panneaux, tableaux, soieries, bijoux, d’un incomparable cachet
artistique.
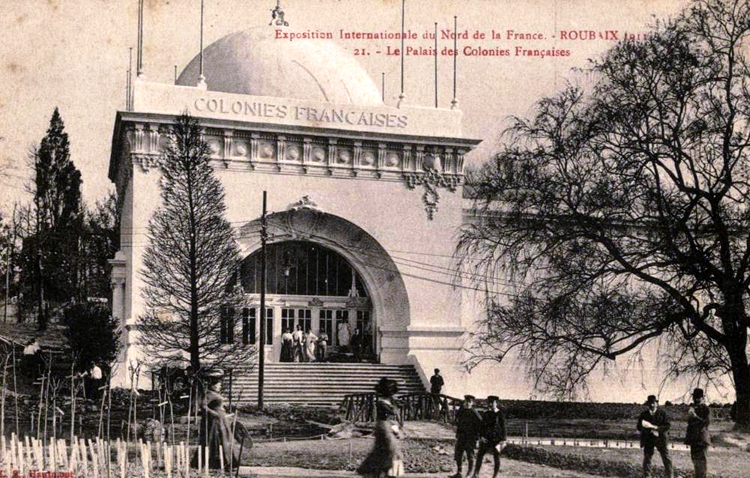
Le pavillon de la
presse coloniale réunit tous les ouvrages utiles aux coloniaux, aux
importateurs et aux exportateurs.
Le peintre
Ernest Prouvost :
Petit fil s d’ Henri Prouvost-Defrenne, 1783-1850, fils de Liévin et Alphonsine
Gruart, il appartient donc à la branche
puinée des Prouvost et est cousin germain d’Amédée II, Edouard, Albert I,
Charles I Prouvost.
Le jeudi 5 août 1909, la presse annonce que
le comité d’initiative de l’ Exposition va lancer un concours d’affiches avec
primes, ouvert à tous les artistes de la région du Nord. Il définit un règlement dont voici les articles
sous forme de synthèse. Il s’agit donc de produire une affiche illustrée
destinée à l’ Exposition internationale du nord de la France qui aura lieu à
Roubaix en 1911. Le format exigé est celui des affiches de gare soit 0,88 de
hauteur sur 0,66 de largeur. Toute liberté est laissée aux créateurs, néanmoins
l’ affiche devra être visible à distance, et d’une forte et expressive simplicité.
Elle devra également contenir l’ inscription Exposition Internationale du Nord
de la France Roubaix 1911, comporter six couleurs au maximum, non compris le
noir. Les projets seront déposés au bureau de l’ exposition (palais de la
chambre de commerce à Roubaix) le 15 septembre 1909 avant cinq heures du soir,
accompagnés d’un pli cacheté contenant le nom de l’ auteur, et extérieurement
un signe ou une devise reproduit sur le dessin. Une exposition publique des
projets aura lieu dans un lieu qui reste à déterminer. Le jury choisira trois
œuvres auxquelles seront attribuées les primes suivantes : 200 francs au
premier, 125 francs au second, 75 francs au troisième. Les projets resteront la
propriété de l’ exposition, qui en disposera comme elle l’ entend : cinquante cinq projets d’affiches seront présentés. Le jury se
met au travail. Il est composé d’Eugène
Mathon, Victor Champier, des artistes peintres
Rémy Cogghe et Ernest Prouvost, de l’ architecte Thibeau, des amateurs
d’arts MM Devillers, Ferlié, et Amédée Prouvost. On apprend que l’ exposition
des affiches se déroulera dans la cour d’honneur de l’ Ecole des arts
industriels à partir du jeudi 14 octobre jusqu’au dimanche 17. »

le tryptique d'Ernest Prouvost
(photo Alain Leprince musée de Roubaix)
L’ Exposition
Internationale du Nord de la France s'est déroulée à Roubaix du 30 avril au 6
novembre 1911. Pendant six mois, dans le
Parc de Barbieux, Roubaix vivra au rythme de son exposition visitée par deux
millions de personnes. L’ historien Philippe Waret raconte...
En partant de l’
avenue des attractions, l’ avenue des Palais commence avec à gauche le palais
des industries. La section italienne se trouve au coeur de ce palais, avec les
chefs-d'oeuvre de verrerie de Venise, les bronzes d'art de Naples, les marbres
de carrare de Florence. Elle présente les productions italiennes, sans oublier
l’ alimentation, avec les vins, les fromages et bien entendu, les pâtes... Suit
un stand consacré à l’ imprimerie et à la photographie, où sont présentées deux
innovations, le dictaphone et la pointeuse automatique.
L’ aéroplane de
Louis Bréguet survole les automobiles, motocyclettes, bicyclettes,
pneumatiques, et autres accessoires. Le
Touring club de France propose le guide des syndicats d'initiative, et des renseignements
sur les compagnies de chemin de fer !
Le Palais de la
Belgique accueille les visiteurs dans un salon luxueux en présence des bustes
des souverains belges. De nombreuses vitrines contiennent les produits textile
s du pays, en particulier Gand, Verviers et Courtrai. Voici maintenant le Grand
Palais, avec sa galerie d'honneur, et les créations prestigieuses de la
manufacture de Sèvres. La galerie mène à un salon des arts réalisé par Victor
Champier et ses élèves de l’ ENAI, puis à la scène des réceptions officielles.
L’ aile droite comprend une série de salons, avec des expositions, des tableaux
et des maquettes. L’ industrie parisienne y tient une grande place. L’ aile gauche
se subdivise en cinq salons successifs : l’ industrie régionale du tapis et les
tapis d'orient. Les trois derniers sont consacrés aux tissus de Roubaix. La
fameuse charte des drapiers est en bonne place. La visite se termine avec les
dioramas sur les différentes phases de traitement de la laine. Le palais de la
chambre de commerce vient ensuite, avec dans le hall central, une allégorie des
sciences sous forme de frise. Un rappel historique, Pierre de Roubaix et la
Charte autorisant Roubaix à faire draps de toutes pièces, des tableaux à la
gloire du progrès et de Roubaix.
La visite se
poursuit avec le palais des machines qui ressemble à une immense usine où l’ on
a regroupé d'innombrables métiers et appareils pour le peignage, le tissage,
les apprêts, la teinturerie.
Le Pavillon
hollandais présente les aspects industriels, commerciaux, artistiques et
historiques du pays. Un salon de lecture, un bureau de renseignements sont à la
disposition des visiteurs. Le pavillon de l’ Australie offre des dioramas
simultanés qui montrent ses productions du sol (vins, céréales) comme du sous sol
(or), mais surtout ses célèbres mérinos appréciés par les entreprises
roubaisiennes.Voici à présent le Palais des mines et de la métallurgie, où l’
on peut voir tous les appareIls d'extraction et la gamme des produits houillers
et la production métallurgique (forges, fonderies). Un véritable puits de mine
en fonctionnement est le clou du palais, avec treuil, galeries et de véritables
mineurs ! Ensuite, le pavillon de la Nouvelle-Zélande présente ses productions
agricoles et d'élevage, dont les laines de moutons, importées à Roubaix.
A l’ autre bout
de l’ avenue, le musée pontifical a trouvé place dans la tourelle en forme de
poivrière du Palais de l’ économie sociale. Il
présente une reconstitution du défilé papal en costumes et un diorama
sur la Basilique Saint-Pierre de Rome. A deux pas de là, le petit pavillon
circulaire du Chili est au centre du village flamand.
Enfin, le
magnifique Palais de l’ Argentine se trouve au bord de l’ étang du parc de
Barbieux. L’ agencement est très moderne : une salle de conférence avec
cinématographe au rez-de-chaussée, éclairage électrique le soir. L’ Argentine y
présente toutes ses productions et ses laines. Le nombre d'exposants, la
diversité des produits font de cette exposition internationale un véritable
catalogue de l’ innovation et du progrès technique et industriel.
En 1911, Roubaix n’a pas voulu que les Arts soient oubliés dans son
Exposition internationale. Il y aura
donc une exposition d’art rétrospectif, dont sera chargé Victor Champier, qui
la pensera, la montera de A jusqu’à Z. Il
a comme idée de montrer l’ évolution de l’ art dans la partie des
Flandres soumise à l’ influence française par les conquêtes de Louis XIV, de la
fin du XVII e et pendant tout le XVIII e
siècle. Son argument est historique : l’ incorporation des villes comme
Lille, Cambrai, Arras, Saint Omer ou Valenciennes à la France, se manifeste par
un changement d‘orientation artistique. Quantité de monuments s’élèvent, hôtels
ou châteaux dans le style français, des fabriques de tapisserie, et de
céramique se créent, les arts du meuble, de la ferronnerie, de la dentelle se
développent, des peintres et des
sculpteurs locaux accèdent à la notoriété. Il
va donc chercher à recomposer un inventaire d’objets d’arts significatif
de cette évolution. Cette exposition fournira une très originale contribution à
l’ étude de la période. Un appel est lancé aux collectionneurs, aux amis
fervents de l’ histoire et de l’ art, aux municipalités des villes. Un exemple de
ses démarches : le 24 mars, il
écrit au Préfet pour obtenir le prêt d’objets d’un intérêt capital pour l’ exposition rétrospective. Deux
tapisseries lilloise de 1703, un banc en bois daté de 1654, et une horloge
qu’il est allé lui-même repérer à l’
hôpital St Sauveur de Lille. Il en
profite pour demander au une peudule Louis XIV genre « Boulle » en
écaille rouge et cuivres signée Vandersteen qu’on lui a signalé dans le bureau
même du Préfet. Et il joint un
formulaire pour l’ assurance.




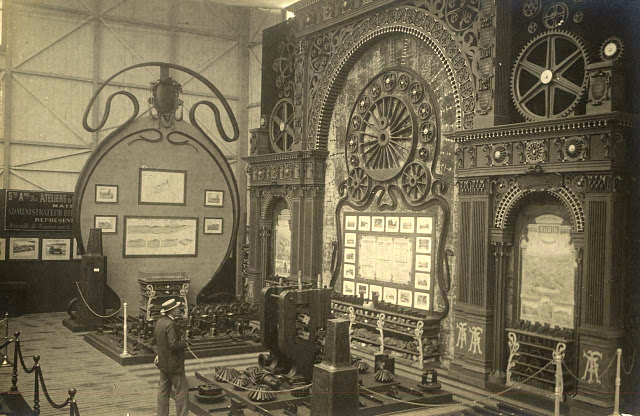
Son
opiniâtreté et son efficacité lui permettront de
réunir un nombre
considérable d’objets, auprès des
municipalités, des collectionneurs et des
amateurs d’art. Le 27 mai, on annonce que l’ exposition
rétrospective est
installée dans la salle des fêtes de la rue de l’
hospice, dite annexe de l’
Exposition. Un prix d’abonnement est proposé de 20 francs
par personne pour
toute la durée de l’ exposition, réduit à
cinq francs si on est déjà abonné à
l’ Exposition internationale. L’ inauguration se
déroule le 9 juin à trois
heures de l’ après midi. Cependant M. Dujardin-Beaumetz,
Sous Secrétaire d’Etat
aux beaux arts étant retenu par le deuil
gouvernemental. c’est Eugène Motte qui inaugurera en
présence des sénateurs et députés du nord et des maires de Lille, Dunkerque,
Douai, Valenciennes Cambrai, Arras.
Champier prend la parole le premier pour
marquer l’ importance des arts dans une ville telle que Roubaix, remercier le
maire de lui avoir confié l’ organisation, rendre hommage à la société
artistique qui a renoncé à faire son exposition d’art contemporain cette année.
Il retrace les phases successives de la
préparation, les soutiens, les appuis..Il
conclut en ces termes : faire
connaître à la foule nos vieilles provinces leurs traditions et leur gloire
d’autrefois, n’est ce pas honorer la France et la faire aimer davantage ?
A son tour, Eugène Motte prend la
parole, regrette le deuil
gouvernemental, et associe aux remerciements Madame Champier. Il dit : cette exposition mérite plus que des éloges, elle est un acte de foi en
l’ idéal, elle est une occasion de ravissement. Puis il fait l’ éloge de Champier et déclare l’
exposition rétrospective ouverte.

L’ exposition est divisée en deux
parties : la première est composée de salons de réception évoquant l’
hôtel somptueux d’un gouverneur de Lille à la fin du XVIIIe. On y trouve des
boiseries anciennes, meubles, tableaux, costumes, étoffes, bibelots du milieu
du règne de Louis XIV jusqu’à la fin de celui de Louis XVI.
La seconde partie est spécialement
consacrée à l’archéologie régionale et aux arts somptuaires particuliers aux
Flandres françaises. Chaque ville dispose de salons où sont réunis des objets
d’art et des souvenirs historiques, iconographies, des productions des
fabriques locales…
L’ exposition rétrospective fonctionne à
partir du 11 juin, elle est ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures, et
l’ entrée est de 1 franc, sauf le vendredi 2 francs. Les tickets de l’
Exposition concèdent le droit d’entrée à l’ exposition rétrospective avec une
réduction de 50%.
Il
faudra d’autres annexes de l’
Exposition pour les Arts. Le salon d’art moderne se tiendra à l’ hôtel de ville
de Roubaix, où il utilise les deux
salles du rez de chaussée pour accueillir d’un côté le 39e
salon de
l’ œuvre des artistes de Liège et de l’ autre
une sélection d’œuvres d’artistes
français, parmi lequels Carolus Duran, Cogghe, Paul Steck,
Lucien Jonas. Le
maire Eugène Motte entouré de ses adjoints, inaugure
lui-même ce salon.
Puis en juillet, Victor Champier
consacre une exposition au peintre Pharaon de Winter à l’ ENAI. Cet ancien élève des écoles
des Beaux arts de Lille et de Paris, est un portraitiste de talent. En 1889, il obtient une médaille de bronze à l’
Exposition universelle de Paris. Selon le journal L’ Echo du Nord, il exposera à Roubaix des portraits et
compositions de type religieux.
Un splendide album de cent planches hors texte sera consacré à l’
exposition rétrospective de Roubaix, comprenant les gravures des œuvres les
plus importantes des collectionneurs du nord de la France, avec un texte
historique sur l’ art dans les Flandres au XVIIe et XVIIIe de Victor Champier.
Une souscription est lancée au prix de 50 francs, par l’ administration du Nord
illustré, au 12 rue Esquermoise à Lille.
Jusque dans les années 1960, le textile se maintint à un niveau
international. « l’ académicien Maurice Schumann constate : Albert Prouvost « avait une vision planétaire de l’
économie ; il avait compris que l’
avenir du Nord était indissociable de celui du monde en pleine métamorphosé; il
n'était dépaysé nulle part; mais, qu'il fut en Afrique du Sud ou en Amérique du Nord,
il pensait aux chances nouvelles que
donneraient un jour à Roubaix le courant des échanges futurs, l’essor des
techniques de pointe, le développement et la diversification des moyens de
communication. »
La foi catholique dans le monde et les roubaisiens:
Issus d'une tradition catholique que fixa la Contre-Réforme, d’innombrables missionnaires,
religieux, prêtres, religieuses, militaires ont dévoué leur vie à l’international.
Citons quelques exemples : Théodore Louis Wibaux
participa à l’évangélisation de la Cochinchine et construisit le Grand
séminaire de Saïgon.Il est enterré depuis 1878 à Saïgon.

Son
neveu, Théodore WIBAUX, Zouave
pontifical à 18 ans pour la défense des états Pontificaux et Jésuite, né
à Roubaix, le 13 février 1849, dans une famille de treize enfants. Son père
était directeur d’une filature. Son éducation fut pieuse. Les enfants étaient
réunis tous les soirs pour la prière, dans le vestibule devant la
statue de Notre Dame, appelée par eux la Vierge de l’escalier. Il fit ses
études dans un institut de Roubaix, puis comme interne à Marcq. Il devint
membre de la Conférence de Saint-Vincent de Paul et s’occupa d’un patronage, le
dimanche en fin d’après-midi.
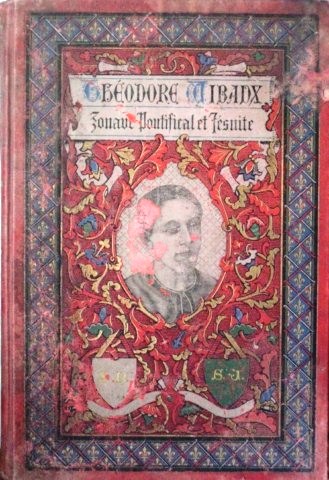

D'
après un récit de Louis Dumoulin, paru en 1902 in Les Contemporains « En
1865, le gouvernement de Napoléon III décida de retirer ses troupes des
Etats pontificaux, cédant aux instances du royaume du Piémont qui voulait
unifier l’Italie. Il ne resta plus qu’à Pie IX à faire appel aux Zouaves et aux
troupes volontaires venant de France, de Belgique, de Hollande et d'
autres pays. Le Pape ne voulait être démis de ses Etats comme un fait
accompli.
Théodore se sentit appelé au combat ; mais son père, d’abord inquiet puis fier
de la résolution de son fils, lui demanda d’attendre encore un an, afin de
se préparer moralement et physiquement.
Théodore écrivit à Louis Veuillot qui lui répondit dans une lettre enthousiaste
:
" Saint Pierre n’a pas maintenant besoin de soldats. C’est nous qui avons
besoin de lui en offrir, qui devons désirer que notre sang coule pour racheter l’abominable
défection de la France (...). Le terrible écroulement qui se prépare à Rome
pour le châtiment du monde sera-t-il honoré du dernier combat ? Aurons-nous un
second Castelfidardo qui nous ménagerait une rançon future ?
Je n’ose l’espérer. Nous avons affaire à des sages qui redoutent de jeter les
fondements de leur édifice dans le sang des martyrs et qui aiment mieux
construire avec la boue des apostasies. Ils se sentent assez forts pour
atteindre leur but, et peut-être avons-nous assez péché pour que Dieu ne nous
permette plus le glorieux rachat du
sang.
Je ne peux donc vous donner un avis décidé ; néanmoins, je penche pour que vous
alliez vous offrir. C’est quelque chose d’avoir fait acte de bonne volonté. Une
bénédiction rayonnera sur toute votre vie...Je me recommande à vos prières.
Louis Veuillot. "
Théodore Wibaux entra dans Rome le 8 décembre 1866, jour de l'Immaculée
Conception. Une trentaine de volontaires français, belges, hollandais et
allemands l’accompagnaient. A la caserne, il fit ses armes et fut vite apprécié
de ses camarades par sa simplicité et sa candeur. Il fit sa première
expédition, le 15 mai 1867, à Corneto, contre une quarantaine de garibaldiens
qui voulaient franchir la frontière à coup de carabines. Ils furent mis en
fuite, sains et saufs... Malheureusement à l’été, le choléra frappa la région
d' Allbano. Théodore ne fut pas le dernier à soigner les malades et à
réconforter les mourants. A 18 ans, lui qui n’avait jamais vu souffrir, il fit
son devoir. La tactique des garibaldiens était de multiplier les attentats dans
les campagnes, afin de masser les troupes pontificales aux frontières et de
faire ainsi le vide à Rome, pour pouvoir d’emparer par la suite de la Ville
Eternelle. Les batailles se succédaient dans la province de Viterbe. Resté à
Rome, dans la garnison, Théodore est aux premières loges, lorsque le 22 octobre
la révolte éclate. La caserne Serristori, minée par les Piémontais, explose,
provoquant la mort d’une vingtaine de personnes. En même temps, Garibaldi
s’est emparé de Monte Rotondo défendu par 300 zouaves. Théodore avec une
quinzaine d’hommes s’occupe de la défense d’un bastion, près de la porte
Saint-Pancrace. Il ' a pas d’artillerie...Le 30 octobre 1867, les Français, si
longtemps attendus, font leur entrée dans Rome. Sur le champ, Garibaldi riposte
à Mentana. Le 2 novembre, une colonne de 5000 hommes, des zouaves, des
carabiniers suisses, des légionnaires, sous le commandement du général de
Polhès, se dirige vers Mentana. La bataille sera affreuse. Les garibaldiens
sont mis en déroute. L’action du lieutenant-colonel de Charette fut décisive.
De retour à Rome, le 6 novembre, les troupes pontificales furent accueillies en
triomphe. Théodore Wibaux eut l' honneur d' une audience particulière de Pie IX,
le 3 janvier 1868. Elle dura un quart d’heure, pendant laquelle il reçut la
bénédiction pour sa famille et la décoration de chevalier de
l’Immaculée-Conception. Il reçut aussi le titre de citoyen romain... Au bout de
deux années d’engagement, une permission de quelques jours lui fut
accordée pour se rendre à nouveau dans sa famille. Mais les événements à son
retour allaient se précipiter. En juillet 1870, la guerre entre la France
et la Prusse fit rappeler les dernières troupes françaises de Rome. En septembre,
70 000 Piémontais envahirent Rome. Les zouaves rentrèrent en France à bord de
l’Orénoque, laissant le Pape prisonnier de ses murs du Vatican dans une
nouvelle Italie... Le bataillon de Théodore se rendit à pied à Châteaudun
où il arrivA le 11 novembre. Il fut incorporé, en tant que sergent-major,
dans le corps des Volontaires de l’Ouest. Il prit part aux combats de Brou
contre les Prussiens, sous les ordres du général de Sonis ; puis à la bataille
de Patay, où le général et les zouaves devaient s’immortaliser sous les plis de
la bannière du Sacré-Coeur. Beaucoup de Français furent tués, ainsi qu’à la
bataille de Loigny, le 2 décembre 1870.
"
Il n’y a plus qu’à invoquer la religion à son secours et à se jeter à corps
perdu dans les bras de la Providence : c' est ainsi que la Foi console et
fortifie ; c' est elle qui fait de la douleur un sujet d' invincible
espérance. " écrit-il à ses parents.
Aux premiers jours de 1871, Charette fut nommé général de brigade et Théodore
sous-lieutenant. Le 13 août, les trois bataillons dont se composaient les
Volontaires de l’Ouest assistaient pour une dernière fois à la messe militaire
de l’aumônier en chef. Après la messe, ils se transfomèrent en carrés, et le
général de Charette annonça le licenciement officiel du régiment. Les zouaves
n’existaient plus ! Quelques jours plus tard, ce fut la république... Théodore
Wibaux, sur le conseil d' un cousin jésuite, fit une retraite dans le
collège de la Compagnie à Saint-Acheul à Amiens : " Je ne voudrais
pas sortir d' ici avec le désespoir dans l' âme, j’y voudrais rester ; mais je
ne me sens pas digne. " Il faiblit toutefois à l’idée de quitter le monde;
il veut entrer dans les troupes d' Afrique. La crise dura peu de temps. Ce que
Théodore avait été aux zouaves, il le fut au noviciat des Jésuites.
Ensuite
il fut envoyé à Boulogne, comme professeur au
collège Notre-Dame. Avec 35
enfants de 11 ans, il développa une émulation incroyable.
Le Père Wibaux menait
ses élèves comme sur un champ de bataille et ils se
prêtaient avec ardeur à ce
jeu ! Il suivit ses élèves jusqu' à la classe
de troisième. La joie fut
bien grande lorsqu' un jour arriva de la part de Pie IX une magnifique
gravure
adressée à l’ancien zouave avec une
bénédiction spéciale pour ses élèves
et
toute une phrase écrite de la main du Pontife. En 1880, les lois
de la IIIème
république dispersèrent les Jésuites qui durent
s’exiler à Jersey...
Le Père Wibaux fut alors un ardent zélateur de la consécration des familles au
Sacré Coeur, dans les pages du " Messager du Sacré-Coeur ". Lorsqu'
il atteint ses 33 ans, il dit à son supérieur : " Je mourrai cette année !
". A la fin du mois de mai se déclara une maladie d’entrailles, et le 10
juin1882 le sacrifice était consommé... décède à Saint Helier à Jersey le 10
juin 1882 ; Dans son testament, il avait déclaré : " Je fais le
sacrifice de ma vie au Sacré Coeur, je l’offre pour la France, l’Eglise, la
Compagnie, la canonisation de Pie IX (aujourd’hui bienheureux...), le régiment,
Charette, le Pape régnant (Léon XIII) et pour tous les miens. " D' après
un récit de Louis Dumoulin, paru en 1902 in Les Contemporains. Bibliographie :
R.P. du Coëtlosquet, Théodore Wibaux, Zouave pontifical et Jésuite. R. Billard
des Portes, Histoire des zouaves pontificaux. Le Père Wibaux est un exemple
parmi d’autres de tant de vocations du XIXème siècle empreintes de
sacrifice et d’amour de la Patrie. Je ne sais pas si son souvenir est encore
conservé. S’il n’est pas déclaré officiellement saint, puisse néanmoins sa
mémoire aider les âmes hésitantes devant les choix d' aujourd’hui !
Lien : http://www.loire1870.fr/volontaire2.htm
Illustration
: le colonel de Charette sous la bannière du Sacré Coeur, à côté de Jeanne
d' Arc (vitrail de l' église de La Guerche, Ille-et-Vilaine ) ;
Autres Zouaves pontificaux apparentés, outre Théodore Wibaux et son beau-frère,
Carlos Eugène Cordonnier.
|
Victor Charvet 1847-1933,
zouave pontifical, aveugle à 30 ans, épouse Gabrielle Locoge; il fut
zouave pontifical à la suite d’une visite rendue par Charrette à ses parents
(en décembre 1866, Athanase de Charette de la Contrie devient
lieutenant-colonel des zouaves toujours sous le commandement d'Allet.). Il
fut blessé, le 25 novembre, à Jura l’Evèque sur le plateau d’Alvain. CHARVET
Victor 13-juin-97 Grenoble Isère Grenoble Isère Zouave 16-avr-17 le Godat
1917. Victor Charvet est un cousin issu de germains de Charles I Jérôme
Prouvost.
|
Ubalde
Arsène Joseph Dewavrin,
fils
de Philippe Auguste Joseph DEWAVRIN, né 1801 - Tourcoing, décédé
1872, Filateur de coton, marié à Roubaix avec Delphine
Pélagie BULTEAU, né le 7 juin 1832 à Tourcoing ; Ubalde décéda le 11
juillet 1864 en Italie et inhumé dans la cathédrale San Pietro à
Frascati ; semble faire partie de la troisième liste ("table
alphabétique des sous-officiers, caporaux et hommes de troupe français ayant
appartenu aux corps des Tirailleurs franco-belge et des zouaves pontificaux).
Il est cousin issu de germain de Charles I Prouvost-Scrépel.
Gaspard
Desurmont,
fils
de Gaspard Desurmont 1823-1895 et Eugénie Motte 1825-1889, marié le 15 octobre
1913 avec Gabrielle Duchange en 1893, lui aussi engagé sous la bannière de
Charrette, tué au mans à 22 ans. Il y a aujourd’hui la 12° génération portant
le prénom de Gaspar Desurmont…
André
Bernard, comte romain et Bernard
(1er,
18 mars 1913), né le 3 février 1844,
Lille, décédé le 25 octobre 1913, Paris (69 ans), zouave
pontifical, marié le 27 octobre 1868, Lille, avec Mathilde
Tilloy, née le 14 juin 1851, Lille, décédée
le 21 juillet 1892, Courrières (Pas-de-Calais) (41 ans), dont
André,
comte Bernard (2e), né le 27 novembre 1869, Courrières
(Pas-de-Calais), décédé le 19 novembre 1909, château de La
Mazure (Mayenne) (39 ans), officier de cavalerie, marié
le 12 juin 1900, Laval (Mayenne), avec Marie Le
Marié , née le 5 janvier 1881, décédée
le 4 janvier 1923, château de La Mazure (Mayenne).
Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983
Franciscaine missionnaire de Marie, fille de Georges Prouvost (cousin
germain de
Charles, petit fils de Félix Dehau) et Marthe Virnot :
« L’homme
propose et Dieu dispose ! Je m’étais tellement
réjouie de t’avoir comme
correcteur et Dieu m’a lancé le grand appel. Au
cours d’une opération
d’urgence, le chirurgien a découvert en moi un cancer bien
avancé. J’en ai pour
quelques mois. Je suis émerveillé de cette
délicatesse du seigneur qui m’a
ccordé un délai pour que je puisse partager ma confiance
et ma joie avec tous
ceux que que j’aime. Je sais que, dans quelques mois, ma
connaissance sera
totalle ; alors je préfère m’abandonner
à la prière plutôt qu’à
l’étude.
Je suis revenue à la tente, ma famille et mes sœurs
acceptent que je finisse
mes jours au milieu de ceux que j’aime(…) Je suis dans la
plus grande action de
grâce, la plénitude de joie.
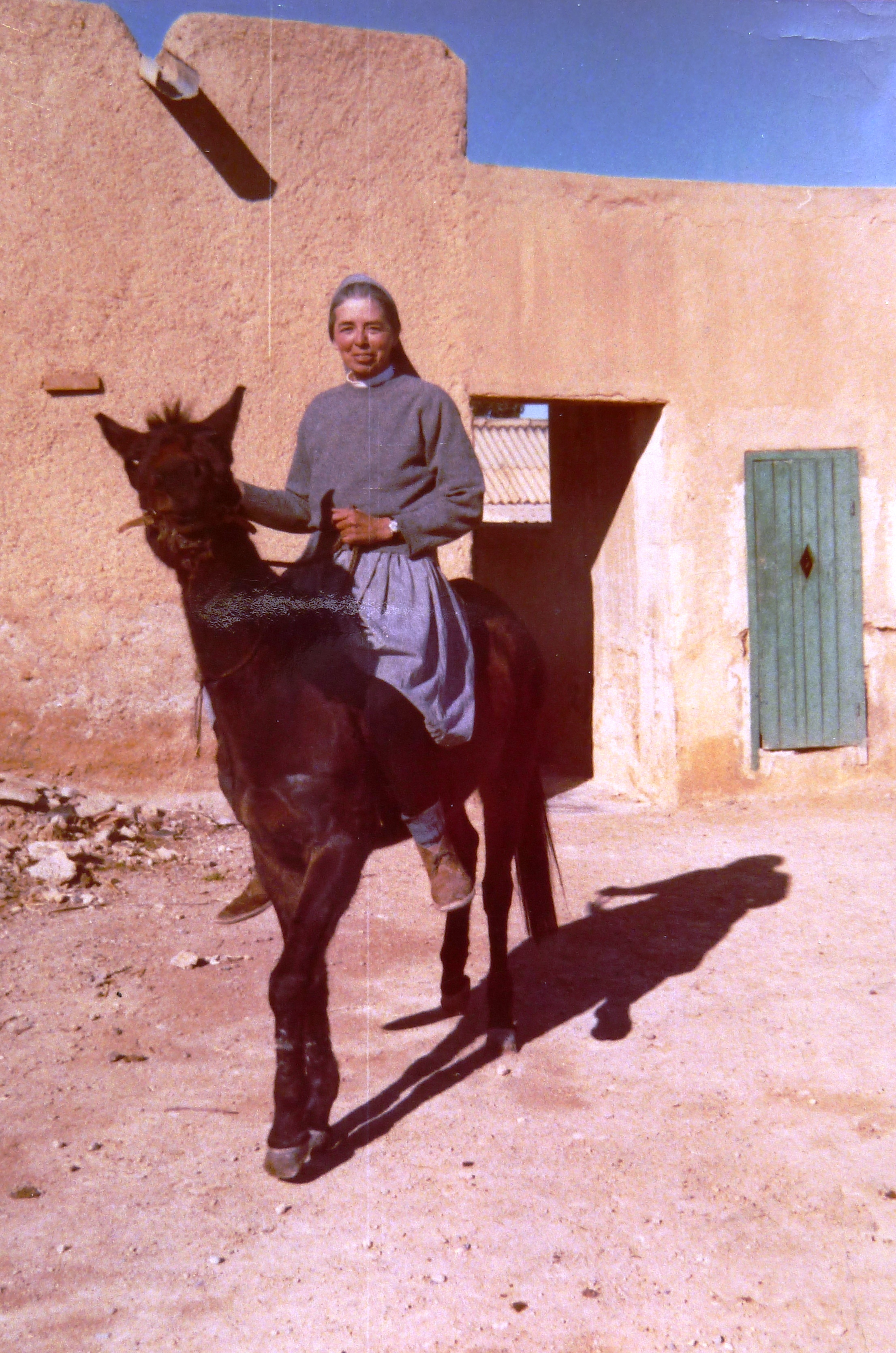
Une femme qui a voulu se faire nomade avec
les nomades : Sœur Cécile Prouvost, 1921-1983.
Née le 15 juillet 1921 à St Maurice des Champs, près de Lille, dans une famille
d’industriels, elle connut une enfance sans privations dans un milieu aisé. De
sa jeunesse, de la première année de guerre, de sa vocation, on ne sait rien.
Entrée dans l’Institut des franciscaines missionnaires de Marie en 1940 à
dix-neuf ans, elle laissa le souvenir d’une novice « casse-cou »
toujours à l’affût de quelque chose à entreprendre, à inventer, sans avoir peur
de l’effort, de la difficulté, du risque ou du danger. Après son noviciat, elle
fit des études d’infirmière puis fut envoyée au Maroc. Elle écrit, fin 1969,
dans un bref résumé de sa vie : J’étais prête à aller dans n’importe quel
pays de monde, sauf en Afrique du Nord et chez les musulmans. C’est là que
l’obéissance m’envoya. J’étais jeune et pleine d’enthousiasme. Je me suis
livrée avec ardeur à toutes les tâches que le Seigneur m’offrit : vie
d’infirmière, étude de la langue du pays, de la religion, de la civilisation.
Je passais successivement dans les maisons (communautés) de Fès, Casablanca,
Taroudant, Rabat. En 1961, j’eus mon obédience pour Midelt. Je fus partout,
malgré des croix réelles, profondément heureuse dans ma vocation, trouvant dans
l’Institut mon plein épanouissement humain et spirituel.
Midelt
fut donc la dernière étape de sa vie conventuelle, avant le grand saut, chez
les nomades. Là, elle avait un poste d’infirmière dans le dispensaire,
dépendant de la Santé publique, et elle s’occupait plus spécialement de
prévention maternelle et infantile. À la fin de 1969, Cécile écrit :
Depuis deux ans, le Seigneur m’attire vers une intimité constante avec lui et
un profond désir de vie contemplative. Lors de ma dernière retraite en
septembre 1969, il me fit voir clairement que ma vie serait nomade-contemplative.
C’est
en juin 1969, au cours de l’ascension de l’Ayachi (le
deuxième sommet du
Haut-Atlas, 3735 mètres) qu’elle ressentit vivement et
douloureusement combien
les nomades étaient abandonnés au point de vue sanitaire.
À la fin de 1969,
elle présente, par écrit, son projet à la
Provinciale et à son conseil, ainsi
qu’à la Supérieure Générale et
à l’archevêque de Rabat. Elle explique :
Je
voudrais donc, dès le printemps 1970, avoir l’autorisation de passer, de temps
en temps, une nuit sous la tente, soit près d’un malade, soit chez des amis
sûrs – et j’en ai de très sûrs. Il faudrait que rapidement, le rythme atteigne
deux nuits par semaine ; tout en continuant mes activités normales au
dispensaire et en communauté. Puis mon désir serait, dans deux ans,
c’est-à-dire au printemps 1972, pouvoir vivre cinq jours sous la tente, dans la
montagne et rentrer dans ma communauté le samedi et le dimanche. Plus une
partie de l’hiver. Il me semble que là, je vivrais mieux l’imitation de Jésus
Christ, la Voie, la Vérité, la Vie de nos âmes, qui a voulu vivre cette vie de
proximité et de communauté avec les plus pauvres de son pays qui étaient si
semblables au nomades de nos régions ; nomade avec les nomades. Non sans
appréhension, ses supérieures et l’archevêque laissèrent ouverte cette
possibilité de proximité avec les plus pauvres de la montagne. Un projet qui
devint réalité en 1970, au rythme prévu. Comme « compagne », dans ces
débuts, elle eut, non pas l’une de ses sœurs, mais une femme berbère et elle
dira : Il s’est créé entre nous une amitié profonde et actuellement, nous
vivons en fraternité comme deux sœurs, heureuses l’une et l’autre de montrer à
notre entourage qu’une musulmane et une chrétienne peuvent vivre ensemble en
réalisant chacune à fond sa religion. Pour nous, ajoute-t-elle, c’est le
dialogue islamo-chrétien vécu, avec simplicité, mais dans la réalité. Très
vite, elle pourra dire : J’ai enregistré et arrive à suivre d’une manière
régulière près de trois cents familles (de nomades). Il doit en rester à peu
près cent cinquante que je n’ai pas encore touchées. Le travail est surtout de
prévention, vaccinations, visites prénatales, surveillance des nourrissons,
dépistages de tuberculose...Nous faisons aussi les soins… Ce qui est important
pour elle dans ce vivre avec,
ce sont les contacts avec les gens qui l’entourent. Entre 1972 et
1974, elle
circule dans un rayon de trente kilomètres autour de Midelt, ce
qui lui permet
de contacter un grand nombre de personnes. En 1972, elle compte 584
familles,
soit 3475 personnes. En 1974, elle compte 659 familles, soit 3833
personnes et,
en infirmière méthodique, elle établit une fiche
par famille. Elle essaie de
sensibiliser les parents à la nécessité des
vaccinations. Mais comment faire
admettre qu’on pique un enfant en bonne santé ? Elle
ne vaccine aucun
enfant sans l’accord de l’un des deux parents. Un autre
point à obtenir, c’est
l’hospitalisation quand le médecin la demande car les gens
ont peur. Elle suit
avec grand soin les enfants : les rachitiques, les
anémiés, les mangeurs
de terre. Mais elle porte surtout ses soins sur
l’éducation : hygiène,
alimentation : « Cela m’est facilité par le
fait que je vis avec eux, et,
en partie comme eux. Je suis à la disposition de ceux qui
viennent chaque jour
entre 7 h 30 et 17 h 30 ; mais pour les urgences, il n’y a
pas d’heure, je
suis à leur disposition jour et nuit. Pour se faire nomade avec
les nomades,
Cécile est vêtue d’un grand burnous d’homme,
coiffée d’une manière qui n’était
ni féminine ni masculine, et chaussée de grosses sandales
berbères, même en
plein hiver. Lorsqu’elle devait prendre le car, pour ne pas
déranger, elle
était prête à partir de bonne heure.
Enveloppée dans mon burnous, je me couche
sur un banc public, on me prend pour un homme et on me laisse
tranquille. Sa
vie à la tente était partagée entre son travail
d’infirmière, la prière à
laquelle elle consacrait beaucoup de temps et l’étude, car
Cécile lisait,
écrivait et étudiait beaucoup. Elle avait même
composé un lexique
français-berbère et berbère-français. Elle
avait entrepris la traduction en
berbère de l’évangile selon saint Marc et
commencé celle de l’évangile selon
saint Jean. Elle avait traduit le « Notre
Père », le « Je vous
salue Marie » et le « Magnificat » et
composé quelques chants.
Elle suit des cours par correspondance, cours de Bible,
d’islamologie, de
théologie. On lui doit aussi un livret sur le traitement par les
plantes
qu’elle complétera au cours des années, ainsi que
des notes sur l’acupuncture.
Sa vie fut laborieuse et austère. Pour bien le comprendre, il
faut se
l’imaginer dans son contexte habituel : non au calme dans sa
chambre ou
son bureau, elle n’en a pas ; mais assise au pied d’un
arbre, ou l’hiver,
près du feu sous la tente ouverte à tous. En 1978
Cécile reçoit une sœur comme
compagne sous la tente ; mais pour que la Fraternité soit
reconnue par les
instances suprêmes de l’Institut, il faudrait une
troisième sœur, qui se fera
attendre encore cinq ans. En février 1983, Cécile est
opérée à l’hôpital d’une
occlusion intestinale. Et cette opération révèle
un cancer très avancé. Trop
avancé même pour qu’on puisse intervenir. Elle est
mise au courant par le
médecin et elle accepte dans la foi, dans la joie et dans
l’espérance. Puis,
malgré l’insistance des siens, elle exprime le
désir de finir ses jours à la
tente, puisque médicalement il n’y a rien à faire.
Elle quitte l’hôpital quand
la plaie est cicatrisée et continue de soigner les nomades par
l’intermédiaire
de la sœur qui est avec elle sous la tente. Les derniers mois,
les souffrances
physiques furent intenses ; et pareillement sa vie d’union
à Dieu. Deux
mois environ avant sa mort, Cécile commença un
jeûne, ne buvant que du liquide.
Je ne vois pas pourquoi je devrais nourrir mes cellules
cancéreuses quand il y
a tant de gens qui meurent de faim…Ce fut la veille de sa mort,
le 10 octobre
1983, qu’arriva – dernière délicatesse du
Seigneur – la reconnaissance par Rome
de cette fraternité sous la tente. C’était dans la
montagne les fêtes de
mariages et toute la nuit avaient résonné les sons des derbouka (tambours), plus
proches ou plus lointains. C’était pour Cécile, l’annonce d’un autre festin,
d’autres noces. À l’aube du mardi 11 octobre 1983, après une nuit de grandes
souffrances, entourée de ses trois sœurs, elle dit : « Je vais vers
mon Père », prononça le nom de Jésus, entra dans la lumière qui n’a pas de
déclin et dans la joie de Dieu. À ses obsèques, dans le cimetière de la Kasbah
Myriem, c’est une foule qui l’accompagnait, composée de chrétiens et de
musulmans, de prêtres et de religieuses ; mais surtout de ses frères et
sœurs de la montagne, les nomades. Témoignages : Un prêtre qui l’a bien
connue : Le but premier de Cécile a été de vivre avec les plus pauvres, de
partager le dénuement de ce peuple berbère, nomade, qu’elle aimait. Le partage
de leur vie avec tout ce qu’il y a de difficile, de dur et parfois même de
rebutant, c’était son choix et non pas une conséquence à supporter tant bien
que mal. Elle aimait les pauvres, non pas en phrases et en théorie, mais dans
la réalité des actes quotidiens. Son programme de vie : - Imitation de
Marie : surtout dans son mystère de la Visitation, puisque, comme elle, je
porte le Corps de son Fils.- Adoratrice de cette Eucharistie avec laquelle je
vis en intimité totale.- Victime, car les sacrifices ne manquent pas quand il
faut affronter les intempéries, la privation de tout ...- Missionnaire, selon
l’esprit de Mère Fondatrice, Marie de la Passion.Son faire-part de décès
composé par elle-mêmeAu nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, Jésus a
dit : Je suis la
Résurrection. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jn 11, 25)
Réjouis-toi avec moi ! Le Seigneur est venu me chercher pour la vie qui ne
finit pas. Je prie pour toi et je t’attends dans la joie de la Résurrection.
Amen. Alleluia ! Cécile Prouvost Monseigneur Chabert, l’archevêque de
Rabat : Je
l’admirais et j’étais fier d’avoir dans mon diocèse une telle ambassadrice de
Jésus parmi les plus pauvres. Elle représentait bien cette option
préférentielle que l’Église demande. Et sa Provinciale : Telle que je la
connais, l’estime et l’admire, profondément dans son don total, dans ce
cheminement qu’elle a fait depuis des années et qui […] me semble une
authentique recherche du Seigneur, à l’exemple de saint François et de Marie de
la Passion.
Henri Louis Marie Joseph Prouvost (1895 - 1983),
de la
lignée non rattachée des Benjamin Prouvost, naquit à Roubaix (Nord) le 1er
octobre 1895. Il fit ses études primaires et secondaires à l'Institution
Notre-Dame des Victoires à Roubaix. Il voulait se destiner aux Missions, et il
fit sa demande au Séminaires de la rue du Bac le 12 juillet 1912. Il entra au
Séminaire des Missions Etrangères de Bièvres le 9 septembre 1912. Il n'avait que
17 ans.
La grande guerre éclata en 1914. Parti pour
le front, il fut blessé en septembre 1916 et réformé temporairement en 1917. Il
fut réformé définitivement en 1919, et rejoint le Séminaire pour y achever ses
études. Ordonné prêtre le 12 mars 1921, il reçut sa destination pour la Mission
de Mysore. Il partit pour l'Inde le 26 septembre 1921. A Bangalore, ville
épiscopale de la Mission de Mysore, il se mit à l'étude des langues au Collège
Saint Joseph. Après quelques années d'étude, il devint professeur, puis recteur
de l'école anglaise en 1931. Enfin, en 1932, il devint Principal du Collège
universitaire. En l'espace de cinq ans, il fit de ce Collège l'une des grandes
institutions universitaires du pays.
En 1937, ce Collège fut confié aux Pères
Jésuites et le Père Prouvost devenait libre. Rappelé en France, il fut envoyé à
Menil-Flin pour fonder un Petit Séminaire MEP. Secondé par quelques confrères
et quelques Soeurs des Missions Etrangères, il recruta des
"postulants", auxquels il enseigna le français et l'anglais. Vint la
guerre de 1939-1945. Elle permit l'intégration plus complète à la vie du
village : prières communes dans la Chapelle de l 'école, services mutules,
hébergements fugitifs, refuge de la population dans les caves du Séminaire au
moment des bombardements. Il assurait la messe paroissiale à Ménil-Flin et ses
sermons appelant les chrétiens à la pratique d'une foi véritable étaient fort
appréciés. Il dirigea cette école missionnaire de 1937 à 1944.
En 1944, une Mission extraordinaire fut proposée
au Père Prouvost. Le Pape Pie XII demanda aux Missions Etrangères de nommer
l'un de leurs membres, pour faire la visite apostolique de toutes les Missions
francophones d'Afrique. Le Père Prouvost fut nommé à ce poste, et après avoir
reçu les consignes des autorités romaines en décembre 1944, il s'envola pour
Dakar en janvier 1945. Il fut un visiteur juste et impartial et fit un rapport
très détaillé, très apprécié à Rome. Tant et si bien que le Pape Pie XII voulut
nommer le Père Prouvost archevêque de Dakar. Mais il présenta respectueusement
ses objections au Pape, et put rejoindre le Séminaire de la rue du Bac, fin
1946.
On lui confia alors le poste de directeur l'information
missionnaire. Il multiplia alors les voyages par toute la France, fit de nombreuses
conférences pour susciter des vocations missionnaires. Il poursuivit ce travail
jusqu'en 1950.
A l'Assemblée générale de la Société en 1950, il est élu
assistant du Supérieur général. Il continua de s'occuper du recrutement, et
presque tous les dimanches, il allait prêcher des "Journées
missionnaires" dans les paroisses ou institutions. Egalement, il dut faire
la visite des Missions en tant que membre du Conseil général. Il put ainsi se
rendre compte du travail des confrères et les réconforter dans leurs
difficultés.
En 1954, il accepta la charge de secrétaire aux "Presses
Missionnaires", organisation fondée pour venir en aide aux Missions pour
tout ce qui concerne livres et appareils audio-visuels et aide financière pour
les traductions de livres dans différentes langues indigènes. Le Père Prouvost
allait trois fois par semaine au bureau situé dans le 7ème arrondissement et
poursuivit sa collaboration jusqu'au mois d'avril 1983.
Avec l'élection d'un nouveau Conseil général en 1960, le Père
Prouvost devint bibliothécaire de l'importante bibliothèque de la rue du Bac.
Mais bientôt avec l'âge, il fut atteint de cataracte double. Sa vue baissa de
plus en plus et il fut déchargé de la bibliothèque en juin 1981. Pendant deux
ans encore, il continua à rendre service, assurant deux heures de confessions
chaque semaine dans la Chapelle du Séminaire.
En 1983, le Supérieur général l'invita à se retirer dans notre
maison de Montbeton, près de Montauban. Il y alla à contre-coeur, mais fit
preuve d'obéissance, mais aussi d'un grand sacrifice. Un jour, alors qu'il
célébrait la messe avec la communauté, il fut pris de malaise, perdit
connaissance et dut être transporté à l'hôpital de Purpan, à Toulouse. En plus
d'une méningite maligne, il fut victime d'une infection urinaire et d'un oedème
au poumon. Après avoir reçu le saint Viatique, il mourut le 28 octobre. La
concélébration fut présidée par le Père Rossignol, vicaire général de la
Société, qui dit au cours de son homélie : "Le Père Henri Prouvost est l'un
de ces hommes qui a tout quitté pour suivre Jésus. Il s'est mis au service de
Jésus avec un rare ensemble de talents et de qualités... Avec son décès, c'est
une grande figure qui disparaît : une grande figure de la Société des Missions
Etrangères, une grande figure du monde missionnaire."
Évêque de Dakar (1947), puis archevêque
(1955) , évêque de Tulle (1962), supérieur général de la Congrégation du
Saint-Esprit (1962), fondateur de la Fraternité St Pie-X
Évêque de Tulle
Né le 29 novembre 1905 -
Roubaix (59, Nord)
Décédé le 25 mars 1991
- Martigny (Suisse)
À l'âge de 85 ans
Ordonné prêtre en 1929
Missionnaire au Gabon (1932-1945)
Supérieur du Scolasticat de Mortain en France (1945 -1947)
Archevêque de Dakar, (1947-1962)
Archevêque de Tulle en France (1962),
Archevêque de Synnada en Phrygie (Syrie), in partibus infidelium
Supérieur de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit (1962-1968)
Fondateur de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X (1970)
"Tradidi vobis quod et accepi"
Populaire défenseur de la messe en latin
ou maurrassien
impénitent, «athanase du XXe siècle» ou «avocat obstiné d’une
théologie attardée», Mgr Lefebvre a suscité toute une imagerie d’Épinal.
Rend-elle bien compte d’une affaire qui eut un large écho, spécialement en
France, et aboutit à un nouveau "schisme" dans l’Église catholique ?
Né
à Tourcoing dans une famille très
pieuse le 29 novembre 1905, Marcel Lefebvre eut au sein de
l’Église un
itinéraire exemplaire. Admis au séminaire français
de Rome en 1923, il est
ordonné prêtre en 1929. Après un an en paroisse
à Lille, il rejoint son frère
René chez les Pères du Saint-Esprit. Au Gabon de 1932
à 1945, puis directeur du
scolasticat de la congrégation, il est choisi par Pie XII comme
vicaire
apostolique de Dakar en juin 1947 et reçoit la
consécration épiscopale des
mains du cardinal Liénart en septembre. En 1955, le cardinal
Tisserant vient
l’introniser premier archevêque de Dakar.
Délégué apostolique pour l’Afrique de
l’Ouest (1948-1959), il participe activement à
l’affirmation d’une Église
africaine ; il a ordonné prêtre son successeur, le futur
cardinal Thiandoum. L’heure
du départ arrive néanmoins, en janvier 1962, pour un
homme réticent vis-à-vis
d’une décolonisation jugée
prématurée. Transféré au modeste
siège de Tulle, il
est élu supérieur général des Spiritains
dès août 1962. C’est ainsi qu’il se
rend, en octobre, à la première session de Vatican II.
Le concile marque un premier tournant
dans ce brillant parcours. Déjà isolé par son soutien à la «Cité catholique»
de Jean Ousset et à la cause de l’«Algérie française», Mgr Lefebvre se
range, à l’inverse des autres évêques français, dans la minorité conservatrice.
Animateur du Coetus internationalis patrum (1964), il réclame une nouvelle
condamnation du communisme et bataille contre la collégialité assimilée au «collectivisme»,
l’œcuménisme et la liberté religieuse, «apostasie légale de la société».
Mais, en 1963, il vote la réforme liturgique. Le futur censeur de la «messe
de Luther» a aussi accepté les premières modifications apportées par Paul VI,
avant la refonte du missel d’avril 1969. En mai 1988, il reconnaît la validité
de la nouvelle messe et la rupture n’est pas intervenue sur ce sujet. Le
contentieux entre Mgr Lefebvre et Rome ne se réduit donc pas à la liturgie latine.
Au demeurant, parmi les nombreux textes conciliaires, le prélat contestataire a
toujours déclaré n’avoir rejeté que Dignitatis humanae et Gaudium et spes . Or
l’après-concile voit se développer une accélération du processus de
sécularisation et une «crise dans l’Église» (Paul VI). Mis en minorité
dans sa congrégation, Mgr Lefebvre démissionne le 30 septembre 1968. Pourtant
il ne renonce pas à «faire l’expérience de la tradition».
Sollicité par neuf séminaristes, il
ouvre en 1969 une maison d’accueil qui, installée à Écône (Suisse) l’année
suivante, devient un véritable séminaire. Le 1er novembre 1970, Mgr Charrière
approuve la constitution d’une Fraternité sacerdotale Saint-Pie X destinée à
rassembler les futurs prêtres. Les évêques de France ne tardent pas à
s’émouvoir devant une institution concurrente et indépendante. D’autant
qu’entre 1970 et 1974 Mgr Lefebvre passe d’une vive critique de l’application
des réformes à une mise en cause du concile lui-même et bientôt du pape. Le
manifeste du 21 novembre 1974 dénonce «la Rome de tendance néo-moderniste et
néo-protestante, qui s’est manifestée clairement dans le concile Vatican II».
Ce brûlot entraîne la réaction de Paul VI: au terme d’une procédure que Mgr
Lefebvre conteste, la Fraternité est supprimée (mai 1975). En juillet 1976,
passant outre à l’interdiction d’ordonner des prêtres, le prélat est suspendu a
divinis .
Devenu chef de file des
traditionalistes, l’évêque dissident développe son œuvre tout en gardant des
liens avec Rome : Paul VI (1976) et Jean-Paul II (1978) le reçoivent. Malgré la
concession liturgique de 1984, les négociations piétinent. Ulcéré par la
rencontre interreligieuse d’Assise (1986), Mgr Lefebvre menace, en juin 1987,
de consacrer des évêques afin d’assurer la pérennité de sa Fraternité. Le
cardinal Ratzinger tente un ultime compromis. Mais l’accord du 5 mai 1988 est
rompu le lendemain par Mgr Lefebvre qui sacre, assisté de Mgr de Castro Mayer,
quatre évêques le 30 juin. Le camp traditionaliste se divise : certains (le
Barroux, la Fraternité Saint-Pierre) acceptent les offres romaines.
Excommunié, le vieil évêque, qui avait
remis sa charge de supérieur en 1983 à l’abbé Schmidberger, meurt le 25 mars
1991. Il lègue une «petite Église catholique de rite traditionnel» (É.
Poulat) d’au moins cent mille fidèles groupés autour des deux cent cinquante
prêtres d’une Fraternité qui entretient six séminaires et un réseau de prieurés
et d’écoles. Il lègue surtout un problème non résolu : quelle peut être
l’attitude de l’Église face à la modernité triomphante ? Campant sur le refus
des droits de l’homme, en particulier de la liberté de conscience, Mgr Lefebvre
rêvait de reconstruire la chrétienté: «Nos chapelles [...], nos monastères,
nos familles nombreuses, nos écoles catholiques, nos entreprises [...], nos
hommes politiques décidés à faire la politique de Jésus-Christ». Il
rappelait importunément que ce rêve fut celui des papes aux XIXe et XXe
siècles, et le proposait comme «Vérité immuable». Répudiant cette
stratégie, l’Église conciliaire a voulu concilier catholicisme et démocratie.
Elle a modernisé ses institutions et s’est proclamée «experte en humanité».
Mais de « Mater et magistra » à « Centesimus annus » en passant
par « Humanae vitae » (encycliques) , elle souligne toujours les failles
du libéralisme.
Entre l’exigence du dialogue et
l’affirmation d’une identité intransigeante, Jean-Paul II poursuivait sur une
voie que Mgr Lefebvre jugeait sans issue.
Enfin, le 21 janvier 2009, sur mandat du
Pape Benoît XVI, la Congrégation pour les évêques a retiré le décret du 1er
Juillet 1988 :
Rome, Congrégation pour les Évêques, le
21 janvier 2009.
Card. Giovanni Battista Re, Préfet de la
Congrégation des Evêques
- Joseph
Charles Lefebvre, né le 15 avril 1892, Tourcoing
(Nord), décédé le 2 avril 1973, Bourges (Cher), inhumé,
cathédrale de Bourges (à l'âge de 80 ans), prêtre du diocèse de
Poitiers, évêque de Troyes (1938-1943), archevêque de Bourges
(1943-1969), cardinal, président de la Conférence épiscopale
française.

Le Cardinal
Achille Liénard 1907-1973),

Évêque de Lille
en 1928, cardinal en 1930, il dirigea la Mission de France de 1954 à 1964 et
s'intéressa surtout aux problèmes sociaux.
Issu d'une famille de la bourgeoisie négociante de Lille, Achille Liénart opte
au début du siècle pour le sacerdoce diocésain. Il se sent proche du Sillon, de
l'ACJF et mène des études au Séminaire français de Rome. Il va s'engager comme
aumônier dans un régiment d'infanterie à Verdun pendant la Grande Guerre. Nommé
professeur au séminaire de Lille, l'abbé Liénart est aussi sollicité par sa
proximité intellectuelle et familiale avec le catholicisme social qui le mène
vers des activités autour des Semaines Sociales, des militants de la CFTC mais
aussi en direction des communautés protestantes et juives. En 1926, il lui est
alors confié l'importante paroisse de Tourcoing-Saint-Christophe qui le met en
contact avec les milieux du syndicalisme chrétien. Il n'hésite pas à prendre la
défense des « prêtres dévoyés » et accusés de communisme par les milieux
d'extrême droite. Rome l'encourage en le nommant évêque de Lille. Très vite, il
embrasse la cause ouvrière en soutenant une mobilisation syndicale à Halluin
face à un consortium qui refuse la négociation. Son engagement social lui vaut
d'être créé cardinal par Pie XI. Très populaire, il s'avère alors le promoteur
principal de toute l'Action catholique dans le Nord, aidant au développement de
la JOC mais aussi de la bourgeoisie chrétienne. Il s'avère également un
organisateur de la présence ecclésiale en milieu urbain. Il réagit fermement
dans certaines affaires dramatiques comme celle du suicide du maire de Lille et
ministre socialiste Roger Salengro, outrageusement diffamé par une presse à
scandale. À l'heure de la débâcle et de Vichy, il se veut loyal envers le
maréchal Pétain, en cela conforme à l'attitude générale de l'épiscopat
français. À la Libération, il succède au cardinal Suhard à la présidence de
l'Assemblée des cardinaux et archevêques.
Soucieux de la pastorale ouvrière, il suit de près « l'expérience » des
prêtres-ouvriers dont il va plaider la cause à Rome en 1954. Il sera nommé à la
tête de la Mission de France. Il porte également une grande attention aux
missions extérieures avec le soutien au mouvement Ad Lucem et
le
jumelage qu'il entreprend avec des diocèses camerounais. Le
concile Vatican II
le place sur la scène internationale avec notamment sa
véhémente intervention
sur le mode d'organisation dans le choix des membres des commissions
conciliaires, lors de la première séance de travail, le
13 octobre 1962. Il est
alors passionné par l'événement du Concile et
partisan de ses orientations. Il
abandonne progressivement sa tâche à partir de 1964. Son
évêque coadjuteur, Adrien Gand, lui succédera en
1968. » Catherine Masson, Le Cardinal Liénart, Évêque
de Lille (1928-1968), Bruno
Dumons. Paris, Éd. du Cerf, 2001. - (23,5x14,5), 784 p, 39 €.
La carrière internationale de la violoniste Gaëtane
Prouvost

Premier prix de violon et de musique de
chambre du Conservatoire de Paris, Gaëtane Prouvost a poursuivi sa formation à
la Juilliard School de New York auprès d’Ivan Galamian comme nombre des
virtuoses contemporains. Mais son véritable maître sera Zino Francescatti, l’un
des grands violonistes du siècle et unique héritier de la technique de
Paganini. Elle lui a consacré une biographie et enregistré un disque de ses
compositions originales et transcriptions. Gaëtane Prouvost est avant tout une
concertiste. Son jeu se prête aussi bien à la légèreté du répertoire baroque,
qu'à la gravité mozartienne. Il excelle dans les grands romantiques et restitue
aux contemporains qualité émotionnelle et musicalité. Dédicataire de plusieurs
œuvres, elle est fréquemment invitée par l'Ensemble Intercontemporain où elle
joue sous la direction de Kent Nagano, Gary Bertini et Pierre Boulez. Choisie
par Olivier Messiaen, elle est l'interprète du Quatuor pour la Fin du Temps
lors de sa création en U.R.S.S. Gaëtane Prouvost est également une chambriste
qui se plaît à faire chanter son violon à l'écoute des autres: Noël Lee, Laurent
Cabasso, Emmanuel Strosser, Jean-Paul Sevilla, Anne Queffélec, Roland Pidoux,
Bruno Canino, Yvan Chiffoleau, Jean-Philippe Collard, etc. Diplômée de
l'Institut Supérieur de Pédagogie, elle partage actuellement ses activités
entre une carrière de soliste et l'enseignement au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris comme dans diverses académies en France et à
l'étranger. Certains de ses élèves sont dès aujourd'hui lauréats des grands
concours internationaux.Auprès de Marie-Christine Barrault, Gaëtane Prouvost a
monté un spectacle Littérature et Musique intitulé "Vol de nuit",
basé sur des textes d’Antoine de Saint-Exupéry. Les deux sonates de Prokofiev
pour violon et piano que Gaëtane Prouvost a enregistrées chez Forlane avec
Abdel Rahman El Bacha, ont suscité l'enthousiasme de la presse (Disque Choc du
Monde de la Musique). L'œuvre pour violon et piano de Gabriel Pierné a été
enregistrée avec Laurent Cabasso pour le label Integral Musique (octobre 2006). Charles de Couëssin et Gaëtane Prouvost,
Zino Francescatti (1902-1991) le chant du violon. Préface de Marcel Landowski.
Édition L’Harmattan (1999), 269 pages
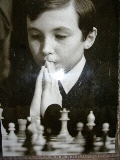
Géry Prouvost, né en 1964, à Paris, est
professeur au Grand Séminaire de philosophie Saint-André Kaggwa de Kinshasa.
Docteur en philosophie de l’Institut catholique de Paris et docteur en histoire
des religions de la Sorbonne, il a déjà publié Catholicité de l’intelligence
métaphysique (1991), Étienne Gilson - Jacques Maritain, Deux approches de
l’être, Correspondance 1923-1971 (1991) et Thomas d’Aquin et les thomismes
(1996). Il est lauréat de l'Institut de France.
Le génie global du Nord peut être observé dans
l’œuvre photographique des sœurs Elisabeth et Françoise Prouvost;

elles ont publié un superbe ouvrage de
portraits de 100 personnalités
françaises, de tous horizons telles que l’abbé Pierre, Noah, Cabrel, Dombasle,
Rampling, Sollers, Mauresmo, Birkin, “M”, Anna Karina, Chandernagor, Jacques
Lang, Moustaki, Elsa, Micheline Presle etc. – qui se sont prêtées au jeu. Une
révélation par la photographie de leur monde imaginaire à la manière des
collages surréalistes.
Elizabeth Prouvost :
15
août du XXe siècle. Née par hasard. Lionne ascendant lion.
1972. Comédienne dans Le soldat et les trois sœurs, film de Pascal
Aubier. Prix Jean Vigo 1978. Assistante caméra sur L'une chante, l'autrepas
d'Agnès Varda.
1990. Caméra d'or au festival de Cannes pour l'image de Farendj, film de
Sabine Prenczina.
1992. Réalisatrice de Stellaplage avec Catherine Jacob et Dominique
Pinon.
1993. Déligatures : première exposition personnelle de photographies sur
le corps, Paris.
1995- Sortie de Edwarda, album de photos d'après le roman de Georges
Bataille, Jean-Pierre Faur éditeur.
1997. Exposition de portraits de Mâcha Méril à la Maison européenne de
la photographie.
Février 2002. Début duprojet looportraits imaginaires.
2003. Tournage à Saint Pétersbourg de Ceux qui aiment ne meurent jamais,
film de Christophe Malavoy.
Françoise Prouvost :
31
décembre du XXe siècle. Née normalement. Cochon dans l'astrologie chinoise.
1967. Mannequin à New York, dans l'agence Eileen Ford.
1972. Comédienne dans Le soldat et les trois sœurs, film de Pascal
Aubier. Prix Jean Vigo 1978. Photographe pour l'agence Petit format.
Couvertures de livres .
1982. Photographe de plateau sur La Balance, de Bob Swaim.
1984. Béalisatrice d'un court-métrage, Une Vie, d'après une nouvelle de
Guy de Maupassant.
1985. Photographe à Paris-Match pour la rubrique Les Gens. 1988.
Réalisatrice du clip de Michel Sardou La même eau qui coule. 1996. Photographe
de publicité à New York.
Février 2002. Début du projet 100 portraits imaginaires. » http://www.eyrolles.com
Si le textile a eu son ère de déclin,
d’autres secteurs ont été pris en main
par les mêmes familles :
François Dalle,
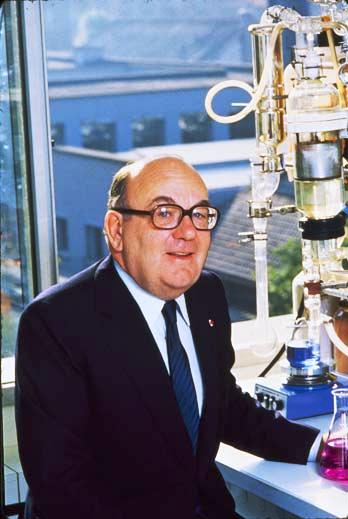
cousin
germain d’Hélène Prouvost-Dalle , s'affirmant soucieux de ses
collaborateurs mais pour mieux leur faire partager son « obsession du supra de
qualité », il métamorphose une
importante PME française en une grande multinationale. L’ industriel a relaté
l’ histoire de l’ entreprise dans un livre intitulé "L’ aventure L’
Oréal", paru en 2001 aux éditions Odile Jacob. Narrant le développement de
ce groupe aux marques emblématiques (Dop, Elnett, Lancôme ou Gemey), François
Dalle profite de cet exercice pour évoquer ses conceptions du management et du
marketing, résumées par la maxime de Schueller « Faire, défaire pour mieux
refaire ». Révélateur aussi, les raisons du choix de son successeur, Lindsay
Owen-Jones: « C'était le pousseur de chiffre d'affaires
dont L’ Oréal aurait besoin après moi. »
La
vente par correspondance
La
Redoute : Le concept de vente par correspondance est né par hasard au moment de la
première guerre mondiale, quand la maison Pollet a du mal à écouler sa
marchandise. Charles a l'idée astucieuse de mettre en vente ses stocks par le
biais de petites annonces dans le journal local. Les lecteurs peuvent ainsi
directement passer leur commande au fabricant qui expédie les produits
directement au domicile. La vente par correspondance est née. En 1928, la
maison Pollet crée un premier catalogue de 16 pages où une quarantaine
d'articles sont répertoriés. Les années passent puis, en 1956, La Redoute
décide d'introduire dans son catalogue des articles de décoration, des
accessoires et des meubles. La Redoute a depuis lors bien changé : en
diversifiant son offre et les tendances, La Redoute veut démocratiser le
design.est actuellement une filiale de Redcats (groupe PPR) ; le groupe est
présent dans une vingtaine de pays. Il s'impose comme le numéro 3 mondial de la
vente à distance derrière les allemands Otto et Quelle qui est le numéro 1
européen de la vente par correspondance avec ses catalogues Quelle et
Neckermann.
Les
3 Suisses, fondés par Xavier Toulemonde-Prouvost, est une filiale de 3 Suisses International qui
appartient à 45 % au Groupe Mulliez et à 50 % au groupe Otto-Versand, le leader
mondial de la vente à distance, présent dans 23 pays et sur trois continents,
l'Europe, l'Amérique et l'Asie. C’est en 1932, à Roubaix, que Xavier Toulemonde
crée les Filatures des 3 Suisses, qui deviendront par la suite les 3 Suisses. Entre
1934 et 1961, 3 Suisses ouvre les premières antennes à l'étranger, notamment en
Belgique, en Allemagne et en Autriche. En 1949, 3 Suisses lance le premier
catalogue « Textile » (28 pages et 436 articles) qui devient par la suite le
catalogue type « Grand magasin ». En 1967, le catalogue fait sensation : une
femme en pantalon figure en couverture alors que dans la rue la jupe reste
l'usage dans la société française. L'intégralité du catalogue 3 Suisses est
accessible sur Internet à partir de l'année 1998.
Blancheporte est une société de vente à distance du nord de la France (Tourcoing).
Fondée en 1806 par les Dassonville, elle a fêté ses 200 ans d’existence. Au
départ, la famille fabrique et vend ses étoffes sur la Grand Place de
Tourcoing. En 1920, l’usine prend le nom de Blanche Porte (d’après le hameau
auquel elle était rattachée).
Elle se
spécialise dans le drap « chaîne retors » et se lance, déjà, dans la vente à
distance. En 1921, l'entreprise met en place les Relais Colis. Dès 1924, les commandes sont expédiées
en 48 heures. En 1934 est édité le premier catalogue de 6 pages, à 300 000
exemplaires. Peu à peu, Blancheporte abandonne la fabrication et devient
distributeur à distance de vêtements et de linge de maison. En 1983, les 3
Suisses prennent une part majoritaire dans le capital[réf. nécessaire].
Blancheporte est n°3 français de la Vente à Distance textile[réf. nécessaire].
Dès 1993, la société atteint le niveau européen : Belgique, République tchèque,
Slovaquie… En 2006, Blancheporte fête ses 200 ans d’existence. Aujourd’hui,
l'entreprise livre plus de 7 millions de colis par an[réf. nécessaire].
Elle édite 2 catalogues généraux par an
et une dizaine de catalogues spécialisés.
Elle propose des vêtements, du linge de maison, des accessoires, etc…
Les Mulliez
est considérée comme l’ une
des plus fortunées d'Europe. Depuis
l'époque de Charles Quint, la famille Mulliez s'illustre dans le
textile. Selon Benoît Boussemart, les membres de la famille
totalisaient en 2010 une fortune de 30,4 milliards d'euros, ce qui les classe
au 1er rang des fortunes françaises devant Bernard Arnault (LVMH) et Liliane
Bettencourt (L’ Oréal).

Si le nom des Mulliez ne vous évoque
rien...Phildar, Auchan, Décathlon, Boulanger, Kiabi, Norauto, Midas, Leroy
Merlin, Tapis Saint-Maclou, Picwic, Brice, Pimkie ou encore Camaieu devenu
Jules, vous parleront sûrement plus. Ajoutons à cette liste : Maco pharma,
Kiloutou, Top office, Electro dépôt, Atac, Bricoman, Bricocenter, Déco
services, Cosily, 1000 tissus papiers peints, Cultura, Pic pain... N’oublions
pas le groupe Agapes (numéro deux de la restauration spécialisée en France,
regroupant Flunch, Pizza Paï, Amarine, Les Trois Brasseurs, et So good), la
banque Accor, les maisons de retraites « Les Orchidées », la presse catholique
qui survit grâce à eux (La Croix du
Nord, du Midi, et du Jura, La Voix du Cantal, La Vie Quercynoise, Le Rouergat, etc.).
Et ajoutons leurs 43% de participation dans le capital des 3 Suisses, et les
quelques Quick et Mac Do franchisés, et tant d’autres ... banque Accord fait exploser les compteurs des
cartes de paiement. La banque Accord de la galaxie Mulliez accompagne le
développement international des enseignes familiales.
Auchan vient du fief de Roubaix dit « les Hauts Champs », tenu de la seigneurie de Herseaux, à
Wambrechies, à 10 livres de relief et à justice de vicomte, comprenaient
autrefois 6 bonniers dont la plus grande partie avait été esclissée de telle
sorte qu'il ne restait au gros du fief, en 1621, que 14 cents de terre, tenant
au bois de Ribaubus et aux terres de Beaumont. Les Hauts-Champs appartenaient,
à la fin du XVIème siècle, à Philippe de Bocquignie, et en 1621 à Marie Le
Mahieu, fille de feu Vaast. En 1596, le meunier des Hauts-Champs était Adam
Delattre. » Les vieilles seigneuries » du chanoine Théodore Leuridan
« De son Brésil natal, Sandra
Mulliez a gardé la spontanéité chaleureuse et communicative. Au service d'une
créativité tous azimuts dans les années 80, à São Paulo, cet enthousiasme est
aujourd'hui consacré aux artistes via SAM Art Projects, son projet de soutien à
des plasticiens confirmés mais peu connus parce qu'issus de pays dits «
émergents ». En moins d'un an et demi, elle a réuni un comité où siègent six
personnalités du monde de l'art ; créé une résidence d'artistes (dont la
première bénéficiaire, Elaine Tedesco, prendra bientôt possession) et un prix
de 20 000 EUR ; mobilisé l'intérêt de collectionneurs et de galeristes,
convaincu des conservateurs de musée de s'associer à son projet... « Mon but
est de découvrir et faire connaître d'autres artistes, en marge des circuits
déjà balisés, et de les aider en leur offrant les conditions qui leur
permettent de réaliser une oeuvre, qui sera ensuite exposée au Palais de Tokyo.
» Avec une conscience aiguë de la responsabilité d'une telle entreprise : pas
question de proposer n'importe quoi, n'importe comment, au public. Le projet se
veut joyeux mais sérieux, et l'engagement total. Une forme de mécénat original
et alternatif. » http://www.connaissancedesarts.com
Association familiale Mulliez
Personnes clés
Gérard Mulliez • Vianney Mulliez • Arnaud Mulliez • Louis Mulliez •
Gonzague Mulliez • Thierry Mulliez • Stéphane Mulliez • Hugues Mulliez
Restauration
Agapes Restauration • Flunch • Pizza Paï • Amarine • Les 3 Brasseurs • So
Good
Grande distribution
Auchan • Alcampo • Atac • Banques Accord et Oney • Cityper • Colmark •
Immochan • Rik et Rok • Elea • La Rinascente • RT Mart • Sabeco • Supermercados
Expresso SMA • Simply Market •
Sport
Koodza • Décathlon : Centre de recherche Decathlon • Decathlondesign et
leurs marques :
Aptonia • Domyos • Geologic • Géonaute • Inesis • Kipsta • Orao • Quechua •
Tribord
Les Fils de Louis Mulliez
Phildar
Automobile
Auto5 • Maxauto • Midas • Norauto
Maison
Saint Maclou • Cosily • Allied Carpets • Home Market •
Essers • Teppichfreund
Autres
Banque Accord • Boulanger • Kiabi • Top Office • Cultura • Youg's • Surcouf
• La vignery • Picwic • Kiloutou
Participations stratégiques
Leroy Merlin • Bricocenter • Obi • Aki • Bricoman
Pimkie • Xanaka
3 Suisses • Alinéa • Aquarelle •
RougeGorge Lingerie • GrosBill • Jules • In Extenso • Tape à l'Œil
Paul Dubrule et le groupe Accor
Maire de Fontainebleau
(1992-2001), Sénateur de Seine et Marne, Paul Dubrule appartient aux grandes
familles du Nord ; les Dubrule sont alliés aux Pollet, Watine, Boutry,
Brabant etc. Co-fondateur avec Gérard Pelisson du groupe Accor en 1967, leader sur le continent européen mais aussi premier opérateur
hôtelier dans le monde.
Il
était à l'origine
la Société d'Investissement et d'Exploitation
Hôteliers (SIEH) puis créa dès sa
première année Novotel à Lille. Le lancement de la
marque Ibis a été matérialisé
en 1974 par une première installation à Bordeaux puis
SIEH devient propriétaire
la même année de la marque Courtepaille. Un an plus tard,
le groupe a acquis la
marque Mercure puis Sofitel en 1980. En 1982, SIEH prit les commandes
de
Jacques Borel International et devient Groupe Novotel SIEH - Jacques
Borel
International. En 1983, le groupe se rebaptisa et devient Groupe Accor,
nom
qu'on lui connait aujourd'hui.
Le Groupe Accor
continua dans la logique de sa politique d'acquisition avec Motel6 en 1990, la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme un an après. Le groupe
nomma en 1997 Jean-Marc Espalioux à la tête puis créa son site officiel :
Accorhotels.com en 2001.
En 2005, le groupe
devient actionnaire du Club Méditerranée dans une proportion de 30%. L'année
suivante, Gilles Pélisson succède à Jean-Marc Espalioux puis cède en 2007
plusieurs activités du groupe. Il acquiert par la même occasion Kadéos et créa
de nouvelles chaînes dont Pullman, MGallery et All Seasons.
Au cours de la même
année, le Groupe Accor lança en collaboration avec le groupe Pierre &
Vacances, Adagio City puis tout seul le programme A-Club en 2009. Aussi, on
assiste à la séparation de Accor Hospitality et Accor Services. Le premier fut
rebaptisé Accor et le second prend le nom de EDENRED.
SuiteHotel intégra
également Novotel sous la dénomination Suite-Novotel puis Accor Services et
MasterCard Europe s'allient en créant un service de prépaiement dénommé PrePay,
solutions dans lequel Accor Services est l'actionnaire majoritaire.
Le Groupe Accor
dispose au total de 33 marques réparties dans divers domaines.
- Hôtellerie : Accor Thalassa, Sofitel, Pullman, Groupe Lucien Barrière,
Novotel, Suitehotel, Mercure, MGallery, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, Hôtel F1
(ex-Formule 1), Motel 6, Adagio City, Orbis.
- Services:Ticket restaurant, Ticket Tesorus, Ticket Services, Kadéos,
PrePay Solutions.
- Autres : Compagnie
des wagons-lits, Lenôtre, pour ne citer que les principales.
Le groupe permet à sa
clientèle de bénéficier de son programme de fidélité ainsi que d'autres offres.
Par conséquent, avec son programme A-Club plusieurs opportunités vous sont
offertes et vous pouvez gagner des points, les convertir etc. Vous pouvez
également avoir accès aux offres hôtelières, offres partenaires, aux promotions
flash AccorHotels et d'autres surprises encore. La Fondation Accor a 112
projets soutenus dans 33 pays (5 continents), impliquant plus de 5 000
collaborateurs.
Les enjeux du
développement durable
L’humanité consomme de
plus en plus de ressources naturelles pour répondre à ses besoins grandissants,
avec des conséquences préoccupantes :
Le monde consomme presque trois fois plus
d’énergie qu’il y a 40 ans, or 80 % de cette énergie est fournie en brûlant du
pétrole, du charbon et du gaz. Cette situation pose aujourd’hui deux soucis
majeurs : d’une part, la combustion d’énergie pollue et réchauffe l’atmosphère
à grande échelle. D’autre part, cette combustion repose sur des ressources
naturelles limitées. Il faudra des millions d’années pour reconstituer les
ressources que nous consommons en quelques années.
Pour subvenir à ses besoins, l’humanité
prélève une part croissante des ressources naturelles de la planète, au point
que celles-ci peinent à se renouveler : les sols tendent à s’appauvrir, les
forêts reculent, les réservoirs d’eau potable s’assèchent et la nature perd en
diversité biologique.
La hausse de la consommation a conduit à
une production mondiale de déchets 1,5 fois supérieure à ce qu’elle était il y
a 20 ans, et seulement 10% sont aujourd’hui recyclés. Ces déchets posent ainsi
à la fois des problèmes de stockage et de pollution sur l’environnement.
A côté de ce constat,
l’humanité est certes trois fois plus riche qu’il y a 40 ans, mais des
problèmes importants persistent :
Plus d'un milliard de personnes vivent
encore en-dessous du seuil de pauvreté mondial, c’est-à-dire 1,25 $ par jour.
L’alimentation est un sujet de
préoccupation au Sud comme au Nord : près d’un milliard de personnes souffrent
aujourd’hui de sous-nutrition, tandis que dans les pays les plus riches les
modes d’alimentation deviennent une source importante de maladies
cardio-vasculaires.
Les évolutions démographiques et sociales
de la planète conduisent à augmenter la rapidité de diffusion des maladies
infectieuses, et donc leur impact. 33 millions de personnes sont par exemple
séropositives dans le monde, dont 90% ne savent pas qu’elles sont infectées.
Enfin, les écarts de développement ont mis
en évidence l’enjeu de l’éducation. Une éducation qui doit souvent être
renforcée à la base, quand on sait que dans des dizaines de pays plus d’une
personne sur deux souffre d’analphabétisme.
Face à ces enjeux,
tous les acteurs de la société peuvent être moteurs de changement.
La responsabilité des
entreprises
Une entreprise, en
particulier, peut être une force de transformation pour le monde à partir du
moment où elle assume ses responsabilités vis-à-vis de ses parties prenantes,
c’est-à-dire des différents groupes qui sont directement ou indirectement liés
à elles.
Le Pacte mondial des
Nations unies, lancé en 1999, fait partie des toutes premières démarches qui
ont engagé les entreprises à exercer cette responsabilité. Celle-ci peut se
manifester à différents niveaux :
La gouvernance : ouverte et transparente,
l’entreprise peut instaurer des stratégies gagnantes qui prennent en compte les
intérêts de toutes les parties prenantes (communautés locales, investisseurs,
fournisseurs…).
Les ressources humaines : lorsqu’une
entreprise s’engage sur la formation de ses employés et la promotion de la
diversité, elle fait avancer l’éducation et l’intégration sociale à son niveau.
Les achats : à travers une politique
d’achats responsables, une entreprise peut aider au développement des petits
producteurs locaux comme à celui des filières globales telles que le bio ou le
commerce équitable.
La communication : à travers la
sensibilisation de ses employés et de ses clients, une entreprise peut faire
avancer des grandes causes comme la lutte contre le VIH/sida ou contre la
déforestation.
Les opérations : à travers des projets
d’envergure, une entreprise peut aider à la diffusion de nouvelles pratiques
telles que le tri sélectif des déchets, et à la promotion de nouvelles
technologies comme l’énergie solaire.
Les possibilités
d’actions sont donc nombreuses. Chacun peut trouver les moyens d’apporter sa
propre contribution.
Le rôle de
l'hôtellerie
L’hôtellerie a un rôle
clé à jouer dans le développement durable. En effet, chaque hôtel est confronté
à son niveau aux problématiques actuelles de l’environnement : chauffage du
bâtiment, consommation de l’eau, gestion des déchets ménagers (clients) et industriels
(blanchisserie, restauration), préservation du site… L’hôtel est donc un vrai
terrain où explorer de nouvelles techniques et de nouvelles manières de vivre.
En outre, un groupe
hôtelier est implanté aux quatre coins du globe : dans les centres-villes et
les banlieues, dans les métropoles et les campagnes, à la montagne et le long
des côtes, des régions les plus modernes aux contrées les plus reculées...
Cette infinie variété des lieux fait du secteur hôtelier le témoin direct et
privilégié des grandes problématiques mondiales, comme le développement
économique, la lutte contre les maladies ou encore l’alphabétisation.
Enfin, les hôtels
voient passer le monde entier entre leurs murs. Ils constituent donc un lieu
unique de sensibilisation auprès du grand public, que ce soit sur des thèmes de
société ou sur des nouvelles pratiques écologiques.
Et Accor ?
Accor, premier
opérateur hôtelier mondial et leader en Europe, est présent dans 90 pays. Avec
145 000 collaborateurs, le Groupe construit chaque jour une vision forte du
développement durable grâce à l’expérience de ses collaborateurs et de ses
clients du monde entier.
Ce positionnement
unique aide sans doute à expliquer l’engagement précurseur de Accor : dès 1974,
les dirigeants du groupe qualifiaient l’environnement de « matière première du
tourisme ». Vingt ans plus tard, en 1994, Accor devenait l’une des premières
grandes entreprises françaises à se doter d’une direction environnement.
Depuis, Accor a eu le
temps d’accumuler une large expérience sur le sujet. Un département a
d’ailleurs été spécifiquement créé en 2002, afin de structurer et d’animer
cette expérience. Aujourd’hui, le développement durable s’articule chez Accor
autour de quelques idées fortes :
le développement durable ne se limite pas à
l’environnement, mais comprend également tout les champs des engagements en
faveur de l’homme (développement local, lutte contre les épidémies, protection
des enfants face au tourisme sexuel).
un groupe tel que Accor gagne à capitaliser
sur sa force de mobilisation. A travers son large réseau d’hôtels et
d’activités dans le monde, Accor a en effet la capacité de rallier un nombre
important de partenaires autour de projets communs.
enfin, la communication du développement
durable doit se concentrer sur des actions concrètes, en restant rigoureuse et
transparente sur les résultats atteints.
Historique de
l’engagement du groupe Accor
1994
Création d’une Direction Environnement du
Groupe.
1998
Lancement de la charte Environnement de
l’hôtelier, qui recommande 15 actions à mener au niveau de chaque hôtel.
2001
Partenariat avec l’association ECPAT, qui
lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le monde.
2002
Création de la Direction Développement
durable du Groupe, traitant les sujets environnementaux et sociétaux.
2003
Adhésion au Pacte mondial des Nations
Unies.
Lancement de la charte Achats durables.
Introduction d’une offre de café équitable
dans les hôtels Sofitel en France.
2004
Ibis engage son réseau dans la
certification environnementale ISO 14001.
2005
Mise à jour de la charte Environnement de
l’hôtelier, qui préconise désormais 65 actions.
Création de OPEN (Outil de Pilotage
Environnemental), un outil intranet qui permet à chaque hôtelier de faire
remonter ses consommations d’eau et d’énergie, ainsi que les actions de la
charte Environnement qu’il met en place.
2006
Lancement du programme Earth Guest, qui
structure les actions menées en matière de responsabilité sociétale et
environnementale autour de huit priorités.
Ouverture du Novotel Montparnasse à Paris,
premier hôtel construit selon les standards HQE® en France.
Conclusion d’un partenariat avec la GBC,
Coalition Mondiale des Entreprises contre le sida, la tuberculose et le
paludisme.
2007
Première édition d’ Earth Guest day, la
journée mondiale des collaborateurs Accor pour le développement durable, le 22
avril, en même temps que la journée mondiale de la Terre.
Début du projet « 100 hôtels solaires »,
qui vise à diffuser la technologie solaire thermique dans l’hôtellerie.
Lancement de « ACT-HIV », le programme de
Accor en matière de prévention et de sensibilisation contre le VIH/sida.
2008
Début
du projet Plant for the Planet, qui
vise à planter 3 millions d’arbres d’ici 2012
grâce aux économies générées par
la réutilisation des serviettes de bain plus d'une nuit par les
clients des
hôtels Accor.
2009
Lancement par la marque Novotel d'un module
de formation en e-learning sur le développement durable à destination des collaborateurs.
Obtention par le futur Suite Novotel
Issy-les-Moulineaux de l'un des premiers certificats NF bâtiments tertiaires -
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) accordé à un hôtel.
2010
Obtention par Accor du Tourism for Tomorrow
Award 2010, décerné par le World Travel & Tourism Council (WTTC), qui
récompense les actions menées par le Groupe dans le monde en faveur du
développement touristique durable.
Lancement d'un partenariat avec l'Institut Pasteur pour agir sur les
maladies émergentes via A|Club, le programme de fidélisation de Accor. Obtention par le Motel 6 Northlake-Speedway
de la certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design »)
qui récompense la construction de bâtiments durables à haute performance.
Jean-Pierre Letartre
est
Président France Luxembourg Maghreb,
d’ Ernst & Young ; diplômé d'un DEA de Droit des
Affaires, Expert
Comptable, Commissaire aux Comptes. Originaire de Lille, il rejoint le
Cabinet Ernst & Young en 1985 et crée en 1986 le bureau pour
la
région Nord. C'est ainsi, que de trois collaborateurs à
sa création, le bureau
Lillois en compte 180 aujourd'hui. En 1994, il est chargé de
développer et
d'animer les activités EY sur l'ensemble des bureaux des
régions et de
développer le marché des entreprises de croissance. En
2005, il accède au poste
de Directeur Général pour l'ensemble de la France. Jean
Pierre Letartre est aussi très
impliqué dans la promotion de l'entreprenariat en France :
il est vice-président
des journées de l'Entrepreneur. Les 3400 collaborateurs et
associés sont
installés dans la tour First de la Défense,
certifiée HQE. Ernst & Young
est un des principaux cabinets d'audit, l'un des Big Four, et le
troisième
réseau mondial en termes de chiffre d'affaires (après
PricewaterhouseCoopers et
Deloitte)2 (2009). Sa mission est de répondre aux enjeux majeurs
de ses clients
(sociétés cotées, entreprises du Middle Market,
jeunes entreprises innovantes,
secteur public, fonds d'investissements…).
Les Arnault

Photo Paris Match
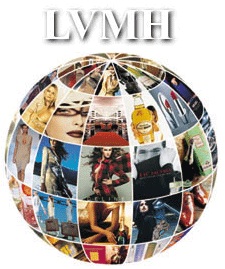
Bernard Arnault est le
père de cinq enfants; de son premier mariage avec Anne Dewavrin (remariée à
Patrice de Maistre), il eut Delphine, administratrice du groupe LVMH depuis 2004 et
Antoine, directeur de la communication chez Louis Vuitton. De sa seconde et
actuelle épouse, Hélène Mercier-Arnault, canadienne, pianiste, il a trois fils . LVMH est un groupe
international ; La majeure partie des 80 000 salariés est basée à l’
international :- 22 % en Amérique du Nord et du Sud, 6 % au Japon, 19 % en Asie-Pacifique, 22 % en Europe (hors France). De plus, 85 %
du chiffre d'affaires sont réalisés à l’ international. Par ailleurs, le
groupe LVMH a établi de nombreux partenariats avec différentes écoles à l’
international.
Le documentaire écrit
par Guillaume Durand et réalisé par Gilles de Maistre "Bernard Arnault,
l’enfance est un destin" diffusé sur France 5 montre l’attachement de
Bernard Arnault pour Roubaix, la ville de sa naissance, de son enfance, de
sa famille,
de ses valeurs et une sensibilité qui s’exprime pleinement
dans son talent pianistique. Il sait être un ambassadeur de la
France dans le monde.
PATRIMOINE
VIVANT
Et
Voici
les
particularités de ces
« Grandes
Familles du Nord » :
Ancienne
identité terrienne ou urbaine en Flandre Méridionale,
Héritages du duché de Bourgogne, d'Espagne, de l’histoire
de France.
Indépendance
du Beffroi des Villes Franches mais Révérence aux
Suzerains.
Recherche
du millénaire et convoité statut
de Bourgeois de Flandres.
Catholicisme exclusif
issu
de la Contre-Réforme des Flandres méridionales
Educations
classiques et strictes
dans des institutions consacrées et
pragmatisme
Exceptionnel
esprit de familles nombreuses,
généreuses, unies, alliées entre elles.
Ces
innombrables parentés croisées
en font
une seule et vaste
famille.
Constitutions
de lignées, dynasties, les ainés au même prénom
jusqu’à 12 générations.
Rôle des chefs
de familles; goût des réunions régulières
des parentèles et cérémonies.
Archivages
des généalogies à travers des
Bottins, tel le "Ravet-Anceau"
Nombreuses
vies consacrées, nombreux
créateurs, nombreux engagés.
Tradition
textile, négociante et fabricante depuis
le Moyen-âge au moins.
Esprit
d’entreprise, de responsabilités et d’excellence
à chaque génération.
Puissance
de travail, solidarités familiales, rôle des alliances.
Vision planétaire depuis cette terre,
longtemps «capitale
mondiale textile ».
Puissance
économique exceptionnelle en France et
dans le monde.
Engagements divers pour
la cité et la Nation et Œuvres innombrables
Innombrables
initiatives sociales, souvent appelées "paternalisme",
en
opposition au capitalisme financier
international.
Grands bâtisseurs: œuvres artistiques remarquables.
Goût des collections, du mécénat.
Goût des demeures, des
intérieurs, des jardins.
Goût des Manufactures, matières et des couleurs.
Capacité
de rebondir puis de se reconvertir dans l’adversité.
Ces
particularités font des « Grandes
Familles du Nord »
un tout appartenant
au Patrimoine Vivant.
AGACHE
ARNAULT BARROIS BEGHIN
DE BAILLIENCOURT BAYART BECQUART
BEHAGHEL BERA BERNARD BESNARD
BIGO BONDUELLE BOSSUT BOUTRY BONTE BRABANT
BREUVART BROUDEHOUX BULTEAU BURRUS
BUTRUILLE
CARISSIMO CATOIRE CATRY
CAULLIEZ CAVROIS CHARVET COISNE
COLOMBIER COUROUBLE
CORTYL CREPY CROMBEZ
CROUAN CUVELIER
DALLE DANSETTE DATHIS DASSONVILLE de
BETTIGNIES DE
COSTER-DECOSTER
DE
FRENNE - DEFRENNE DECROIX DEHAU - DEHAU DE STAPLANDE DE
GANDT
DEBIEVRE DELAME CHOMBART CHRISTORY
CROMBEZ DE LATTRE - DELATTRE
DELANNOY DE LE BECQUE - DELEBECQUE
DE BRIGODE DE
LE CROYS - DELECROIX
DELCOURT DELEPLANQUE DE LE RUE - DELERUE DE LE SALLE - DELESALLE
De LESPAUL
DELLOYE de VAREILLES
SOMMIERES DELAHOUSSE DE LAOUTRE DELAOUTRE DEMEESTERE
DE MEULENAERE DENONVILLIERS
DUPONT DERODE DERVAUX DERVILLE
DESBONNETS
DESCAMPS DESMAZIERES
DESOMBRE
DESPATURE DESRUELLES DES TOMBES - DESTOMBES
DEVEMY DE SURMONT - DESURMONT DEVILDER DE WAVRIN - DEWAVRIN D’HALLUIN DILLIES
DOUTRIAUX DROULERS DUBAR DUBRULE
DUBOIS
DUBUS DUCATTEAU DUCHATELET
DUFOUR DU
HAMEL DUJARDIN DUPIRE DUPREZ DUQUENNOY DURIEZ DUROT DUTHOIT
DUVILLIER ELOY
ERNOULT
FAUCHILLE
FAURE FAUVARQUE FLIPO
FLORIN FROIDURE
FROISSART GERARD
GIARD GHESQUIERE GLORIEUX GOURLET
GRARDEL GRAS GRIMONPREZ
GALLANT GUERMONPREZ HOUZE de
L’AULNOIT HEYNDRICKX
HUET IBLED JOIRE JONVILLE
LE BLAN LEFEBVRE
LEMAIRE LECOMTE LEPEE
JONGLEZ de LIGNE LECLERCQ
LEMAITRE
LEPLAT LEPOUTRE
LENGLART
LEROUX LESAFFRE LESTIENNE
LESUR LEURENT
LIAGRE LE THIERRY D’ ENNEQUIN LIENART LORTHIOIS
LOTTHE
LOUCHEUR
MAES
MABILLE DE PONCHEVILLE
MAILLARD MACQUART de TERLINE
MAILLOT
MALARD
MALFAIT MAQUET MAS DE TREHOULT
MASQUELIER MASUREL MATHIAS
MATHON
MEILLASSOUX MIGNOT MINART MONTPELLIER MORAEL
MOTTE MOTTEZ MOURCOU
MULLIEZ
NICOLLE OUTTERS OVIGNEUR PATTYN
PIAT PIERARD POISSONNIER
POLLET PROUVOST PUPPINCK RAMMAERT
RASSON REQUILLART R EUMAUX ROGEAU
ROQUETTE ROUSSEL
SARTORIUS SCALABRE SCALBERT SCREPEL SCRIVE
SEGARD SION SIX THIRIEZ TIBERGHIEN THELLIER
DE PONCHEVILLE
THERY TOULEMONDE TOURRET TRECA VAN DEN BERGHE VANDAME
VALDELIEVRE VALENTIN VAN ELSLANDE VERHAEGHE VERLEY
VERSTRAETE VIENNE VOREUX WACRENIER WARTEL
VIRNOT - VIRNOT de LAMISSART VERNIER WAMBERGHE
WALLAERT WATEL WATINE WATTINNE WATRELOT
WATRIGANT WAMBERGHE WAUQUIEZ
WIBAUX WILLOT
WOUSSEN
Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃-Pour vous, les princes-为了您,王子!
Retour
Association
des Lignages de France (A.L.F), Noblesse française,
Identité agnatique, Blason héraldique, Thésaurus
agnatique, Thésaurus visuel agnatique, Lignées
familiales, Bien Commun, Patrimoine familial, Éducation
traditionnelle, Religion catholique, Dynasties familiales, Élite
traditionnelle, Marcel Lefebvre, Retour de la royauté, Formation
traditionnelle, Photographies familiales, Portraits mémoriels,
Repère familial, Province familiale,
Dérogance,Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, Duc d'Anjou,
Aîné des Capétiens, communication,
événementiel, théologie, histoire,
généalogie, art, philosophie, marché de l'art,
marché de l'immobilier, Paris, agence, Pour vous, les princes,
sphère, logo, être humain, transcendance, blason, famille,
Prouvost, VIRNOT-VIRNOT de LAMISSART, ouvrages, site web, internautes,
Révolution, aristocratie, bourgeoisie, noblesse,
éducation, religion, royauté, monarchie,
république, retour, royauté catholique, élites,
patrimoine, manufactures royales, concile Vatican II, liturgie, chant,
églises modernes, Mai 68, morale, famille, vocations,
liberté religieuse, indifférentisme, relativisme,
collégialité, vêtements laïcs, prêtre,
soutane, arbres à fruits, Malin, frontières, monnaie,
pouvoir régalien, tissu industriel, chrétiens d'Occident.
Association of Lineages of France (A.L.F), French
nobility, Agnatic identity, Heraldic coat of arms, Agnatic thesaurus, Agnatic
visual thesaurus, Family lines, Common good, Family heritage, Traditional
education, Catholic religion, Family dynasties, Traditional elite, Marcel
Lefebvre, Return of royalty, Traditional training, Family photographs, Memorial
portraits, Family landmark, Family province, Derogation, Monsignor Prince Louis
of Bourbon, Duke of Anjou, Elder of the Capetians, communication, events,
theology, history, genealogy, art, philosophy , art market, real estate market,
Paris, agency, For you, the princes, sphere, logo, human being, transcendence,
coat of arms, family, Prouvost, VIRNOT-VIRNOT de LAMISSART, works, website,
Internet users , Revolution, aristocracy, bourgeoisie, nobility, education,
religion, royalty, monarchy, republic, return, Catholic royalty, elites,
heritage, royal manufactures, Vatican Council II, liturgy, song, modern
churches, May 68, morality, family, vocations , religious freedom,
indifferentism, relativism, collegiality, secular clothing, priest, cassock,
fruit trees, Malin, borders, currency, sovereign power, industrial fabric,
Western Christians.
grandes familles du Nord ; grandes familles des
Flandres ; grandes familles des hauts de France ; familles
patriciennes du Nord
grandes familles du Nord ; grandes familles des
Flandres ; grandes familles des hauts de France

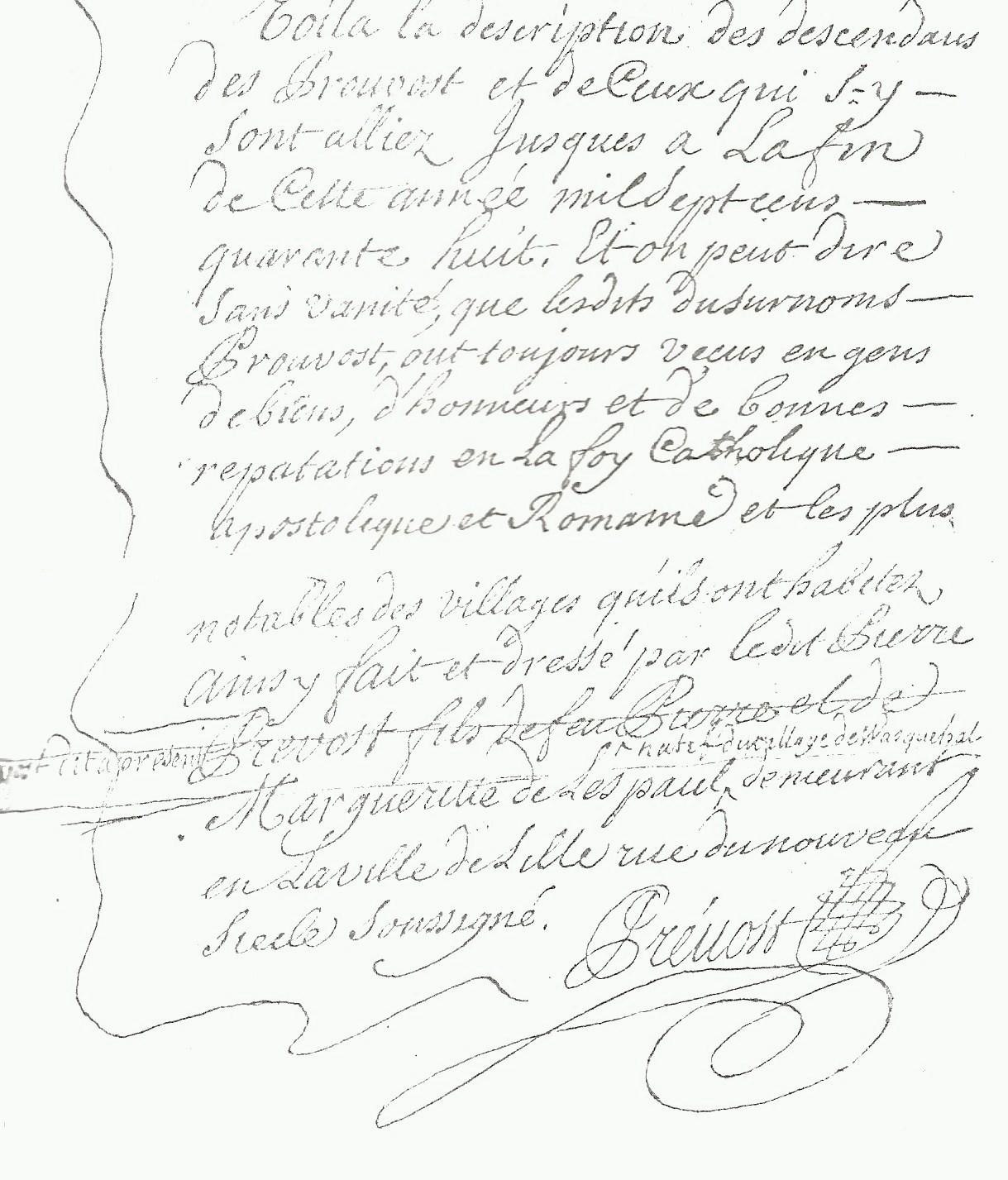
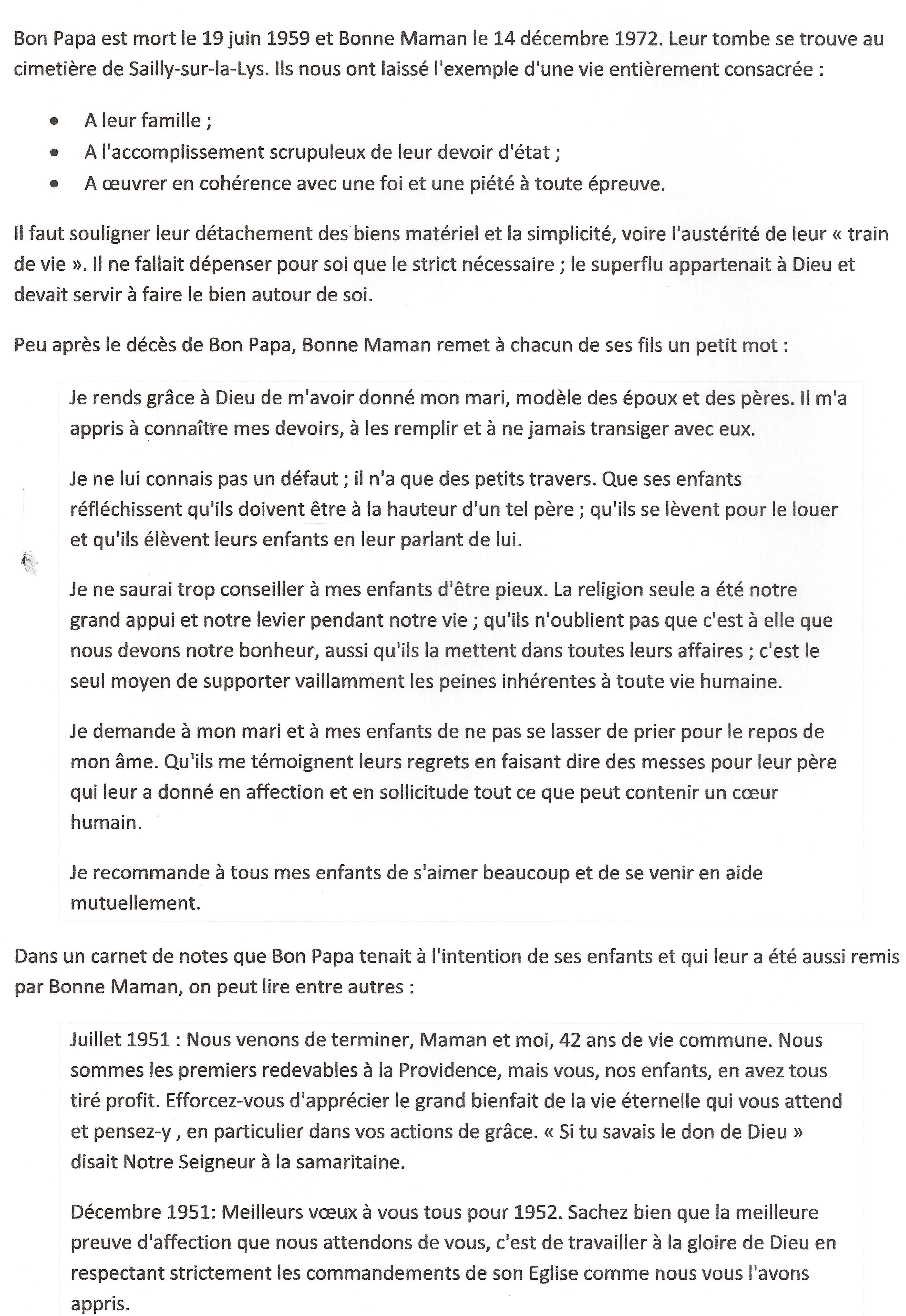



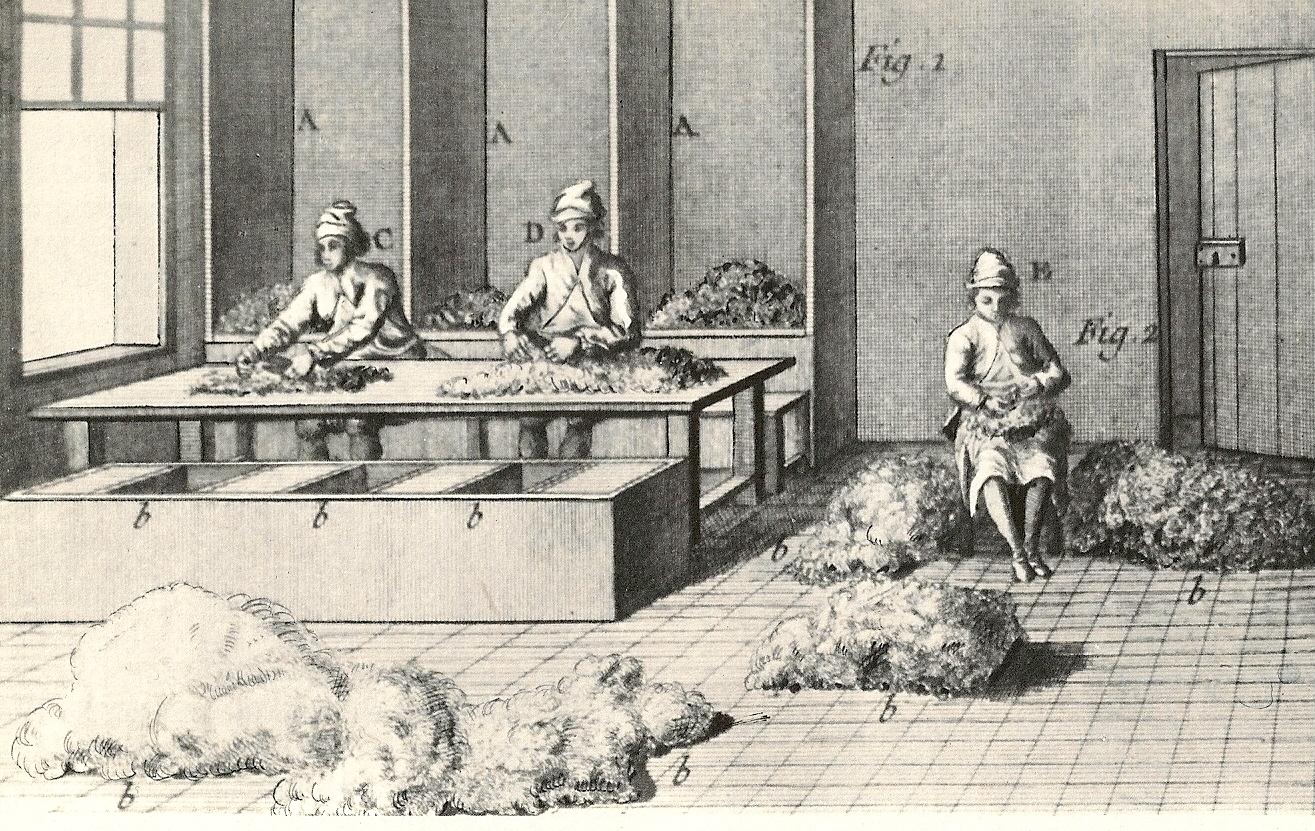
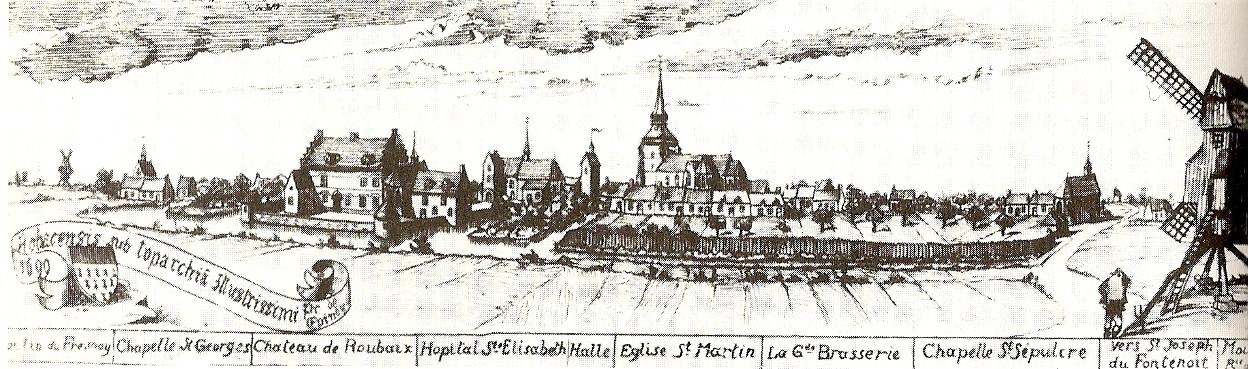








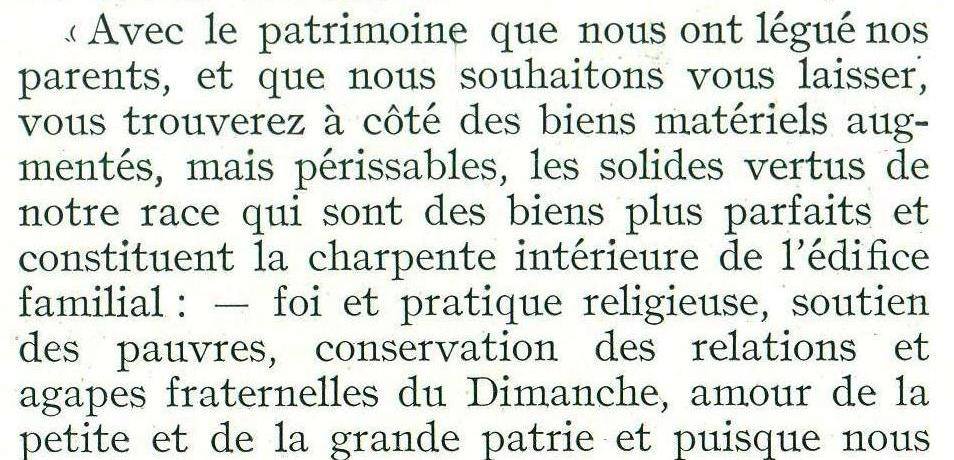
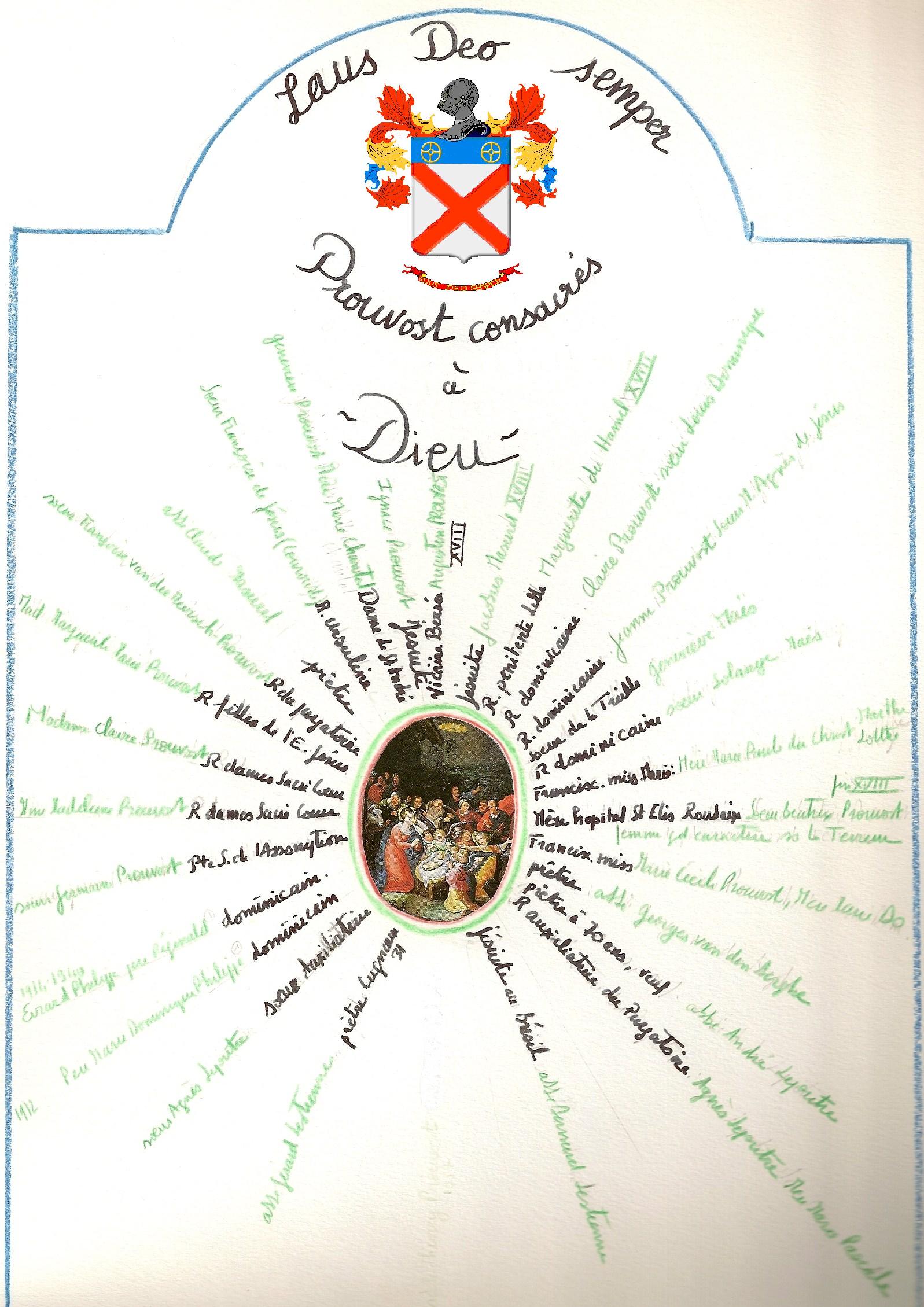




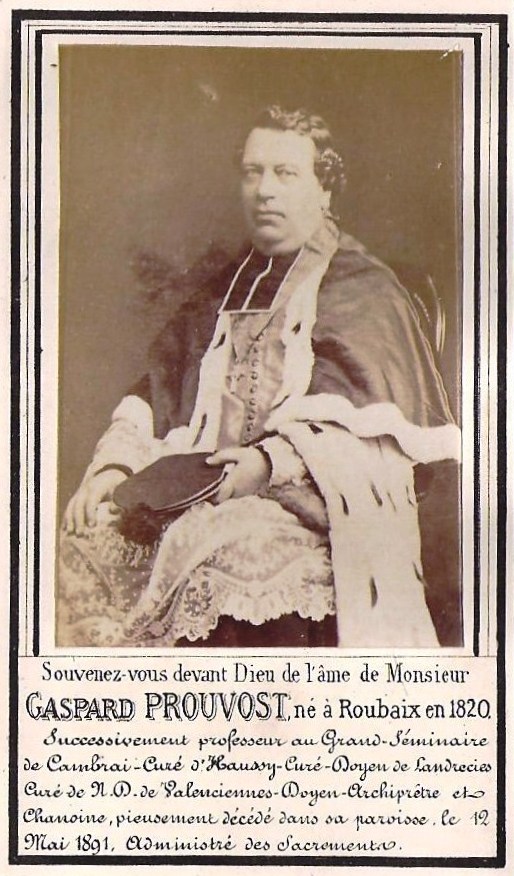

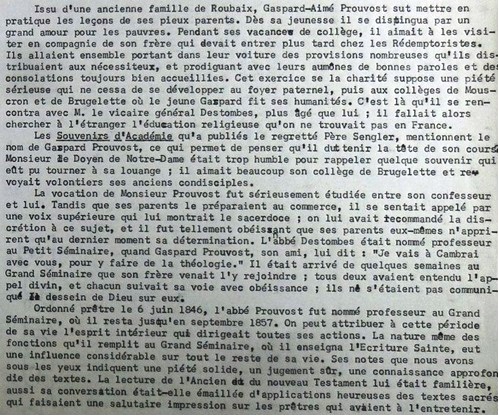
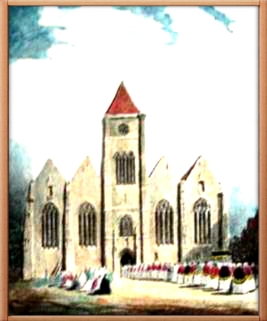
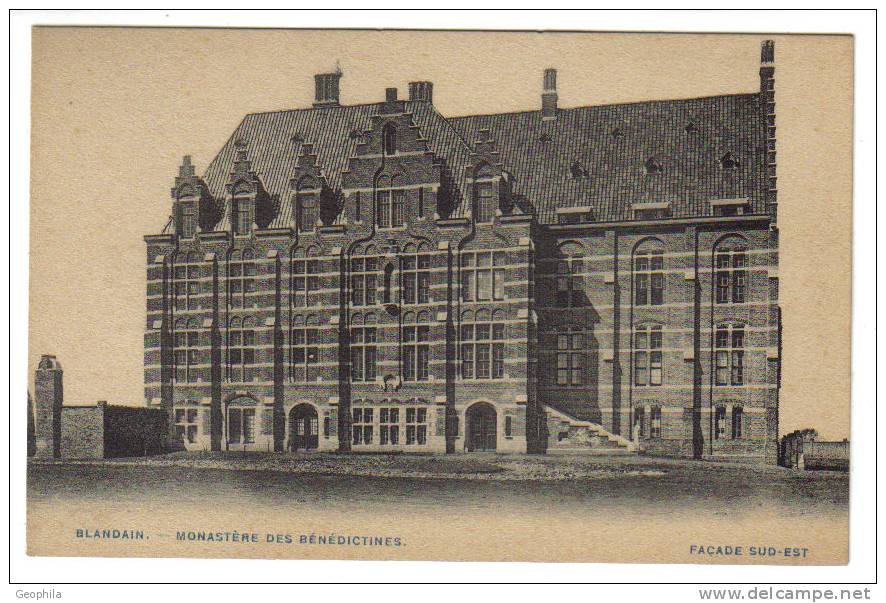
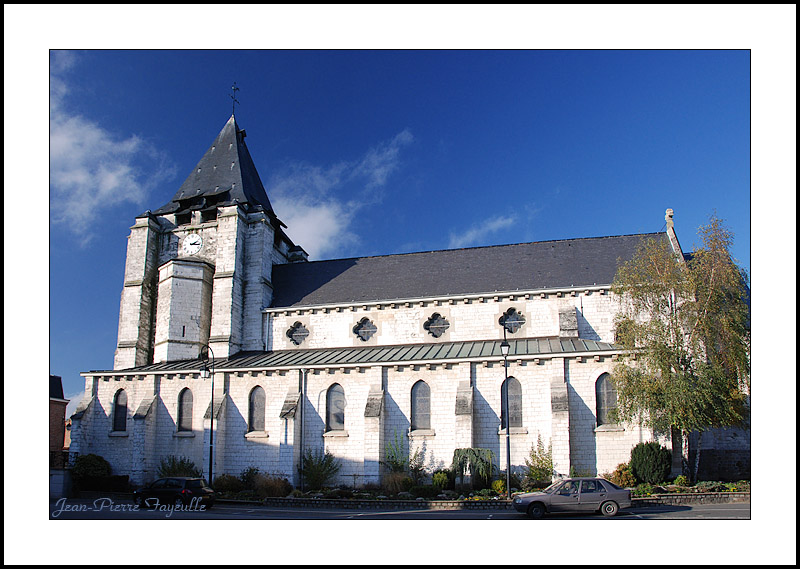


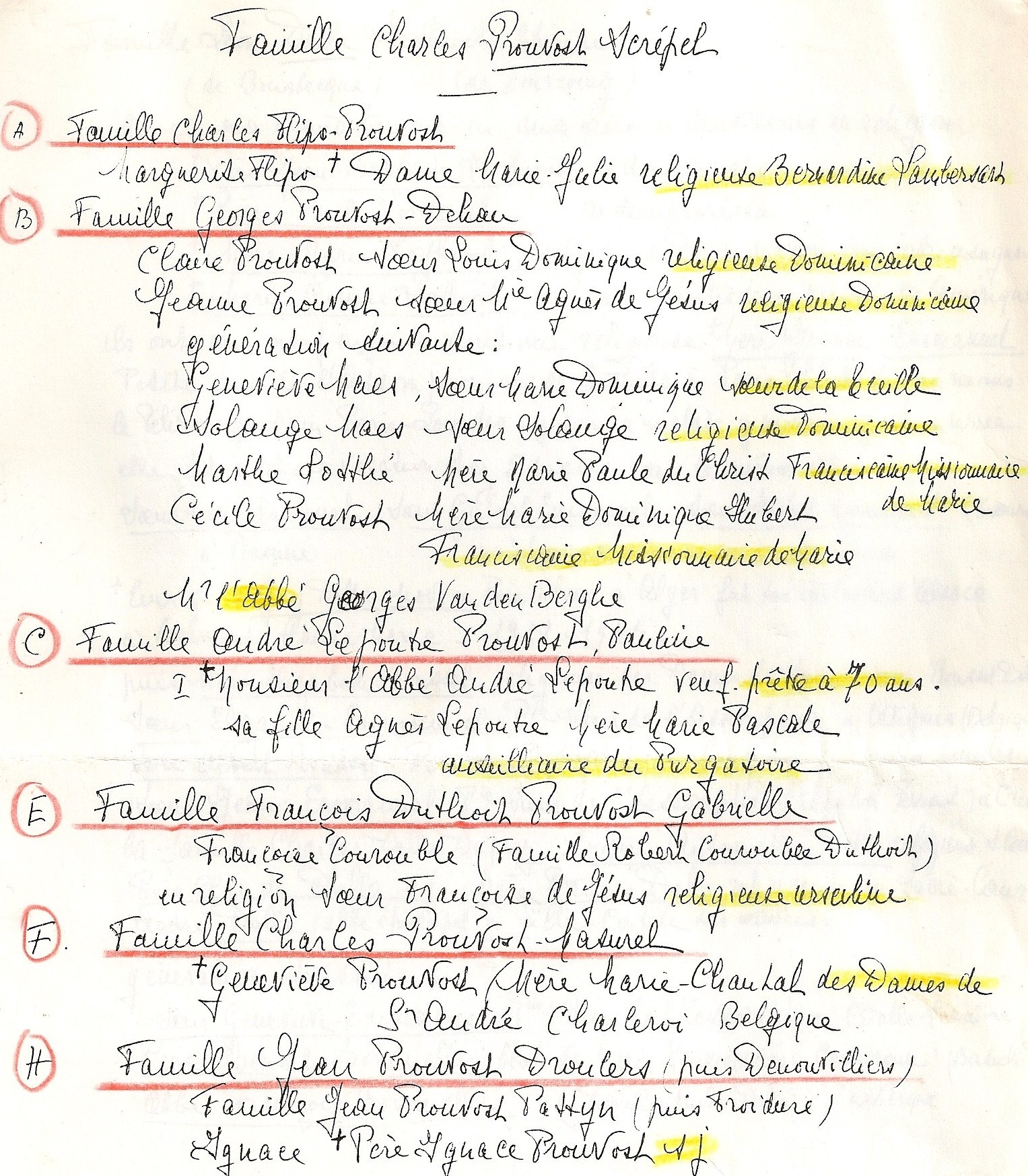
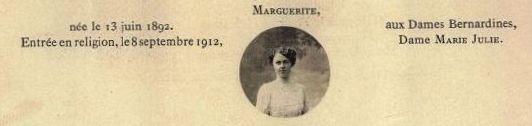
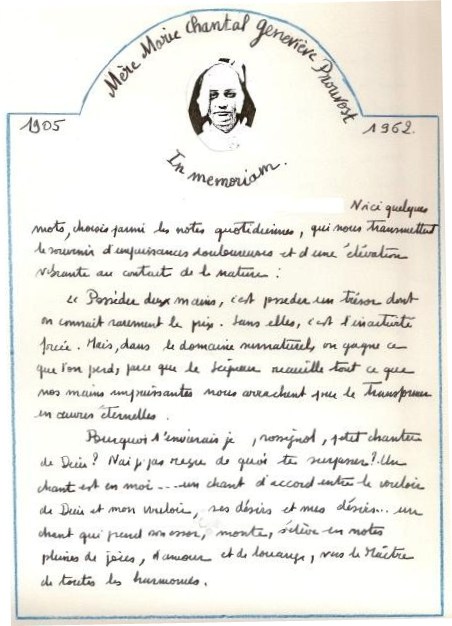
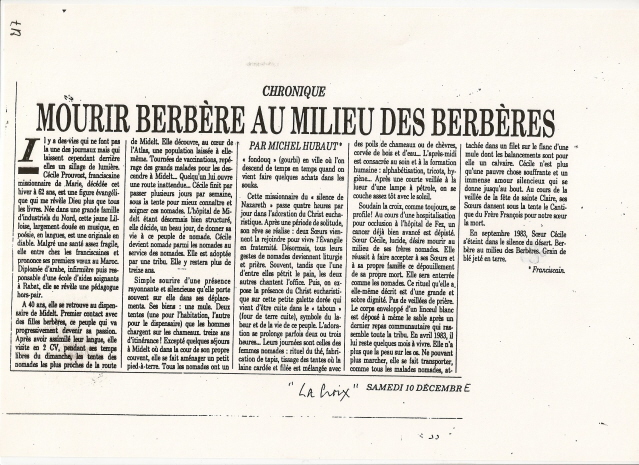
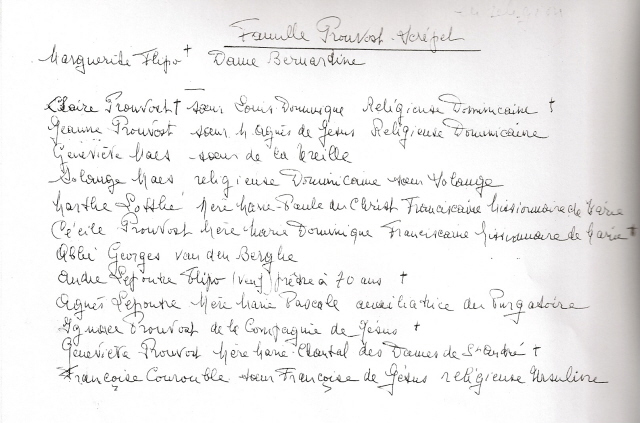



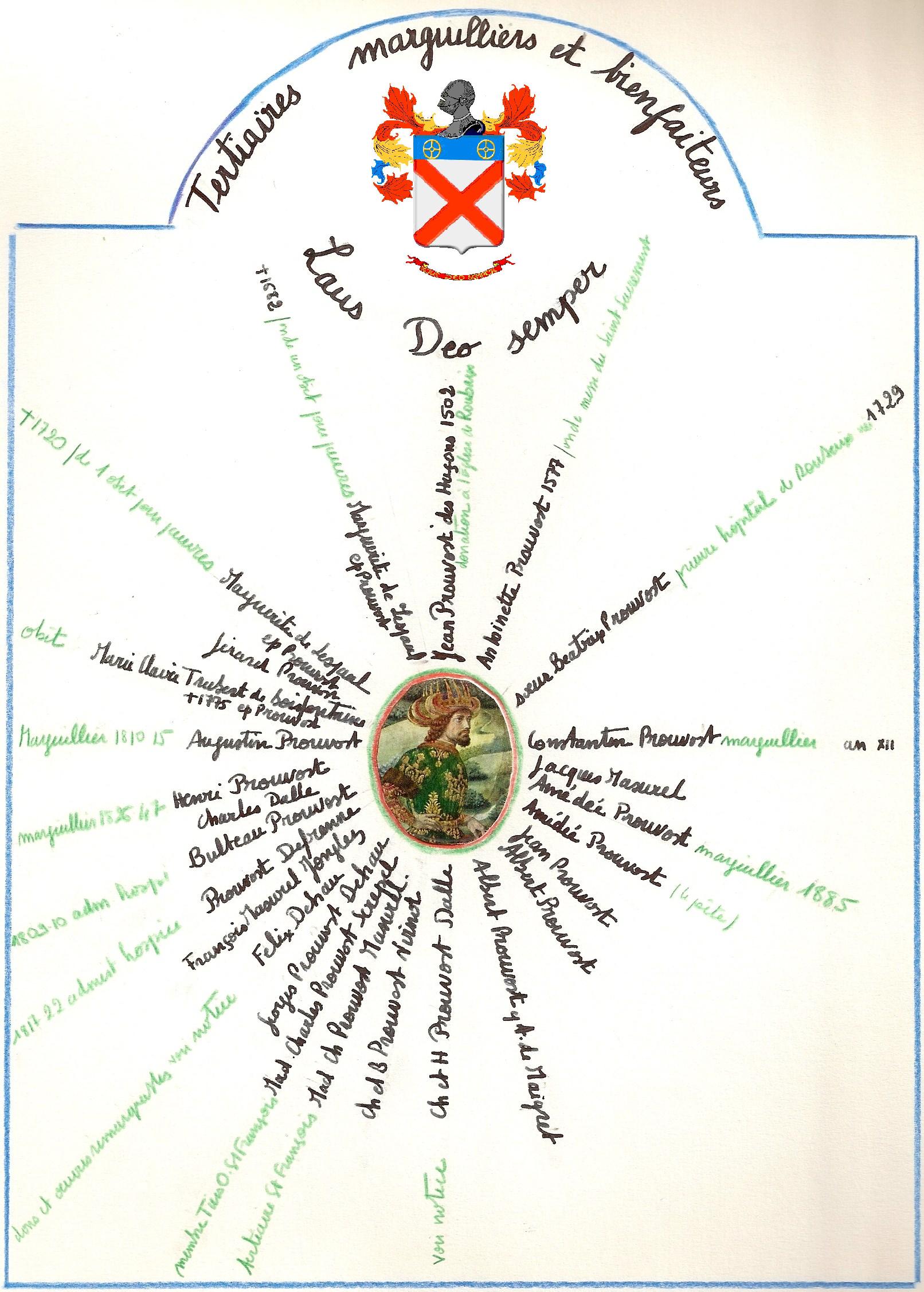
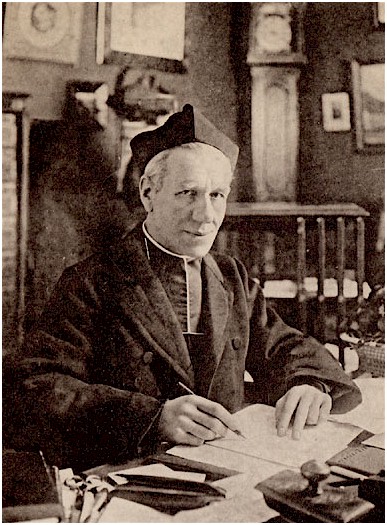
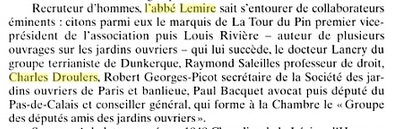
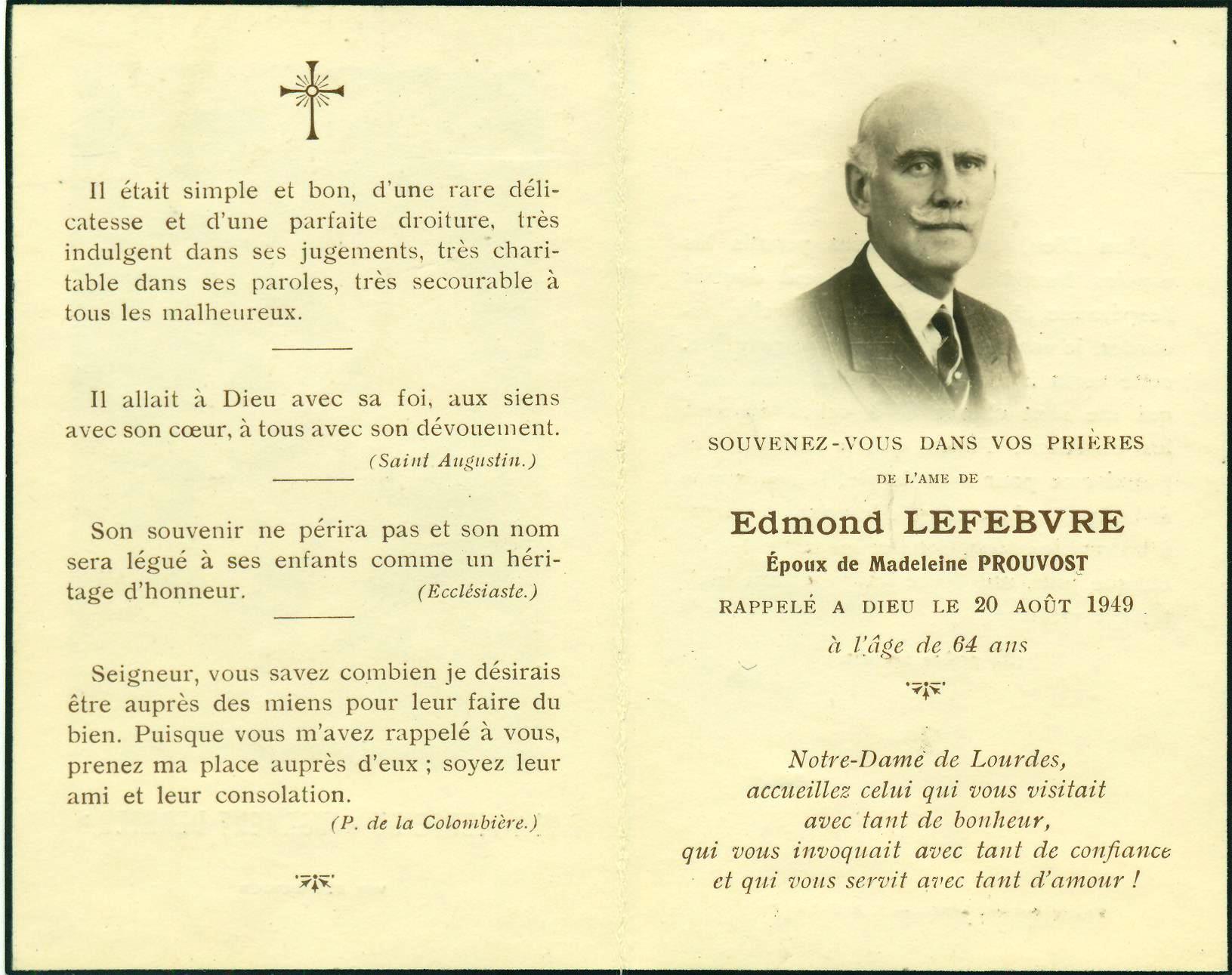

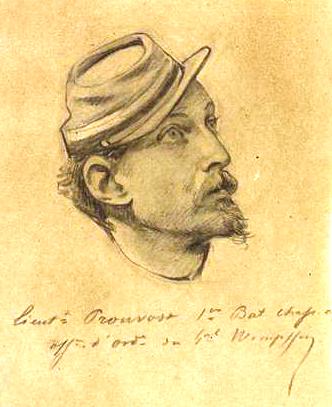

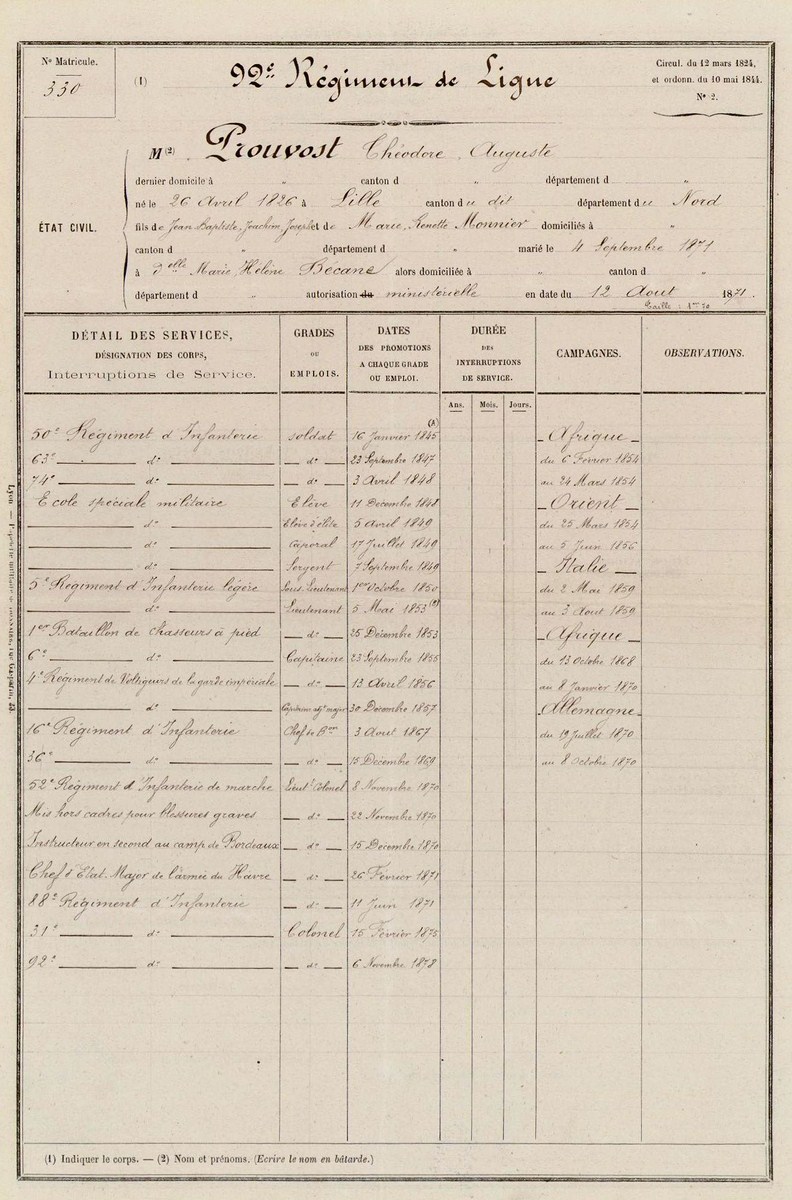
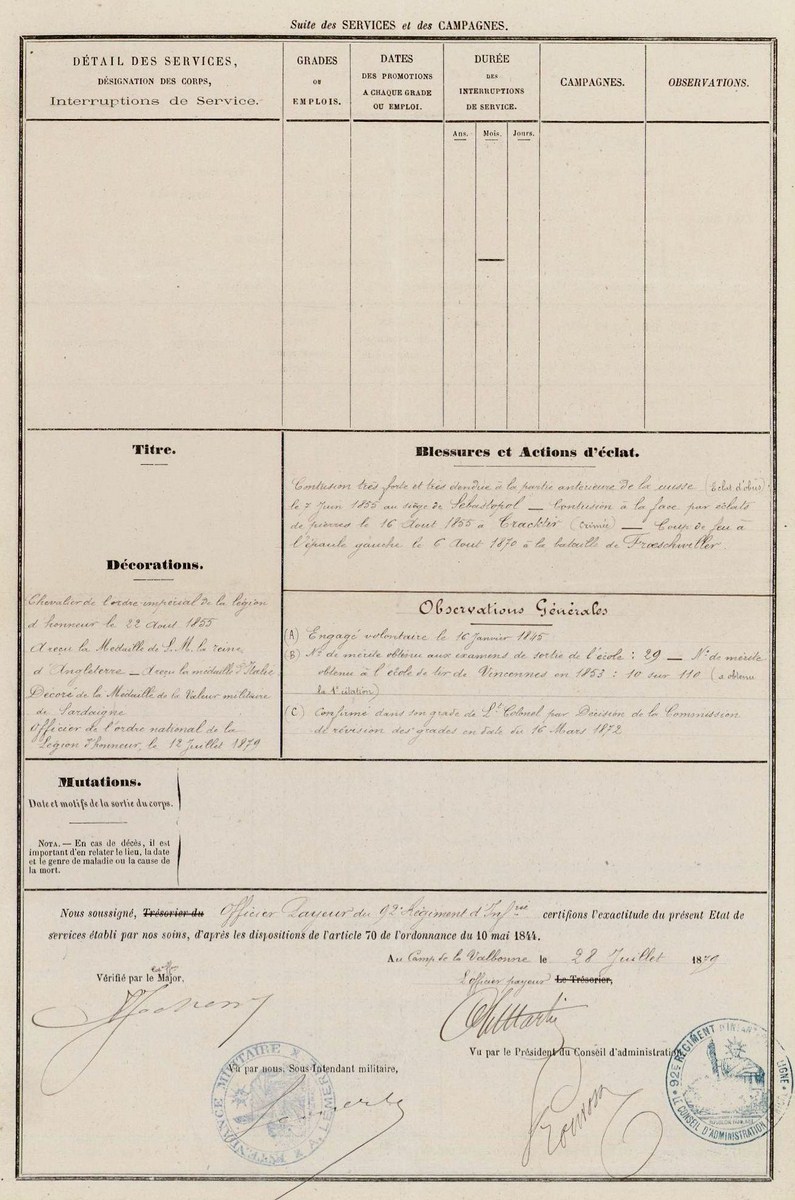
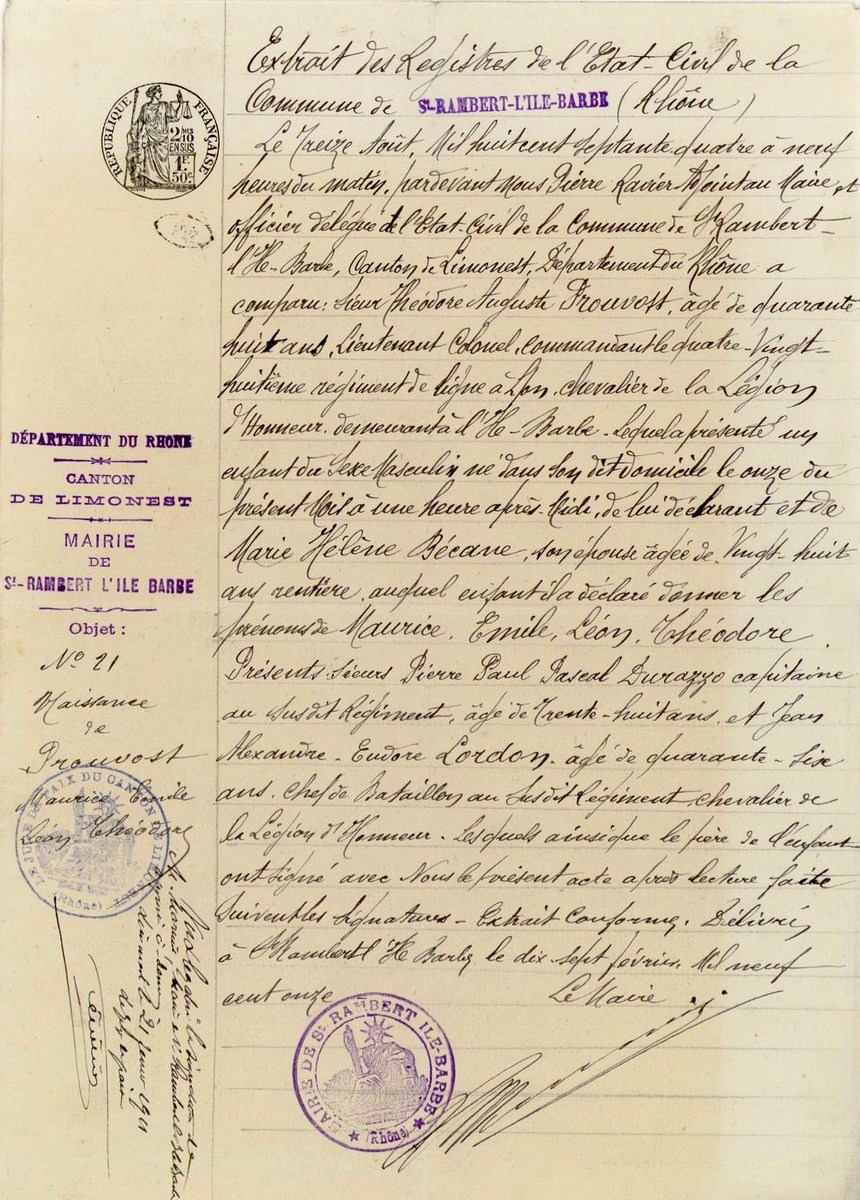
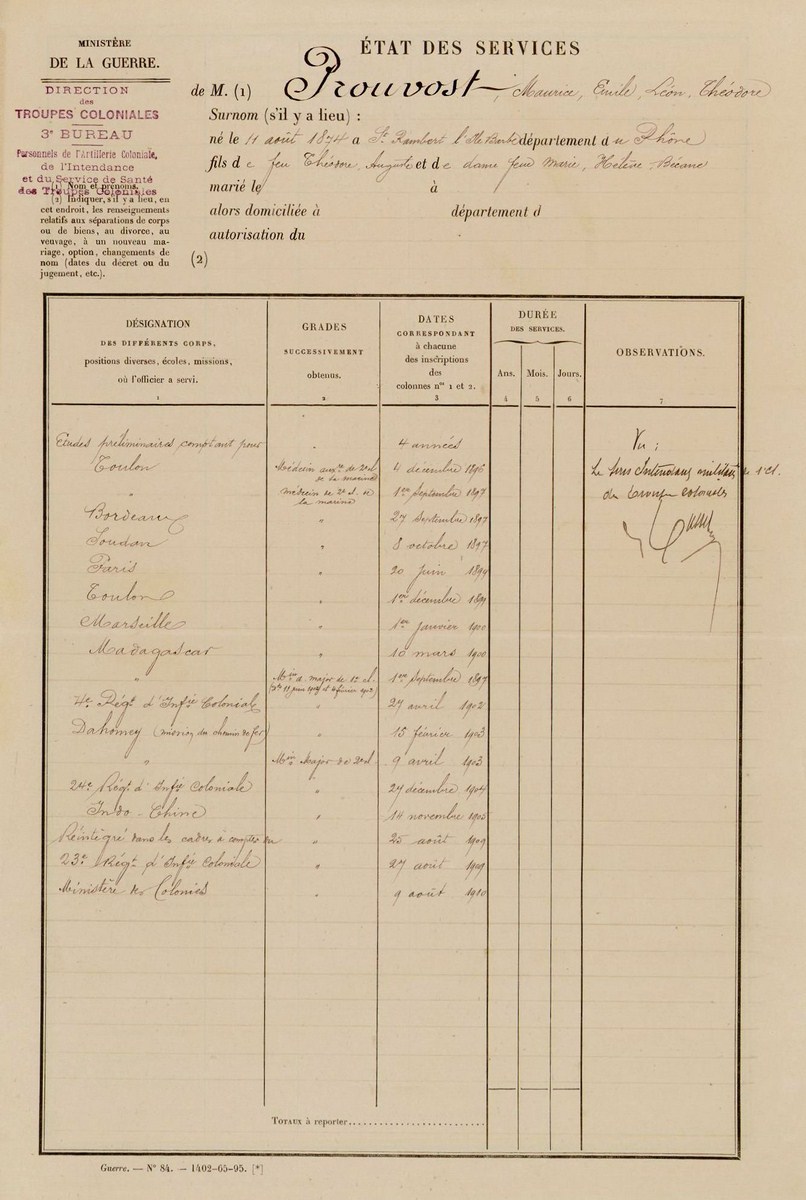
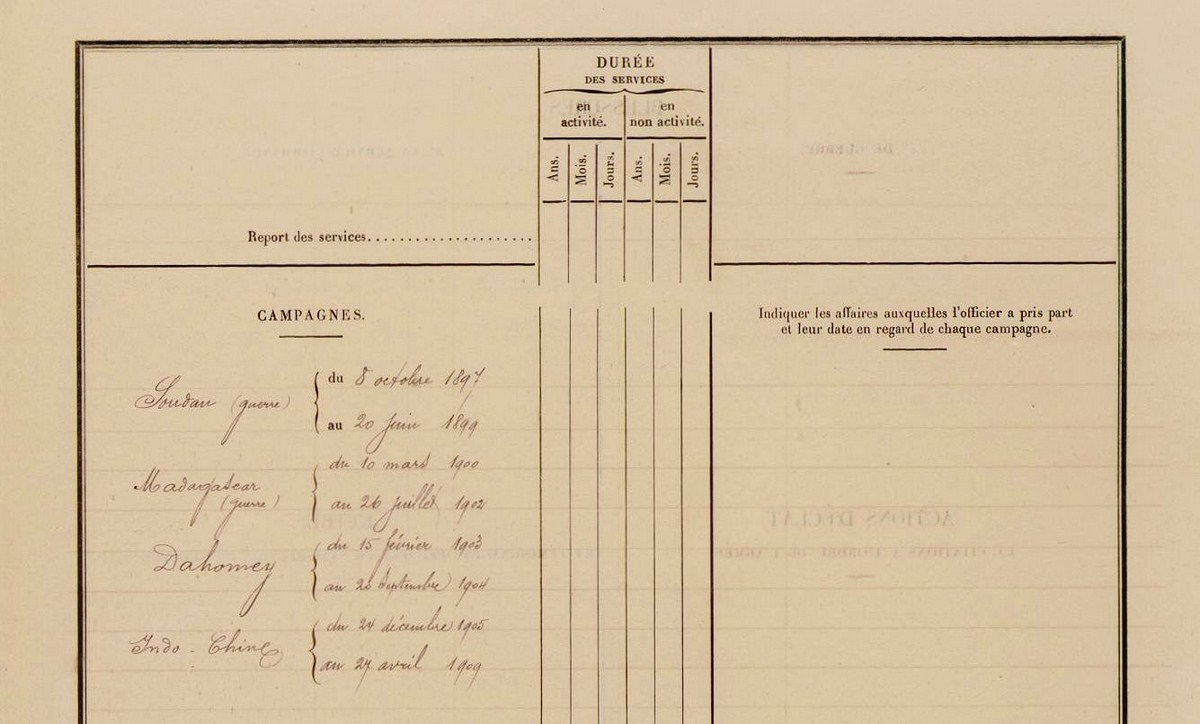
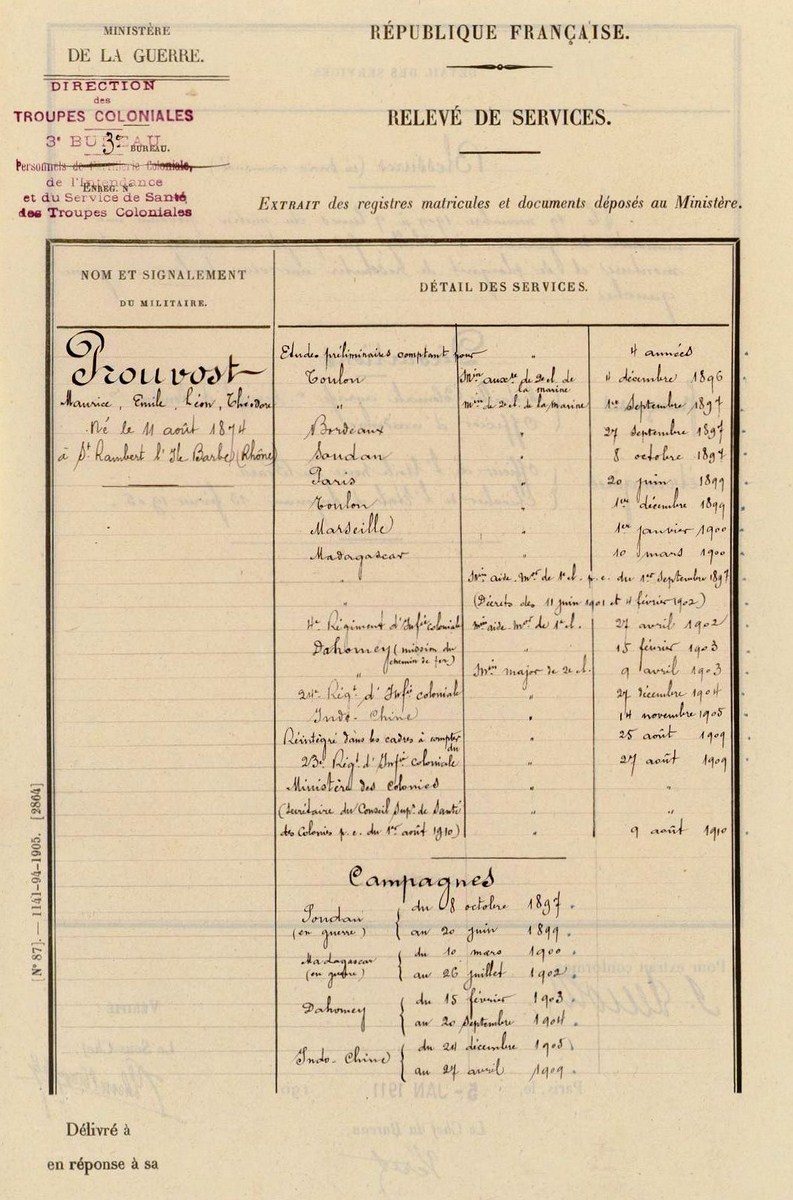
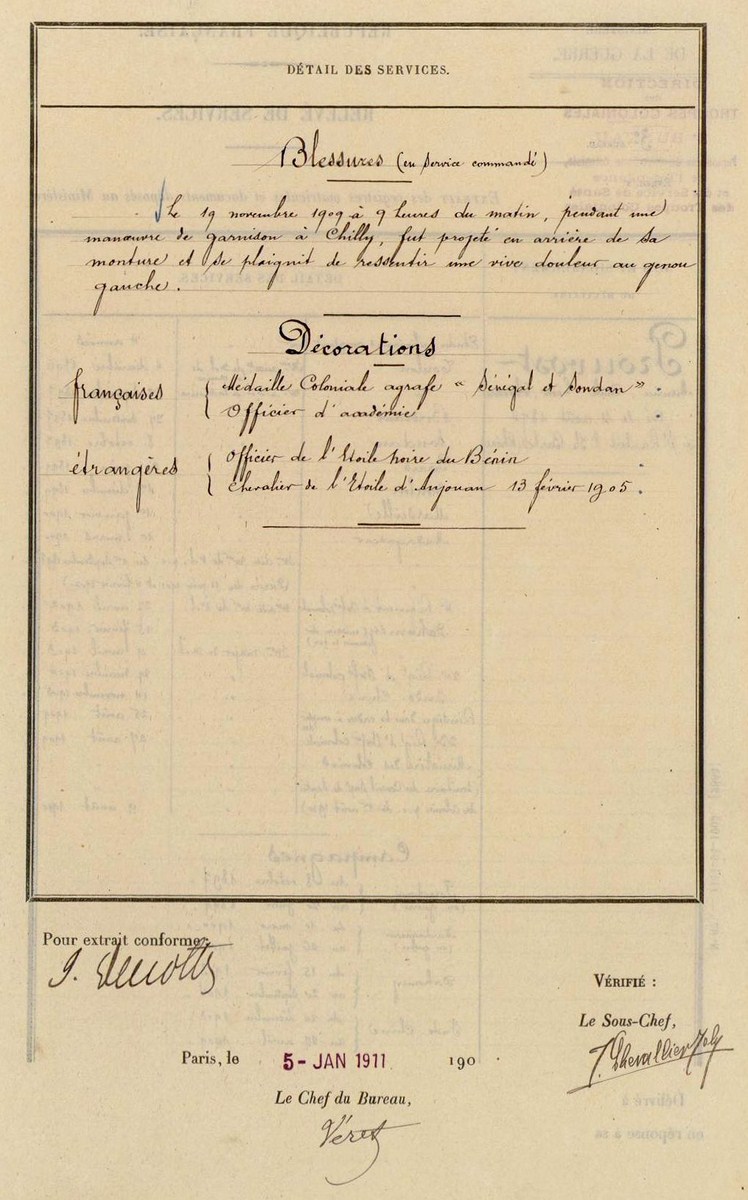
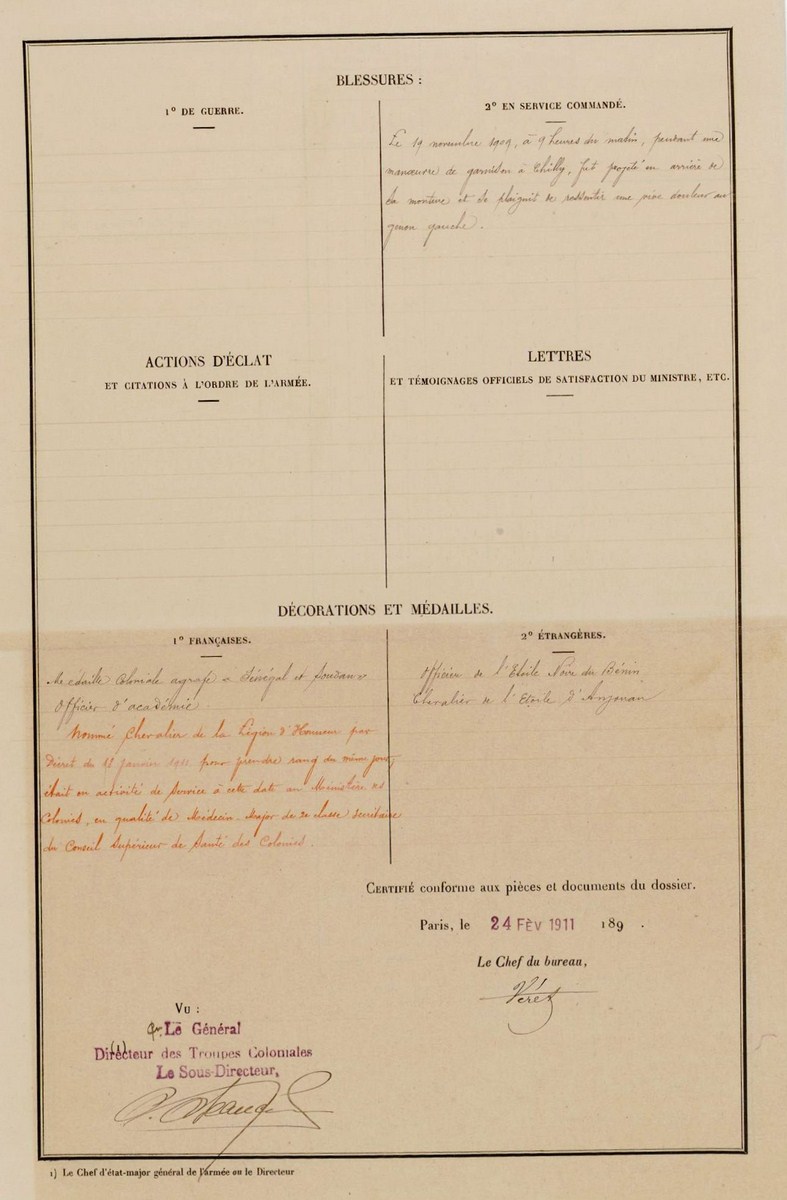

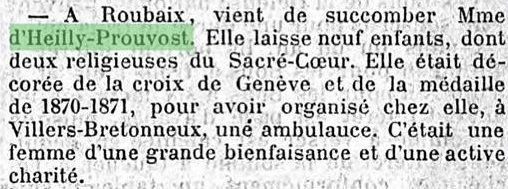
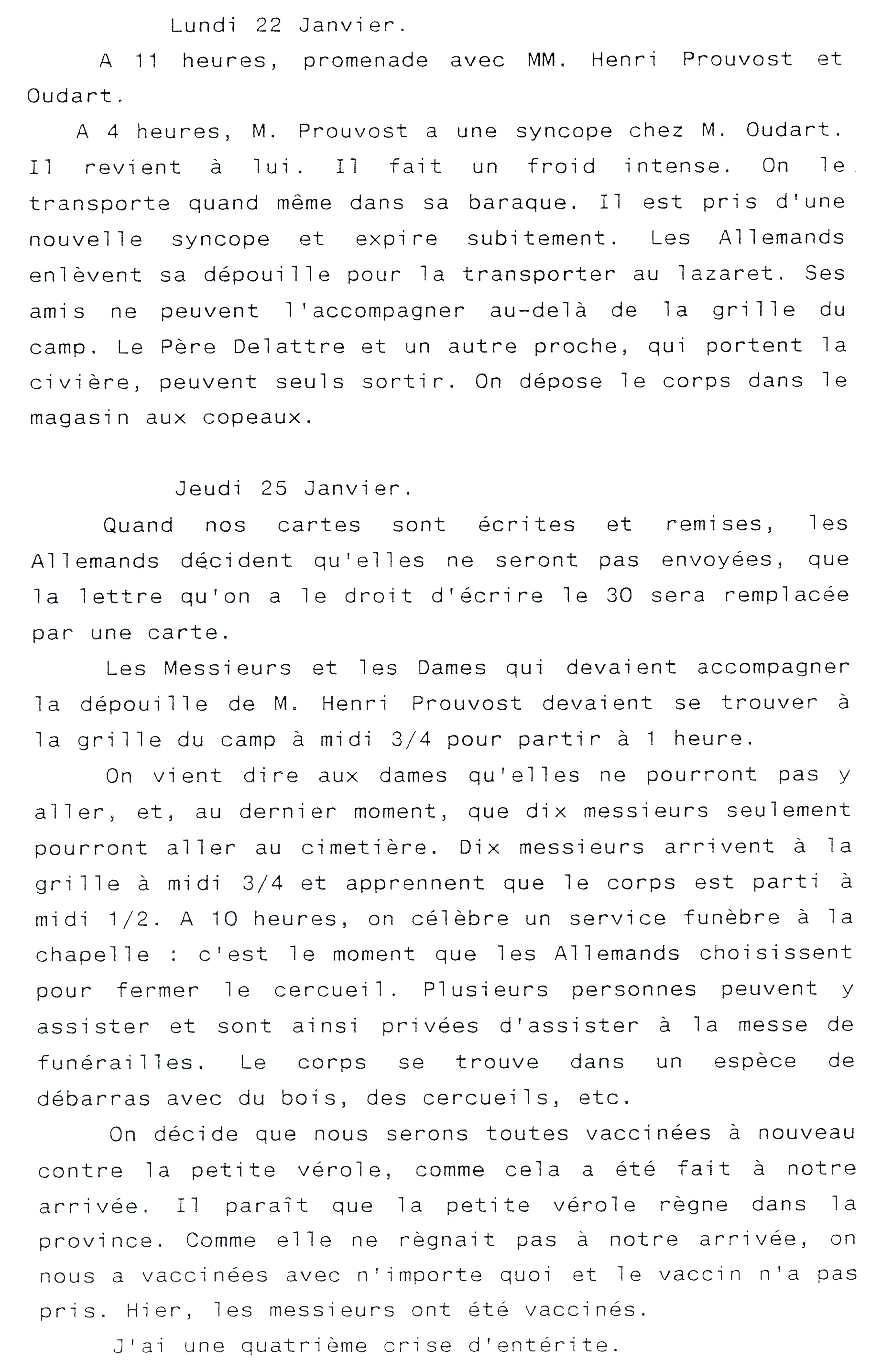
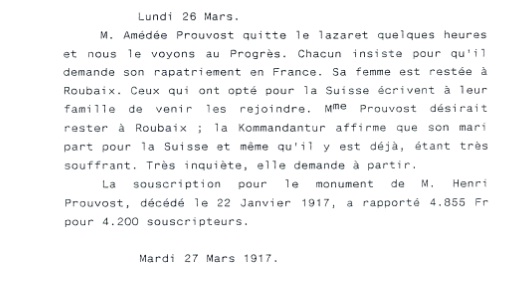
 *
*