Pierre-Urbain (Pedro) Virnot "a habité assez peu de temps dans cette
demeure ; on trouve dans les archives transcrites par Théophile
Virnot, l’intérêt qu’il portait à l’ architecte de ce palais : Lequeux et sa fin tragique qui défraya la
chronique à l’époque (assassiné par un jardinier) ; 10 ou 15 ans après,
Pedro achète l’un des chefs d’œuvre de l’architecte. Il y aurait organisé une
salle de jeux clandestine dans l’aile gauche, juste avant sa faillite, et cela
aurait précipité sa chute." Nicolas Virnot
Il vendit la demeure à son parent Louis de Brigode, en 1809 au marquis (François) d’Hangouwart par son commanditaire. »; la tante de Pierre Urbain VIRNOT, la sœur de sa mère Catherine Charlotte Virnot-Lenglart, avait épousé Jean Chrysostome de Brigode, seigneur de Canteleu; son autre soeur Virnot de Lamissart-Lenglart avait un gendre et une belle fille Prouvost.
."L'hôtel d'Avelin est la première
réalisation du tout jeune architecte Michel-Joseph Lequeux, sur une commande de François Augustin
Anne Hubert Colette, marquis d'Hangouart, dernier comte d'Avelin, chevalier de
Malte, qui, en 1775, lui confie le soin de dresser les plans de sa nouvelle
maison de ville à Lille. L'ancien hôtel Hangouart d'Avelin est
démoli par Lequeux pour faire place au bâtiment actuel érigé en 1777.Confisqué
à la Révolution, vendu comme bien national, l’hôtel
d’Avelin est revendu par Pierre-Urbain Virnot, dit Pedro, à Louis Marie Joseph de
Brigode, maire de Lille. C'est dans cet hôtel, chez le maire, que Louis XVIII
passe la nuit du 22 au 23 mars 1815, lorsqu'il fuit Paris au retour de Napoléon. Cédé au comte Charles-Joseph du
Maisniel, l'hôtel prend alors
le nom d'hôtel du Maisniel. En 1849, c'est le Cercle du Nord, cercle chic de la bourgeoisie lilloise
qui comptera 1100 adhérents, qui s'y installe et y aménage des salles de jeux,
un fumoir, une bibliothèque et une salle de concert. Racheté par la Ville de
Lille en 1887 pour accueillir le rectorat transféré de Douai, l'hôtel reste le siège de l'académie
de Lille jusqu'en 2011. Le 14 août 1917, il est endommagé par une bombe
anglaise, tombée sur la partie gauche de l'hôtel. La ville de Lille a décidé de
le mettre en vente par une délibération adoptée par le conseil municipal le 10
février 2014. Ce bâtiment fait l’objet d’un inscription au titre des monuments
historiques depuis le 14 mars 1944. Le 27 novembre 2014, le promoteur
immobilier Sofim a été identifié par la ville de Lille pour en assurer sa
restauration complète avec l'architecte du Patrimoine François Bisman. Le
bâtiment sera divisé en appartements, avec la construction d'un immeuble à
vocation locative dans le jardin ainsi qu'un parking souterrain sont
prévus." Wikipedia[1] Wikipedia
Michel-Joseph Lequeux (24 octobre 1753 à Lille -
15 avril 1786) est un architecte dont l'œuvre domine sans conteste
l'architecture de la capitale flamande à la fin du XVIIIe siècle. Fils d'un
sculpteur lillois, Michel-Joseph Lequeux est lauréat de l'école d'architecture
de Lille en 1769. En 1774, il part à Paris pour compléter sa formation. De retour à
Lille, il obtient son premier chantier important en 1777, la construction de
l'hôtel d'Avelin (aujourd'hui siège du Rectorat). En 1783,
l'intendant Charles d'Esmangart s'installe à Lille et lui apporte son soutien.
Plusieurs grands chantiers lui sont alors confiés. Mais il meurt prématurément,
le 15 avril 1786, frappé d'un coup de couteau par un jardinier lors d'une
dispute sur le chantier de l'Hôtel de l'Intendance (aujourd'hui siège de
l'Evêché).
Michel-Joseph Lequeux a su pratiquer un art original sans jamais
s'abaisser à copier de prestigieux modèles. Son style se caractérise par de
grands nus, des masses épurées, des arêtes vives et des rythmes simples. C'est
sa première réalisation, l'hôtel d'Avelin, qui est considérée comme l'expression
la plus parfaite de son génie. Grâce à une clientèle riche et au soutien de
l'intendant Esmangart, il a pu construire d'élégants hôtels néo-classiques :
d'Avelin (1777), Petipas de Walle (1778), Delagarde (1780), du Chambge d'Elbecq (1781), de l'Intendance (1786). Il a également
édifié le théâtre de Lille en 1785 (détruit en 1903 dans un incendie) et,
à Douai, le bâtiment du parlement de Flandre (1785), aujourd'hui Palais de Justice. » [2] Wikipedia
Note: Auguste Joseph de Lagarde de Boutigny, seigneur de Bielville, 1748- 1817, trésorier de France au bureau de Lille, époux d'Hubertine Clotilde Durot, était le beau frère de Catherine-Françoise Prouvost, 1752-1801, épouse de François Joseph Durot, famille à l'origine des Manufactures Royales de Lille.
Cette magnifique lithographie du grand Debucourt, d’après un tableau du chevalier de Basserode , représente le roi Louis XVIII faisant ses adieux avant de partir en exil de Lille à Gand. Il sera reçu et logé en l’hôtel d’Avelin à Lille chez le maire, le Comte de Brigode. Il y a aussi le Comte Simeon, préfet de Lille, Monsieur de Gramont, le prince de Poix, le prince de Condé, le duc d’Orléans, François, Comte (depuis Marquis) de Jaucourt, pilier de la Restauration, qui dirigeait depuis Gand les Affaires Etrangères, Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, l'ancien camarade d'études à Brienne et Secrétaire de Napoléon, qui, lui aussi, a fait le voyage de Gand après s'être rallié au Roi., le Père Elisée, Blacas, les maréchaux Berthier, Mortier , Mac-Donald.



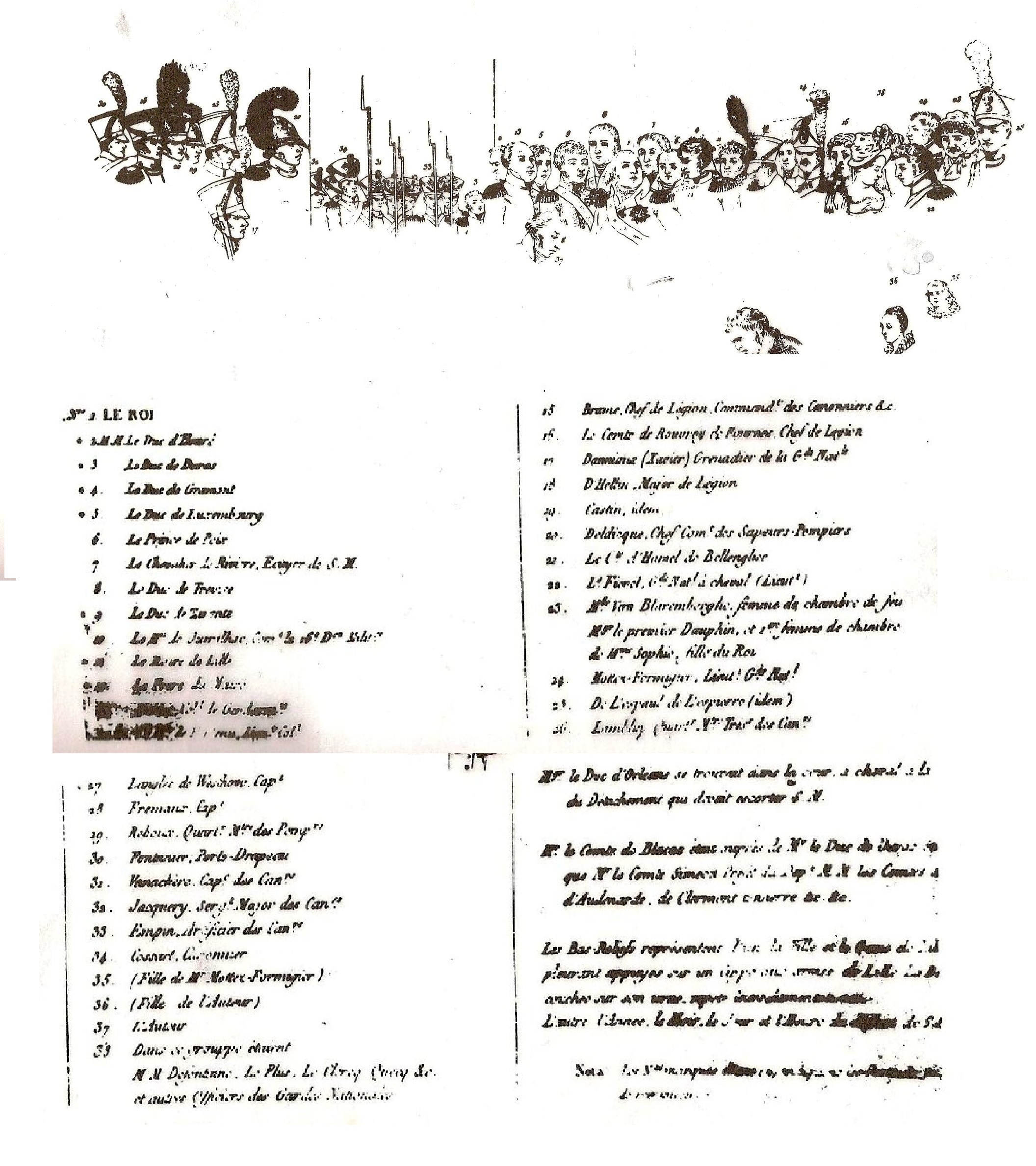
|
Quelques figures familiales dans la gravure
On y voit le Chevalier de Basserode, à genoux, et sa fille à
droite; ce dernier était un familier d’un aïeul remarquable :
« Charles Marie Le Thierry d’Ennequin, écuyer, époux de Catherine
Charlotte Virnot, mademoiselle de Stradin, du nom d'un fief de ses parents, le chevalier de Basserode , et Victor Virnot qui en étaient des hôtes
assidus.
Le chevalier Charles François marie Le
Prévost de Basserode, né le 25 juin 1774, émigré, armée de Condé, marié le 16
juin 1798 à Lille avec Marie Anne Lespagnol de Grimby, décédée en 1829, dont
Catherine Joséphine née en 1799, Henriette Philippine née en 1801, Luce
Valentine qui épousa Charles Joseph Desfontaines de Preux dont Gustave époux
de Léontine de Frémin du Sartel, Charlotte Ida née en 1805. La
fille de Charles, Caroline Joséphine Le Prévost de
Basserode épousa Louis Ernest de Muyssart (né à
Londres le 7 août 1795, décédé au
château de Launay près Epernon1841) sans
postérité ; Louis Ernest était le fils de
Jean Baptiste, Comte de Muyssart, grand bailly de Wavrin, maire de
Lille de 1816 à 1830, député du Nord, commandeur
de la Légion d’Honneur : celui-ci vendit le
château du Gardin en 1832 qui allait devenir le Collège
libre de Marcq, apprécié des familles du Nord. |
|||
Louis
Mottez et
Marie-Wallerie de Formigier de Beaupuy : Louis Mottez jura, en
l’église Saint
Etienne, fidélité à la nation, à la loi, au
Roi et applaudit la déclaration des
droits de l’homme ; chevalier de la légion
d’honneur, conseiller
municipal, adjoint au maire de Lille jusqu’à la
révolution de 1830, il fut
aussi peintre ; allié à la famille, il fut aussi,
entre autres, le centre
de ce « petit théâtre sans
prétentions » qu’il animait dans
l’hôtel Virnot
de la place Saint Martin et qui lui permettait de réunir
cette société
élégante issue du XVIII° siècle ; une
liste des invités le démontre. Il
était le petit-fils de Marie Aldegonde Le Thierry
d’Ennequin, dame de la
Boutillerie, deuxième enfant de Jacques Charles, écuyer,
Sgr d’Ennequin, La
Boutillerie, Riencourt etc et de Marie Anne Françoise de
Bonneval
et de Messire
Guillaume de Formigier de Beaupuy, gentilhomme, page du Roi Louis XVI et qui
eut une conduite de courage lors de l’invasion des Tuileries par le
peuple : il était de cette branche issue des nobles Bonneval
Leur fils, Victor
Mottez,

élève de Picot et
d’Ingres (c’est lui qui enleva sur le mur de son atelier à Rome un portrait par
Mottez de son épouse et qu’il réinstalla à Paris) eut un beau parcours de
peintre reconnu, ; ce portrait est au Louvre aujourd’hui) ; outre les
portraits de Charles, Urbain et Lucien Le Thierry d’Ennequin, il portraitura
des membres princiers européens portant le nom d’Aumale, Ligne, Guise, Orléans,
Guizot, Walewska, orna les églises St Germain l’Auxerrois, St Séverin et il fut
reçu à de nombreux salons de peinture avec son œuvre prolifique.
Vanackere, capitaine
des canonniers dont notre aïeul, le capitaine Ovigneur 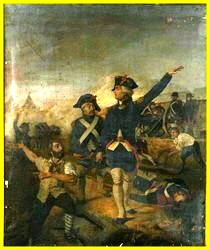 fut le héros. Le nom Vanackère figure dans les cartons d’invitation de la
place Saint Martin. Louis Vanackère fut président de la Chambre de Commerce et
maire de Lille ; Nicolas Désiré Vanackère publia des mémoires:
"Séances publiques de la société d'amateurs des sciences et arts de la
ville de Lille"
fut le héros. Le nom Vanackère figure dans les cartons d’invitation de la
place Saint Martin. Louis Vanackère fut président de la Chambre de Commerce et
maire de Lille ; Nicolas Désiré Vanackère publia des mémoires:
"Séances publiques de la société d'amateurs des sciences et arts de la
ville de Lille"
Mademoiselle van
Blarenberghe  était première femme de chambre de Monsieur le premier Dauphin
et première femme de chambre de Madame Sophie, fille du Roi. Elle devait faire
partie de la célèbre dynastie des peintres et miniaturistes de Lille et aussi
de Versailles qui figurent sur les cartons d’invitation de la place Saint
Martin ; la dernière des van Blarenberghe épousa Charles Dathis, poète,
licencié en droit, négociant, frère de notre aïeule Madame Prosper
Derode-Dathis.
était première femme de chambre de Monsieur le premier Dauphin
et première femme de chambre de Madame Sophie, fille du Roi. Elle devait faire
partie de la célèbre dynastie des peintres et miniaturistes de Lille et aussi
de Versailles qui figurent sur les cartons d’invitation de la place Saint
Martin ; la dernière des van Blarenberghe épousa Charles Dathis, poète,
licencié en droit, négociant, frère de notre aïeule Madame Prosper
Derode-Dathis.
Quecq, officier
de la Garde Nationale, comme le chevalier Francois Emmanuel Quecq d’Henriprêt
qui épousa Charlotte Virnot de Lamissart, la fille du trésorier de Lille,
Charles Louis.
Leplus, officier de la
garde nationale, figure parmi les invités de l’hôtel Virnot, place
Saint Martin à Lille. Les Leplus furent une dynastie d'architectes essentiels à
Lille: Romain Joseph Leplus (1724-1789), Amé-François Joseph Leplus
(1770-1831), et son cousin Victor-Louis Leplus (1798-1851).
de Lespaul de Lespierre, probablement Clément Joseph 1770-1827 est le grand père du baron d'Haubersart; sa femme, Laurence Quecq d’Henripret, petite fille Virnot de Lamissart. Il est apparenté aux Prouvost-de Lespaul.

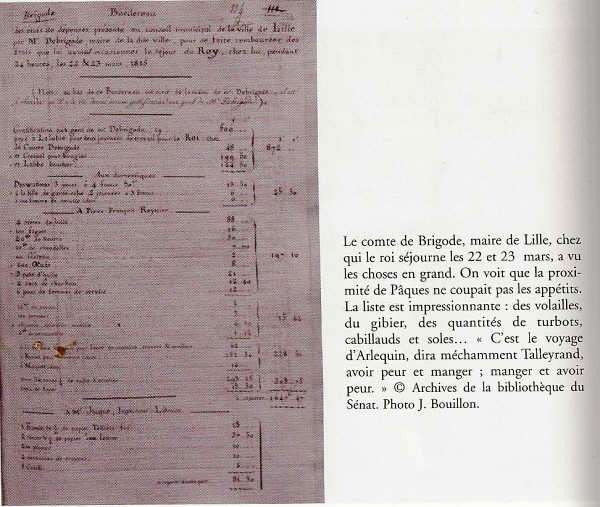
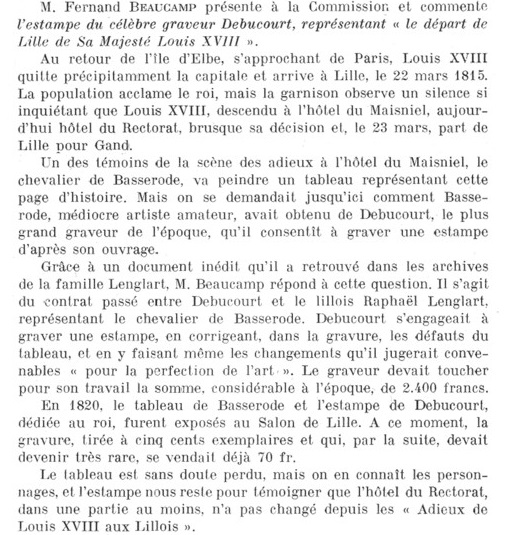
Basserode RNoms des personnes invitées à la représentation d'Arlequin et des deux Alvarets en l'hôtel Virnot à Lille, soit place Saint Martin, soit rue de Tournai.":4
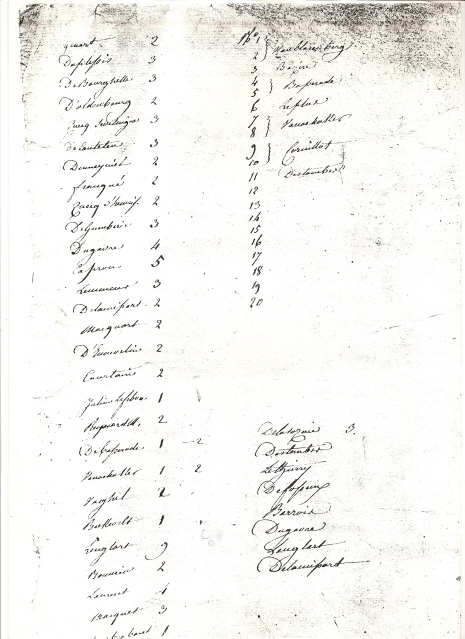
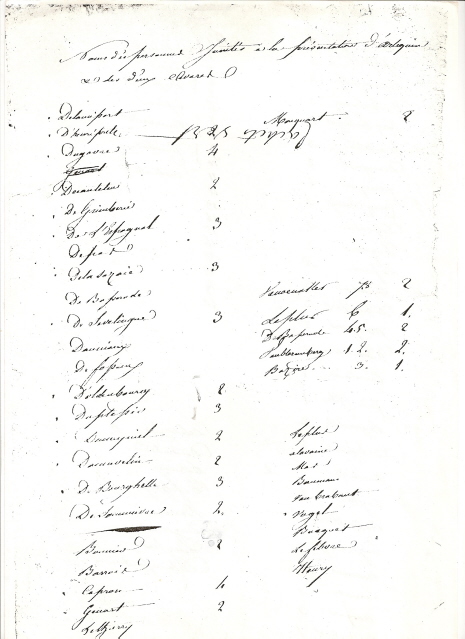



Basserode Revue du Nord-1938-vol2024-num 2093-pp.74-78
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


soeur de Marie-Alexandrine Virnot de Lamissart-Lenglart dont deux enfants épousèrent des Prouvost:
et son frère Louis-Urbain VIRNOT de LAMISSART, né le 23 Novembre 1779, décédé le 20 septembre 1837; en Prairial an X (3I mai 1802), épouse Aimée-Joseph PROUVOST, décédée le 30 Mai 1819, 44 ans, fille de Jean Baptiste Prouvost, négociant et Marie-Magdelaine Isabelle Joseph Baillant, dont un fils Urbain-Léon PROUVOST, né le 29 Fructidor, an XII (16 Septembre 1804), décédé le 26 Vendémiaire 15/12/04. le 11 Prairial an X (3I Mai IS02), il avait épousé Aimée-Joseph PROUVOST, décédée le 30 Mai 1819, âgée de 44 ans, dont un fils Urbain-Léon VIRNOT de LAMISSART, ne le 29 Fructidor, an XII (16 Septembre 1804), décédé le 26 Vendémiaire (I5 Décembre de la même année). A propos de l'hôtel Virnot de Lamissart, en janvier 1838, Barthélemy Delespaul, dit Delespaul Aîné, achète aux héritiers de Monsieur Virnot-Delamyssart, moyennant 91.720 francs, une belle maison avec atelier adjacent, située 73 rue de Jemmapes à Lille (actuellement 52, façade de l'esplanade à Lille); Il s’agit de la succession de Louis-Urbain VIRNOT de LAMISSART.








En 1771, Joos Clemmen, un des premiers barons du textile gantois, devint propriétaire d’un palais dans la Rue des Champs (Veldstraat). David ’t Kindt, talentueux architecte rococo à Gand, avait acheté préalablement cette demeure (à l’origine trois plus petites maisons) sans jamais avoir achevé l’aménagement. Clemmen s’occupera de l’achèvement et de la somptueuse décoration intérieure. Le grand salon côté jardin fut décoré de tentures de soie chinoise peintes. Aujourd’hui ce salon chinois est absolument unique. Nulle part on trouve un ensemble aussi intact.et des peintures murales des 18e et 19e siècles. Dans le fond du jardin, le long de la Lys, Clemmen fit construire un bel entrepôt de style classiciste où il a établi une imprimerie de coton.Le Musée Arnold Vander Haeghen comprend une reconstruction du bureau et la bibliothèque du gagnant du prix Nobel belge Maurice Maeterlinck, les cabinets de Charles et Victor Stuyvaert Doudelet. En 1836, la demeure a été détenue par la famille Vander Haeghen Gand. La famille a quitté le bâtiment légué à la ville de Gand, mais à la condition que la fonction de musée serait donnée. En 1953, le bâtiment était également ouvert comme un musée et nommé d'après Arnold Vander Haeghen (de 1869 à 1942). Depuis 1997, le bâtiment est également utilisé par la culture des services et des Arts de Gand.Aujourd’hui singulière parmi la longue rangée d’étalages, la maison de maître avec sa splendide façade était pourtant là la première!"
"David François 't Kindt1, né à Gand,
comté de Flandre (Pays-Bas du Sud, dans le Saint-Empire), le 12
janvier 1699 et y décédé le 14 juillet 1770 est un
architecte flamand actif à Gand, capitale du comté de
Flandre. Il figure avec son confrère Bernard de Wilde, parmi les
représentants les plus marquants du rococo gantois. Son art se
caractérise par une influence du baroque exubérant de
l'Allemagne du Sud pondéré par le style Louis XV. Il reçut une formation traditionnelle de maître
d'œuvre au sein de la corporation des charpentiers dont il
reçut la maîtrise à 27 ans.
Il créa surtout de beaux hôtels de maître où son style particulier se remarque.
Œuvres à Gand
Le Corps de Garde, 1738.
l'hôtel 't Kindt, construit en 1746 à
la place de l'ancien steen de la famille Damman van Oombergen, et vendu
lors de la construction à la famille de Ghellinck.
L'hôtel de Coninck (1753), siège du Design Museum Gent
L'hôtel d'Hane-Steenhuyse (1768)
L'hôtel Clemmen (1746-1772), actuellement "Musée Vander Haeghen".

Le château de Braem, acheté par Josse Clemmen revint à Régis Durot 1751, Lille 10 avril 1830 époux d'Anne Barbe Clemmen.
"Le Château Braem
est
un château dans le district de Belgique Gentbrugge dans la
province de Flandre-Orientale. Le château est situé dans
le parc français Néanmoins, nommé d'après
un ancien maire de Gentbrugge.
Hughe Braem et Isabelle Van Halewijn construit le château au
14ème siècle. Le château était alors le
Canal Reed, une ligne de défense majeur autour de la ville de
Gand. Dans les travaux de rénovation du 19ème
siècle fait en sorte que le château a obtenu sa forme
actuelle. Dans le début du 20e siècle, le
propriétaire de la Kethule Groverman de famille. Gentbrugge a
acheté en 1946, utilisé comme la mairie jusqu'en 1974 et
a donné le nom de son dernier maire au parc.
L'académie
En 2012, l'Académie des Arts de Pont Gand sur la base ici,
autrefois connu comme l'Académie de la musique, parole et danse
Emiel Hullebroeck. L'académie donne l'éducation à
temps partiel pour tous les groupes d'âge. L'académie est
à côté de l'école principale de six
départements qui sont logés dans d'autres endroits."
Louis-Marie-Joseph de Brigode-Kemlandt (1776-1827)
Armoiries du Comte de Brigode - © infographie lillempire

Chambellan de l'Empereur
Chevalier d'empire en janvier 1809
Comte sous majorat en août de la même année
né le 24 octobre 1776 (baptisé à l'église St Etienne) à Lille
En 1804, pour le sacre
de l'empereur, le comte de Brigode fut un des commissaires chargés d'aller
chercher le Pape et de l'accompagner à Paris.
Il fut de service, auprès du
Saint-Père, pendant son séjour.
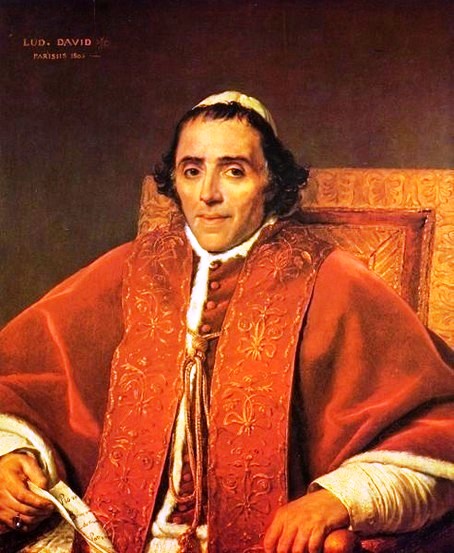
Avec Monsieur Durosnel, écuyer de l'Empereur, il fit également le voyage de retour à Rome.

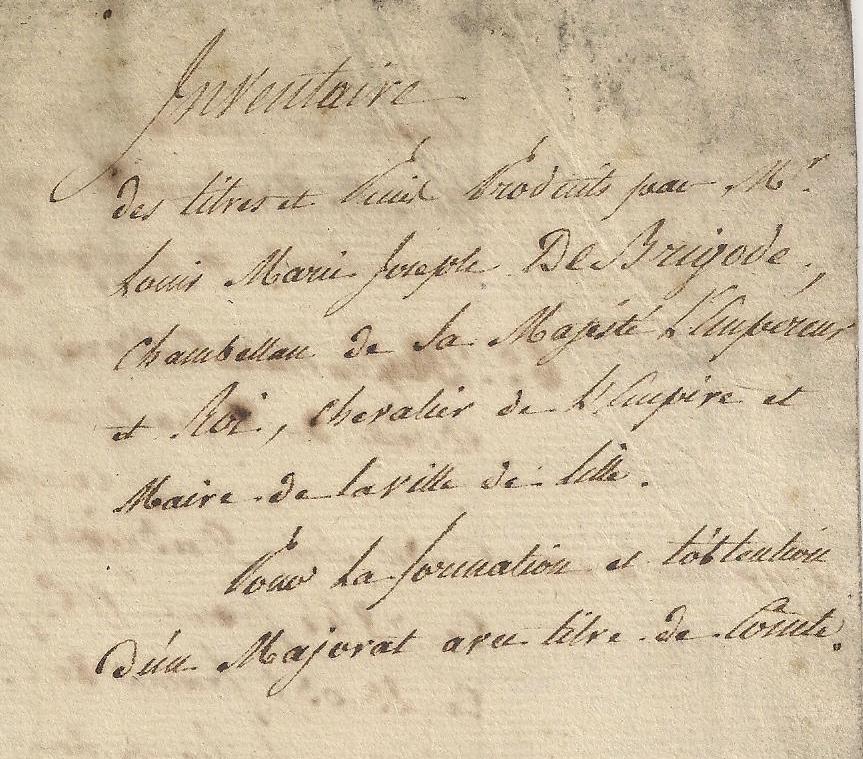
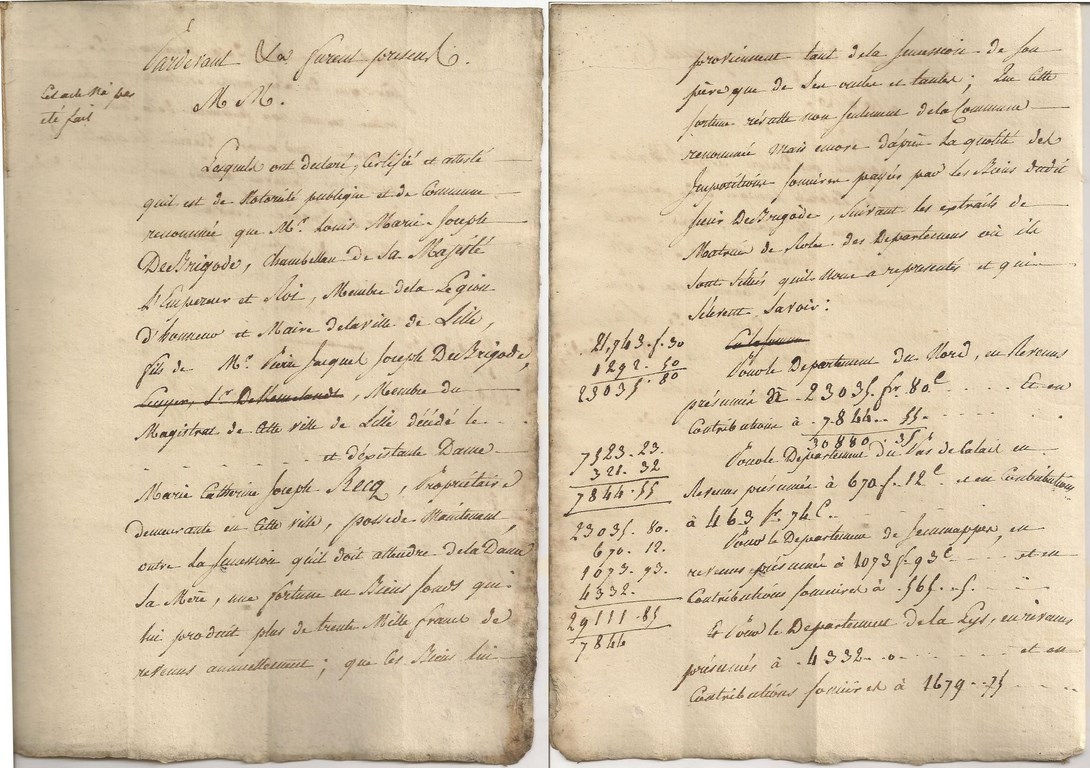
De 1811 à 1812, il a tenu en Espagne, un détachement de la
maison de l'Empereur, des écuyers, des brigades de chevaux, des mulets de bât,
et tout un service de campagne.
Il accomplit son service auprès de l'Empereur, sans abandonner toutefois les
fonctions administratives de Maire qui lui avaient été confiées.
le Comte De Brigode était, également le commandant (nominal) en Chef de la Garde d'Honneur de Lille depuis 1809.
Chambellans
1805 - DARBERG
En 1814, il jure fidélité aux Bourbons. Des placards
apparaissaient déjà sur les murs de la ville :
» De Brigode-Kenlan, Chambellan du Tyran, prends tes guêtres et
va-t-en. »
www.lillempire.fr/index.php/Louis-Marie-Joseph-de-Brigode.html
Le 22 mars, Louis XVIII se dirigeant vers Gand, s'arrêta dans la Résidence
du Comte, accompagné de ses fidèles, Maréchaux et Ministres. L’hôtel d’Avelin
avait été vendu par Pierre-Urbain Virnot en 1809 au marquis (François)
d’Hangouwart par son commanditaire : » Monsieur Louis Marie Joseph de
Brigode, chambelland de Sa Majesté l’Empereur et roi, membre de la Légion d’Honneur,
pour lui, en jouir en toute propriété de ladite acquisition »; la tante de
Pierre Urbain VIRNOT, la sœur de sa mère Catherine Charlotte Virnot-Lenglart,
avait épousé Jean Chrysostome de Brigode, seigneur de Canteleu;
Le lendemain, le comte
de Brigode donna sa démission, persuadé que l'abdication de Fontainebleau et le
serment qu'il avait prêté à un autre souverain. indiquaient un nouveau but au
dévouement et à la loyauté qui avaient marqué sa carrière.
Élevé à la pairie le
17 août 1815, M. de Brigode a constamment défendu à la tribune de la chambre
héréditaire les institutions garanties par la Charte, et voté contre les lois
d'exception qui tendaient à l'anéantir.
Histoire biographique
de la Chambre des pairs, depuis la Restauration jusqu'à l'époque actuelle:
depuis la Restauration jusqu'à l'époque actuelle Par Alexandre Lardier Publié
par Brissot-Thivars, 1829
Dans le procès du
maréchal Ney, il fut l'un des cinq pairs, (le comte de Nicolaï, le marquis
d'Aligre, le comte de Brigode, le comte de Sainte-Suzanne et le duc de
Choiseul-Stainville,) qui tout en s'abstenant, proposèrent de recommander le
Maréchal à la clémence du Roi.
« Lanjuinais, soutenu par Malville, Lemercier, Lenoir-Laroche et Cholet,
tente de faire adopter la peine de déportation que 17 pairs votèrent. Parmi
eux, le duc de Broglie. Cinq pairs, le comte de Nicolaï, le marquis d'Aligre,
le comte de Brigode, le comte de Sainte-Suzanne et le duc de
Choiseul-Stainville, tout en s'abstenant, proposent de recommander le maréchal
à la clémence du roi. Finalement, 139 voix, réduites à 128, à cause d'avis
semblablesentre parents, réclament la peine de mort. Parmi ceux qui ont voté la
mort : 5 maréchaux d'Empire : Sérurier, Kellermann, Pérignon, Victor et Marmont
(au contraire, le maréchal Davout est venu le défendre, et le maréchal Laurent
de Gouvion Saint-Cyr a voté la déportation), le vicomte de Chateaubriand, le
comte Ferrand surnommé « le Marat blanc » et le comte Lynch nommé par Napoléon
maire de Bordeaux, comte de l'Empire et chevalier de la Légion d'honneur, qui
va jusqu'à réclamer la guillotine. En outre, non content d'avoir obtenu la
condamnation du maréchal, Bellart requiert qu'il soit rayé des cadres de la
Légion d'honneur. Une petite phrase circule sur l'avocat Bellart à l'époque : «
Si l'éloquence est un bel art, Bellart n'est point l'éloquence. »La sentence
est rendue à onze heures et demie du soir. Les pairs appliquent la règle du
conseil de guerre et la lisent en l'absence de l'accusé.Les défenseurs ayant
compris que tout espoir est perdu n'assistentpas à la lecture de l'arrêt et se
rendent dans la cellule qu'occupedepuis deux jours le maréchal, au Palais du
Luxembourg. C'est une petite pièce située au troisième étage sous les combles,
à l'extrémité ouest de la galerie où le Sénat conservateur avait installé ses
archives, au-dessus de l'actuelle salle des conférences. Une plaque de marbre y
a été apposée en 1935. » http://grandearmee.forumactif.org/t14p105-les-generaux-francais-de-l-empire
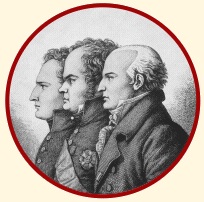
De g. à
d. : La Bédoyère, Ney et Lavalette
Coll.
Bibl. mun. e Grenoble
Cl. Piccardy
Monsieur le comte de Brigode était, excellent musicien et avait, également, la réputation d'avoir beaucoup d'esprit.
(les salons de Paris, Comtesse d'Abrantès).
"Ce ne fut qu'en 1806, après la victoire d'Austerlitz, que la Cour impériale prit une couleur décidée et eut une position tout à fait arrêtée. Jusque-là il y avait beaucoup de luxe, beaucoup de fêtes, une grande profusion de beaux habits, de diamants, de voitures, de chevaux; mais, au fond, rien n'était bien réglé et totalement arrêté. Il ne suffisait pas d'avoir M. de Montesquiou pour grand-chambellan, M. de Ségur pour grand-maître des cérémonies, et MM. de Montmorency, de Mortemart, de Bouillé, d'Angosse, de Beaumont, de Brigode, de Mérode, etc., pour chambellans ordinaires; MM. d'Audenarde, de Caulaincourt, etc., pour écuyers; et mesdames de Montmorency, de Noailles, de Serrant, de Mortemart, de Bouillé, etc., pour dames du palais: tout cela ne suffisait pas. Il fallait une volonté émanée, annoncée comme loi et de très-haut. Sans cela rien ne pouvait aller."
"Des charades en actions, dit M. de Metternich, qui, en sa qualité de jeune père, était du conseil.—Oui, oui, des charades en actions!—Et la maréchale nous fit ouvrir sa garde-robe, que nous explorâmes au grand chagrin de ses femmes, à en juger par le désespoir des miennes, lorsque la chose arrivait chez moi; mais aussi nous nous amusâmes beaucoup... Deux charades eurent surtout un succès complet: or-ange et pou-pon. La première fut représentée magnifiquement par la prise du Mexique ou du Pérou, je ne sais lequel; une scène du temple du soleil: tout cela était admirable; et puis le sacrifice d'Abraham; mais la seconde fut un triomphe. La première partie n'était pas facile à faire... Nous représentâmes Antiochus et Stratonice!... le moment où le médecin juge, par la fréquence du pouls, de la passion du prince; nous y fûmes très-applaudis. M. de Brigode joua le rôle du père, comme s'il eût été à l'Opéra. Le pont fut représenté par l'action de Coclès, et enfin le poupon le fut burlesquement par M. de Palfy, faisant le nourrisson, et par Grandcourt, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui aura tout à l'heure sa place, car il ne bougeait de chez moi, et certes on s'en amusait assez pour lui témoigner au moins de la reconnaissance par un souvenir: il faisait la nourrice."
"La duchesse d’Abrantès rappelle dans ses Mémoires que : « Madame Ney joue parfaitement la comédie et chante d’une manière remarquable ; sa voix n’a pas une grande étendue, mais les cordes en sont justes, pures et d’un timbre charmant ; elle prononce bien, et je me rappelle toujours avec plaisir le temps où, s’accompagnant de ses petites mains si jolies et si blanches, elle me chantait en courant à la Malmaison, tandis que nous passions par la galerie pour nous rendre au théâtre, une de ces ravissantes canzonne de Crescentini. Il me revint qu’un jour (c’était pour la fête de l’impératrice Joséphine, 19 mars, en 1807, pendant la campagne de Tilsitt), nous nous arrêtâmes dans la galerie de musique, la maréchale Ney et moi, tandis qu’on nous attendait et qu’on nous cherchait pour une répétition. Nous avions avec nous M. de Brigode, chambellan de l’empereur, et très bon musicien, comme on le sait. Don Juan était sur le piano, la maréchale ouvrit la partition, c’était précisément à l’endroit du joli duo : Là cidarem lamano. “Dépêchons-nous dit-elle, nous aurons encore le temps. ” Et nous voilà debout, nos rôles sous le bras, ainsi que la queue de nos robes, moi les accompagnant, eux chantant ce charmant morceau auquel je trouvai, ce jour-là, plus que jamais le défaut d’être trop court. La voix de la maréchale se mariait admirablement avec le ténor de M. de Brigode, et ces deux voix, à peine couvertes par le piano et résonnant dans cette pièce où la foule toujours pressée ôte à la voix tous les avantages, mais dans laquelle nous n’étions alors que nous trois, me firent une impression dont le souvenir m’intéresse encore. » http://www.cairn.info
"Quant aux tours, elles étaient tout simplement représentées par quatre personnes fort volumineuses : M. de Ponte (chambellan de l'Empereur), M. de Bausset (préfet du Palais), M. de Brigode (chambellan d'ordonnance de l'Empereur) ; je ne me rappelle plus quelle était la quatrième. Anatole (officier d'ordonnance de l'Empereur) et Eugène (colonel du 13e chasseurs) de Montesquiou, son frère, MM. de Septeuil et Jules de Canouville (aides-de-camp du prince de Nenchâtel). Ernest de Canouville (maréchal-des-logis de l'Empereur), Fritz de Pourtalès et M. de Curneux (aides-de-camp du prince de Neuchâtel), furent chargés de représenter les cavaliers, les fous et les rois." général baron de Marbot "
"Nous organisâmes la fête de l'Impératrice, en l'absence de la reine Hortense. La reine de Naples et la princesse Pauline, qui pourtant n'aimaient guère l'Impératrice, mais qui avaient rêvé qu'elles jouaient bien la comédie, voulurent se mettre en évidence, et deux pièces furent commandées. L'une à M. de Longchamps, secrétaire des commandements de la grande-duchesse de Berg; l'autre, à un auteur de vaudevilles, un poëte connu. Les rôles furent distribués à tous ceux que les princesses nommèrent, mais elles ne pouvaient prendre que dans l'intimité de l'Impératrice qui alors était encore régnante.
La première de ces pièces était jouée par la princesse Caroline (grande-duchesse de Berg), la maréchale Ney, qui remplissait à ravir un rôle de vieille, madame de Rémusat, madame de Nansouty et madame de Lavalette, les hommes étaient M. d'Abrantès, M. de Mont-Breton, M. le marquis d'Angosse, M. le comte de Brigode, et je ne me rappelle plus qui. Dans l'autre pièce, celle de M. de Longchamps, les acteurs étaient en plus petit nombre, et l'intrigue était fort peu de chose. C'était le maire de Ruel qui tenait la scène, pour répondre à tous ceux qui venaient lui demander un compliment pour la bonne Princesse qui devait passer dans une heure. Je remplissais le rôle d'une petite filleule de l'Impératrice, une jeune paysanne, venant demander un compliment au maire de Ruel. Le rôle du maire était admirablement bien joué par M. de Mont-Breton. Il faisait un compliment stupide, mais amusant, et voulait me le faire répéter. Je le comprenais aussi mal qu'il me l'expliquait; là était le comique de notre scène, qui, en effet, fut très-applaudie.
M. le comte de Brigode était, comme on sait, excellent musicien et avait beaucoup d'esprit. Il fit une partie de ses couplets et la musique, ce qui donna à notre vaudeville un caractère original que l'autre n'avait pas. Je ne puis me rappeler tous les couplets de M. de Brigode, mais je crois pouvoir en citer un, c'est le dernier. Il faisait le rôle d'un incroyable de village, et pour ce rôle il avait un délicieux costume. Il s'appelait Lolo-Dubourg; et son chapeau à trois cornes d'une énorme dimension, qui était comme celui de Potier dans les Petites Danaïdes, son gilet rayé, à franges, son habit café au lait, dont les pans en queue de morue lui descendaient jusqu'aux pieds, sa culotte courte, ses bas chinés avec des bottes à retroussis, deux énormes breloques en argent qui se jouaient gracieusement au-dessous de son gilet: tout le costume, comme on le voit, ne démentait pas Lolo-Dubourg, et, lui-même, il joua le rôle en perfection." Histoire des salons de Paris par la duchesse d'Abrantès.
En 1818, Louis XVIII le confirme dans son titre de Comte. Louis vendra l’hôtel en 1821 à Charles du Maisniel .
. 
Un laissez-passez pour les Pays-Bas
conservé en Mairie de Lille, donne une description succinte : taille : 1,73,
cheveux : chatain, front : haut, yeux : bleu, nez : régulier, bouche : moyenne,
menton : rond, visage : ovale, teint coloré!
En premières noces, il épousa, le 1er février 1801 Marie Bonne
Romaine Potteau 1780-1802,
fille de Bon Louis Joseph Potteau, écuyer et Françoise Joseph Le Mesre, dont Arthur 1801-1821
La villa Gabrielle est
construite au milieu du XVIIIe siècle. C'est alors la maison de campagne de Bon Louis Joseph Potteau.
A la Révolution française, le bâtiment est gravement
endommagé. En 1801, la villa devient la propriété de la famille de
Brigode.
En 1856, alors que
Gabrielle de Brigode décède, François Adrien de Brigode hérite de la villa et
fonde un hospice pour vieillards : la villa devient alors l'hospice
Gabrielle. L'hospice est géré par une congrégation catholique, les Filles
de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Différentes congrégations de
religieuses y resteront jusque 1975, et l'endroit sert aussi de lieu
d'éducation. En 1873, Noémi de Brigode, vicomtesse de Clercy, soeur de
François-Adrien de Brigode, fait construire un ouvroir à côté de l'hospice. Les
industriels du textile y font travailler des jeunes filles de la région.
L’ouvroir cesse de fonctionner à la fin des années 1930 et il est finalement
démoli en 1973. En 1878, Noémi de Brigode fait construire une chapelle à
l'arrière du bâtiment. La chapelle sera détruite en 1991, dans le cadre du
projet de réhabilitation de l’ensemble.
En 1965, Geoffroy de
Montalembert fait don de la villa à la Congrégation du Sauveur. Cette dernière
le vend en 1981 à une association de Rotary International. La Communauté urbaine de Lille
le rachète en 1986, et finalement il devient la propriété de la ville de Villeneuve d'Ascq en 1988. En 1986, la villa
est inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques.
En 1989, la villa est
endommagée par un incendie et est restauré par les services municipaux. Depuis
1997, la villa est occupée par les services du Centre communal d'action
sociale.

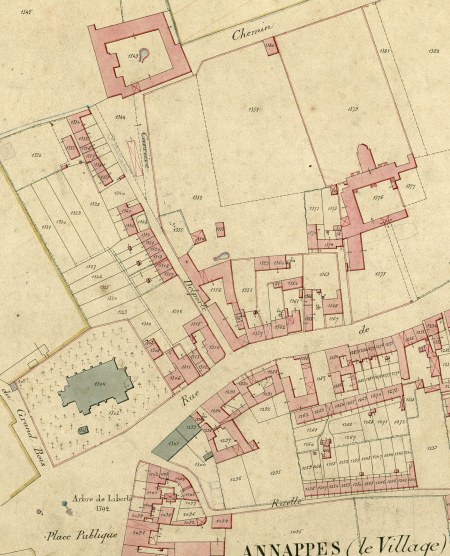 .
.
Le 2 avril 1825, il épousa, en seconde noce, Émilie Louise
Marie Françoise Joséphine (de) Pellapra. Officiellement fille de
Françoise-Marie Leroy, elle-même fille d’un libraire de Lyon et de son mari,
Henri (de) Pellapra, riche financier devenu sous l’Empire receveur des
Finances, Émilie Pellapra laissait entendre qu’elle était la
fille naturelle de Napoléon Ier. Ce dernier aurait eu une aventure avec sa
mère lors d’une étape à Lyon. Louis de Brigode succomba d'une atteinte
d'apoplexie le 22 septembre 1827 à Bourbonne-les-Bains.



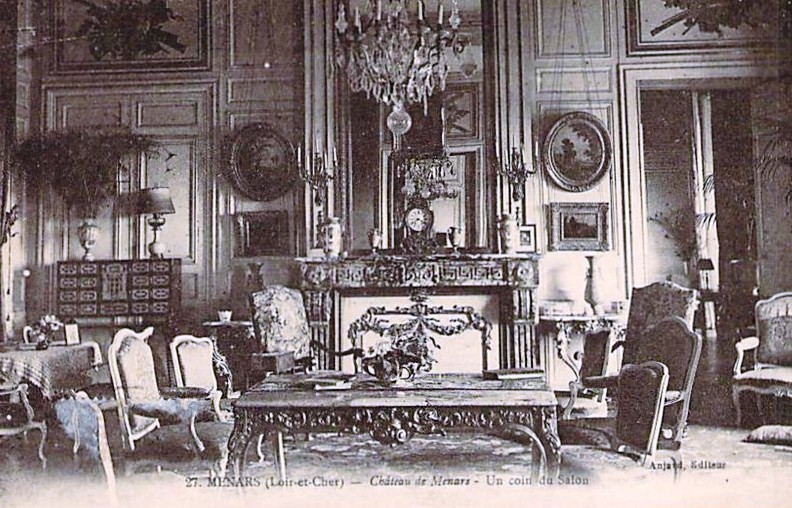

Camée donné par Napoléon Bonaparte à Madame de Pellapra

« Alexandre Abel Félix Lauwick, parfois
orthographié Lauwich, né le 24 mars 1823 à Lille et mort le 6 février 1886 au
21, avenue George V à Paris 8°, est un peintre orientaliste français. Issu
d'une grande famille de la bourgeoisie lilloise, Alexandre Lauwick est le fils
de Charles Frédéric Joseph Lauwick, propriétaire, et Catherine Françoise Joseph
Durot, et le petit-fils de Catherine-Françoise Prouvost. En 1864, il épouse à
Paris Louise-Thérèse Riesener, nièce d’Eugène Delacroix. Après des études aux
beaux-arts de Lille, Alexandre Lauwick est élève de Charles Gleyre aux
beaux-arts de Paris. Il peint ensuite sur le motif à Barbizon, puis voyage en
Italie et en Afrique du Nord. Il reste alors plusieurs années en Algérie où il
fait partie de la Société des Beaux-Arts d'Alger. Il a exposé au Salon de Paris
de 1850 à 1869 des toiles exclusivement orientalistes. Œuvres :Femme juive de
la province d’Alger (1861), Palais des beaux-arts de Lille.
« Oeuvres exposées au salon annuel organisé par le Ministère de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts (Surintendance des beaux-arts), en 1865, au Palais des Champs-Elysées à Paris. Tirage photographique sur papier albuminé représentant : - "Retour de l'enfant prodigue", tableau par François Germain Léopold Tabar, No 2030, appartient à l'auteur;
- "Léda", tableau par Gaston Casimir
Saint-Pierre, No 1914, appartient à l'auteur; - "Jésus, source de
vie", d'après le chapitre VII, verset 37 de l'Evangile selon St-Jean,
tableau par Charles Henri Michel, No 1511; - "Une rue au Caire",
tableau par Alexandre Lauwick, No 1258; - "La Vierge et l'Enfant
Jésus", d'après l'Evangile de la Saint-Enfance, tableau par Albert
Lambron, No 1209.

Elève de son père Henri-François
Riesener et d’ Antoine-Jean Gros. Passionné de beau, recherchant les techniques
nouvelles de coloris, Léon Riesener a dès sa jeunesse une carrière de lutte
contre le goût de son temps malgré toutes les difficultés rencontrées. C'est au
retour de son père qu'il fait plus ample connaissance avec son cousin germain
Eugène Delacroix, plus âgé que lui de dix ans, qui fit son portrait :
Petite fille de Henri-François
Riesener (1767-1828),
fils du grand ébéniste et père de
Léon Riesener, fut élève de Vincent, puis de Jacques-Louis David, dont il
quitta l'atelier pour aller à l'armée au moment des guerres de la Révolution.
Il fit des portraits d'Eugène de Beauharnais, de Napoléon, du comte de Cessac.
En 1815 il alla en Russie et y resta sept ans, où il fit un portrait équestre
du tsar Alexandre. Il mourut peu après son retour à Paris. C'est Henri Riesener
qui fit entrer son neveu, Eugène Delacroix, dans l'atelier de Guérin.
Henri-François Riesener meurt à Paris, le 7 février 1828.


époux en 1807 Féliicté Longrois,
dame d'annonce de l'impératrice Joséphine.
Arrière-petite fille de Jean-Henri Riesener
(1734-1806),
élève de Jean-François Oeben. Il
épouse la veuve de ce dernier, Françoise-Marguerite Vandercruse. Reçu maître en
1768, il est nommé « ébéniste ordinaire du roi » en 1774, et pendant dix ans il
fournira la Cour et la famille royale en meubles fastueux de style
néo-classique. Il est considéré comme l'un des meilleurs représentants du style
transition et achèvera notamment le célèbre bureau à cylindre de Louis XV
commencé par Oeben. Parmi ses spécificités il convient de noter l'utilisation
de bronzes dorés d'une très grande finesse; il est l'un des premiers à
dissimuler systématiquement les fixations de ces derniers. Avec l'aide de
Pierre-Elisabeth de Fontanieu, intendant du Garde-Meuble, Riesener est celui
qui fera évoluer le style Louis XV vers le style Louis XVI. Après la Révolution
Française sa popularité décline et il se retire en 1800. Pendant les ventes
révolutionnaires, il rachète une partie de sa production à des prix inférieurs
à ceux auxquels la Couronne les lui avait achetés mais ne parviendra pas à les
revendre, étant donné qu'une grande partie de sa clientèle a disparu mais
également du fait que le goût ai changé.

Françoise-Marguerite
Vandercruse est la fille de François
Vandercruse dit La Croix, 1728-1799, ébéniste, flamand d'origine, surnom
emprunté également par son fils, Roger, ébéniste à la Cour, lui aussi, qui
signa ses œuvres R.V.L.C. pour Roger Vandercruse La Croix, célèbre ébéniste qui
estampillait RVLC : bien que travaillant surtout pour d'autres, le marchand
Poirier (vers 1720-1785) ou les ébénistes Pierre IV Migeon (1701-1758) et
Jean-François Oeben (1721-1763), il exerce des charges importantes de sa
corporation. Il produit aussi pour la Couronne au début des années 1770, par
l'intermédiaire de l'ébéniste de la Cour Gilles Joubert (1689-1775). Admis à la
maîtrise en 1755, il pratique d'abord largement la marqueterie de fleurs, puis
plus volontiers les motifs géométriques: croisillons - enserrant ou non des
barbeaux ou bleuets, losanges imbriqués, coeurs et losanges entrelacés. Dans
les années 1760, il partage avec Oeben les décors en cercles imbriqués. En un
temps où s'impose l'acajou, il préfère les plaquages de bois clairs, bois de
rose puis citronnier. Il livre surtout des meubles légers et des commodes
transition, à caisson droit sur pieds galbés. RVLC réalise plusieurs
secrétaires en armoire de forme légèrement galbée ouvrant à rideaux
coulissants, avec des bronzes d'un rocaille assagi. Plus tard le modèle achevé
du secrétaire ouvrira à abattant ou à cylindre. A l'intérieur de celui-ci, la
marqueterie partiellement colorée conserve sa vivacité d'origine.
Thérèse
Riesener est la nièce du peintre Eugène Delacroix, cousin germain de son père
Léon RIESENER : Eugène Delacroix est le quatrième enfant de Charles Delacroix
et de Victoire Oeben. Son père a été le secrétaire de Turgot (homme politique
libéral) qu'il a suivi de Limoges à Paris. Député de la Marne, sous la
Convention, il vote la mort du roi, comme le peintre David. Rallié à l'Empire,
il devient préfet de Marseille en avril 1800, puis trois ans plus tard, en
avril 1803, préfet de Bordeaux où il meurt le 4 novembre 1805. Sa mère, née en
1758, descend d'une famille d'ébénistes de renom les Oeben. Son grand-père, le
père de sa mère, Jean-François Oeben est le célèbre ébéniste de Louis XV. Elle
est également apparentée aux Riesener par le mariage de sa mère avec Jean-Henri
Riesener. De cette seconde union est né Henri-François Riesener, peintre,
demi-frère de Victoire et oncle d'Eugène Delacroix. Elle est morte le 3
septembre 1814, en le laissant dans un grand dénuement.
Le
couple a eu, au total, quatre enfants : trois garçons et une fille.
Charles-Henri, l’aîné, est né le 9 janvier 1779 et a fait une très belle
carrière dans les armées impériales. Promu maréchal de camp honoraire en 1815,
il est démobilisé avec le grade de général (mais en qualité de demi-solde)5. Le
second enfant, une fille, Henriette, est née en 1780 et est morte en 1827.
C’est en 1797 qu’elle épouse Raymond de Verminac (1762-1822)6, un diplomate.
Elle recueille son frère en 1814, à la mort de sa mère. A la demande de son
mari7, David fait son portrait (Musée du Louvre), en 1799, dans une formule
qu'il développe dans les dernières années de la Révolution, c'est à dire le
modèle assis, coupé aux genoux, sur un fond uni8. Son mari fait également
sculpter par Joseph Chinard (1756-1813) son buste en Diane chasseresse
préparant ses traits (1808, Musée du Louvre)9. Son second frère, Henri, est né
en 1784 et est tué le 14 juin 1807, à la Bataille de Friedland. Le règlement de
la succession maternelle ruine la famille Delacroix. Ce désastre engloutit
toute la fortune des enfants (une propriété, achetée par la mère de l'artiste
afin de couvrir une créance, dû être vendue à perte).
Eugène
Delacroix : daguerréotype de 1842 par son cousin Léon Riesener,
Daguerréotype

Les Manufactures Royales de Lille sont l'oeuvre d’Arnould-François DUROT, de ses enfants et leurs conjoints:
LEPERRE, PROUVOST, de LAGARDE, CLEMMEN, BAYARD.
Bourgeois de Lille, il est un remarquable exemple de parcours
proto-industriel : sa vie intense a été racontée par Alexis
Cordonnier dans son article sur l'une des manufactures : « Une industrie d’art au siècle des
lumières : l’indiennerie DUROT (1765-1790) dont sont extraites les citations dans cette étude:
Les racines des Durot sont terriennes, issues d’un milieu notable de Flandres, éloignées de la simple culture de la terre.
"
Son oncle maternel, Antoine Delagarde, occupe la fonction de
lieutenant-prévôt de la ville de Valenciennes. Les
ecclésiastiques de renom sont également nombreux dans la
famille : son cousin Dom Ildephonse Lernould siège sur
l’abbatiat d’Hasnon entre 1758 et 1785.
Ces origines le font certainement bénéficier d’une
éducation solide. Placé par son père chez un
marchand mercier de Lille, il apprend durant deux ans l’art du
commerce et le sens des responsabilités.
Naturellement intégré dès la fin de
son apprentissage au sein du puissant corps des grossiers-merciers, il
cherche une alliance susceptible de le hisser parmi
l’élite de son groupe socioprofessionnel. Son choix se
porte sur Marie-Jeanne Michez, fille de l’un des maîtres
les plus en vue de la jurande. Les destinées des jeunes gens
sont unies le 11 août 1733 par l’oncle de
l’épouse, curé de Lompret. La famille Michez compte
elle aussi plusieurs hommes d’Église. Dotés de
manière équilibrée, les époux installent
leur boutique dans la principale artère commerçante de la
ville : la rue des Malades.
Pour asseoir son statut social, Durot achète la
bourgeoisie de Lille et commence à enseigner son métier
à des jeunes gens, d’ailleurs souvent originaires de la
même région que lui. Arnould-François Durot
accueille également dans son foyer son propre frère :
Louis-François. Prêtre sans paroisse, celui-ci offre
à son frère toutes ses économies et participe
à la vie de la maison en assurant l’éducation de
ses 10 neveux et nièces. (AD Nord, tabellion de Lille 159-40 et
3086-149 .)
Citons quelques passages : « Guidé par
le désir d’asseoir son projet à long terme, Durot
se donne les moyens de ses rêves d’expansion.
Influencé par d’autres indienneurs, il adopte le
modèle idéal de la manufacture-château. Le 13
août 1777, il obtient le bail du château de Beaupré,
à Haubourdin, auprès du comte de Roncq. Outre le
caractère prestigieux de cette nouvelle transaction, il
s’adjuge une grande bâtisse campagnarde, un espace immense,
relié à Lille par le canal de la Deûle, ainsi que
d’agréables revenus fonciers. Toujours animé par un
esprit de conquête, il obtient le 4 mars 1778 du
propriétaire des lieux et de l’intendant la construction
d’un puisoir et d’une sécherie, nécessaires
à son activité ».
« Lille y est peu mentionnée dans la
mesure où l’indiennerie y est restreinte et se
résume à la fabrique de la famille Durot. Celle-ci anime
durant 25 ans tout un secteur de l’industrie textile, en
bâtissant le premier grand site de production centralisée
de Lille. Bénéficiant de nombreux soutiens techniques,
politiques, et financiers, elle poursuit avec succès
l’aventure jusqu’à la crise générale
de la branche à la fin des années 1780 ».
.
"Arnould
François Durot,
né le 18 janvier 1701,
Wallers-en-Hainaut, décédé le 11 juin 1780,
Lille (59) (à l'âge de 79 ans), fondateur des Manufactures royales de
Lille.
Ils créèrent ou rachetèrent les:
Manufacture Royale des
toiles peintes, indiennes et papiers peints
en façon de damas & d'indienne de la Ville de Lille
qu’il créa : lettres
patentes le 25 janvier 1770 (toiles frappées des armes fleurdelisées),
Manufacture Royale de Mousselines d’Houplines
(association avec de
Raincour) en 1768
Manufacture Royale de verres,
rachetée en 1775 et nommée
sous la raison de son fils ainé « Louis-François Durot et fils »,
dirigée avec son gendre Auguste de LAGARDE ; cédée en 1777 à son associé
Bernard Rousselle
Manufacture Royale de
porcelaines de Monseigneur le Dauphin 
"fut
créée le 13 janvier 1784, place de Carmes, par
Louis-François Leperre-Durot, son gendre.
"Dorothée-Julie conclut une alliance toute aussi honorable. Elle unit sa destinée le 10 août 1773 à celle de François-Joseph Leperre, héritier d’une lignée de négociants en épices. Son père, Charles-François, y avait adjoint l’une des activités les plus rémunératrices du moment : le raffinage du sel. Lors du mariage, la position sociale de la famille Leperre atteint un sommet puisque l’oncle de l’époux, Antoine-François, est alors directeur de la chambre de commerce de Lille. Là encore, les jeunes gens s’offrent chacun 25 000 livres.[1]AD Nord, tabellion de Lille 3085-100.
1774 est également l’année que choisit Durot pour établir définitivement sa résidence rue de l’Arc : veuf et père d’enfants mûrs, cet espace lui suffit dorénavant. Il cède alors l’usufruit de sa maison de la rue des Malades à son gendre Leperre.[2] AD Nord, tabellion de Lille 3086-16 et 3090-57 et AM...
Elle produit uniquement de la porcelaine dure selon une nouvelle méthode de cuisson à la houille et non pas au bois grâce au Sieur Vannier. Ce dernier obtient le 24 mai 1785 un privilège industriel pour autoriser la création d’une manufacture à Valenciennes de porcelaine cuite exclusivement au charbon de terre. Un groupe représentant une Descente de Croix d’après Rubens et inscrit « Cuit au charbon de terre ce trente juin 1786 Vannier à Valenciennes» est conservé dans les collections du Château de Versailles. Comme de nombreuses fabriques à l’époque, la manufacture lilloise cherche un protecteur. C’est ainsi qu’elle envoie un important vase à M. de Calonne en 1785 (conservé au musée des Beaux-Arts de Lille ; inv. C2521) pour lui demander d’intercéder en leur faveur et obtenir la protection du Dauphin. Elle obtient entretemps (1784) l’autorisation de prendre le titre de manufacture royale. Calonne (1734-1802) originaire de Douai avait été Intendant de Flandres et d’Artois (1778-1783) puis contrôleur général des Finances (1783-1787). Le 31 mai 1785, il appelle Leperre-Durot à Paris pour des démonstrations, et désirant que Lille rivalise avec Tournai, envoie un courrier à son successeur à Lille : « (…) il serait à propos que cette manufacture de qui je viens de recevoir un très bel échantillon de ses ouvrages en fit un aux armes du Dauphin (…)" catalogue de la vente Rémilleux
Une pièce du musée de Lille est marquée « cuit au charbon de terre en 1785
».
Marque au « dauphin couronné » et « A Lille ».
mort
au début de la Révolution française en 1789; Le
titre de Dauphin fut alors porté par son frère, Louis
Charles, le futur Louis XVII.
Pour les partisans de Naundorff, ce fut le cœur du Dauphin
né en 1781 qui fut étudié et non celui de Louis
XVII puisqu’il aurait survécu.
Son cœur fut conservé au Val de Grâce à Paris
puis fut récemment authentifié comme Habsbourg et
replacé en la basilique de Saint-Denis.
Après la Révolution, elle fut dirigée par Gaboria. Elle ferma en 1817
History of the Manufactures
The Manufactures Royales de Lille, created between 1768 and 1784, are the work of Arnold François Durot, his children and their spouses: LEPERRE, PROUVOST, de LAGARDE
The Royal Painting Factory: paintings, Indian painting and Damascus and Indian style wallpaper of city of Lille: letters patent from January 25, 1770 (paintings struck with 'fleur de lys' marks)
Royal
Muslin Factory of Houplines from 1768
Royal Glass Factory, bought in 1775, directed by his son-in-law Auguste de Lagarde.
Stepfather
of Louis-François-Leperre Durot, founder of the Royal Porcelain Manufactory
of the Dauphin  , founded in 1784, Place des Carmes in Lille manufactured
coal fired hard porcelain. After the
Revolution, it was directed by Gaboria. It closed in 1817. In
1786, with the protection of M. de Calonne, the company was placed under the
protection of the Dauphin in 1786, the eldest son of King Louis XVI, Louis
Joseph, born 1781, died at the beginning of the French Revolution in 1789;
hence the mark of a "crowned Dolphin" and
"at Lille". The
title of Dauphin was then carried by his brother, Louis Charles, the future
Louis XVII. Louis Joseph's heart
was kept at Val de Grâce in Paris and was recently authenticated as being
Habsburgs and placed in the basilica of Saint-Denis.
, founded in 1784, Place des Carmes in Lille manufactured
coal fired hard porcelain. After the
Revolution, it was directed by Gaboria. It closed in 1817. In
1786, with the protection of M. de Calonne, the company was placed under the
protection of the Dauphin in 1786, the eldest son of King Louis XVI, Louis
Joseph, born 1781, died at the beginning of the French Revolution in 1789;
hence the mark of a "crowned Dolphin" and
"at Lille". The
title of Dauphin was then carried by his brother, Louis Charles, the future
Louis XVII. Louis Joseph's heart
was kept at Val de Grâce in Paris and was recently authenticated as being
Habsburgs and placed in the basilica of Saint-Denis.
Thierry Prouvost takes back these family Factories.


Calonne, ses armoiries sur l'urne du Musée de Lille, la famille Royale par Madame Vigée-Lebrun, avec l'ainé, Louis, Joseph, Dauphin de France.
Charles-Alexandre de
Calonne (1734-1802), « financier et homme politique français, nommé
contrôleur général des Finances par Louis XVI pour résoudre le déficit public.
« Né à Douai le 20 janvier 1734, Il poursuivit une carrière juridique
avant de devenir intendant à Metz en 1766, puis à Lille en 1778, où ses grandes
qualités d'administrateur, alliées à ses dons de courtisan, lui valurent d'être
nommé contrôleur général des Finances en 1783, peu après la démission de
Necker. La situation financière du royaume était catastrophique : aux dettes
héritées des règnes précédents, liées aux guerres et aux fastes de la Cour,
s'étaient ajoutées les dépenses engagées pour soutenir les colons pendant la
guerre de l'Indépendance américaine. Calonne lança d'abord l'État dans une
politique de dépenses dont l'objectif était de rassurer le pays sur sa santé
financière réelle et, en restaurant la confiance, d'obtenir ainsi de nouveaux
prêts. Cependant, la crise financière ne faisant qu'empirer, Calonne reprit les
projets de Turgot et Necker, ses prédécesseurs, en présentant, le 20 août 1786,
un vaste plan de réformes audacieuses, en particulier dans le domaine fiscal :
remplacement des vingtièmes par la»
subvention territoriale », impôt foncier payable par tous les
propriétaires, y compris par le clergé et la noblesse, suppression des douanes
intérieures et liberté du commerce des grains. Calonne proposait enfin, la
création d'assemblées provinciales et municipales élues sans distinction
d'ordre. Prévoyant le refus du Parlement, Calonne obtint de soumettre son
projet, en février 1787, à l'Assemblée des notables nommée par le roi.
Seulement, celle-ci, composée de princes du sang, de ducs et d'officiers, tous
privilégiés, rejeta toutes les réformes qui remettaient en cause leurs
prérogatives fiscales. Calonne, abandonné par le roi, fut renvoyé en avril et
remplacé par Loménie de Brienne. Calonne quitta la France, tout d'abord pour
les Flandres, puis pour l'Anglétérre. Il épousa la cause des contre-révolutionnaires
et conseilla la noblesse en exil, de 1790 à 1792. En 1802, sous le Consulat, il
fut libre de rentrer en France et y mourut peu après»
Wikipedia « Contenu soumis
à la licence CC-BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article
Charles Alexandre de Calonne de Wikipédia en français
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_de_Calonne).


PROVENANCE : Vente Thierry de
Maigret, Paris, le 2 décembre 2011, lot 89 a pair of late 18th
century Lille porcelain two-handled and monogrammed vases, with ormolu
mounts.
D’après la forme des
vases de Sèvres dits « Bachelier» , oviformes munis
d’anses à enroulement en forme de feuilles
d’acanthe, la base du corps godronnée en spirale, le
piédouche enrichi d’un tore de laurier enrubanné
reposant sur une base carrée ; à décor or sur les
faces de médaillons avec deux L entrelacés
surmontés d’une couronne royale, les revers de
médaillons en grisaille représentant des trophées
militaires, encadrés de grands vases antiques polychromes garnis
d’importants bouquets de fleurs et reposant sur des consoles
rocailles, au-dessus d’une large frise or d’arabesques
composée de palmes, guirlande de myrthe, de lauriers et pampres
de vigne entrelacées ; les socles en bronze doré de forme
carrée, moulurée et à décor amati ;
éclats restaurés sur la partie haute des
piédouches, quelques usures à la dorure Hauteur totale :
53,5 cm. (21in.) ; Hauteur des vases : 49 cm. (19 in.) 80,000-120,000
$88,000-130,000 £57,000-84,000
« Je me chargerai de lui faire
agréer (…) et d’obtenir qu’il approuva que
cette manufacture portait son nom (…) provisoirement». Le
Dauphin avait alors un peu plus de trois ans… La manufacture va
en effet réaliser un important vase pour le Dauphin ; il se
trouve aujourd’hui dans les collections du Rijksmuseum (inv.
BK-1965-104). Il est intéressant de noter que ces deux vases
tout comme la paire qui nous intéresse aujourd’hui
s’inspirent de formes créées à Sèvres
environ vingt ans auparavant par Etienne Falconet et Jean-Jacques
Bachelier (vase « royal» ou aux «
tourterelles» ; vase « à jet d’eau »;
vase « Bachelier à anses relevées» ). Une
autre paire dans le même esprit (avec leurs couvercles) a
été vendue par Maîtres Ader-Tajan-Picard, Paris, 9
mars 1988, lot 20, et avant chez Christie’s, Londres, 5 juillet
1974, lot 181. Même si Falconet est certainement
précurseur dans la création de modèles de vases de
style néoclassique, ce style est largement diffusé par
Jean-Jacques Bachelier. Bachelier débute à la manufacture
de Vincennes en 1748 où il fournit des modèles pour
l’atelier des peintres ; il devient Directeur artistique en 1751
et finalement prend en charge l’atelier de sculpture de 1766
à 1773 après le départ de Falconet pour la Russie.
De nombreux vases ont été créés à
cette époque, qui d’ailleurs pour certains portent son nom
: vases « Bachelier ovale» ; « Bachelier
à cartouche en relief » , « Bachelier à
deux anses élevées» , « Bachelier à
serpens» , « Bachelier à couronne» , «
Bachelier à anses élevées» , ou encore
cassolette « Bachelier» Pierre Ennés dans son
catalogue, « Un défi au goût»
mentionne que « le court interim de Bachelier correspond selon
nous à une période très importante ; une
période charnière dans la production de
Sèvres» . En revanche le décor commun retenu pour
cet ensemble de vases, outre le décor d’armoiries, de
monogrammes et symboles royaux, présente une déclinaison
de décor dit « à la Salembier» . Henri
Salembier avait réalisé des Cahiers d’Ornements,
gravés par Juillet en 1777-78.
Il est considéré comme
l’un des précurseurs du style Louis XVI. En 1780 est
publié son Cahier d’Arabesques qui sera une source
iconographique majeure des arts décoratifs de cette
époque. La manufacture perd le Sieur Vannier et la
qualité de la production qui n’est plus aussi bonne,
contraint Leperre à revenir à l’usage du bois pour
finalement la vendre en 1790 à M. Gaboria. Elle change de
nombreuses fois de mains et ferme définitivement en 1817.
La paire présentée
aujourd’hui est une des très belles illustrations du
début de la production de cette manufacture. Probablement
produite en vue d’un cadeau pour le roi, ce qui expliquerait les
monogrammes aux deux L entrelacés et surmontés de la
couronne royale ; il n’est néanmoins pas possible de
l’affirmer faute de documents tangibles. Nous tenons à
remercier MM. Bernard Dragesco et Didier Cramoisan pour nous avoir
confirmé l’attribution à cette manufacture et
indiqué le vase conservé dans les collections du
Rijksmuseum d’Amsterdam. Dessin préparatoire et
plâtre conservés à Sèvres-Cité de la
céramique (avec l’aimable autorisation des
archives)."
A
droite: " Lidded vase. Leperre-Durot Factory, Lille,
c.1785. Painted and gilded hard-paste porcelain. The Leperre-Durot
porcelain factory was founded in 1784 and shortly afterwards placed
under the patronage of three-year-old dauphin, the eldest son of the
French king Louis XVI. The lid of this impressive piece is surmounted
by the dauphin's crown and the handles are in the shape of dolphins.
The crown prince's coat of arms and monogram are incorporated in the
decoration. "

Palais des Beaux-Arts de Lille

Collection Thierry Prouvost



Arnould-François Durot installa sa manufacture-château au château de Beaupré, à Haubourdin, propriété du comte de Roncq

« Fleuron du patrimoine haubourdinois, le
somptueux château de Beaupré, bâti au 13è siècle sur l'emplacement d'une maison
religieuse, a été reconstruit au 16è siècle sous l'empereur Charles Quint.
L'édifice succombera sous les coups des démolisseurs en 1966 pour laisser place
au lycée actuel qui porte son nom. Du château de Beaupré, les anciens
Haubourdinois conservent encore le souvenir de son aspect renaissance, de style
espagnol. On le découvrait à l'extrémité d'une longue et belle avenue, bordée
d'arbres, qui deviendra plus tard l'avenue de Beaupré.
Au sujet des enfants d'Arnould-François Durot


fille de Pierre Joseph
PROUVOST et de Marie-Catherine RAMERY dit de BOULOGNE :
de gueules, au chevron
d'or, acc. de trois têtes et cols de biche du même Armorial de
J.B. RIETSTAP.
« Le
26 (janvier 1771) Marie Catherine Ramery, veuve en première
noces d'André Delebecque, épouse de Pierre Joseph
Prouvost, décédée le 24,
agée de 50 ans à été inhumée dans
cette église présent son époux et Jean Baptiste
Devernay ». Archives du Nord, Roubaix, 1771, p 708/1042
|
|
Jacques Prouvost 1670-1704 &1698 Antoinette Masurel 1670-1730 |
|||
|
| |
||||
| | | | | |||
|
Marie Agnès Florin 1712-1767 |
|
|||
| | | ||||
| Pierre Joseph Prouvost 1725-1797 &1751 Marie Catherine Ramery dit de Boulogne 1720-1771 |
||||
| | | ||||
| Catherine Françoise Prouvost 1752-1801 | ||||
|
|
||||

"Issue
du milieu négociant de Roubaix, cette dernière est la
nièce du fabricant de toiles Liévin Deffrenne,
associé à la grande maison de Lille « Veuve Deldicq
et fils-Brovellio-et Cie ». On voit aisément le
bénéfice que l’indiennerie peut tirer de cette
union.
• Peu de temps après
l’épisode mouvementé du partage,
François-Joseph décide de voler de ses propres ailes,
laissant à nouveau planer le spectre d’une faillite. La
société est dissoute à l’initiative du cadet
le 16 novembre 1781, avec pour conséquence, un nouvel
éclatement des mises de fond. Louis-François est
contraint de débourser la somme de 60 000 livres pour compenser
le départ de son frère. Il est tout de même
prévu que ce remboursement sera effectué en six
versements annuels. (AD Nord, tabellion de Lille 823-63 et 3093-14)
François-Joseph est alors sur le point d’épouser
Catherine Prouvost, liée aux milieux de la draperie
roubaisienne, et assure par là un approvisionnement à son
futur commerce. Il se lance lui-même dans l’industrie des
indiennes et installe rue de la Nef une modeste manufacture, qui
n’atteindra jamais la dimension de celle de son
aîné, mais devient rapidement prospère et viable
à longue échéance.
• Si Louis-François se permet le luxe
d’une séparation d’avec son frère,
c’est qu’il a obtenu des assurances par ailleurs. En effet,
dès le 1er janvier 1782, il forme une société en
nom collectif avec son principal concurrent : Josse Marousse."
Lignée médiévale des Ramery de Boulogne
bourgeois de Lille à chaque génération ;
Marie n’est pas rattachée mais fait très certainement partie de cette famille.
Cette famille porte : De gueules au chevron d'or, accompagné de trois têtes et
cols de biche de même.
Le surnom de cette famille indiquerait un lieu d'origine.
(Base Roglo)
Colart Ramery dit de Boulogne ca 1350|
I
Simon Ramery dit de Boulogne ca 1380
Bourgeois de Lille en 1419
I
Simon Ramery dit de Boulogne ca 1410
Bourgeois de Lille en 1443.
I
Guillaume Ramery dit de Boulogne ca 1440-/1502
Bourgeois de Lille le 6-5-1485.
I
Guillaume Ramery dit de Boulogne ca 1475-/1530
Bourgeois de Lille le 2-1-1495.
I
Mathieu Ramery dit de Boulogne 1515-/1573
Bourgeois de Lille en 1542.
Jeanne Cauchefer
I
Melchior Ramery dit de Boulogne
Bourgeois de Lille le 18-11-1587.
"Pierre-Joseph Prouvost tenait un journal sur un ordo de Tournai, diocèse auquel appartenait Roubaix. Ce Pierre Prouvost, né en 1725, à Roubaix, avait épousé Marie-Catherine de Ramery, de Mons, en Belgique. Il habitait rue du Fontenoy. Il était l’un des cinquante maîtres de manufacture de tissus. Il était imposé à 12 livres. Le document qu’il nous a laissé est bien curieux. Le 2 novembre 1771, écrit il, nous avons mis en bouteilles une pièce de champagne rouge venant de Monsieur Roussel, de Tourcoing. Nous avons payé 221 florins 15. Il y avait en cave : Bourgogne, vieux Frontignan, vin de Rilly, une pièce de champagne à 22 de gros la pièce, une pièce de Macon à 14 de gros. (…) : Pierre Prouvost reçoit le 20 janvier, la famille : l’abbé Prouvost, Philippe Constantin, son père, Pierre Constantin, son oncle, sa sœur Béatrice Prouvost, qui fut prieure de l’Hôpital sous la Révolution, sa mère Agnès Florin et d’autres. (…) : Le 1° septembre, table ouverte pendant trois jours pour fêter la dédicace ducate de Roubaix) : grande réunion des familles de Fontenoy, Desmazières, Charvet, Lenôtre, Deldique, Deffrennes, Delannoy. En cette circonstance, on a bu 27 bouteilles de Mâcon et 25 flacons de champagne. L’année terminée, on fait l’inventaire de la cave : Pierre Prouvost constate qu’on a consommé pour l’année 1771-72, en liqueurs, Macon, Rilly, Bourgogne et Champagne, 187 flacons et 175 bouteilles »

Tableau de Garemijn transcrivant bien la vie quotidienne des Prouvost au XVIII° siècle.
Son cousin germain Pierre
Contantin Prouvost habitait rue Saint
Georges à Roubaix, « une maison qu’il avait
acheté avec cinq autres pour la sommes de 530 florins, 13
patars et 5
deniers aux héritiers d’Albert et Joseph Lecomte. La maison avait un magnifique jardin dont les
murs étaient couverts de vignes de raisins bleus et blancs. En été les fleurs
donnaient un air enchanteur à la propriété, plantée d’arbres à fusées, dont on
cueillait les fruits en juillet ; on y trouvait aussi des beurrés, des
callebasses, l’amande de Suède. Il y avait deux grandes pelouses qui furent
la cause d’un procès entre Constantin Prouvost et son voisin, Pierre Rouzé qui
avait la prétention d’y curer son linge. Constantin Prouvost ne dédaignait pas les
plaisirs de la table. Les faïences de porcelaine de Tournai et de
Lille étaient, à cette époque, d’un usage courant. Il y avait chez lui, de
belles pièces d’argenterie portant la marque des Fermiers Généraux de Lille :
l’alouette volante : parmi ces pièces, on admirait une grande cafetière
Louis XV et un important service à liqueur Louis XVI composé de quatre carafons
garnis de rinceaux et roses et, au centre, une pyramide surmontée d’une grosse
boule d’argent qui représentait, sans doute, une montgolfière, très à la mode,
même dans le ?, à la suite des ballons inventés en juillet 1783. »

Extraits d’un article par Ernest Prouvost, le
peintre, fils de Liévin, auteur de la branche puinée.
petite fille de Pierre Joseph PROUVOST, (1699-1774) (frère de
Jacques Prouvost-Florin), maître
de manufacture, échevin de Roubaix, et de Marie Jeanne de LE BECQUE , 1707-1778, « d’azur à un chevron
d’or accompagnés en chef de deux vols d’argent et en pointe d’une bécasse
d’or » , famille dont le tronc se perd dans le XIII° siècle et qui fournit
jusqu'à 17 échevins à Roubaix, sept religieuses de l'Hôpital Sainte Elisabeth, et Marie Barbe de
Lespierre;

De Le Becque- Delebecque
Flandres
Armes : d’azur à un chevron d’or accompagné,
en chef, de deux vols d’argent et, en pointe, d’une
bécasse d’or.
Alliances : de Mesmay, Piat, de Wavrin, Mathon, de Lespierre, d’Halluin, de Le Rue, Prouvost.
Marie-Jeanne de Le Becque appartient à une lignée dont le
tronc se perd dans le XIII ° siècle et qui fournit
jusqu'à 17 échevins à Roubaix, sept religieuses de
l'Hôpital Sainte Elisabeth; le curé Jacques Legroux
déclare en 1714 : « le bourg de Roubaix est
considérable et ancien ; ses manufactures le rendent
célèbre plus que bien des grandes villes en France, en
Espagne et ailleurs ».

Marie-Jeanne de le Becque-Prouvost de le Becque

nièce de Béatrix Prouvost est entrée à l’hôpital Sainte Elisabeth
de Roubaix, le 15 janvier 1749, à dessein d'y être religieuse et elle y
professe et en a été fait prieure en l'an 1764 née le 6 février 1728, fut chanoinesse de Saint Augustin ;
fondé en 1500 Isabeau de Roubaix, en 1764 ; Béatrix s’illustra lors de


nièce de Jacques II Prouvost (1699-1774) inhumé dans l'église de Roubaix), Maître de
manufacture, épouse à Roubaix 1712 Marie-Agnès Florin (1712-1767), fille de
Jean Nicolas Florin, membre de


Nièce aussi de Liévin-Joseph DEFRENNE, important toilier associé à « la grande maison de Lille « Veuve Deldicq et fils-Brovellio-et Cie ».












De Fontaine de Resbecq
Notes sur la descendance
de Louis de Lagarde de Boutigny, chevalier de Lagarde, seigneur de Boutigny,
baptisé le 12 mai 1717, Valenciennes (Notre Dame de La Chaussée), décédé le 27
janvier 1749, Lille (Saint-Etienne), Nord (peut-être 31 ans), avocat en
Parlement de Paris & de Flandres, substitut au Bureau des Finances de
Lille, procureur du Roi à la Prévôté le Comte de Valenciennes, marié avec
Henriette Barat, baptisée le 23 juillet 1718, Lille (Saint-Maurice), décédée le
23 mai 1784, Lille (Saint-Etienne), (peut-être 65 ans), dont Aimée Adélaïde de
Lagarde de Boutigny, née le 10 avril 1749, Lille (Saint-Etienne), Nord, décédée
le 27 octobre 1817, Lille, Nord (68 ans), mariée le 3 mai 1773 avec Jean
François Joseph Duquesne, seigneur de Surparcq, né en 1742, Esquerchin, Nord,
décédé le 29 novembre 1806, Ascq, Nord (64 ans), avocat au Parlement de
Flandres, greffier criminel de la Ville de Lille, conseiller à la Gouvernance
& Souverain Baillage de Lille,
dont
Alexandre Henri Duquesne de Surparcq, baptisé le 8 mars 1774, Lille (Saint
Etienne), o Adélaïde Catherine Augusta Duquesne de Surparcq, baptisée le 28
avril 1775, Lille (Saint Etienne), mariée le 17 juillet 1793, Lille, Nord, avec
Jean Philippe Bouchez, né en 1766, Revin, Ardennes, chirurgien major au 4ème
Régiment de Chasseurs du Nord. o François Régis Duquesne de Surparcq, baptisé
le 8 juillet 1776, Lille (Saint-Etienne), Nord, décédé le 12 juin 1806, Siegen,
Rhénanie du Nord Westphalie, Allemagne (peut-être 29 ans), garde magasins de la
1ère Division de Dragons de la Grande Armée. o Aimée Charlotte Clothilde de
Duquesne de Surparcq, baptisée le 17 août 1777, Lille (Saint Etienne), o
Ildephonse Ferdinand Duquesne de Surparcq, né le 1er septembre 1778, Lille
(Saint-Etienne), Nord, baptisé, Lille (Saint-Etienne), o Catherine Suzanne
Duquesne de Surparcq, née le 20 octobre 1779, Lille (Saint-Etienne), Nord,
baptisée le 2 novembre 1779, Lille (Saint Etienne), mariée le 3 février 1801,
Ascq, Nord, avec Jean Baptiste Prosper Moroy, né le 28 juin 1768, Reims, o
Charles Désiré Duquesne de Surparcq, baptisé le 14 novembre 1781, Lille (Saint
Etienne), o Aimé François Duquesne de Surparcq, baptisé le 21 octobre 1782,
Lille (Saint Etienne), Nord, décédé le 13 avril 1840, Hôpital Maritime de Fort
Royal, Ile de la Martinique (peut-être 57 ans), huissier du Conseil Privé,
capitaine de la 1ère Légion du Nord. Caroline Henriette Nathalie Duquesne de
Surparcq, baptisée le 9 novembre 1784, Lille (Saint Etienne), Nord, décédée le
7 janvier 1785, Lille (Saint-Sauveur), (peut-être un mois). Albertine Olympiade
Lucie Duquesne de Surparcq, baptisée le 29 mai 1786, Lille (Saint-Maurice),
mariée le 12 février 1806, Ascq, Nord, avec Benoît Joseph Bucquoy, né le 13
mars 1768, rentier à Taisnières en Thiérache. o Odile Sophie Duquesne de
Surparcq, baptisée en 1788, décédée le 28 avril 1789, Lille (Sainte-Catherine),
(peut-être un an).
de Dorothée-Julie DUROT épouse de François-Joseph LEPERRE,
fondateur de
de Marie-Catherine et Amélie-Félicité DUROT qui épousèrent deux frères : Pierre-François et Jean-Baptiste Beghein d’Aignerue.
de Pierre-Marie-Régis DUROT qui épousa la
fille d’un des plus gros fabricant de toiles peintes des Pays-Bas
catholiques : la gantoise Anne-Barbe CLEMMEN
de Louis-François DUROT qui épousa Marguerite BAYARD, riche propriétaire aux Antilles.
" Se
sentant injustement privilégié et désirant
éviter un procès long et onéreux,
Louis-François cède et accepte de réviser le
testament. Il renonce à de multiples avantages par une
convention avec ses frères et sœurs le 27 juin. Il reste
seul à pouvoir exploiter la manufacture de la rue de l’Arc
et à utiliser la raison sociale « Louis-François
Durot et fils », clause primordiale en terme commercial. La
société est tout de même prolongée
jusqu’au 31 décembre 1780, afin d’établir un
bilan exact des comptes. Louis reste également libre de
reprendre le château de Beaupré à son compte, mais
en laisse finalement la disponibilité à la
communauté. Il renonce également au legs de tous les
meubles de la succession, ainsi qu’à la jouissance de la
Cour des bateliers. " " 1781. Le premier quart échoit à
Régis, les trois autres quarts revenant à
Louis-François et François-Joseph, qui décident de
poursuivre l’association à deux." "Louis-François
Durot est affaibli mais pas abattu. Il reste associé dans un
premier temps à son frère François-Joseph,
conserve la manufacture, ainsi que les 3/4 des toiles formant la
matière première. Il garde également une forte
complicité avec son autre frère Augustin, reconverti
exclusivement dans la blanchisserie et la teinture, et résident
à Beaupré, dont il a racheté le bail."
de Nathalie-Françoise DUROT, dominicaine au couvent de Lille
de Patrice-Joseph DUROT, religieux à l’abbaye de Marchiennes.


Photos Renaud Guibal, Jean Luc Mondanel
Malgré une erreur de jeunesse et
un fils naturel reconnu, Pierre-Marie-Régis est le premier à trouver l’âme
sœur. Le 23 février 1779, il épouse Anne-Barbe CLEMMEN (des barons de PETEGHEM) -
Gand (Saint-Jacques), fille de l’un des plus gros fabricants
de toiles peintes des Pays-Bas catholiques : la gantoise Anne-Barbe Clemmen.
L’homogamie est parfaite, peut-être même trop pour éviter les conflits dus à la
concurrence naturelle entre des entreprises similaires. La manufacture de Josse
Clemmen semble tout de même surpasser celle de Durot.
Régis Durot, lui aussi indienneur. Depuis son
alliance avec Anne-Barbe Clemmen, ce dernier s’est rapproché de sa
belle-famille au point de rompre les liens avec la sienne. Il apparaît
d’ailleurs dans la succession de son père comme le plus virulent à l’égard des
privilèges réservés à son aîné. Son beau-père, Josse Clemmen, est un important
négociant belge, en cheville avec l’Espagne et la France. En 1777, il avait
érigé à Gand une imprimerie de toiles avec le soutien actif du gouvernement
autrichien. Acteur d’un succès fulgurant, il emploie désormais 400 ouvriers et
associe à son entreprise ses sept enfants. Véritable brasseur d’affaires, il
semble surpasser Durot dans la mesure où il arme lui-même ses navires, là où
son homologue français se contente de diversifier ses participations
industrielles.
L’ambition de Josse Clemmen et de son gendre
fait de l’ombre à Durot et Marousse. La rivalité se fait plus pressante du fait
des conflits familiaux. Afin de promouvoir une implantation durable, le
négociant gantois a d’ailleurs largement investi dans l’immobilier lillois.
S’étant rendu propriétaire d’une maison rue Basse, il y installe son gendre, et
finance totalement les infrastructures de la fabrique. Il lui adjoint même l’un
de ses fils, Liévin-Jacques, pour le seconder dans cette vaste entreprise. Tant
et si bien que Pierre-Marie-Régis paie désormais une capitation plus forte que
celle de son frère (80 livres contre 75 pour Louis-François).
La menace se précise fortement peu après.
Prenant prétexte d’un arrêt du Conseil d’État du 10 novembre 1785, intimant à
tous les indienneurs de se faire connaître, Clemmen lance une requête osée au
Magistrat le 13 janvier 1786. Il y
réclame le bénéfice de l’apposition du plomb de la ville sur ses toiles
peintes, ce qui suppose bien sûr un contrôle de la part des autorités. Méfiant,
le procureur-syndic, dont l’amitié envers Arnould-François Durot s’est reportée
sur son fils, consulte Louis-François sur le bien fondé d’une telle demande.
Immédiatement, la fraude saute aux yeux du fabricant : Clemmen tente d’obtenir
une marque française afin de vendre illégalement les toiles colorées dans son
atelier de Gand et importées à Lille en secret.
Tentant de faire vibrer la fibre sociale des
échevins, le gantois envoie une seconde missive dans laquelle il exprime son
désir d’attirer des imprimeurs anglais et hollandais qui favoriseraient l’essor
de ce pan d’industrie au bénéfice de toute la cité ; le refrain est déjà connu…
C’est sans compter sur l’audience de Durot, à qui tous les caciques de la ville
sont liés. Réitérant son désaccord, celui-ci fait échouer la requête le 28
février. Il faut signaler que lui et Régis sont toujours en procès suite à la
liquidation de la succession paternelle, et en particulier à l’attribution du
château de Beaupré. Cet épisode précipite certainement l’établissement d’un
Bureau des Manufactures à Lille le 23 mars 1786. Si Durot se contentait aisément
de l’absence d’un tel organe auparavant, il est désormais un rempart face aux
abus d’une concurrence agressive. Clemmen voit ses rêves de grandeur
momentanément stoppés par ce refus, le soutien des institutions étant toujours
acquis à l’artisan local : Louis-François Durot.
10 avril 1830 Décès - Gand (Rue des Champs N° 167); il habitait en 1802 rue MARJOLAINE, puis dès 1805 la rue des Champs. A son décès ses héritiers vendent les bâtiments de la Manufacture Clemmen, semblant s'y désintéresser.
Il fit partie des 8 Conseillers Communaux de Gand désignés par l'occupant français le 26 Décembre 1795. Il acquiert en 1801 le Braem Kasteel à GENTBRUGGE, qui avait appartenu au XVIIème siècle à Charles TRIEST, frère d'Antoine, évêque de GAND; il agrandira le parc et procédera à diverses modifications du bâtiment. Il est membre de la Société D'Agriculture et de Botanique de Gand.
Retour Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du
Dauphin 皇家海豚工廠
Thierry-Prouvost-蒂埃里·普罗沃 Pour vous, les princes !-为了您,王子!Manufactures Royales du
Dauphin 皇家海豚工廠